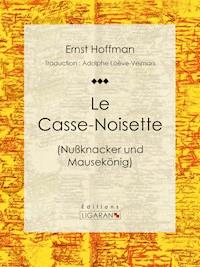Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
"Les Contes fantastiques de Hoffman, Ernst sont un recueil de contes qui vous emmènent dans un monde merveilleux et mystérieux. Ce livre est une véritable invitation à l'imagination et à l'évasion.Ernst Hoffman, l'auteur de ces contes, est un écrivain allemand du XIXe siècle. Il est connu pour ses histoires fantastiques qui mêlent le réel et l'imaginaire. Dans ce livre, il nous transporte dans des univers étranges et fascinants où les personnages sont confrontés à des situations extraordinaires.Les Contes fantastiques de Hoffman sont une véritable ode à la créativité et à l'originalité. Chaque histoire est unique et nous plonge dans un univers différent. On y découvre des personnages étranges et attachants, des lieux mystérieux et des événements surprenants.Ce livre est idéal pour les amateurs de fantastique et de littérature imaginative. Les Contes fantastiques de Hoffman sont une source d'inspiration pour les écrivains en herbe et les artistes en quête d'originalité.En somme, les Contes fantastiques de Hoffman, Ernst sont un livre à découvrir absolument. Ils vous feront voyager dans des mondes extraordinaires et vous feront rêver comme jamais auparavant. Alors, laissez-vous emporter par la magie de ces contes et plongez dans un univers fantastique et envoûtant.Extrait : ""Hélas ! disait en pleurant l'infortunée créature, Dieu n'aura-t-il jamais pitié de moi ! Voilà trois ans que mon homme, en allant à sa vigne, trouva sur sa route un sac d'argent dont le bon emploi nous promettait quelque aisance. Il achète un coin de terre, avec un maisonnette, et, à peine installés, voilà que tous les malheurs nous arrivent."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 646
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335007350
©Ligaran 2014
Au bord d’un champ de genêts fleuris, que baigne, en fuyant vers le nord, l’eau rêveuse du Rhin, près d’un village dont les toits épars s’enfoncent, comme des nids d’alouettes, sous des massifs de verdure embaumée, une femme jeune encore, aux traits doux, mais flétris par la misère, venait de tomber, en plein soleil, à côté du fardeau de bois mort qu’elle avait péniblement ramassé dans les broussailles voisines.
« – Hélas ! disait en pleurant l’infortunée créature, Dieu n’aura-t-il jamais pitié de moi ! voilà trois ans que mon homme, en allant à sa vigne, trouvait sur la route un sac d’argent dont le bon emploi nous promettait quelque aisance. Il achète un coin de terre, avec une maisonnette, et, à peine installés, voilà que tous les malheurs nous arrivent. Un orage coupe nos récoltes, le feu dévore la grange ; des créanciers sans pitié nous dépouillent du reste, et, pour comble de désolation, je mets au jour un petit monstre qui fait la risée de tout le monde. Ah ! c’est trop de chagrin pour une seule vie ! mon Dieu ! mon Dieu ! que je voudrais mourir ! »
En achevant cette plainte mêlée de sanglots, la paysanne cacha son front dans ses mains, et pleura si longtemps, qu’épuisée par la chaleur et la soif, elle s’endormit peu à peu, d’un sommeil qui ressemblait à l’évanouissement.
Tout près d’elle rampait sur l’herbe, avec des grognements de chat, une petite masse de chair affublée de haillons. Figurez-vous une tête en forme de melon chevelu, d’où se détacherait, entre deux yeux ronds et rouges, un nez en bec de cigogne, rabattu sur une bouche taillée jusqu’aux oreilles. Cette tête, couturée de rides comme l’écorce des vieux chênes, s’emboîte, sans cou, dans un buste sculpté en courge, et que terminent deux minces fuseaux qui lui tiennent lieu de jambes. Si cette hideuse machine n’avait pas en de mouvement, on eût pu la prendre pour une souche d’arbre noueux, ou pour un gros radis fendu.
En ce moment vint à passer, au retour de sa promenade quotidienne, une jeune femme admirablement belle, et aussi célèbre, dans toute la contrée, par ses bienfaits que par les grâces ravissantes de sa personne.
C’était mademoiselle de Rosabelverde, chanoinesse d’un chapitre dont la noblesse orgueilleuse prétendait remonter aux Croisades.
Le triste spectacle qui s’étalait à ses yeux éveilla dans son cœur une émotion compatissante. Elle s’arrêta et parut réfléchir. « Pauvres gens, murmurait-elle à voix basse, je lis votre avenir ; mais je ne puis le changer. Le ciel, qui distribue les destins, vous réserve jusqu’à la tombe une vie d’épreuves et de fréquente détresse. L’argent vous serait un secours inutile, car il n’adoucirait vos privations que pour les rendre ensuite plus pénibles. Travaillez donc, et que la résignation vous soit légère ! Quant à cet enfant difforme, il ne lui est pas même permis de racheter sa laideur par les dons de la force, ou de l’intelligence ; mais j’essaierai de le protéger, pour qu’il vous soit moins à charge. »
Et se penchant vers l’avorton, qui s’était accroupi presque sous les jupes de sa mère, la chanoinesse étendit lentement et doucement les mains, à plusieurs reprises, sur la forêt de cheveux roux dont il s’enveloppait. Sous ses passes magnétiques, cette crinière enchevêtrée se démêla peu à peu, et se partagea en deux bandeaux, soyeux et lisses, qui ondoyèrent en boucles fines. Cette opération faite, mademoiselle de Rosabelverde tira de sa poche un flacon plein d’une eau dorée, en aspergea la mère et l’enfant, et s’éloigna d’un pas rapide, en descendant un chemin creux à l’angle duquel elle disparut.
La pauvre paysanne ne s’éveilla qu’au coucher du soleil, toute surprise de sentir une force inconnue, qui pénétrait ses sens d’une vie nouvelle et d’un bien-être ineffable. « Ô doux Jésus ! s’écria-t-elle, que je vous bénis du repos que vous m’avez envoyé ! Ce sommeil réparateur m’a rafraîchi le sang et rendu le courage. Allons, petit Zach, lève-toi, nous n’avons que le temps de gagner notre chaumière avant la nuit. Eh, mais, bonté divine ! qui donc t’a peigné si joliment pendant que je dormais ? c’est un ange ou le diable en personne : Dieu le bénisse en tout cas ! Allons vite, vite, petit, grimpe derrière moi, sur mon fagot… »
Et la paysanne se rechargeait, sans plus songer au poids qui l’avait accablée. Mais le petit Zach, au lieu d’obéir, se prit à sauter sur l’herbe comme une grenouille gonflée, en répétant d’une voix très claire, avec mille grimaces : « – Je ne veux plus être à cheval sur ce fagot, je veux courir. »
« – Miséricorde ! il ne grogne plus, il parle en vraie personne naturelle, et il marche comme s’il avait des jambes ! oh ! oh ! puisque tu gazouilles si bien, et que tu sautes encore mieux, tu devrais bien aussi changer de figure ! mais le bon Dieu ne te fera pas celle grâce. Allons, que sa sainte volonté soit faite ! » Et en disant cela, la femme l’entraîna par la main, et se remit en route, d’un pied ferme et dispos.
En passant devant l’église du village, elle rencontra le pasteur qui prenait le frais sur un banc de pierre, en jouant avec un bel enfant aux cheveux blonds, à peine âgé de trois ans. « Eh ! bonsoir, mère Lise, lui dit-il avec un doux sourire ; venez-vous de loin, si chargée ? Reposez-vous donc une minute ; ma gouvernante va vous verser un coup de vin. »
Mère Lise ne demandait pas mieux ; elle jeta son fagot devant la porte, mais ce mouvement fut si brusque, que maître Zach, qui se cramponnait à ses jupes, fit une pirouette et alla rouler dans les jambes du pasteur. « Ah ! le délicieux enfant que vous avez là, mère Lise, dit l’homme de Dieu en relevant l’avorton ; comme vous devez être heureuse de ce présent du ciel ! ce petit ange est une bénédiction sur votre ménage ! »
La paysanne resta stupéfaite, et regarda le pasteur avec des yeux effarés ; elle le crut fou. De son côté, le petit Zach se débattait comme une araignée, et, poussant des cris rauques et sauvages, il s’efforça d’égratigner le nez du pieux vieillard qui voulait l’embrasser. « – Oh ! la maudite bête ! » s’écria Lise, pourpre de honte et toute déconcertée.
« – Comment donc, répliqua le pasteur, pouvez-vous traiter de la sorte un petit être si merveilleusement gentil ? tenez, je le vois bien, vous êtes une mauvaise mère ; eh bien, je veux me charger de cet enfant ; laissez-le-moi, je l’élèverai, je l’instruirai, j’en ferai un homme accompli, tandis que, chez vous, il s’étiolerait dans la misère et la stupidité ! »
« – Mais, monsieur le pasteur, reprit la paysanne hors d’elle-même, malgré tout le respect que je vous porte, vous vous moquez des gens ou vous avez la berlue ! que feriez-vous jamais de cet affreux petit singe qui ne sait que grogner, griffer et mordre ? »
« – Allez, vous êtes folle, ou indigne des dons de Dieu ! s’écria, en se levant, d’un air sévère, le digne ecclésiastique ; ce que j’ai dit est bien dit ; ne vous inquiétez plus de cet enfant ; je l’adopte avec joie, et je vous en ôte le souci. »
À ces mots, il emporta dans ses bras le petit Zach, qui grognait comme un chien hargneux, et rentra au presbytère, dont il ferma la porte au nez de Lise. « Décidément, se dit la paysanne, en reprenant son fardeau de ramée, notre pasteur a perdu la tête ; mais je serais bien sotte de le contrarier. Qui vivra verra. Mon homme sera fièrement aise de la bonne aubaine qui nous arrive, et les gens du village ne me montreront plus au doigt. »
Cette scène un peu étrange m’oblige de confier au lecteur, avant d’aller plus loin, certaines révélations sur la mystérieuse chanoinesse qu’il vient d’entrevoir.
Douée d’un port de reine, cette belle personne unissait à la majesté des formes une physionomie dont la bienveillance ordinaire se voilait parfois d’une ombre sinistre, surtout dans les temps d’orage. Mais pendant toute la saison des roses, quand le ciel était pur et doux, son visage gardait une expression ravissante qui séduisait tous les cœurs. Elle paraissait avoir tout au plus vingt-cinq ans, et néanmoins les vieillards de la contrée affirmaient, avec une secrète terreur, qu’ils la connaissaient depuis leur enfance. Nul ne pouvait d’ailleurs expliquer comment le temps restait sans effet sur sa jeunesse et sa beauté. On lui attribuait le secret de faire éclore à volonté, sur les terrains les plus arides, les plus magnifiques rosiers à cent feuilles qui eussent jamais fleuri dans un jardin royal. On disait encore que, dans ses promenades solitaires, elle conversait tout haut avec des êtres invisibles dont les voix lui répondaient. Un jeune forestier du voisinage prétendait même l’avoir aperçue au fond d’un bois, folâtrant avec des oiseaux bizarres et inconnus dans la contrée, qui semblaient lui chanter des histoires dont elle riait aux éclats.
J’ajoute, dût-on m’accuser d’une indiscrétion diplomatique, que le très haut baron Prætextatus de Mondenschein, intendant des domaines du chapitre dont mademoiselle de Rosabelverde faisait partie, avait procédé à son admission par ordre exprès du prince régnant. Mais ce digne personnage ne savait que penser d’un tel ordre, car il avait compulsé vingt fois toutes les généalogies de la noblesse d’Allemagne et les chroniques les plus rares, sans découvrir la moindre trace de la glorieuse et puissante maison dont mademoiselle de Rosabelverde devait être issue, pour obtenir les honneurs du canonicat. Désespéré de ses recherches stériles, et ne pouvant se décider à enfreindre ouvertement les us et coutumes de cette institution féodale, il avait supplié la chanoinesse de changer au moins son nom en celui de Rosenschœn, appartenant à une famille disparue, et dont il pourrait lui prêter, sans obstacle, les trente-deux quartiers héraldiques, pour justifier son inscription sur le registre chapitral. Elle avait répondu en lui riant au nez : « Faites ce qu’il vous plaira, cher baron. Il n’en poussera pas une rose de moins dans mon parterre, ni un cheveu de plus sur votre crâne fêlé. » Le baron furieux s’était vengé de cette raillerie en faisant circuler de tous côtés certaines rumeurs soupçonneuses auxquelles il mêlait le mot de sorcellerie. Des anecdotes malignes s’amassèrent peu à peu, comme un orage lointain. Une femme jalouse de la beauté de mademoiselle de Rosenschœn, soutenait effrontément que toutes les fois que la chanoinesse éternuait un peu fort à sa fenêtre, le lait tournait dans tout le pays. Une autre affirmait que le fils du maître d’école, surpris par la chanoinesse à voler des fruits dans le cellier du chapitre, était resté la bouche béante pendant trois jours. Tout le monde enfin se persuada que la redoutable demoiselle commandait au feu et à l’eau, jetait des sorts sur les gens qui lui déplaisaient, et s’en allait chaque nuit au sabbat, à cheval sur un serpent noir qui vomissait des flammes bleues. Ces caquets de la malveillance furent poussés si loin, qu’un beau jour les esprits forts du voisinage formèrent le dessein d’aller assiéger le chapitre, d’y saisir la belle sorcière et de la jeter à l’eau avec une pierre au cou, sans autres formes de procès.
Mademoiselle de Rosenschœn, avertie à temps du péril qui la menaçait, s’enfuit à la résidence du prince régnant, pour lui porter ses plaintes ; et M. le baron Prætextatus reçut une dépêche ministérielle qui le traitait d’imbécile, en lui enjoignant de mettre en prison pour huit jours, au pain sec, les malotrus qui s’étaient proposé de faire prendre un bain forcé à une chanoinesse. Cette simple mesure d’ordre public dispersa les conjurés.
Le prince savait fort bien, par les archives secrètes de l’État, que mademoiselle de Rosenschœn n’était, en réalité, rien moins que la fée Rosabelverde, célèbre sous le règne de son père Démétrius. À cette époque, en effet, la principauté était un vrai paradis terrestre, dans lequel tout le monde jouissait d’une parfaite félicité, de la plus riche abondance, et d’une paix inaltérable, sans que le pouvoir eût à se mêler de rien.
Du vivant de son père, le prince Paphnuce, héritier présomptif de l’État, prétendait cependant que le gouvernement n’avait pas le sens commun, parce que les choses allaient toutes seules. Aussi voulut-il, dès son avènement, tout bouleverser, sous prétexte de réformes. Le premier décret du nouveau souverain éleva M. André, son valet de chambre, au poste de premier ministre. Cette faveur était bien méritée, car le fidèle serviteur avait jadis prêté à son maître trois florins, pour payer son écot dans une auberge située au-delà de la frontière, certain jour que monseigneur avait oublié sa bourse, comme un simple mortel.
« – Mon ami, lui dit Paphnuce, l’État, c’est moi. Pour régner, comme je l’entends, il me faut des hommes tels que toi. Je veux t’associer à ma gloire. Il s’agit de répandre les lumières du progrès au sein du peuple qui m’a prêté serment de fidélité… »
« – Ah ! monseigneur ! s’écria le nouveau premier ministre en tombant à genoux, vous serez, dans l’histoire, plus grand que Charlemagne, et Louis XIV, s’il vivait encore, ne s’élèverait pas à la hauteur de votre jarretière. Vous allez décréter votre immortalité ! »
« – C’est une idée, mon garçon, reprit Paphnuce en aspirant une grosse pincée de tabac d’Espagne, mets-toi vite à cette table et écris :
« Nous, Paphnuce Ier, par la grâce de Dieu, prince souverain, décrétons ce qui suit : Dès aujourd’hui les lumières sont introduites dans toute l’étendue de nos États ; mandons et ordonnons à chacun de se conduire en conséquence. Le présent décret sera affiché en tous lieux, et proclamé à son de trompe. »
« – Mais, prince, cela ne peut pas aller ainsi ! » s’écria le valet-ministre, en jetant la plume.
« – Hein ? qu’est-ce à dire ? »
« – Permettez, monseigneur, à votre fidèle ministre, d’exposer à Votre Altesse qu’avant d’introduire les lumières, c’est-à-dire doubler les impôts pour vos menus plaisirs, établir la conscription pour vous faire une garde, bâtir une maison de force pour loger les ennemis du progrès, et un collège pour enseigner aux enfants de vos sujets l’art de conspirer contre vous en lisant l’histoire romaine ; avant, dis-je, d’ordonner toutes ces grandes choses qui élèveront l’État à la hauteur des royaumes voisins, il est indispensable d’en chasser tous les gens qui se permettraient de séduire votre peuple, en dénigrant à ses yeux l’avantage de ces institutions. »
« – Tu parles comme un livre, reprit Paphnuce ; j’ai choisi en toi un ministre sans pareil. Eh bien, il faut proscrire ces ennemis des lumières… mais où sont-ils ? »
« – Ce sont les fées, monseigneur. »
« – Les fées ! » s’écria le prince en ouvrant des yeux effarés.
« – Oui, monseigneur, et malgré le bienveillant préjugé qui les a maintenues jusqu’ici sous votre protection, souffrez que je déclare que ces perfides créatures tiennent, de temps immémorial, ce pays dans l’obscurantisme. Elles distillent sur toutes les familles un poison narcotique dont l’effet est de plonger les gens dans une fatale insouciance. Elles se promènent dans les airs, et si vous faites, par exemple, un tarif de douanes pour attirer des écus dans vos coffres, elles sont capables de jeter, par la cheminée, dans la maison de tout citoyen peu scrupuleux sur ses devoirs envers vous, des marchandises qui n’auront pas payé de droits ! Il faut donc au plus vite les renvoyer dans le pays des Mille et une Nuits. »
« – Ah ! diable ! c’est aisé à dire, reprit le prince Paphnuce ; mais ce pays des Mille et une Nuits est peut-être bien loin. Je ne l’ai jamais trouvé sur ma géographie ; et puis, si ces gaillardes qui voltigent si bien ne veulent pas déguerpir ? Et si du haut des nues elles soulevaient mon peuple ? »
« – Nous tâcherons de les surprendre, ajouta le ministre, en les faisant arrêter à domicile pendant la nuit, par la police secrète, quelques heures avant la publication du décret. »
« – Tu es un homme lumineux ! s’écria Paphnuce. Je me repose sur toi du succès, et je vais me coucher… . »
L’exécution de ce coup d’État n’avait point tardé. Mais la fée Rosabelverde, échappée seule aux limiers de la police, s’était enfuie dans les bois, avec un précieux talisman qui lui prêtait des séductions irrésistibles. Elle rencontra un jour le prince à la chasse, et lui demanda la faveur d’entrer dans un chapitre noble, où elle jouirait du privilège de rester à l’abri de l’invasion des lumières, promettant, en échange, de ne point s’occuper de politique. Le prince, charmé de ses grâces, ne put s’y refuser, malgré les représentations du premier ministre. Il allait même souvent la visiter incognito, et cela nous explique assez pourquoi le baron Prætextatus faillit tomber en disgrâce pour s’être permis de la molester.
Le prince Paphnuce ne vécut pas assez longtemps pour jouir des splendides institutions dont son valet de chambre avait doté ses États. Il mourut jeune et fut peu regretté. Mais un de ses parents, le prince régnant actuel, avait pieusement hérité de son pouvoir et de ses projets. Vingt ans après, la ville de Kerepes, capitale de la principauté, possédait une fameuse université, dont le professeur le plus remarquable se nommait Mosch-Terpin. Cet homme érudit faisait le cours d’histoire naturelle. Il avait découvert, entre autres merveilles scientifiques et à la suite d’une foule de curieuses expériences, que la nuit résulte de l’absence du jour. Ce trait de génie l’avait fait décorer, et l’amphithéâtre, où il donnait ses leçons, regorgeait d’écoliers dignes de marcher sur ses traces.
L’un d’eux, Balthazar, fils de bonne bourgeoisie, était un beau blond de vingt-trois à vingt-quatre ans, svelte et bien pris, avec un visage de jeune fille, des cheveux bouclés, ruisselant à flots d’or, et des yeux dont l’éclair s’éteignait de temps en temps sous les voiles d’une pâle mélancolie. Sa jaquette de velours noir tailladé, avec des manchettes garnies de fraîches dentelles, et une toque à plume rouge, lui formaient un costume élégant à ravir. En sortant du cours de Mosch-Terpin, au lieu de courir les tavernes et les salles d’armes, comme ses turbulents condisciples, il s’en allait, d’un pas rêveur, vers un petit bois peu distant de la ville, et dont il adorait les sentiers pleins d’ombre et de silence.
Un jour, son ami Fabian, de deux ans plus jeune, cervelle étourdie et cœur toujours joyeux, se mit en tête de faire la guerre à cette habitude excentrique. « – Holà ! lui cria-t-il en courant après lui, holà ! cher Balthazar, il y a temps pour tout. Laisse donc un peu là ton air pensif et tes allures de saint qui mène le diable en terre. Viens tirer une botte avec moi, et, si tu veux, j’irai ensuite faire compagnie à tes méditations ! »
« – Merci, merci, Fabian, répondit Balthazar avec froideur ; chacun peut vivre à sa manière, pourvu qu’elle ne gêne pas autrui. J’aime la solitude, par goût naturel ou par d’autres motifs ; et je t’engage, sans façon ni rancune, à faire choix d’un autre plastron. »
« – Ah ! reprit Fabian, ce n’est point parler en ami, et je ne mérite vraiment pas cette bouderie. Aussi, pour te punir, je ne te quitte point. Si tu refuses de venir à la salle d’armes, je confisque ta personne ; je te suis au bois, au ciel, en enfer, partout, car ta figure me fait peine ; tu as un chagrin caché. La solitude est mauvaise aux âmes qui souffrent. Bon gré, mal gré, je veux te guérir. »
À ces mots, il prit le bras de Balthazar, qui se laissa entraîner sans réplique, mais en dévorant une impatience fiévreuse, tandis que Fabian l’étourdissait par son babil effréné.
Quand ils arrivèrent au bois, parmi les murmures de la feuillée et les chants des oiseaux, Balthazar se prit à respirer ; il lui semblait qu’un poids énorme fût tombé de sa poitrine. « – Oh ! que je me sens heureux ! oh ! qu’il fait bon ici ! s’écria-t-il en étendant les bras, comme s’il eût voulu presser, dans une étreinte amoureuse, les arbres et les buissons qui l’entouraient. » – N’est-ce pas, Fabian, que tu sens, comme moi, ton cœur s’épanouir et s’inonder d’impressions ravissantes ! »
– Ma foi, mon cher, à vrai dire, répliqua Fabian, je ne te comprends pas tout à fait. Je ne suis point ennemi des promenades champêtres, quand elles ont un but utile, tel que celui d’herboriser en compagnie de notre digne professeur Mosch-Terpin, qui connaît tant de choses et qui les explique si bien… »
« – Oh ! tais-toi ! tais-toi ! fit Balthazar avec un geste d’horreur. Ne prononce pas ici le nom de Mosch-Terpin. Je hais cet homme, sans savoir pourquoi. Ses leçons me semblent un blasphème contre la divine nature dont il profane les mystères en voulant les pénétrer. Que de fois j’ai senti, en l’écoutant, des accès de rage qui me poussaient à mettre en pièces ses fioles, ses alambics et tout son attirail de savant ! Tandis qu’ici, vois, Fabian, comme le ciel nous sourit ; comme ce petit coin de l’univers s’emplit de charme rêveur ! On dirait que ces herbes, qu’agite le vent du soir, se racontent tout bas des histoires divines ! Mon cœur comprend le langage secret des ruisseaux qui frissonnent sur un lit de blancs cailloux… »
« – Allons, bon ! toujours la même ritournelle ! s’écria de nouveau Fabian. – Ô poète ! puisque tu sais si bien te faire un monde à ta guise, et converser avec les éléments, pourquoi daignes-tu t’abaisser à suivre le cours de Mosch-Terpin ? »
« – Eh ! que te dirais-je, ami ? Je suis le jouet d’une puissance occulte… »
« – Cachée dans les yeux bleus de la jolie Candida ! Tu n’as pas besoin de le dire ; toute l’Université t’a deviné, reprit Fabian. Mais il ne faut pas que cet amour platonique te métamorphose en saule pleureur. Au lieu de courir les bois, à la piste des baisers du zéphyr, viens, retournons à la ville ; qui sait si tu n’apercevras pas la jolie fille de Mosch-Terpin, pour échanger avec elle une œillade enflammée dont tu béniras le hasard ou ton étoile… Viens, viens ! » Et Fabian se mit encore une fois à entraîner Balthazar qui ne lui résista plus.
En sortant des taillis, les deux amis entendirent, sur la route, le hennissement d’un cheval qui arrivait au-devant d’eux, au petit galop de chasse, en soulevant un nuage de poussière. « – Tiens, dit Fabian, voilà une rosse de louage qui s’est débarrassée de son cavalier. Arrêtons cette bête, et tâchons de retrouver l’autre. » Et il s’élança sur le chemin pour barrer le passage. Mais au même instant, le cheval se cabra. Une grosse botte forte, s’échappant de l’étrier et lancée violemment par la secousse, faillit atteindre l’étudiant en plein visage, tandis qu’une petite masse noire, décrochée de la selle, roulait dans le sable entre ses jambes. Le cheval débarrassé ne bougea plus, et se mit à flairer sa victime qui nageait dans une ornière en essayant, pour se relever, mille contorsions inutiles.
Ce personnage exigu ressemblait à une grosse pomme jaune plantée sur une fourchette, et dans laquelle on aurait déchiqueté en causant, au dessert, une espèce de masque humain. Fabian se prit à rire aux éclats, en faisant le tour de cette caricature. Le nabot, ramassant son chapeau avec une grotesque arrogance, lança un regard fauve à l’étudiant et lui cria, d’une voix rauque et fêlée : « – Suis-je sur le chemin de Kerepes ? » – « Parfaitement, monsieur, » répondit Balthazar, qui venait de courir après les deux bottes fortes et les présentait, le plus sérieusement possible, au bizarre voyageur. Mais c’était vraie chaussure de géant pour un si petit homme qui s’exténuait en vains efforts pour y rentrer d’aplomb, et retombait sans cesse, le derrière sur le sable.
Balthazar, prenant pitié de sa peine, le souleva de terre en le prenant par les épaules malgré ses trépignements, et lui glissa une jambe dans chaque botte, puis il le porta sur l’étrier. Mais le nain, voulant enfourcher sa bête, manqua son élan et roula de l’autre côté de la selle. « – Ah ! cher monsieur, quelle voltige ! » s’écria Fabian qui riait aux larmes depuis le commencement de cette scène.
« – Cher monsieur, qu’est-à-dire ? » miaula sur un ton de chat furieux le petit homme indigné ; cher monsieur ! Me prenez-vous pour un stupide bourgeois ? Ne voyez-vous pas que je suis étudiant comme vous, et que demain, à Kerepes, nous pourrions fort bien, si vous n’étiez aussi poltron que malappris, mesurer deux rapières ? »
À cette saillie, Fabian n’y tint plus : « – À merveille, seigneur phénomène ; et souffrez que je m’excuse en vous remettant à califourchon. » Et saisissant, à bras tendus, son incroyable adversaire qui se démenait comme une sauterelle, il le jeta sur le dos du cheval qui repartit à bride abattue.
« – C’est mal, dit alors Balthazar, d’insulter, comme tu viens de le faire, un pauvre être disgracié de la nature ; car, enfin, il peut avoir du cœur, tout comme un paladin, et s’il est vraiment étudiant, tu seras peut-être obligé d’échanger avec lui un coup de pistolet… »
« – De pistolet d’apothicaire, pour lui rafraîchir le sang ! Vive Dieu ! Balthazar, quelle philanthropie tu déploies en faveur de ce crapaud à face humaine ! Je te conseille de faire une belle élégie sur les erreurs de la nature. En attendant, je cours à la ville, car l’entrée d’un pareil magot va y faire une émeute ! »
Balthazar, heureux de rester seul, reprit le chemin du bois, pour y jeter, à son aise, aux échos, le doux nom de Candida. La brusque franchise de Fabian lui avait révélé tout entier le secret de son cœur. L’idéal de son amour adolescent venait tout à coup de revêtir une forme palpable ; mais comment espérer que cet amour de pauvre étudiant pût jamais être agréé par un homme aussi positif et aussi haut placé que le professeur Mosch-Terpin ?. .
Quand Balthazar rentra le soir, un peu tard, dans Kerepes, chargé de roses sauvages qu’il avait cueillies, en songeant qu’il n’aurait jamais le courage de les offrir à l’ange de ses rêves, il fut bien surpris de se trouver, au coin d’une rue, nez à nez avec le professeur, au bras duquel s’appuyait gracieusement la belle Candida, fraîche et légère comme une liane en fleurs. « – Eh ! mon cher élève, dit en souriant M. Mosch-Terpin, nous sommes donc allé au bois, faire un peu de botanique ? Vraiment, vous êtes un garçon studieux auquel je m’intéresse. Venez donc me voir, mon bon ami ; je vous donnerai des conseils, et je vous montrerai un appareil pneumatique dont je suis l’inventeur. Demain, par exemple, il y aura chez moi un cercle d’amis intimes ; on causera physiologie entre deux tasses de thé. Soyez des nôtres ; j’en serai charmé. Bonsoir, cher monsieur Balthazar ; nous comptons sur vous. »
Cher monsieur Balthazar ! Nous comptons sur vous ! Et Candida venait de sourire !
La foudre tombant aux pieds de l’étudiant ne l’eût pas plus stupéfié ; le seuil du paradis, s’ouvrant tout à coup devant lui, ne lui eût pas offert une musique plus adorable que les paroles charmantes qui caressaient encore son oreille et son cœur.
Le joyeux Fabian qui avait enfilé à toute vitesse un sentier de traverse, avec l’espoir de devancer encore le cavalier nain, ne put le rejoindre que des yeux, au moment où il franchissait la porte de la ville, en compagnie d’un autre personnage de bonne mine, qui maniait avec adresse un coursier de riche encolure. « – Par Dieu, se dit notre espiègle, à quoi sert de me fouler la rate ! si ce camarade rabougri se rend à l’Université, comme il le prétend, on lui indiquera pour logis l’hôtel du Cheval volant. Je l’y retrouverai bien, quoique ce soit grand dommage de ne point assister au débotté. »
Contre son attente, il trouva, dans les rues, les passants fort tranquilles, et rencontra même, en face du Cheval volant, trois ou quatre étudiants qui devisaient entre eux de l’air le plus indifférent ; et cependant, le garçon d’hôtel s’occupait à desseller la monture du petit voyageur. « – Comment diable, cria Fabian à l’un de ses camarades, tu n’as pas vu descendre ici, tout à l’heure, un affreux pantin, moitié homme et moitié singe, avec des bottes fortes dont chacune le logerait tout entier ? »
« – Nous venons de voir, il y a quelques minutes, répondirent les jeunes gens, deux cavaliers très élégants et parfaitement montés. L’un d’eux était de petite taille, il est vrai, mais d’une tournure charmante, avec un visage rose encadré de magnifiques cheveux blonds. Il a sauté à terre avec une légèreté pleine de grâce… »
« – Quoi, sans perdre ses bottes, et sans rouler dans le ruisseau ! » Et Fabian restait tout interdit, ses amis le crurent fou.
Le même soir, Balthazar, qui partageait avec lui la même chambre, ne put s’empêcher de lui confier son bonheur. « – Bravo, s’écria Fabian ; je te vois en route pour l’île d’Amour ; mais la course est un peu longue ! mademoiselle Candida sera peut-être un peu rétive : prends garde, ami, de te laisser désarçonner ! »
« – Ah ! trêve de pareils quolibets, interrompit Balthazar avec humeur, ou je te prierais de ne plus prononcer devant moi le nom de la chaste créature que j’adore. »
« – À ton aise, n’en parlons plus, et laisse-moi dormir, » reprit Fabian, légèrement piqué de cette boutade.
Je dois avouer, en fidèle narrateur, que mademoiselle Candida Mosch-Terpin était réellement une personne fort capable d’inspirer une passion à la fleur des étudiants de Kerepes. Elle avait peut-être une bouche un peu grande, des lèvres un peu fortes ; mais de si belles dents et un regard si magnétique ! Ses cheveux cendrés se lissaient en bandeaux sur un front d’une pureté sans modèle. Sa taille, flexible comme une tige de lis, était pleine de séductions, et quand elle parlait, on eût cru entendre un gazouillement céleste. Elle savait jouer du clavecin, danser la gavotte et faire, comme une petite fée, le ménage de son illustre père. Simple et naïve comme l’innocence, elle ne cherchait point à s’étouffer dans un corset pour paraître plus mince. Elle raffolait du thé et des tartines au beurre ; riait de tout, excepté de la pluie qui parfois ajournait sa promenade, ou d’une tache imprimée par hasard à sa robe favorite, et se trouvait à cent lieues de l’idée qu’on s’avisât de songer à elle pour autre chose que folâtrer. L’excellente fille serait tombée des nues, si elle eût pu soupçonner tout le souci que prenait Balthazar pour se composer une toilette de soirée digne d’attirer ses regards. Ce costume se composait pourtant de la fameuse jaquette de velours noir, avec des manches tailladées à l’ancienne mode allemande, avec une collerette brodée en point de Bruxelles, une culotte blanche, des bottes à la chevalière, ornées de glands d’argent, un feutre anglais et des gants de Suède.
Balthazar palpitait d’aise, en arrivant sur la pointe du pied chez le professeur. Il rougit comme une cerise en pénétrant dans le salon. Cette rougeur fut attribuée à sa modestie, et lui concilia tout d’abord la bienveillance générale. Mais quand mademoiselle Candida, qui faisait, avec une rare aisance, les honneurs de la soirée, vint lui présenter un plateau, en disant : « – Cher monsieur Balthazar, veuillez choisir ; voilà du rhum et du marasquin, des biscuits et du pumpernickel, » l’étudiant sentit ses jambes se dérober sous lui, ouvrit la bouche sans pouvoir articuler un seul mot, et se laissa aller sur une chaise.
Candida dut le juger bien sot, car elle n’entendait rien à l’amour. Fabian, qui lorgnait tout du coin de l’œil, vint heureusement au secours de son ami. « Ce n’est rien, mademoiselle, lui dit-il à demi-voix ; c’est la chaleur qui donne à ce pauvre Balthazar des éblouissements. Viens, frère, ajouta-t-il, faisons quelques pas dans la salle voisine ; l’air et le mouvement te remettront. »
Mais voilà que la porte s’ouvre. Mosch-Terpin introduit, en le conduisant par la main, un petit homme qu’il présente à la société ; et donnant à sa voix de contrebasse l’expression la plus solennelle : « – Mesdames et messieurs, dit-il, voici le jeune seigneur Cinabre, arrivé d’hier à Kerepes, où il veut bien étudier la jurisprudence. Le seigneur Cinabre est un prodige d’esprit dont on parle dans toute l’Allemagne. Son séjour dans notre ville est une bonne fortune, et les plus brillantes sociétés se disputeront la faveur de le posséder quelquefois. »
Fabian et Balthazar avaient sur-le-champ reconnu le petit monstre de la veille. « – Que diable ! dit Fabian tout bas à son ami, que diable vient chercher ici cette espèce de mandragore ? » – « Chut ! fit Balthazar ; qu’on ne t’entende point ! Je me doutais bien que ce pauvre garçon devait racheter sa laideur par les dons de l’intelligence, et j’avais raison de te dire qu’il ne faut se moquer de personne. » Puis, comme pour réparer autant que possible, par une attention délicate, l’impolitesse commise la veille par son ami, Balthazar s’avança pour saluer M. Cinabre, et lui demander s’il ne se ressentait point de sa chute de cheval.
Mais Cinabre se rejeta en arrière en s’étayant d’une petite canne, se hissa sur la pointe des pieds, et répondit de sa voix la plus nasillarde : « – Ah ! bah ! ah ! bah ! jeune homme, qu’entendez-vous avec votre chute de cheval ? Vous êtes un âne, mon cher. Vous ne savez donc pas que j’ai fait la dernière guerre dans les cuirassiers de l’Empereur, et que j’étais chargé de la haute école d’équitation ? »
Là-dessus, il voulut faire une pirouette sur le talon gauche, à la mode des marquis français, pour tourner le dos à son interlocuteur ; mais sa canne glissa sur le parquet ciré, et il roula, comme la veille. Balthazar s’empressa de lui tendre la main, mais par mégarde, il effleura sa tête, et Cinabre poussa un tel glapissement, que tous les assistants tressaillirent. On entoura Balthazar interdit, en lui demandant pour quel motif il se permettait d’imiter, dans un salon de bonne compagnie, le cri d’un matou auquel on aurait écrasé la queue. Deux vieux messieurs, qui abhorraient les chats, avaient déjà grimpé sur leurs chaises pour sauver leurs mollets ; une dame à vapeurs s’était évanouie ; M. Mosch-Terpin protestait contre une si mauvaise plaisanterie, et Candida se disait : « Je n’aurais jamais cru que ce M. Balthazar fût si niais ! »
Le pauvre étudiant se sentait sur des épines, et cherchait à s’excuser. « – Allons, allons, jeune homme, reprit Mosch-Terpin, on voit que vous n’avez pas encore l’usage du beau monde, mais cela viendra. Une autre fois ne vous jetez plus à quatre pattes avec cet affreux miaou au milieu d’une soirée littéraire… »
« – Mais, mon digne monsieur, je vous jure… »
« – C’est bon, c’est bon. Il faut que jeunesse se passe… on vous a pardonné. »
« – Oui, ajouta Candida, en se glissant derrière Balthazar, papa vous aimera bien, à condition que vous ne ferez plus de ces vilaines choses. »
Ce tumulte apaisé, la conversation reprit son cours. Cinabre s’installa sur un sofa, entre deux jolies dames, tout fier et tout pimpant d’occuper cette place enviée. Balthazar, qui ne savait plus quelle contenance garder, et dont l’esprit cherchait en vain l’énigme de cette aventure, crut saisir le moment favorable pour rentrer dans les bonnes grâces de la société en récitant un charmant petit poème de sa composition, sur les amours du rossignol et de la rose. Il se tira de cette épreuve avec une véritable supériorité, et jouissait d’avance de l’effet qu’il aurait produit sur l’imagination de Candida. Plusieurs fois un doux murmure et de gracieux hochements de tête l’avaient encouragé. Mais quand il eut achevé, tout le monde s’écria d’une seule voix : « – Charmant ! divin ! merveilleuse poésie ! Ah ! cher monsieur Cinabre, quel plaisir vous nous avez fait ! »
« – Damnation ! hurla Balthazar en s’arrachant les cheveux. Le malheureux étudiant pensa devenir fou. Mais personne ne prenait garde à lui. Chacun s’empressait à l’envi autour de Cinabre, qui se prélassait avec une morgue étourdissante, en marmottant : « Oh ! c’est une misère que je griffonnai la nuit passée, dans une heure d’insomnie. Je fais mieux que cela, quand j’y mets quelques soins. »
Mosch-Terpin voulut féliciter Cinabre, qui lui envoya des coups de pied dans l’estomac en le menaçant de lui arracher le nez. Mais l’honorable professeur prenait tout cela pour des luttes de modestie, et répétait sans cesse : « – Le jeune seigneur Cinabre sera un de ces jours le plus grand poète du siècle ! » Pour comble de stupéfaction, Candida elle-même vint poser ses lèvres roses sur la face jaune et bouffie du magot.
Balthazar, témoin de cette hallucination générale, s’enflamma tout à coup du même délire : « Oui, s’écria-t-il d’une voix tonnante, oui, sublime Cinabre, tu es un grand poète, et si tous les gens qui m’écoutent ne sont pas des fous échappés des petites maisons, je ne suis moi-même qu’un imbécile ! »
C’était l’heure du souper. Cinabre offrit, en sautillant, son bras à Candida, pour la conduire dans la salle à manger, et Balthazar crut remarquer que la jeune fille avait pour l’avorton des regards pleins de tendresse. Il s’enfuit sans chapeau, et regagna son logis à travers une pluie d’orage qui le surprit en route et le mouilla jusqu’aux os.
Quelques jours après cette soirée, le pauvre Balthazar, abîmé dans sa tristesse, était allé s’asseoir au fond d’un bois éloigné de la ville, sur une roche escarpée, au-dessus d’un précipice où bondissaient en cascades les vagues d’un torrent chargé de débris. Le ciel était sombre, comme dans une journée d’hiver ; et les croassements de quelques oiseaux de proie se mêlaient seuls au bruit lugubre et monotone des flots plombés qui creusaient leur lit en abîme. L’étudiant repassait dans son esprit sa malheureuse aventure qui avait détruit ses douces espérances. Peu à peu, sa pensée se dégagea du nuage qui en troublait la lucidité. Tout à coup il se leva debout sur l’extrémité du rocher, l’œil en feu, la chevelure au vent, le visage pourpre de colère. Sa main crispée lacérait sa poitrine haletante, et il jeta aux échos de la solitude qui l’entourait le serment de se venger de Cinabre, dût-il payer de son sang la destruction du sortilège qui étouffait son avenir.
Comme il revenait, à pas lents, vers la ville, fortifié par cette héroïque résolution, il rencontra le célèbre violoniste Sbiocca, son professeur de musique, dans une berline de voyage. « – Eh ! quoi, mon cher maître, lui dit-il, est-ce que vous quittez Kerepes, où tout le monde raffole de vous, et où vous gagnez avec votre archet, autant de florins que d’applaudissements ? »
« – Hélas ! mon cher élève et ami, répondit Sbiocca d’une voix dolente, je fuis Kerepes comme la peste. Depuis trois jours cette pauvre ville est au pouvoir du diable ! Figurez-vous qu’hier, je jouais au Cercle de Conversation de dernier concerto de Viotti, un morceau de premier ordre, qui transporte au ciel, vous le savez, les âmes les plus rebelles à l’harmonie. Eh bien ! à peine avais-je donné le dernier coup d’archet, que j’entends crier au milieu des bravos : « – Vive le seigneur Cinabre, le plus admirable musicien de l’Europe ! » À ces mots, je trouve à mes côtés une espèce de singe, haut comme ma botte, qui se met à piailler : « – Mes bons messieurs, mes belles dames, faites-moi grâce ! j’ai fait mon possible pour vous plaire. Je ferai mieux une autre fois pour mériter votre indulgence ! » Et les bravos, les trépignements recommencent de plus belle. Vous comprenez, cher monsieur Balthazar, ce qui dut se passer en moi. J’empoigne le petit monstre aux cheveux, mais l’auditoire bouleverse l’orchestre, me renverse, et me traîne par les pieds hors de la salle, en me traitant de brigand et de possédé. Et ce sont mes propres élèves qui m’ont fait cet outrage ! Ah ! cher monsieur Balthazar, si vous rencontrez quelque part cet avorton maudit, dites-lui que si jamais il tombe sous ma main, je le ferai passer par le trou de ma contrebasse. – Adieu, mon cher élève : Dieu vous garde ! »
Pendant que maître Sbiocca s’éloignait, Balthazar se persuadait de plus en plus que Cinabre était un lutin sorti de l’enfer pour le désespoir des honnêtes gens. Un peu plus loin, il aperçut un autre de ses amis, le référendaire Pulcher, pâle, les vêtements en désordre, appuyé contre un arbre, et armé d’un pistolet qu’il allait s’appliquer sur le front. S’élancer, désarmer son ami, le serrer dans ses bras, c’est ce que lit Balthazar aussi prompt que l’éclair.
« – Oh ! mon Dieu, balbutia Pulcher, d’une voix entrecoupée de sanglots, pourquoi m’empêcher de mourir ! N’ai-je pas tout perdu, ne suis-je pas couvert d’une honte ineffaçable ! » Et comme Balthazar l’accablait de questions affectueuses : « – Écoute, ami, reprit Pulcher ; tu sais que je ne suis pas riche, et que je n’avais d’autre avenir que la perspective d’un modeste emploi de secrétaire auprès du ministre des affaires étrangères. Je m’étais préparé pour concourir, avec un zèle si laborieux, que j’arrivais ce matin, plein d’une juste confiance, devant les examinateurs. Et voilà que je trouve, pour rival, un petit drôle étique et hideusement contrefait, qu’on m’annonce se nommer Cinabre. L’examen est commencé. Je réponds, sans me flatter, d’une manière brillante. Vient le tour de l’avorton, qui se met à croasser, à geindre, et à se tortiller sur sa chaise, d’où il tombe trois fois. Je le ramasse par pitié, et l’examen fini, le président du conseil se lève, embrasse avec effusion Cinabre, aux applaudissements de l’auditoire, le qualifie d’enfant sublime, et me traite de paresseux et d’ignare ! De plus, me dit-il, vous avez à l’audience une attitude fort malséante ; je ne sais si vous êtes ivre ; mais vous êtes tombé trois fois de votre chaise, et M. Cinabre a eu la bonté de vous relever. Quand on aspire à la diplomatie, monsieur Pulcher, il faut être intelligent, studieux et sobre. Vous pouvez vous retirer. Je sortis de la salle à tâtons, me croyant atteint de fièvre chaude, à la suite d’un si long travail, et, le lendemain, je me traînai chez le ministre, convaincu que j’avais été le jouet de mes sens. J’y trouvai Cinabre installé, et le ministre me reçut avec le dédain le plus méprisant. Tu vois bien, Balthazar, que le diable se mêle de ma destinée. Laisse-moi mourir ! »
« – Non, tu ne mourras pas, » s’écria Balthazar, en lui racontant sa propre aventure chez le professeur Mosch-Terpin, et celle du maître de musique. « Écoute, ami Pulcher, j’ai ouï dire que le prince Paphnuce, fondateur de notre Université, avait jadis découvert et chassé de ses États, des enchanteurs et des fées. Or, parmi ces êtres mystérieux, il y a de bons et de mauvais génies. Je crois que ce Cinabre aura échappé à la proscription, et qu’il bouleverse ici toutes les cervelles pour la plus grande gloire de la féerie. Mais il se peut aussi qu’un bon génie plane encore sur la contrée, avec le pouvoir d’effacer les maux semés par ce diablotin. C’est ce que, peut-être, nous saurons bientôt… Mais, tiens ! écoute ! n’entends-tu pas vibrer une harmonie lointaine ? On dirait le son d’une harpe éolienne ! »
Les deux amis se turent, en prêtant l’oreille. Peu à peu ce concert fantastique parut se rapprocher ; puis le bois se remplit subitement d’une lueur azurée, et, sur un petit nuage qui glissait en effleurant la terre, parut un char, en forme de double coquille entrouverte, d’où jaillissaient les reflets nacrés d’un éclat éblouissant. Sur ce char était assis un homme âgé, vêtu à la chinoise, et la tête couverte d’un large chapeau surmonté d’une aigrette de feu. L’attelage, composé de deux licornes blanches, avec des harnais d’or, était conduit par un faisan d’argent qui tenait les rênes dans son bec. Par-derrière, un grand scarabée vert et or agitait l’air de ses ailes flamboyantes. Le bruit des roues produisait la musique mystérieuse que les jeunes gens avaient admirée avec saisissement. Le vieillard leur sourit en passant, et disparut dans l’épaisseur des bois.
« – Ah ! s’écria Balthazar, je pressentais bien que la Providence nous enverrait un secours ! Patience et courage : le règne de Cinabre touche à sa fin ! »
Le ministre des affaires étrangères, qui avait l’insigne agrément de posséder Cinabre pour secrétaire intime, était le petit-fils de ce baron Prætextatus de Mondenschein, dont nous avons raconté les intrigues contre mademoiselle de Rosabelverde. Il portait le même nom que son aïeul, et jouissait de la confiance illimitée du prince Barsanuph, parent et successeur de Paphnuce. Monseigneur Barsanuph ne dédaignait pas de jouer aux quilles ou de danser la gavotte avec son ministre favori ; il acceptait même, de temps en temps, chez lui, de petits déjeuners sans étiquette, invariablement composés d’alouettes de Leipzig, arrosées de quelques verres d’eau-de-vie de Dantzig. M. le secrétaire intime avait place à table ; il se permettait de mettre la main au plat le premier, sans aucune cérémonie ; il avalait les alouettes d’une seule bouchée, et en jetait les os sur la culotte de Son Altesse. Ces procédés gastronomiques lui valurent les félicitations du prince régnant, qui exigeait que Cinabre fût toujours placé à sa droite.
Le ministre Prætextatus profita un jour de cette circonstance pour recommander son favori à la bienveillance particulière de Son Altesse. M. Cinabre était, disait-il, un phénomène de savoir et d’habileté diplomatique, et ses rapports sur les questions les plus épineuses brillaient d’une lucidité sans égale.
« – Pardon, » interrompit timidement un jeune employé du cabinet, à qui la rougeur montait au front. » Votre Excellence a probablement oublié que, depuis son entrée au cabinet, M. Cinabre n’a pas encore écrit une seule ligne. »
« – Vous êtes un impertinent ! s’écria le prince Barsanuph. Mon ministre a raison, et vous ne savez ce que vous dites. Vous feriez beaucoup mieux, monsieur, de manger proprement et de ne pas jeter de graisse sur ma culotte de casimir. Comment voulez-vous que mes sujets me respectent, s’ils me voient une culotte tachée. Sortez d’ici et ne reparaissez devant mes yeux que quand vous aurez trouvé une recette qui neutralise l’effet naturel des substances grasses sur les étoiles. Quant à vous, mon jeune ami (poursuivit le prince en s’adressant à Cinabre, qui ne cessait de lui jeter des débris d’alouettes sur les cuisses), quant à vous, dont M. le ministre Prætextatus me fait un éloge si remarquable et si mérité, je vous nomme, dès à présent, mon conseiller intime. »
Revenons à nos étudiants. Balthazar, en rentrant dans sa petite chambre, où l’attendait son ami Fabian, avait le regard enflammé et le cœur plein d’espoir. Il raconta avec enthousiasme la rencontre merveilleuse qu’il venait de faire dans le bois.
« – Allons donc, mon brave, s’écria Fabian, te voilà encore dupe d’une nouvelle fantasmagorie. Ce que tu prends pour un magicien, n’est pas autre chose qu’un médecin nommé Prosper Alpanus. Cet original s’habille d’une façon très excentrique. Tout son attirail ressemble aux lubies du propriétaire. Son cabriolet, comme tu le dis fort bien, a la forme d’une conque argentée ; mais la musique qui l’accompagne, n’a rien de merveilleux. Elle se compose d’un orgue portatif, dont la caisse est accrochée entre les roues. Le soufflet d’orgue est mis en mouvement par un ressort caché. Ce que tu appelles un faisan d’argent, n’est qu’un jockey vêtu de blanc ; et le grand scarabée d’or, aux ailes déployées, me fait assez l’effet d’un parasol. Ses chevaux n’ont de la licorne que l’apparence, grâce à une espèce de cornet long et pointu, adapté au frontail de la bride. De plus, le docteur possède, dit-on, (et que ne dit-on pas de lui ?) une canne dont la pomme est garnie d’un cristal étincelant, à travers lequel on peut voir, comme dans un miroir, l’image de la personne à laquelle on pense… »
« – Vraiment ? » fit Balthazar.
« – Et, poursuivit Fabian, il n’y a qu’un illuminé comme toi qui puisse voir toutes choses sous l’aspect qu’elles n’ont pas, et s’abîmer l’esprit dans une foule de superstitions extravagantes. Or, pour t’en guérir une bonne fois, si c’est possible, nous irons faire ensemble une visite au docteur Alpanus. »
« – Allons-y tout de suite, » répliqua vivement Balthazar. Ce qui fut dit fut fait.
Le docteur habitait, tout près de la ville, une jolie maison entourée d’un parc. Quand les étudiants y arrivèrent, la grille du parc était fermée. « Comment faire pour entrer ? » dit Fabian. « – Je crois, répondit Balthazar, qu’il faut frapper. »
Au bruit du marteau succéda un long bourdonnement souterrain ; la grille tourna sur ses gonds, sans qu’on eût vu l’ombre d’un portier. Nos amis côtoyaient une avenue bordée d’arbres exotiques, lorsque Fabian remarqua tout à coup deux grenouilles énormes qui le suivaient en sautillant. « – Voilà un parc bien tenu, si l’on y trouve pareille vermine ! » s’écria-t-il en ramassant une pierre qu’il lança à ces vilaines bêtes. Mais à l’instant les grenouilles disparurent, et à leur place on ne vit plus qu’un vieil homme et une vieille femme qui semblaient sarcler de mauvaises herbes. « Vilains manants, grommela la vieille femme, pourquoi venez-vous assommer de pauvres gens qui gagnent leur pain à la sueur de leur front ? »
À cette apostrophe, Fabian se mordit les lèvres et perdit un peu de son assurance moqueuse. Un arrivait à la maison. Balthazar tira une sonnette. La porte s’ouvrit, et une autruche se présenta. « – À la bonne heure, dit Fabian, voilà un concierge tant soit peu distingué ! Veux-tu nous annoncer à M. le docteur, mon bel oiseau ? » Et joignant le geste à la parole, il voulut caresser l’autruche, qui lui allongea un coup de bec. Mais Fabian n’eut pas le temps de se fâcher, car le docteur en personne venait lui-même au-devant des visiteurs.
C’était un petit homme à peau bistrée, coiffé d’une calotte de velours d’où s’échappaient de longs cheveux blancs. Il portait une robe de chambre à ramages indiens, et des bottines rouges garnies de fourrures fines. Sa physionomie respirait la douceur, et n’offrait rien d’étrange au premier abord. Mais, en le regardant avec attention, on apercevait, comme dans une cage de verre, une figure plus petite s’agiter à l’intérieur de son visage.
« – Soyez les bienvenus, messieurs, dit-il en souriant. J’attendais votre visite ; veuillez m’accompagner. »
La pièce où il les conduisit formait une rotonde, tapissée de bleu et recevant le jour par une coupole vitrée. Au centre, s’élevait une table de marbre blanc que soutenait un sphinx accroupi.
« – En quoi, mes amis, puis-je vous servir ? » reprit le docteur Alpanus.
Balthazar commença le récit de ses aventures et des odieuses mystifications que Cinabre lui avait attirées. Pendant que l’étudiant parlait, le docteur semblait enfoncé dans une profonde méditation. Quand Balthazar eut fini, il secoua la tête, en disant d’un air grave : « – Ce petit Cinabre ne peut être autre chose qu’une mandragore ; au reste, je possède ici tous les types de cette race ; nous pouvons vérifier le fait immédiatement. »
À ces mots, Prosper Alpanus toucha du doigt un bouton d’or, caché dans les plis des tentures. Un large rideau glissa sur ses tringles, et laissa voir une collection de volumes in-folio splendidement reliés. Une élégante échelle, en bois de cèdre, descendit d’elle-même du plafond, et Alpanus en franchit lestement les degrés pour aller prendre, sur le rayon le plus haut de sa bibliothèque, l’un des in-folio, qu’il apporta sur la table de marbre. C’était l’histoire naturelle des Mandragores, ou Hommes-racines.
Il l’ouvrit.
À mesure qu’il touchait une des figures peintes sur les feuillets du livre, en demandant à Balthazar et à Fabian si elle ressemblait à Cinabre, la figure s’animait, sautait hors de la page et se mettait à gambader sur la table de marbre en poussant des petits cris de toutes sortes, jusqu’à ce que le docteur la saisissant par la tête, la recouchât dans le volume, où elle redevenait plate et immobile comme une image coloriée.
Le livre entier fut feuilleté sans résultat.
« – Voyons l’histoire des Gnomes, dit Alpanus.
Cette recherche fut également vaine.
« – Allons, reprit le docteur un peu déconcerté, il faut avoir recours à une autre opération. »
Et il emmena les deux étudiants dans une autre salle fort retirée, de forme ovale, et dont les parois transparentes semblaient se fondre dans un clair-obscur vaporeux qui offrait l’aspect d’une forêt pleine de mystères.
Alpanus plaça au centre de cette salle un grand miroir de cristal, qu’il couvrit d’un crêpe.
« – Balthazar, » dit-il alors, « venez devant ce miroir ; fixez votre pensée sur Candida de toutes les forces de votre âme. Regardez, la voyez-vous ? »
Balthazar obéit, tandis qu’Alpanus, placé derrière lui, décrivait autour de sa tête des cercles mystérieux.
Au bout de quelques secondes, l’image de Candida s’éleva au-dessus du miroir ; mais à ses côtés apparut en même temps Cinabre, qu’elle enlaçait de ses mains blanchettes en le contemplant avec des regards pleins d’amour. Balthazar bondit comme un tigre ; mais le bras du docteur le cloua sur place, en disant : « Pas un mot, tout serait perdu ! Prenez cette baguette, et touchez-en Cinabre. »
Aussitôt on vit le petit monstre se tordre en convulsions et rouler à terre.
« – C’est assez, » reprit alors Alpanus, « j’ai découvert la vérité.
Cinabre n’est ni une mandragore ni un gnome, c’est un avorton ordinaire, de race humaine. Seulement, il y a en lui je ne sais quelle puissance occulte dont il est la manifestation. J’étudierai cette question plus à loisir, et j’en pénétrerai le secret.
« Tranquillisez-vous d’abord, et revenez ici dans quelques jours. »
Les deux étudiants se retirèrent en se livrant à des impressions différentes.
« – Si le docteur Alpanus était sorcier, se disait Fabian, il nous en aurait fourni la preuve, en débarrassant Balthazar de ce maudit Cinabre. Il fait, il est vrai, un peu de magie blanche, mais je suis sûr que le professeur Mosch-Terpin, qui sait tant de belles choses, lui rendrait encore des points. »
Balthazar était moins incrédule ; il marchait derrière Fabian, le front penché et l’âme pleine d’impatience, lorsqu’en levant les yeux sur son ami, sa surprise fut si forte, qu’il s’arrêta tout court en lui criant :
« – Ah çà, mon cher, où avais-je donc la tête, que je n’ai pas encore admiré ta toilette !
« Depuis quand vas-tu en visite avec un habit dont les basques balayent la poussière du chemin, tandis que les manches ne t’arrivent pas au coude ? »
Fabian crut tomber des nues.
La remarque de son ami était vraie.
Balthazar lui rendit le service de remonter l’habit sur ses épaules et de tirer les manches jusqu’à ce qu’elles fussent redescendues à la longueur nécessaire.
Tout alla bien jusqu’aux portes de la ville ; mais alors l’ensorcellement recommença de plus belle.
Les manches disparurent, et les pans s’allongèrent de plusieurs aunes.
Il fallut passer ainsi, tout le long des rues, au milieu des huées de tout le monde, avec la poursuite d’une troupe de polissons qui gambadaient sur la queue de l’habit ; le pauvre Fabian, trébuchant à chaque pas, ne parvint à se soustraire à leurs assauts qu’en se jetant à corps perdu dans la première maison dont il trouva la porte ouverte. L’habit reprit sur-le-champ ses proportions ordinaires.
Quant à Balthazar, il n’avait pas suivi jusqu’au bout la mésaventure de son camarade ; car le jeune Pulcher, qui le cherchait partout depuis le matin, l’avait rencontré à la porte de Kerepes, et l’avait entraîné dans une ruelle déserte pour lui dire : « Je ne conçois pas ton imprudence ! Comment n’es-tu pas encore parti ? Ne sais-tu pas qu’il y a un ordre d’arrestation lancé contre toi, et que les huissiers de l’Université sont à tes trousses ? »
Balthazar pensait rêver. « Un ordre d’arrestation, et pour quel crime ? »
« – Il paraît, » continua Pulcher, « que tu es entré de force dans la maison du professeur Mosch-Terpin, et qu’y ayant trouvé Cinabre qui faisait la cour à Candida, tu l’as rossé comme un chien ; si bien que M. le conseiller intime du prince régnant est aux trois quarts assommé. »
« Allons donc ! » s’écria Balthazar, « je n’ai pas remis le pied chez Mosch-Terpin depuis sa fameuse soirée. Je cours les champs depuis ce matin, avec mon ami Fabian… »
« – Et tu coucheras en prison si tu ne regagnes pas les champs au plus vite. Donne-moi ta clé, car ton logis est surveillé par la police. Je me charge de t’envoyer secrètement tes effets au village voisin, où il faut te cacher en attendant que ton affaire soit assoupie, ou qu’on puisse te faire filer plus loin.
Pendant que ces choses se passaient, le professeur Mosch-Terpin nageait dans l’orgueil. M. le conseiller intime Cinabre lui avait fait l’honneur de demander la main de Candida. » Grâce à un pareil gendre, se disait l’illustre savant, je m’élèverai de plus en plus dans la faveur du prince, et je finirai par devenir ambassadeur ou ministre. Il est vrai que M. Cinabre n’est pas précisément un bel homme ; on pourrait même, sans mentir, sans le calomnier, regretter que… . Mais, chut ! pas d’imprudence ! La considération, les honneurs tiennent lieu de bien des agréments physiques. Plus d’une belle fille de Kerepes serait fort aise d’un tel époux. C’est un gaillard qui fera un chemin rapide, et pour le suivre à petite distance, je donnerais, je crois, de grand cœur, toutes mes curiosités d’histoire naturelle.
Candida, de son côté, ne témoignait aucune répugnance marquée pour Cinabre, et ne pouvait comprendre qu’on ne le jugeât pas un petit homme accompli. Décidément, la pauvre fille était ensorcelée.
M. le conseiller intime Cinabre habitait une charmante maison, dans le plus beau quartier de la ville. Son jardin était décoré d’une pelouse du vert le plus attrayant, qu’entourait une haie de rosiers magnifiques. On avait remarqué que tous les neuf jours, Cinabre se levait avec l’aurore, passait sa robe de chambre à ramages, descendait au jardin et s’éclipsait pendant une bonne heure dans le massif de rosiers.
Le référendaire Pulcher, ce fidèle ami de Balthazar, fort intrigué de ce détail intime, escalada une nuit la muraille du jardin, et vint se cacher sous la haie de rosiers pour épier la promenade mystérieuse de M. le conseiller. À l’aube du jour un doux zéphyr agita les buissons et les fleurs, dont le parfum devint plus suave et plus pénétrant. Une belle femme voilée, avec des ailes transparentes comme l’azur, descendit des cieux et vint se poser au milieu d’une touffe de rosiers, au moment même où Cinabre sortait de la maison. Elle attira le nain sur ses genoux et passa un peigne d’or dans son épaisse chevelure. Cinabre semblait jouir comme un chat ; il allongeait ses jambes grêles et miaulait en se tortillant. Quand sa toilette fut terminée, la dame merveilleuse sépara du doigt, en deux parties égales, les cheveux de Cinabre, et de la raie qui se formait ainsi jaillit une traînée d’étincelles. « – Adieu, petit, » dit l’inconnue ; « sois prudent si tu veux être heureux. » À ces mots, elle déploya ses ailes et remonta lentement dans les airs en effeuillant une énorme rose qu’elle avait cueillie.
Pulcher fut quelque temps à se remettre du trouble que cette étrange apparition venait de lui causer. Lorsque Cinabre, après s’être bien épanoui aux rayons du soleil levant, se leva pour regagner sa maison, il découvrit le référendaire, et lui lançant un clignotement d’yeux furibonds : « – Que faites-vous ici, monsieur ? » lui cria-t-il de sa voix la plus aigre. « – Monsieur le conseiller, » répondit Pulcher, « permettez que je vous complimente de vos belles connaissances et que je vous baise la main. » En même temps il fit un pas. Cinabre voulut s’esquiver, mais ses petites jambes s’embarrassèrent parmi les herbes de la pelouse ; il roula dans la rosée et s’enfuit en rampant comme un lézard. Pulcher décampa au plus vite, et s’empressa d’écrire à Balthazar pour lui raconter ce bizarre évènement.
Quant à Cinabre, il avait éprouvé une telle colère de s’être vu surpris, qu’il se mit au lit avec un accès de fièvre. Le prince Barsanuph, consterné de cette nouvelle, se hâta de lui dépêcher son premier médecin. « – Monseigneur, » dit le docteur à Cinabre en lui tâtant le pouls, vous usez votre santé pour le service de l’État. De trop longues méditations politiques ont enflammé le sang de Votre Excellence. J’aperçois sur le sommet de votre tête une trace rouge comme du feu, et qui dénote un commencement d’inflammation cérébrale. » À ces mots, il voulut passer sa main sur la partie qu’il jugeait douloureuse. Mais Cinabre fit un bond dans son lit et mordit au doigt le respectable docteur en l’accablant d’injures.
Le prince Barsanuph trouva fort mauvais que le premier médecin osât se plaindre des procédés de son favori, surtout quand M. le ministre Prætextatus vint lui annoncer que Cinabre, malgré son état de souffrance, avait voulu assister au conseil, pour y présenter lui-même un volumineux rapport sur une des questions les plus épineuses de la politique du moment. Il ne craignit point de déroger à l’étiquette en se rendant chez Cinabre, le prit dans ses bras et lui attacha sur la poitrine la grande étoile de l’ordre du Tigre-Vert, décoration réservée aux services publics les plus éminents. « – Maintenant, » dit-il en se tournant vers le ministre Prætextatus, qui l’accompagnait, « maintenant, monsieur le ministre, vous pouvez prendre votre retraite. Vous serez très avantageusement remplacé auprès de moi par ce cher Cinabre, que Dieu veuille me conserver longtemps, pour ma gloire et pour le bonheur de mon peuple. »
Le ministre, stupéfait de recevoir ainsi son congé, ne put s’éloigner sans décocher à son successeur un regard fauve et plein de vengeance. Mais le prince ordonnait : il fallait se résigner.
Cinabre était donc ministre. En cette qualité, il ne pouvait se dispenser de porter continuellement la décoration du Tigre-Vert. Mais il y eut d’énormes difficultés à vaincre pour en adapter les insignes au buste rabougri et tortillé du petit nain. Le prince fut obligé de confier l’étude de cette grave question à la sagacité d’une commission spéciale, composée de deux philosophes et du naturaliste de la cour. Le naturaliste passa sept jours à calculer le problème des proportions de Cinabre, et fit appeler le tailleur de Son Altesse pour l’éclairer de ses lumières. Ce tailleur était un habile homme, fort versé dans son art, et qui décida très spirituellement que, vu les protubérances irrémédiables qui nuisaient à la taille d’ailleurs fort élégante du ministre, il fallait fixer le grand cordon du Tigre-Vert au moyen d’une rangée de boutons. Et comme cette opération n’exigeait pas moins de vingt boutons, comme il importait aussi de ménager l’amour-propre de Cinabre, le prince décida que l’ordre du Tigre-Vert serait divisé en plusieurs classes, distinguées par le nombre de boutons que ses membres auraient le droit de porter. Cinabre, en sa qualité de ministre favori, était seul autorisé à se décorer de vingt boutons en diamant.