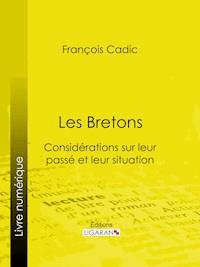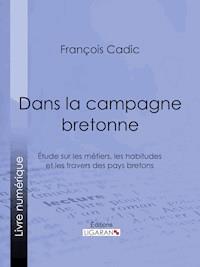
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "L'âme du campagnard breton est un sanctuaire fermé que l'œil du profane pénètre difficilement. Il faut l'avoir fréquenté longtemps, pour pouvoir le deviner. Comme la nature grise qui l'enveloppe, elle est mélancolique et réservée. La langue, les habitudes de localisme, la méfiance de l'étranger sont pour elle des préservatifs qui la mettent à l'abri des doctrines nouvelles et subversives."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 108
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
La Bretagne, depuis quelque temps, est le pays à la mode. Son nom est sur toutes les lèvres, et les derniers évènements ont encore grandi sa réputation. Il n’est petit bourgeois, amoureux de villégiature, qui ne rêve d’un coin perdu parmi les rochers de son littoral. Aux artistes en quête d’impressions fortes, aux écrivains en mal de roman, aux poètes à la recherche de rimes neuves, elle apparaît comme une terre sacrée, source d’inspiration. Sa nature est si étrange, son peuple si singulièrement conservé dans son originalité puissante !
A-t-elle profité, au moins, la Bretagne, au contact des étrangers ? A-t-elle gagné d’être mieux connue ? Il est à craindre que non. Il semble même que d’année en année quelque chose s’en va de son caractère. Avec les lignes de chemin de fer qui les sillonnent, ses paysages prennent des aspects de banalité, et à travers les récits de ses explorateurs fantaisistes, les traits qu’on lui prête ne sont trop souvent qu’une vaine caricature, une contrefaçon de la vérité.
Il conviendrait au moins que ses fils, ceux que son air a vivifiés, ceux qui ont vécu sa vie intime, ceux qui ont appris à l’aimer autrement que par snobisme, entrassent en scène à leur tour. À eux d’empêcher qu’on défigure ou qu’on ridiculise leur mère. À eux de dire ce qu’ils savent d’elle, dans des œuvres inspirées par l’exacte vérité.
Quelque modeste qu’elle soit, c’est de cette pensée que s’inspire la brochure que nous publions.
Nous nous étions proposés antérieurement d’exposer, en termes rapides, quel avait été le rôle joué par la Race Bretonne à travers l’histoire, quels services ellerendait aujourd’hui encore à la France et à l’Église, quelles difficultés elle rencontrait dans l’accomplissement de sa mission, de quel danger terrible enfin elle était menacée du fait d’une Émigration mal comprise et mal dirigée. Nous voulons entreprendre ici de pénétrer au cœur même de cette race, de l’étudier sur son sol natal, dans ses types divers, dans sa façon de penser et d’agir, dans sa vie de chaque jour.
Ce que nous avons envisagé, ce n’est pas le Breton des villes, plus ou moins mâtiné d’étranger, plus ou moins rebelle aux traditions du pays, qui affiche trop volontiers le mépris de la langue et des idées nationales, c’est le Breton de la campagne, l’homme de la race demeuré bien fidèle à lui-même, fidèle aux habitudes ancestrales et qui, docile au précepte divin : Vous mangerez votre pain à la sueur de votre front, s’en va dans l’existence vers les destinées que la Providence lui a marquées, en poussant la charrue, en maniant la hache ou l’aviron.
Ceci, en effet, est une étude des métiers et des habitudes dans la campagne Bretonne. Puisse cette étude être goûtée de nos lecteurs ! notre ambition sera satisfaite, si, grâce à elle, à l’heure où sévit contre sa langue une persécution officielle stupidement rageuse, la Bretagne trouve moyen d’être plus connue, plus appréciée, surtout plus aimée. Qu’elle vive toujours, la Bretagne, qu’elle vive et que ses ennemis soient confondus !
F.C.
En Général
L’âme du campagnard breton est un sanctuaire fermé que l’œil du profane pénètre difficilement. Il faut l’avoir fréquenté longtemps, pour pouvoir la deviner. Comme la nature grise qui l’enveloppe, elle est mélancolique et réservée. La langue, les habitudes de localisme, la méfiance de l’étranger sont pour elle des préservatifs qui la mettent à l’abri des doctrines nouvelles et subversives. Quelques sentiments pourtant la dominent qu’on sent transpirer d’instinct : l’amour du sol natal, la passion de la liberté, l’attachement aux croyances religieuses. Interrogez-le, étudiez sa chanson. L’un et l’autre vous diront : oui, certes, aux prises avec le labeur journalier, avec les rigueurs du sort, avec la malice des hommes, elle est dure la condition du campagnard. Que d’amertumes et de tristesses ! combien rude l’outil ! Combien ingrate la terre, que de sueurs pour féconder ses sillons ! Oui, mais n’est-ce pas la terre qu’ont cultivée les ancêtres, qui a reçu leurs ossements, qui recevra aussi les siens à son jour ? Si l’atmosphère qui l’entoure est sombre, du moins c’est une atmosphère de liberté. Si le pain de seigle qu’il mange est le pain du malheureux, au moins l’a-t-il gagné.
Et puis, lorsque le cœur est trop plein, lorsque, silencieusement, dans l’excès du labeur, les larmes montent aux paupières, n’a-t-il pas la faculté de redresser le regard vers le ciel ? Venez à moi, vous qui pleurez ! lui dit une voix du haut de la croix qui protège au cimetière les tombes des trépassés, et cela suffit pour lui rendre courage.
Chrétien il est, le campagnard breton, jusqu’à la moelle, et telle est la raison de sa force et de son endurance, telle est peut-être aussi la raison des préventions qu’il nourrit contre les colporteurs d’idées mauvaises, généralement figurés sous les traits des gens de ville.
Pourquoi le dissimuler, en effet ? Cet homme, aux convictions si profondément enracinées, a pour le moins des haines aussi tenaces, et c’est encore là une des particularités de son caractère.
Sans doute, dans la société campagnarde elle-même, il y a bien des oppositions d’une classe à l’autre. On battra froid au meunier qui, dans les sacs, prend mesure trop pleine. On se méfiera du tailleur dont la langue est aussi pointue que l’aiguille. On n’estimera pas l’aubergiste, parce que sa maison est le rendez-vous des viveurs. Mais, après tout, ceux-là sont aussi des campagnards. Leurs petits méfaits leur vaudront d’être ridiculisés peut-être. Cela ne deviendra pas de l’hostilité.
Il en est autrement de l’homme de ville. Voilà le véritable ennemi.
Pour qui ne connaît pas à fond l’esprit du campagnard breton, il est impossible de se rendre compte de l’intensité de ce sentiment. Dans la ville, il ne voit qu’agents du fisc retors, chats fourrés et jouisseurs, toutes gens qui n’ont que du mépris pour lui, qui spéculent sur sa détresse, et qui battent monnaie avec les produits de son travail.
Il n’y aurait rien d’exagéré à prétendre que l’histoire de la Bretagne dans les temps passés, aussi bien que les évènements du temps présent, trouvent en partie leur explication dans l’opposition de ces deux personnages, du campagnard et du citadin.
Hier, c’était la Révolution. L’homme de ville est volontaire national, apôtre des principes nouveaux. Vite le paysan décroche son fusil ; le voilà chouan, défenseur de l’ancien régime.
Aujourd’hui, ce sont les élections. Le citadin est-il à gauche ? Regardez à droite, vous verrez le campagnard.
Les chaudes batailles qu’ils se livrent, lorsque les circonstances les amènent en présence l’un de l’autre ! Pour le campagnard du reste, bourgeois et artisans des villes, c’est tout un. La qualité d’homme de ville suffit pour provoquer des rixes à l’occasion.
Au soir des grands Pardons, malheur aux jeunes messieurs qui sont restés courtiser les belles filles et qui ont prolongé trop tard leurs libations dans les auberges en plein vent ! Les robustes gars de la campagne leur font jusque chez eux une conduite qui leur laisse parfois de cuisants souvenirs.
Quand viennent les tirages au sort, c’est chose autrement grave. La ville ressemble à une place prise d’assaut. Il ne suffit pas toujours de la gendarmerie sur pied de guerre, il faut y adjoindre la troupe. Aux conscrits de la campagne, les abords de la mairie, les rues et les auberges ; à eux la place publique sur laquelle leurs binious mènent la ronde entraînante. Aux conscrits citadins à payer les rubans, à régaler leurs hôtes d’un jour, sous peine de faire connaissance avec des poings solides. Il n’y a pas jusqu’aux respectables municipaux mêmes qui ne soient exposés à de graves sévices. Qu’il leur prenne fantaisie, par exemple, d’élever arbitrairement les droits d’octroi sur les marchandises apportées au marché, et l’on entendra de belles clameurs de colère ; or, de la colère à l’émeute, pour le campagnard, il n’y a qu’un pas.
Entre autres villes de Bretagne, Pontivy, pour ne citer que celle-là, occupe un des centres d’agitation les plus mouvementés.
Au premier aspect cependant, rien de plus calme que les habitants d’alentour. Avec leurs vestes blanches, brodées de velours et semées de boutons de métal, on dirait des moutons (c’est, en effet, le nom sous lequel on les désigne). Mais, si du mouton ils ont la toison, ils n’en ont pas toujours le caractère. Ils furent terribles durant le soulèvement de la Chouannerie, ils le furent encore depuis. Les plus agressives et les plus ardentes, à chaque fois, ce furent les femmes.
Les gens de la génération actuelle se rappellent fort bien deux journées populaires. À la première, il y a de cela près de quarante ans, on venait de mettre un droit excessif sur le beurre, les œufs, les grains, à l’entrée de la ville. Le jour du marché, ce fut un spectacle tragique. Par tous les chemins, des bandes de paysans accoururent, le Penbah à la main, Pourlets de Guéméné, Fichauds de Cléguerec, Fourauds de Noyal, Chag dû (chiens noirs) de Locminé, décidés à tout saccager. En vain, le maire voulut-il les calmer. Une femme lui brisa un panier d’œufs sur la tête, ce qui le mit en piteux état et ce qui lui valut, dans la suite, une chanson malicieuse de la part d’un barde campagnard. Il fallut une charge de cavalerie en règle pour rétablir l’ordre.
La seconde émeute éclata, voilà vingt-cinq ans bientôt, à l’occasion d’une imposition excessive des grains. C’était encore la municipalité qui avait eu cette idée. Le jour du marché, sept personnes seulement apportèrent du grain. Le couteau à la main, les femmes de la campagne attendaient ; en un clin d’œil, les sacs furent éventrés et le grain répandu sur la route. Aussitôt une manifestation houleuse se produisit à travers la ville. Afin de ne pas fournir aux soldats de motif d’intervention, les hommes se tinrent sur la réserve. Les femmes besognèrent à leur place.
Le plus fautif des municipaux, l’instigateur de la mesure, était un de ces Homais prétentieux, pauvre homme à cerveau étroit, tel qu’on en rencontre dans les sous-préfectures ignorées, qui tiennent boutique ouverte d’anticléricalisme et ne manquent pas une occasion de commettre des sottises.
Dès le début, une clameur immense s’était élevée : Au Blavet, à l’eau, le municipal ! Éperdu, haletant, il fuyait dans la ville, traqué par la foule. Soudain, l’église se dressa devant lui. Il y avait, paraît-il, plus de vingt ans qu’il n’y avait mis les pieds ; comme un fou, il en franchit le seuil, demandant protection à Dieu et à ses ministres. Saisis d’étonnement devant cet acte de dévotion et aussi de respect à cause du saint lieu, les poursuivants s’arrêtèrent. Mais, pour débloquer la place, en vain les gendarmes donnèrent-ils de leurs personnes et cherchèrent-ils à entraîner les meneurs, ils furent renversés de cheval, piétinés et ne trouvèrent le salut qu’en se réfugiant eux-mêmes dans la prison.
La nuit et l’ordre de retirer l’imposition calmèrent seuls l’effervescence de la foule.
Tel est le campagnard breton. Son âme a bien été façonnée, domptée par la vertu du Christ. Par nature, elle est patiente et résignée, contente de peu, satisfaite de la grosse toile dont il s’habille, du pain de seigle et du lait aigre dont il se nourrit. Néanmoins, tout au fond, cette âme secrète une flamme qu’une légère couche de cendre recouvre à peine et qu’il ne fait pas bon aviver.
Il a la haine de ce qui sent l’oppression, de ce qui froisse sa dignité. Sur la table du bourgeois, il le sait, il y a bon rôti et bon vin ; il se doute que c’est lui qui en fait les frais ; il ne s’en offense pas. Mais, ce qu’il ne pardonne pas, c’est qu’on se rie de sa bonté d’âme, en la traitant de naïveté, c’est qu’on le pressure contre toute justice, car alors l’instinct de la révolte se réveille avec une sauvage énergie.
Nul au monde n’a, comme lui, la fierté de sa condition ; nul au monde n’exige non plus davantage qu’on respecte l’outil qui lui sert de gagne-pain et les traditions dont il a vécu.
Ils feront bien d’y regarder à deux fois, les semeurs d’ivraie qui viennent de loin jeter le trouble dans son esprit, sous prétexte de l’arracher à ses préjugés. Quand Jacques Bonhomme se fâche, ses colères sont terribles ; il se pourrait que ses premières victimes fussent les apôtres de l’Évangile de haine ; oui, vraiment, mieux vaut que le campagnard breton dise à Dieu : Je vous aime ! que s’il criait à la société : Je vous hais ! Son aïeul a eu raison de lui enseigner à prier, dans ses chagrins, et pour répéter les paroles d’une chanson populaire, « à peiner nuit jour afin de gagner le Paradis » plutôt que de lui apprendre ces mots d’une autre chanson connue :
Je vous trouve mal avisés, paysans, de travailler toute la semaine, et d’aller à Pontivy envoyer votre argent le lundi.
D’aller à Pontivy leur apporter votre argent, alors que, chaque jour, ils mettent rôti au feu.