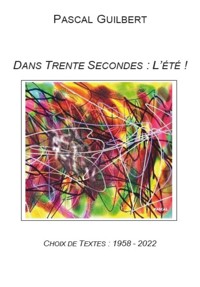
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Publishroom
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Pascal Guilbert : plus de soixante-cinq ans d’activité créatrice toujours vive, en écriture, peinture, sculpture...Vers douze ans, déjà lecteur boulimique et mélomane précoce, il dessine et commence à écrire ; il se ressent « artiste » — sans prononcer le mot. La confirmation viendra du poète Serge Wellens (1927-2010), qu’il rencontre à quatorze ans et à qui il confie ses premiers textes. Le poète l’accueille en poésie en lui transmettant la recommandation de Max Jacob d’avoir un métier et une exigence : n’écrire, ne créer, qu’en en éprouvant l’impérieuse nécessité.
Ainsi, il a exclu de faire une carrière artistique. Pendant et après ses études supérieures (Sociologie, entre autres) il exerce divers métiers nourriciers, sans que le déchire le grand écart entre des activités de cadre dirigeant ou d’autres plus modestes et celles de poète et plasticien.
Alors depuis des années, comme le roi, le poème vient quand il veut.
Il peut être « l’humble glose d’instants ténus », une chronique ; ou parfois « l’incantation d’un discours d’enchantement ». Ce qu’évoque le titre d’un de ses recueils : Chroniques et discours. Recueil inédit comme ils le sont tous, même s’il a souvent tiré certains de ses textes pour quelques intimes qui goûtent aussi ses travaux plastiques.
Il serait donc le poète inconnu ? Cette conjecture suscite un désir renouvelé de partager davantage, d’élargir son cercle à de nouveaux lecteurs ; peut-être aussi, en publiant, d’affirmer publiquement son identité, comme lorsqu’il expose ses peintures.
Le choix de textes qui compose ce livre représente un tiers de ses écrits, poèmes, chansons, récits, nouvelles. Il a longtemps hésité entre deux titres génériques : Le plaisir solitaire ou Chroniques et discours — ce dernier ayant sa préférence mais faisait écrire à Serge Wellens en 2002 « …te dire mon bonheur de lecteur de Chroniques et discours (…) quel talent, quel humour, quelle originalité profonde des textes qui s’enchaînent avec une belle rigueur d’écriture ! (...) Mais devant ce titre solennel, même Henri Michaux, sans doute, aurait hésité ! ».
Se souvenant de cet avis, il a choisi la promesse de lumière d’un été à venir et repris le titre d’un autre recueil : "Dans trente secondes : l’été !"
Et en attendant, il écrit, il peint ou dessine, il façonne ses volumes de plastiques sculptés à la flamme...
Fernand Cortex
À PROPOS DE L'AUTEUR
Pascal Guilbert : poète et plasticien avec plus de 65 ans d'activité créatrice toujours vive ! Vers 12 ans, déjà lecteur boulimique et mélomane précoce, il dessine et commence à écrire ; il se ressent "artiste". Ce que confirme le poète Serge Wellens à qui il confie, à 14 ans, ses premiers textes. Suivant son conseil de n'écrire qu'en en ressentant l'urgence, il exclut de faire "carrière artistique". Après la Fac il exerce des métiers de conseil et il écrit poèmes,chansons,récits, tous inédits. Sauf pour quelques intimes, il serait "le poète inconnu" ? Il décide de publier un choix de ses textes et en attendant ses nouveaux lecteurs, il écrit, il peint ou façonne ses " plastiques sculptés à la flamme"
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 147
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Mentions légales
Publishroom Factorywww.publishroom.com
ISBN : 978-2-38625-226-6
Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon, aux termes des articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
Page de Titre
Pascal Guilbert
Dans Trente Secondes : L’été !
Choix de Textes : 1958-2022
A Franceline,et à mes intimes, vifs ou morts,ardentes ou éteintes.
Pascal Guilbert © 2024
"Chez les fourmis, je suis un poète célèbre"
Serge Wellens (Santé des ruines)
"J’ai écouté, guetté, malaxé, humé, respiré chaque phrase, à plein corps.J’ai travaillé. Travailleuse du verbe serait ma raison sociale."
Marie-Hélène Lafon (Suites pour sanglier)
"Curieuse activité solitaire que celle d’écrire."
Patrick Modiano (Discours à l’Académie Suédoise)
Les textes réunis pour ce livre ont été choisis dans les recueils ou cycles inédits :
L’envers de la vague. – Dans trente secondes : l’été ! – La pomme à abattre.Les singes verts du printemps. – La vie à la campagne. – Nouvelles impressions d’Autriche.Le plaisir solitaire. – Chroniques et discours. – Catalogue d’automne.Quatorze chansons.
Le plus souvent, j’écris petit
Le plus souvent, j’écris petit : pattes de mouche et textes de petite jauge — des poèmes, si l’on veut — qu’ils soient l’humble glose d’instants ténus ou la vertigineuse incantation d’un discours d’enchantement.
À écrire petit il arrive qu’à force de restrictions, de corrections et de repentirs, il ne reste rien.
Rien : tout vaut mieux que petitement. C’est pourquoi très souvent je n’écris rien : je vais peindre ou pétrir.
Parfois aussi je crois que je ne peux pas : pièce d’échecs qu’on saisit par la tête pour l’exiler de la partie, j’existe dans un entre-deux de pure inertie où seule une perfusion continue de lecture assure ma survie. Entre ces parenthèses — deux pauvres murs démaquillés, insultés par les affiches putassières à la gloire du Marché totalitaire, molestés par les bombages, sapés par les infiltrations d’urine — je redeviens le petit garçon blotti contre son ours qui sent bon la tendresse, le fragile inventeur d’un monde pétillant de joie… Mais de méchantes gens aux regards et aux souliers épais menacent en ricanant ses jouets délicats, les heurtent, les bousculent, et comme par mégarde, en s’excusant presque, les écrasent.
A ce moment, je sais que je ne devrais pas.
En cela point d’aveu complaisant d’impuissance ? Pas l’ombre d’un pointilleux formalisme ? Nulle posture de poète au labeur, « comme un soc oblique dans le poème aride » ?
Oui, ces mauvaises mœurs, peut-être. Mais une morale, certainement.
Et cette fois encore je n’ai rien écrit, ou si peu, à peine ce qui précède et d’un crayon furtif.
On aura bien compris que, tout en y pensant continûment car telle est ma vie, qui en dépend, j’écris le moins souvent possible et à mots recomptés, en suspendant mon souffle.
Arles, 27-28 .09.2014 – (Catalogue d’automne)
Comme traducteur
Comme traducteur je gagnais à peu près la vie.
Le génie, j’en fais mon affaire, écrivais-je en toute simplicité dans les marges des livres du temps.
L’aube froissait le ciel un peu partout dans cette petite Europe, dans cette petite ville d’Europe où je me ravitaillais le soir par frayeur des malsaines clartés du jour d’hiver.
Quelques maisons étaient épinglées sur la carte et, tracés au fil, les chemins à empreinter du talon, les brouillards à délaver aux phares exténués d’une vieille Chrysler en surchauffe.
C’est ainsi que tôt matin on se glisse furtivement vers le premier troquet où nos imparfaits sont caducs, où l’analyse réaliste disloque nos perceptions erratiques.
Dans la vie (c’est-à-dire entre neuf et dix-sept heures, au pire) on traduit, on trahit, en révélant quelques clichés qui nous occuperont le temps d’une mise en équation, on s’éternise, on se prolonge de ce côté-ci du temps en vraisemblance adulte et enfantine acuité.
Par quelque petits accidents, dialogues inopportuns ou réfections sommaires d’anciennes velléités, la réalité pouvait prétendre à se vêtir de neuf (en dépit de la désuétude, du trépas annoncé des paysages et de l’usure de la convoitise) au profit d’un bref émerveillement, d’un repiquage prometteur de travaux épars — direction assistée d’une préhension chaleureuse, comme étreindre ou s’asseoir au coin exigu d’une table saturée de poèmes.
Comme traducteur, je désavouais mes limites (magie blanche ou physique amusante) et pratiquais sans restriction ni scrupule l’acte intransigeant et sans issue d’énoncer la vie dans l’explosion maîtrisée de poèmes — pudiquement dénommés textes.
Caen, 9.01.1963 – Rév. 1974 – (Dans trente secondes : l’été !)
IMAGE
Sous un frais feuillage d’étoiles
sourit la douce enfant chérie
venue puiser au bord de sa fenêtre
l’eau de la lune
Le jour elle vole au ventre vert des vagues
d’éblouissantes syncopes de soleil
ces brindilles salées qui craquent dans l’œil
Ensablée dans l’envie d’une mer tropicale
elle savoure le bâillement d’un chat noir d’août
longuement déplié au balcon et roussi par l’effort
Tirés aux quatre vents de l’agonie
nos cris de silex émerveillent la pénombre
dans le grand lit défait d’une fin de nuit d’enfance
Caen, 05.1959 – (L’envers de la vague)
On descendait les petites collines
On descendait les petites collines orageuses qui auraient pu converger en un coin de campagne à peine encombrée des vestiges d’une guerre plus-que-parfaite, une salle au gravier jonché de fourrures, extrêmement profonde et basse, où instaurer le règne épanoui d’un lit trop vaste, placé trop près des flammes dangereuses de l’âtre.
En fait, elles se contentaient d’un pénible lacis de routes encollées de crachin, elles dérivaient vers la mer en proie à elle-même et nous descendions, nous juxtaposions nos corps, nous descendions sans parvenir à envisager le sommeil, absorbés par la succession des paysages, engoncés dans les ruelles, les haies, vers la nuit.
Elle croyait désirer l’intime tutoiement de la mort, pour devenir enfin en nous, peut-être simplement en moi, avoir subi l’irruption explosive de lumières sanglantes, caresser l’unique corps, le corps immobile ; puis elle tressaillait, elle habillait ses mots de couleurs connues, de saveurs rassurantes.
On traversait le terroir vallonné, d’une douceur humide, planté de cimetières mal portants, obsédé de pacages et de pentes vertes. La maison de notre enfance, les classes intimes de notre enfance : on les rencontrait çà et là et on lançait un souriant appel aux souvenirs, pour n’être pas contraints de reconnaître qu’elles repoussaient mal, déracinées sans précaution, pour ne pas s’avouer qu’elles accusaient notre âge avec une insouciance pénible.
Le carrefour existait réellement, mais de façon trop personnelle pour correspondre à son image publicitaire. Il commandait pourtant l’accès du refuge où nous achevions de descendre en notre solitude. Ils faisaient ce qu’ils voulaient, sans espérer réussir ; je regardais le bois d’une table incroyablement massive, trop beau, trop usé, pour être vraiment inerte et j’identifiais l’indolence absolue de ses veines sombres, les fripures de teintes, j’aimais qu’il reflétât ce grand feu.
Elle était assise contre moi, attendant que la chaleur ait pris la consistance de la tendresse et elle me regardait, préférant penser que je me préparais à écrire.
Caen, 18.10. 1962 – (Dans trente secondes : l’été !)
Dans les rues battues par le noir
Juliet : – Yond light is not daylight, I know it, I(William Shakespeare : Romeo and Juliet, Act III Sc. IV)
Dans les rues battues par le noir, la lueur qui circule est à peine celle d’une allumette.
Marche, dans les saisons pluvieuses de la nuit, soupèse les gros murs décourageant l’escalade, jusqu’à la maison, la clé, les fenêtres d’eau lourde, la table, l’eau, le lit où je te déshabille tellement où tu me caresse si fort que nous parvenons enfin aux ténèbres.
En bas, ils habitent le salon pour les nuits, ils éternisent leur lexique, ils ne demandent rien, il fait toujours nuit quelque part.
Plus tard et plus loin, lorsque nous fûmes déplacés dans l’étendue – au-delà des portes délavées qui éclusaient les chambres louées à vil prix dont le plancher s’effondrait aux jours d’affluence – plus tard et plus loin : sans rapport avec ce temps, seuls et sans rapport.
Le gris liquide effrangé au ras de l’horizon, ce n’est pas la lumière du jour ; en bas, ils se carrent dans les débris du salon, nous sommes entre eux, ils n’ouvrent pas les volets.
Les chambres fragiles, les amis pour la vie, l’eau du lit, le lent discours assuré de la nuit : il se peut qu’ils opèrent toujours en cette demeure, qu’ils balaient leurs cendres sous les tapis, nous bordent pour mourir, nous étreignent à pleins bras, qu’ils restent jusqu’à toujours, jusqu’au fauteuil roulant, au dernier qui enterrera les autres ; il se peut, c’est toujours l’été quelque part, là n’est pas la question de la lumière – et libres de craquer l’allumette, libres de partir quand nous les aurons oubliés – quand il ne nous reste plus de mémoire, à peine assez, plus tard et plus loin, pour situer le lit et la table sous la fenêtre, dans l’obscurité.
Caen, 29.10. 1963 – (Dans trente secondes : l’été !)
L'averse de lumière
L’averse de lumière méchante se fait plus drue lorsqu’on progresse dans les territoires déglingués de la PLAINE.
Elle est morose, la plaine – et pleine de sa peine ; on la sillonne sans trêve à perdre haleine. Pour tout dire, ce n’est point la tendre pâture où Margot filait la laine sur fond de bétail paissant (encore ébaubie par l’effet d’un droit de cuissage exercé en hâte ou transie par la grâce au fil d’un angélus) – pour quelques sous l’an et de grosses soupes, toute une vie.
Il s’agit d’une grande étendue de plaine : aucune haie de troènes maigrichons n’en borne les frontières. Elle ne vaut que sa teinte sans vraies variantes ; elle s’estime à son aspect de terne terre fréquemment rabotée, elle est peinte, ou plutôt badigeonnée à la merde.
Les HLM s’estompent, les polyesters délaissent une perception envahie par tous les gros bouleaux, les verts arbres et verveines ; quelques saules anthropomorphes donnent l’occasion de s’attrister sur la perte sèche d’un horizon liquide.
C’est la glaise : la campagne souveraine, la herse pour toute porte, terrier et plantoir pour tout coït. Les maisons au faciès ravagé sont fièrement ancrées sur les rives des rues bouseuses. Un soir, les termites repus en surgissent et pfuitt ! – l’habitant dévêtu de ses murailles ne songera plus qu’à rebâtir ; tapotant de la paume de petits tas de déjections familiales, il en façonne les briques nécessaires. Conduite avec soin et bénéficiant de l’heureuse alternance de selles consistantes (pour le gros œuvre) et de diarrhées bien dosées (pour tout mortier) la réfection des murs porteurs peut occuper une génération. Mais peu de gens habitent désormais ces logis que l’on épargne en visite, troquant les lourds sabots contre les hospitaliers patins de feutre culottés sur le cérumen de maint parquet.
« C’est bien pareil en ville ! » — diront les urbains, les mitoyens, et tous les sacrés sacristains frivoles des cathédrales suburbaines.
Pourtant, dans la PLAINE… Dans la plaine c’est la glaise qui colle aux pattes, qui colle aux poils des jambes, aux poils, qui colle et qui est la seule espérance chaque fois qu’une aube resplendit, avec sa mauvaise haleine et ses poches pleines de fric sous les yeux.
Poitiers 24.03.1971 – (La vie à la campagne)
Certes j'ai peu pour demeurer
Certes j’ai peu pour demeurer
j’attends l’eau glacée frétillante
j’espère le raisin fondant
j’imagine l’enfant nuageux des images
ou bien je prends simplement le train-train au hasard
je resquille sur le matin frustrant.
Bien triste qui reconnaîtrait
à quel point, à quel point je m’abrège
en attendant que le mot choisi rétrécisse au lavage.
(Heureusement le vin ne tourne pas toujours vinaigre
et le pain bien élevé lève en s’étirant chez les boulangers infaillibles
tandis que l’assaisonnement d’échalotes platinées
dénature sans réticence les bavettes non-freudiennes.
Heureusement faut pas toujours courir chez le boucher persillé
pour trouver le rut moustachu bien tendre ou fait à point.)
Bien malin qui saurait avec quelle vive douceur
je peigne et recoiffe et repeigne
le parasol d’un petit sexe nacarat.
Bien inspiré qui va piger
que j’amuse ma mort en tirant à la ligne
que j’invente la rhétorique posthume déjà feutrée dont on fait les bérets.
Neuilly sur Seine, 05. 1975 – (Le plaisir solitaire)
Gustav Mahler aurait embrasé
Gustav Mahler aurait embrasé ces marges d’un matin qui ne nous appartiendrait plus, sinon par la souffrance du désir. Déjà nous n’habitions plus ces endroits, ces futaies climatisées, les forêts d’hommes raidis sur le papier sensible.
Les grognements affectueux qui parviendraient aux galaxies prochaines ne sauraient évoquer nos vives voix ; ici ou là, quelque part, nous avions su planter les choux et tirer la subsistance.
La lumière déclinante lissait le sable des plages sales et de vieux pianistes se nourrissaient de mousse amère dans la tiédeur de bars minuscules tendus de tissus nostalgiques. Avec effort, on touchait le fond de la Nuit comme pour une véritable noyade : brusquement cela devenait tellement effrayant qu’il fallait à tout prix dormir, s’élancer en apnée contre le sommeil, désirer l’effondrement d’un brouillard sur les trottoirs fatigués et les jardins de sable.
Baisser l’abat-jour ? Je lançais un chiffon rouge à même la lampe, parce que j’avais aimé cet ocre fumant qui orangeait nos visages nus et pouvait réchauffer les draps de tout un hiver humide. Je promenais le regret furtif de circonstances révolues et les regains de mémoire exaltés, dans cet espace d’absence qui contrefaisait le temps. Il suffirait de si peu : se façonner une sorte de sous-bois poudroyant d’éclats solaires où l’élan symphonique étayerait le tumulus de terreau qui nous aiderait à mourir.
Avec l’argent graisseux, nous savions étancher nos velléités impatientes jusqu’à plus soif : ainsi les heures chiffraient bêtement l’état de nos artères, du midi pétillant à la torpeur des vêpres. Il s’agissait pourtant d’instants d’été semblables aux bonheurs affolés d’une seizième année, mais les clichés d’adolescence adhéraient seulement aux pages des albums et se périmeraient jusqu’à la faillite. Les gens assuraient divers intérims. Ils se dévisageaient avec indifférence, croisaient leurs regards sans tain.
Il s’agissait peut-être de nous : alors nous lancions une relecture haletante de nos petites histoires, nous en faisions la glose complaisante à bord de rafiots en rade pour conjurer cet évanouissement du sens, ce détachement contre-nature.
Pourtant quelques-uns continuaient, bondissaient, s’épousaient sans arrêt : nous aimions intensément notre Terre que nous étoufferions pourtant ou qui s’embraserait à feu vif. Et ç’était parfois tellement bouleversant qu’il fallait se précipiter contre le silence, désirer l’effacement d’un crépuscule sur les jardins anxieux et les avenues de poussière.
Caen, 12.06. – 05.10.1963 – (Dans trente secondes : l’été !)
À l’ombre du gros numéro
À l’ombre du gros numéro, portée sur le trottoir gris clair qui espère tes pas, je sirote l’air du temps.
En face, un vieux couple d’atlantes Arvernes à moustaches endosse le fardeau d’une demeure couleur de suie où parfois des enfants s’allument dans la clameur dorée des bougies commémoratives.
Au flanc d’une vieille mercerie qui ne trouvera plus repreneur, les murs vocifèrent l’héraldique alambiquée de pompeux illettrés.
Brusquement, une escouade d’éboueurs à cheval portant livrée sang et or traverse la place à grand vacarme, effrayant les platanes et raflant au vol les sacs noirs luisants gonflés d’ordure.
C’est une de ces petites villes où s’éternise la nostalgie des avant-guerres. Ici, dans la pénombre tiède de nos réveils enfantins, les jeux de lumière au plafond présageaient les bonheurs de la journée, l’excitante surprise de la vie.
Une de ces villes paisibles, tentées pourtant par des frissons barbares, que nous arpentons l’une après l’autre, que nous habitons peu, dont il nous restera l’intuition, quelques pauvres indices, des factures dérisoires.
Il faut l’admettre : le monde n’est plus tout à fait où nous l’avions mis. Ainsi nous allons notre pas dans ces villes où tout peut arriver, déjouant au jour le jour l’insanité des sectes d’insectes.
Mais à la tombée du soir, épaule contre épaule, vautrés dans le rotin, nous sirotons notre éternité.
C’est un jasmin profond dans les narines, un long sanglot à l’envers, une immense inspiration qui gave bien au-delà des poumons.
Tous les soirs, les épaules embrassées.
Riom 18.06. 2002 – (Chroniques et discours)
Dans trente secondes : l’été !
L’été de cet été-là.
Il approchait à la vitesse d’un orage et nous sentions que même si la pluie ne venait pas à tomber ce ne pourrait être la réédition de quelque été antérieur. Nous n’attendions pas qu’un dieu doré au sourire appris par cœur surgisse pour escamoter la guerre et nous éblouir au long de journées débordantes de symboles irréfutables — que la lumière, en somme, se ferait.
L’été n’était qu’un prétexte qui avait grandi avec nous, pour se mettre à la vie.
Si l’on persistait à n’y aimer que peu de monde à la fois par limites biologiques ou handicap adolescent, c’était alors de façon précise et immobile comme mourir et peut-être qu’enfin s’apprivoiseraient les belles manières d’être et d’exulter ensemble.
En contrepoint, la fonction vitale était un réel et délicieux soulagement, la même transe dans le tréfonds intime, la même vague déferlante qui submerge l’enfant en pleurs.
L’orage d’été.
En frissonnant de joie sous l’ondée émouvante, on avouait dépendre absolument de l’été, comme de n’importe quelle ritournelle entêtante, comme de n’importe quel autre été.
Tirer doucement sur le fil de l’été.
On ne pouvait pas vraiment mourir en été, ou c’était alors un accident, une preuve d’inexpérience. Mais il arrivait d’être rigoureusement immobile, même sans support musical, persiennes fermées, profondément mort et tout chaud, tout chaud, le regard au plafond. Et peut-être suis-je vêtu tout entier par ton corps.
« Tu sais, l’été… » — Voilà : tirer tendrement sur ce fil sans ficeler l’instant.





























