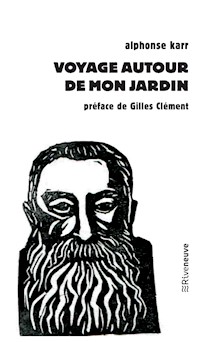Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "Qui est-ce donc qui a publié dernièrement une histoire groënlandaise ? J'en sais une aussi, et je voudrais la raconter. – J'espère que ce n'est pas la même. – Il paraît que l'autre narrateur a pris, pour savoir son histoire, un procédé et un chemin tout différents des miens."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de qualité de grands livres de la littérature classique mais également des livres rares en partenariat avec la BNF. Beaucoup de soins sont apportés à ces versions ebook pour éviter les fautes que l'on trouve trop souvent dans des versions numériques de ces textes.
LIGARAN propose des grands classiques dans les domaines suivants :
• Livres rares
• Livres libertins
• Livres d'Histoire
• Poésies
• Première guerre mondiale
• Jeunesse
• Policier
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 280
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335087383
©Ligaran 2015
Conte groenlandais
Qui est-ce donc qui a publié dernièrement une histoire groenlandaise ? J’en sais une aussi, et je voudrais la raconter. – J’espère que ce n’est pas la même. – Il paraît que l’autre narrateur a pris, pour savoir son histoire, un procédé et un chemin tout différents des miens. Il est allé dans l’océan Arctique – 70 degrés de latitude nord – et a subi les fatigues d’un rude voyage, tandis que, moi, j’ai lu autrefois mon histoire dans un bouquin au coin d’un bon feu de houille, ou couché sur l’herbe, du temps que j’habitais la France et la Normandie.
C’est à vous que j’adresse ce récit, habitants autochtones ou accidentels de ce doux pays de Nice ; j’espère qu’il vous fera apprécier l’hiver que vous allez escamoter.
Il y a fort longtemps – dans une partie du Groenland que ma mémoire ne me permet pas de déterminer d’une façon très précise – entre Julianeshaab et Egedesminde, vivaient deux jeunes gens, fille et garçon, d’une beauté si merveilleuse, que les habitants leur donnèrent les noms de deux de leurs ancêtres, qui, selon la tradition du pays, après beaucoup de hauts faits en tout genre, devinrent, l’un le soleil, l’autre la lune.
Malheureusement, j’ai oublié ces deux noms, et, doué de peu de facilité pour les langues, je n’ai jamais su le groenlandais ; cela me fait perdre beaucoup de couleur locale que je serai forcé de remplacer par d’autres procédés. Les appeler Lune et Soleil en français, comme il peut, au premier moment, paraître raisonnable de le faire, pourrait jeter sur mon récit une teinte à demi-grotesque que je veux éviter. – Nous leur donnerons, s’il vous plaît, des noms danois qui pourraient bien avoir été les leurs avant qu’on les eût nommés Lune et Soleil ; nous les appellerons Frédérique et Harald.
Frédérique était née sur la plage où se passe notre histoire ; Harald était venu récemment en canot de la partie la plus reculée ; on pensait qu’il avait, pendant une pêche lointaine, rencontré Frédérique avec ses parents, et que c’était l’amour qui lui avait fait quitter son pays.
Cependant, comme il arriva à la fin de l’été, qui dure six semaines, et que, à cette époque, on s’occupe opiniâtrement d’amasser les provisions de l’hiver, les deux jeunes gens ou ne se rencontrèrent pas, ou ne se virent que de loin ; mais bientôt commença l’hiver de dix mois et demi, et on se retira dans les habitations.
Ces habitations sont des souterrains creusés à efforts communs, et dans lesquels chaque famille se creuse dans une anfractuosité une petite hutte particulière, où l’on se renferme avec ses provisions. – Le froid devenait piquant : 45 degrés centigrades au-dessous de zéro.
Harald invita Frédérique et sa famille à un festin dans sa hutte. Frédérique se para de son mieux ; elle se peignit le front de jaune et les mains de vermillon ; elle serra autour de sa taille une peau de renne, passa dans son nez un large anneau de cuivre, mit son beau collier de dents de requin et ses bracelets de coquillages ; dans ses cheveux nattés et oints d’huile de baleine étaient attachés des morceaux de corail. La richesse, l’élégance et le bon goût de cette parure portèrent le dernier coup à l’indépendance d’Harald. En effet, Frédérique, sans être tout à fait l’esclave de la mode, sans en adopter les exagérations, la suivait cependant de façon à conserver la réputation qu’elle s’était acquise d’être la fille la mieux mise de la tribu.
Harald était riche : autour de sa hutte étaient rangés un grand nombre de vases pleins d’huile de phoque et de baleine ; des morceaux de ces mêmes poissons, desséchés à la fumée, étaient appendus aux parois, dans une telle profusion, qu’il était impossible qu’il consommât seul toutes ces provisions pendant l’hiver.
Harald était somptueusement vêtu d’un grand tapis formé de la peau de huit renards rouges ; il répondit avec modestie aux éloges que l’on fit de sa fortune, de façon à montrer qu’il ne s’en enorgueillissait pas ; il fit asseoir ses convives sur des lits de mousse sèche et de lichen, et le festin commença. – On plaça devant Frédérique une queue de baleine, morceau fort estimé ; on but de l’huile de baleine d’une fraîcheur exquise ; les têtes commençaient à s’échauffer, lorsque Harald se leva et récita un poème qu’il avait composé en l’honneur de Frédérique :
« Oh ! qu’il soit, après sa mort, enseveli sans son arc et ses flèches, sans canot et sans harpon, celui qui oserait me disputer la belle Frédérique ! qu’il erre dans l’autre vie, désarmé, au milieu des troupes de rennes et de lièvres blancs ! qu’il voie, du bord de la mer, se jouer, aux orages, des troupes de phoques, sans qu’il puisse les atteindre !
Que, dans les régions des âmes, ce séjour des bienheureux où il y a des étés de six mois, et où il ne gèle jamais qu’à 15 degrés, son crâne serve de coupe pour boire l’huile parfumée et enivrante des lampes célestes, à celui qui oserait arrêter sur elle des regards de convoitise !
Frédérique est plus belle que le premier soleil qui fond la glace, plus charmante que les premières mousses vertes du printemps. »
Cette poésie fut généralement admirée. Frédérique, en particulier, y fut sensible. En effet, on demandait un jour à une jolie femme :
– Lesquels aimeriez-vous mieux, des vers de Lamartine ou de ceux de Victor Hugo ?
– J’aime mieux, dit-elle, des vers de quatorze pieds faits par un nommé Gustave ; mais ils sont faits pour moi.
La famille de Frédérique fut enchantée de voir un pareil parti se présenter pour leur fille.
Harald offrit alors timidement quelques présents qui achevèrent d’émerveiller les grands-parents ; il voulut lui-même attacher à l’extrémité des longues tresses de Frédérique deux boutons de guêtre en cuivre avec le n° 19, désignant un régiment danois, qu’un soldat lui avait abandonnés contre la peau d’un renard blanc.
Il lui donna des aiguilles d’os de poisson et la peau entière d’un ours blanc pour lui servir de lit ; il lui donna encore une grande jarre pleine d’une excellente huile de baleine et quatre paniers d’œufs de poisson séchés.
Les parents les déclarèrent fiancés.
On comprend que l’amoureux Harald pressait le jour de l’hymen ; mais Frédérique, qui était coquette, et qui voulait encore jouir de sa liberté, exigea qu’on remît l’union à l’hiver suivant, lorsque l’on se renfermerait de nouveau sous la terre. En vain Harald supplia, en vain la famille de Frédérique se joignit à ses prières : elle fut inflexible.
L’hiver se passa ainsi ; la glace fondit, la neige laissa voir les lichens et la mousse ; on sortit des cavernes et l’on se mit en devoir de ramasser les provisions pour l’hiver, qui allait recommencer dans six semaines.
Personne n’était aussi ardent que Harald ; il ne s’agissait plus pour lui de subvenir à ses besoins ; il fallait que Frédérique fût heureuse et riche ; il voulut qu’elle pût manger des grillades de veau marin tous les jours, et eût de l’huile de baleine à discrétion pour assaisonner les mets, allumer les lampes et oindre ses beaux cheveux.
Mais, au plus beau moment de la pêche, il survint une tempête qui chassa tout le poisson de la côte. La plupart se résignèrent à vivre plus maigrement pendant l’hiver et à se contenter de ce qu’ils avaient pu prendre jusque-là ; mais Harald ne voulut rien écouter. Il décida qu’il partirait et suivrait le poisson sur une autre plage. Quelques autres pêcheurs résolurent d’imiter son exemple. Il alla trouver Frédérique et lui dit :
– Chère âme, je pars ; peut-être me sera-t-il bien difficile de revenir et la plupart de mes compagnons resteront, pendant l’hiver qui vient, sur les plages où nous allons pêcher. Sois ma femme, alors tu pourras venir avec moi.
Frédérique refusa opiniâtrement.
– Nous nous marierons cet hiver ; et, si tu ne peux revenir, nous nous marierons au printemps.
Frédérique mentait, car elle désirait aussi vivement que Harald voir leur union accomplie ; mais elle pensait ainsi se faire valoir davantage.
Harald partit en lui laissant les provisions qu’il avait déjà amassées.
Quand Frédérique eut vu son bateau disparaître à l’horizon, elle fondit en larmes, et regretta amèrement son obstination.
Puis elle se mit à préparer des vêtements de peau pour l’hiver en attendant le retour de son fiancé, adressant des prières au Grand Esprit.
De ce jour, Frédérique négligea sa parure ; on ne la revit plus donner le ton et la mode aux filles du pays, et le vert-de-gris vint oxyder jusqu’aux boutons de guêtre de cuivre, présent magnifique que Harald avait attaché à ses cheveux le jour de leurs fiançailles.
Cependant elle était toujours belle, et elle charma les yeux du vieux Norghus.
Norghus était le Groenlandais le plus riche et le plus puissant ; il avait deux bateaux et quatre hommes à son service ; il possédait quatre-vingts jarres d’huile dans sa demeure d’hiver, et vingt veaux marins enfouis dans la neige pour ses provisions.
Mais Frédérique méprisa son amour et refusa ses présents.
Norghus s’adressa alors aux parents de la fille. – Le Groenland est bien stérile, bien pauvre ; cependant on y trouve encore de quoi corrompre les esprits et acheter les consciences. Terrible appât de l’huile de baleine ! inflexibles attraits des tranches de phoque fumées ! amour aveugle des richesses en un mot ! les parents se prononcèrent pour Norghus et ordonnèrent à Frédérique d’oublier Harald.
Les parents de Frédérique décidèrent son mariage et en fixèrent le jour. Norghus envoya des présents qui excitèrent l’admiration universelle. Il y avait, entre autres raretés, un vêtement composé de huit peaux de renne blanche ; une femme enveloppée là-dedans présentait un tel volume, qu’elle n’aurait pu entrer dans aucune hutte. Mais voici le procédé que la mode avait mis en usage : Cette fourrure était roulée autour du corps ; lorsque celle qui la portait avait le dessein d’entrer quelque part, quelqu’un retenait la fourrure par un bout, la femme tournait sur elle-même et déroulait ainsi trois ou quatre tours ; puis, une fois entrée, elle tournait dans l’autre sens, et roulait de nouveau le tout autour de sa taille.
Il y avait une espèce de chapeau fait avec des fanons de baleine et orné d’une garniture d’os de poisson. Cette coiffure n’était permise qu’aux femmes d’une certaine condition ; sans qu’il y eût à ce sujet ni loi ni pénalité, il y avait des femmes qui n’auraient osé la mettre à aucun prix.
Il y avait des anneaux de nez de toutes les grandeurs.
Si bien que les filles disaient, sans se préoccuper de la vieillesse, de la laideur et de la férocité de Norghus :
– Il faut avouer que cette petite Frédérique a bien du bonheur !
Ce n’était pas l’opinion de Frédérique. Aussi, la veille de son mariage avec Norghus, elle disparut subitement, et, malgré toutes les recherches, on ne put la retrouver. On la crut morte ; mais il n’en était rien : elle s’était retirée dans les montagnes, au fond d’une grotte où elle vivait de baies sauvages et de quelques oiseaux qu’elle attrapait ; tous les jours, elle descendait au bord de la mer, sur une plage déserte, et elle interrogeait l’horizon ; car l’hiver était passé, il faisait à peine 15 degrés de froid. Cette douce température disposait l’âme aux rêveries de l’amour et aux décevantes espérances. Les lichens et les mousses perçaient la neige, les bouleaux gonflaient leurs bourgeons résineux, la nature reprenait son éclat.
À chaque instant, on voyait revenir quelques-uns de ceux qui avaient, par une pêche lointaine, été entraînés et retenus sur d’autres rivages.
Un jour, Frédérique reconnut à l’horizon le bateau d’Harald ; quel bonheur d’avoir souffert pour lui et pour la foi qu’elle lui avait jurée ! quels charmants récits elle allait faire et entendre !
Mais le bateau approche ; deux hommes sont dedans, aucun des deux n’est Harald.
L’un prend la parole et dit à Frédérique :
– Comment se fait-il que Harald ne soit pas là pour nous recevoir et nous aider à débarquer la pêche ?
– Harald ! dit-elle, il n’est donc pas avec vous ?
– Non ; la pêche faite, ne pouvant plus vivre sans vous, il nous a laissés en route pour revenir sur un bateau d’écorce.
– Personne ne l’a vu.
– Hélas ! nous le lui disions bien, qu’il n’arriverait pas ; mais il était si résolu, qu’il avait fini par nous faire partager sa confiance. Hélas ! hélas ! nous avons perdu par ta faute, ô Frédérique, le plus brave et le plus habile pêcheur de notre côte !
Frédérique ne prononça pas un mot pour se justifier, pas un mot pour se plaindre ; elle ne versa pas une larme. Comme les gens de la tribu s’assemblaient autour d’elle, et disaient : « C’est elle, la voilà revenue ; » elle fit signe qu’on ne lui parlât pas ; elle monta sur un canot et le poussa au large ; puis ce canot se rapetissa en s’éloignant ; puis, le soir, on le vit disparaître dans la brume. Ses parents se mirent à sa recherche, mais jamais on ne la retrouva.
On prétend qu’ils se sont réunis et ont été changés en alcyons ; mais on ne donne pas de preuves.
Il y a un an, je rencontrai un jour le seigneur Boschi, qui a été quelque temps intendant général de la ville de Nice.
– Vous avez envoyé ce matin, me dit-il, une dépêche singulière.
– Qu’y trouvez-vous de singulier ?
– C’est la première fois que je vois écrire par le télégraphe ce seul mot fichtre ! que, du reste, je ne comprends pas.
– C’est un juron, comme qui dirait, pour vous autres ultra-catholiques, per Bacco ! ou vergogna !
– Mais… par le télégraphe…
– Parce que le télégraphe coûte cher, vous croyez qu’il doit avoir la solennité de la tragédie, qu’on ne doit lui faire parler que la langue de Louis XIV ? Mais, au contraire, s’il y a quelque chose qui doive s’envoyer par la télégraphie, c’est un juron. Qu’est-ce qu’un juron, en effet ? Un mot par lequel l’homme en colère exhale d’un seul coup des sentiments qui demanderaient quelquefois un volume pour s’exprimer congrûment.
– Mais, pour le même prix, vous auriez pu écrire quinze mots.
– Fichtre, pour être développé, en demandait deux cents.
Fichtre voulait dire : Je vous ai écrit deux fois, vous ne m’avez pas répondu ; vous savez cependant que l’affaire dont je vous ai chargé est aussi importante pour vous que pour moi ; ne pas vous en occuper, c’est manquer à la fois d’amitié et d’intelligence. Je suis très irrité de ce retard ; vous n’avez cependant pas oublié que, chaque fois que j’ai pu vous être bon à quelque chose, même en ce qui personnellement ne m’intéressait en rien, je me suis conduit tout autrement ; si vous n’avez pas fait l’affaire, dépêchez-vous et songez que j’attends.
Fichtre veut encore dire pour les gens qui voient les nuances : Vous voyez que je jure, signe d’impatience, mais en même temps signe de familiarité ; donc, je ne suis pas tout à fait fâché contre vous ; il y a encore moyen de réparer votre faute.
Fichtre est un juron facétieux et badin ; il exprime l’impatience, n’exprime pas encore la colère, mais l’annonce, si vous ne vous mettez pas en mesure de faire ce que j’ai le droit d’attendre de vous.
Voilà ce que veut dire fichtre, et pas mal de choses encore ; quatorze mots de plus ne m’auraient servi de rien. Il fallait dire tout – ou ne dire que fichtre.
Je vis l’intendant Boschi plus étonné que convaincu.
– Fichtre ! ajoutai-je, a encore quelque chose de bon : d’abord, c’est qu’il ne raconte pas de mes affaires, aux employés du télégraphe, plus qu’il ne me plaît de leur en dire ; ensuite, c’est que, sans ce mot qui vous a intrigué, je ne saurais pas que vous prenez connaissance des dépêches.
L’intendant me quitta, et je continuai à penser au télégraphe – et j’y ai souvent pensé depuis.
D’où vient que le secret des lettres est un droit social si souvent, si énergiquement proclamé ; que les gouvernements qui l’ont violé autrefois s’en sont toujours défendu et que les dépêches électriques, qui ne sont que des lettres émises d’une autre façon, n’auraient pas droit au même secret ? est-ce parce que le port en coûte plus cher ? Ce serait, au contraire, pour certaines personnes – pas pour moi – une garantie de plus.
Quelqu’un – pas vous, mes chers lecteurs ! pas vous, mes spirituelles lectrices ! – va peut-être me dire :
– Mais on ne peut cacheter une dépêche télégraphique.
Je répondrai que ce ne sont pas les moyens qui manqueraient.
J’en ai un jour essayé un ; ce n’est pas celui-là que je recommanderai, parce qu’il s’est trouvé être très mauvais.
J’écrivis ma dépêche en latin ; j’avais pour cela deux raisons : une raison de conserver un demi-voile sur ma missive ; une raison d’économie : on peut dire en quinze mots latins des choses qui exigeraient vingt mots français.
Voici comment je vis que mon moyen était mauvais :
D’abord, l’employé du télégraphe me dit en lisant ma lettre avec quelque difficulté et craignant de se tromper :
– Je vous ai écrit, n’est-ce pas, misi litteras ?
– Oui, monsieur, répondis-je.
Voilà pour le secret.
Voici maintenant pour l’économie :
Si l’employé au télégraphe auquel je voulais faire un secret savait le latin, mon correspondant ne le savait pas.
Il me répondit quelques heures après :
« J’ai oublié le latin ; écrivez-moi en français. Je mets à votre compte cette dépêche nulle et fantaisiste. »
Il me fallut refaire une dépêche en français ; total : trois dépêches.
Le moyen que je conseille est celui-ci ; il n’y a rien, je crois, dans les règlements qui le prohibe et il est très facile : Faites un alphabet avec votre correspondant, donnez aux lettres ordinaires une autre valeur, renversez l’alphabet, convenez que z sera a, par exemple, que b sera y, que c sera x et vice versa. Vous écrivez à une femme :
PX DKEG ZYMU
Il n’y aura qu’elle qui saura que vous lui avez écrit : Je vous aime.
Et vraiment, il y a comme cela un certain nombre de choses qui ne se peuvent guère dire tout haut et devant témoins.
Il se passe à Monaco quelque chose de bizarre. – Par un juste retour des choses d’ici-bas, la maison de jeu est en perte : non pas que les joueurs aient gagné – allons donc ! – mais l’administration, chaque fois qu’elle gagne deux francs sur la rouge ou sur la noire, commande pour quatre mille francs de quelque chose. Il y a, assure-t-on, un peu d’embarras dans les affaires ; de sorte que le jeu qui, quand il gagne – et il gagne toujours – reçoit ordinairement les pontes d’un air affable et tout gracieux et le sourire sur les lèvres, a, à Monaco, un air maussade et refrogné ; en un mot, la banque à l’air d’un ponte.
Des plaintes se font entendre ; on pense que le prince de Monaco, ou Son Altesse Charles… sera obligé d’intervenir.
À propos des jeux, il est une morale dont je me suis occupé quelquefois et que j’appelle la morale de papier.
C’est à cette morale que j’ai dit souvent : « Attention ! ne fermons pas les égouts tant qu’il y a des ruisseaux. » Cette morale ne veut pas qu’il y ait de jeux publics à Nice – c’est-à-dire pas de roulette ; – et la loterie y est en vigueur, du moins encore pour un temps, la loterie, le plus disproportionné, le moins loyal des jeux. Mais les enfants, grâce à la morale de papier, sont élevés dans la terreur de la roulette et dans une grande indulgence pour la loterie. La mère qui nourrit un terne depuis dix ans fait les plus beaux discours à son fils contre le jeu. Or, à la roulette, le joueur et la banque jouent presque à chance égale, et cette petite différence suffit pour assurer le bénéfice de la banque, tandis qu’à la loterie, le jeu le plus égal, le moins insensé, est celui où le joueur joue un seul numéro et où il a une chance pour lui et quatre-vingt-dix-neuf contre lui.
C’est la morale de papier qui a amené le luxe honteux des femmes, et voici comment la chose s’est faite :
Les courtisanes de profession adoptaient des costumes bizarres, – des législateurs moins bêtes les leur avaient quelquefois imposés, – des robes décolletées dans la rue, la tête nue, des fleurs dans les cheveux, des souliers de satin, des robes de moire, d’or, etc.
À cette même époque, les honnêtes femmes, et même simplement les femmes comme il faut, même les plus riches, même les plus élégantes, se piquaient de ne porter dans la rue que des costumes simples.
Ici, la morale de papier est intervenue ; la morale de papier est essentiellement hypocrite : elle se soucie peu des mauvaises mœurs, pourvu qu’elles soient déguisées, fardées et embéguinées.
Les courtisanes avaient un costume qui les faisait reconnaître, et ne parcouraient que certains quartiers et certains emplacements.
Il était trop évident pour la morale de papier qu’il y avait là de ces pauvres filles.
L’autre morale se contentait de savoir qu’il n’y en avait pas ailleurs, que l’on ne pouvait les confondre avec les autres femmes, et qu’on ne les rencontrait que quand on le voulait.
La morale de papier a fermé ces asiles et ces quartiers, et elle a imposé aux filles le costume de toutes les femmes.
De sorte que, aujourd’hui, il y en a partout ; on prend une femme de la classe dite honnête pour une fille des rues – et une fille pour une femme de l’autre classe.
Il fallait aller les chercher, – on les rencontre.
Ce n’est pas tout.
Jamais aucune femme n’aurait osé s’habiller comme ces pauvres prostituées ; beaucoup étaient retenues sur le bord de l’abîme par la nécessité d’afficher la honteuse profession.
Aujourd’hui, on a ainsi au moins décuplé le nombre de ces malheureuses, en leur permettant de rester confondues dans la foule ; on a recruté, pour cette vicieuse armée, les grisettes, les ouvrières, etc., qui ont passé lorettes.
D’autre part, ces filles qui sont entretenues par le public, ont nécessairement plus d’argent à dépenser pour leurs affublements que les femmes honnêtes, qui ne peuvent guère ruiner qu’un mari et un amant.
Celles-ci voyaient sans grande envie les courtisanes afficher un luxe qui les désignait hautement comme courtisanes ; aujourd’hui, le luxe de ces filles est un luxe que toute femme peut étaler, pourvu qu’elle ait assez d’argent.
En la voyant, on se dit :
– C’est peut-être une courtisane, c’est peut-être une femme très riche.
Et la plupart en courent la chance.
Il en est de même de la fermeture des maisons de jeu. À la roulette, il fallait une certaine résolution pour se faire voir, ou une passion à un degré où elle trouve toujours à se satisfaire.
On jouait avec des chances mauvaises mais connues d’avance – sous la surveillance facile de la police.
Aujourd’hui, les villes sont pleines de tripots clandestins où l’on n’a plus à combattre les chances inégales du hasard, mais l’adresse criminelle des escrocs.
Ainsi, la morale de papier a créé les lorettes et les tripots.
J’ai habité bien longtemps une petite bourgade au bord de l’Océan. Pendant deux ou trois ans, j’ai été à peu près seul. J’avais un grand jardin, deux petits canots, des filets – et la mer.
Ô pauvre Robinson ! ce n’est pas des Caraïbes et des anthropophages qu’il faut te défier !
J’aime assez les méchants ; ils ne m’ont jamais fait grand mal ; de ceux-là, on se défie, et on a le droit de se défier. Contre eux, on se défend ; on ne va pas sottement à leur rencontre, les mains vides et ouvertes pour serrer leurs mains, la poitrine nue, le cœur découvert.
Ô pauvre Robinson ! ce n’est pas des Caraïbes et des anthropophages qu’il faut te défier !
C’est Vendredi qu’il faut craindre.
Je me rappelle une des incarnations de ce terrible Vendredi.
Celui-là était de la pire espère ; c’était de ces gens que l’on appelle « bons garçons ; » de ces gens qui passent pour obligeants parce qu’ils aiment à se mêler, à se fourrer dans la vie, dans les affaires d’autrui.
Vous appelez un domestique pour faire porter une lettre :
– Ne dérangez donc personne, s’écrie Vendredi, je mettrai votre lettre en passant.
– Comment, en passant ? mais vous ne savez pas où je l’envoie.
– C’est égal ; moi, je passe partout, c’est mon chemin partout ; je ne vous suis jamais bon à rien, je viens ici fumer, jaser, vous ennuyer ; je ne suis pas assez sûr d’être agréable, je veux être utile ; sans cela, je ne reviendrai pas. – Allons, donnez-moi votre lettre.
Tenez.
Il part, et l’on se dit :
– Quel bon garçon !
Seulement, trois ou quatre jours après, vous apprenez qu’il a dit à vingt personnes où et à qui il a porté une lettre pour vous ; vous apprenez que, quand il rencontre la femme à laquelle il a porté la lettre, il la salue d’un air d’intelligence ; si bien que son mari lui a demandé :
– D’où connaissez-vous donc ce monsieur ?
Vous attendez sa première visite – car vous n’allez jamais chez lui – pour lui « laver la tête. »
Vous vous attendez à des dénégations, vous avez rassemblé vos preuves ; mais, au premier mot, il s’écrie :
– C’est vrai, je suis un animal, un bavard ! Voulez-vous me tuer ? Tenez ! (Et il décroche un yatagan de votre muraille.) Exigez-vous que je me jette à l’eau ? Je suis une affreuse canaille ! Voulez-vous que je demande pardon à cette dame, à genoux, au milieu de la rue ?
Vous vous plaignez à vos amis communs ; tout le monde vous dit :
– Quoi ! Hippolyte, tu es fâché contre Hippolyte, un si bon garçon ? Allons donc !
Et on vous force de vous réconcilier.
Il est vrai qu’un jour, en remuant des papiers sur votre table, il voit une carte d’huissier.
– Tiens ! tiens ! il vient des huissiers ici ? s’écrie-t-il.
– Si vous étiez plus discret et mieux élevé, dites-vous, vous ne sauriez pas cet incident. Oui, il vient des huissiers ici.
– Eh bien, je ne vous le pardonnerai jamais.
– Quoi ? que voulez-vous dire ? C’est moi qui ne devrais jamais vous pardonner votre manie de farfouiller !
– Non, je ne vous le pardonnerai jamais. Savez-vous ce que vous avez fait ?
– Oui, certes : j’ai fait une dette que je ne puis payer aussi vite que le voudrait mon créancier.
– Ce n’est pas cela ! Vous aviez une occasion de me montrer un peu d’amitié, de me faire un sensible plaisir – et vous l’avez laissé perdre. Vous pouviez me dire : « Eh ! là-bas, Hippolyte ! j’ai besoin d’argent, mon bon homme ! » Et Hippolyte, qui n’est pas précisément Crésus, a un ou deux billets de mille francs dans sa tirelire au service de ses amis, Hippolyte eût été enchanté ; mais non, monsieur est fier, monsieur méprise Hippolyte ; il faut que ce soit par hasard que Hippolyte apprenne que les huissiers ont envahi les pénates de son ami ; et quand l’apprend-il ? juste le lendemain du jour où il a prêté jusqu’à son dernier sou à une espèce d’inconnu, à un homme quelconque qu’il n’aime pas, qui ne lui rendra peut-être jamais son argent ! De sorte qu’aujourd’hui, nous voilà bien – vous à la merci de l’huissier – moi dans l’impuissance de vous aider – et en position de perdre mon argent, que vous m’auriez sauvé en me l’empruntant. Non, non, je ne vous pardonnerai jamais ce trait-là. Je voudrais perdre mon argent, pour que vous en eussiez du remords. J’ai la sottise d’être votre ami, et vous n’êtes pas le mien, voilà tout.
Et il sort furieux.
Et vous dites :
– Il est bien indiscret, bien ennuyeux ; mais quel bon garçon !
Et vous lui écrivez pour le consoler.
Hippolyte, donc, m’envoya, un jour, de Paris une lettre pour me demander l’hospitalité ; les raisons qu’il me donna étaient de celles auxquelles il n’y a aucune objection à faire : il était dans un embarras d’affaires qui se débrouillerait de lui-même dans un mois ou deux.
Et Vendredi imprima la trace de son pied sur le sable du jardin de Robinson.
Ô Vendredi ! c’est un jour funeste qui a été ton parrain ?
Je le reçus de mon mieux ; il resta quatre mois ; puis, un jour, il m’annonça que ses affaires étaient terminées, mais qu’il ne me quitterait plus.
– Vos affaires, dis-je, sont terminées ?
– Oui.
– Bien terminées ?
– Oui, vous dis-je.
– Tout à fait comme vous le vouliez ?
– Tout à fait.
– Alors je puis vous dire, sans me gêner, qu’il vaut mieux que nous demeurions chacun chez nous. Vous connaissez Gavarni ?
– Certes.
Eh bien, il y a un joli dessin de lui dont je lui ai, un jour, donné la légende. Rien que de très vrai. « Oreste et Pylade seraient volontiers morts l’un pour l’autre ; mais ils se seraient brouillés s’ils n’avaient eu qu’une cuvette et qu’un pot à l’eau. »
– Je comprends ; eh bien, je vous aime davantage de votre franchise ; je vais louer une maison dans le village ; nous serons chacun chez nous, et, quand je viendrai ici, vous me direz comme vous faisiez à Paris : « Hippolyte, mon bon, fichez-moi le camp, j’ai à travailler ; » ou : « Je veux être seul. » Rien ne me fait tant de plaisir que quand on me dit : « Fichez-moi le camp, » parce que, quand on ne me le dit pas, je suis sûr que ma présence fait plaisir à mes amis.
– Quel bon garçon ! pensai-je.
Et j’avais presque des remords de lui avoir répondu durement.
– À propos, dit-il, avez-vous de l’argent ?
– Oui, assez pour moi, et même un peu à votre service.
– Eh bien, je n’ai pas de chance ! c’est au contraire que je voulais vous en offrir ; mais c’est fait pour moi – un poète qui a de l’argent, vous le faites exprès ! Allons, adieu ; je vais louer une maison, je vais chercher mes meubles à Paris, et je m’installe ici pour le reste de mes jours.
Vendredi tint sa promesse ; – deux mois après, il était citoyen de la bourgade ; il s’occupa soigneusement de son installation. Je trouvai, un jour, le charpentier du village très occupé autour d’un de mes canots.
– Que faites-vous là, maître Vatinel ?
– Quelque chose de très difficile, monsieur Alphonse ; prendre le gabarit d’un bateau pour en faire un semblable, et tout à fait semblable ; car M. Hippolyte m’a dit qu’il ne le prendrait pas s’il y trouvait la moindre différence, sauf une seule : il faut que son canot ait un pied de long de plus que le vôtre.
– Ah ! c’est M. Hippolyte… ?
– Oui, et il veut qu’il soit peint de blanc comme les vôtres – avec les tolets, les porte-tolets et les plaques de cuivre.
– Il ne vous a pas dit de lui donner le même nom ?
– Ça, ça ne se peut pas, la marine ne veut pas ; mais ça n’en est pas bien loin : le vôtre, celui-ci, s’appelle le Goëland ; le sien s’appellera la Mouette.
Je fis une grimace involontaire ; j’étais, au fond, très vexé ; ce qu’on peut faire de pis à un homme, c’est de lui causer un de ces petits chagrins honteux qui touchent à de petites vanités secrètes dont les blessures sont réelles, mais un peu ridicules à avouer.
Ce n’était pas tout : j’avais depuis longtemps adopté comme plus commode à la mer le costume des pilotes de Quillebeuf et du Havre ; ce costume avait, de plus, l’avantage de me confondre avec les autres pêcheurs, et de me faire échapper à une curiosité presque toujours importune et toujours embarrassante.
Eh bien, un matin, au détour d’un chemin, je me rencontrai vis-à-vis de moi-même, c’est-à-dire que je trouvai, en face de moi, un homme tout pareil à moi : Vendredi s’était fait, comme moi, couper les cheveux ras ; la chaussure, la vareuse, le chapeau, tout était semblable ; à dix pas, l’on devait nous prendre l’un pour l’autre ; – je le pris un instant pour moi.
L’année précédente, j’avais été parrain d’un bateau de course.
Tous les ans, à la fête des régates, mes braves pilotes étaient invariablement battus par les Anglais, qui venaient de chez eux ramasser les prix et s’en retournaient.
Cette infériorité tenait à plusieurs causes.
La première, c’est que ces hommes formaient un équipage toujours le même, accoutumé à ramer ensemble, n’ayant pas d’autre profession que de courir aux régates, et, conséquemment, plus exercé, plus entraîné que les nôtres.
La seconde, c’est qu’ils amenaient des bateaux faits pour la course, qui ne peuvent servir à autre chose et sacrifient tout aux conditions de la légèreté et de la vitesse.
Nos pilotes avaient formé, entre eux, un équipage exercé, et résolurent d’avoir un bateau à leur gré ; ce bateau fut construit tout en bois de cèdre, et gréé avec un soin paternel.
Quand il fut terminé, on me fit l’honneur de me choisir pour le parrain.
Ce fut l’occasion d’une modeste petite fête, d’un dîner très simple où l’on but du cidre, un verre de vin et un verre de punch.