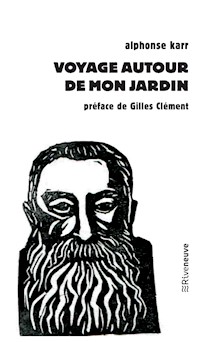Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Extrait : "Il y avait dans le jardin d'Hélène une sorte de tonnelle, formée par quatre ou cinq grands acacias, qui mêlaient par le haut de leurs branches mobiles, leur feuillage étroit et découpé... et déjà jauni par le soleil du mois de juin. Entre les acacias, des lilas d'un vert sombre fermaient de leur feuillée épaisse les espaces vides."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 228
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il l’écoute, non pour ce qu’elle dit, mais pour sa voix.
FRÉDÉRIC SOULIÉ.
Il y avait dans le jardin d’Hélène une sorte de tonnelle, formée par quatre ou cinq grands acacias, qui mêlaient par le haut leurs branches mobiles, leur feuillage étroit et découpé… et déjà jauni par le soleil du mois de juin. Entre les acacias, des lilas d’un vert sombre fermaient de leur feuillée épaisse les espaces vides. – Un houblon serpentait autour d’un acacia, et étendait ses branches et ses feuilles semblables à des feuilles de vigne, mais, d’un vert presque noir, sur les arbres voisins – trois ou quatre chèvrefeuilles grimpaient aussi dans les arbres, et retombaient en guirlandes parfumées.
Par l’entrée étroite laissée à la tonnelle on ne voyait rien, si ce n’est, à trente pas environ, un rideau de peupliers serrés les uns contre les autres, et se balançant au moindre vent. Devant les peupliers, quelques saules au feuillage bleu servaient à masquer entièrement la vue.
Dans l’espace compris entre les peupliers et la tonnelle, il n’y avait rien que de l’herbe, qui cachait presque entièrement un petit ruisseau, de telle sorte que les yeux ne voyaient que de la verdure, mais variée de toutes les formes et de toutes les nuances. – Seulement le liseron grimpait après les joncs les plus élevés, et étalait ses grandes cloches blanches – une sorte de plante marine, dont le nom nous est inconnu, élançait une touffe de verges vertes, terminées par un épi de fleurs violettes, qui se découpaient avec une inconcevable richesse sur le fond vert de l’horizon.
Nous aimons les horizons bornés ; un horizon trop vaste nous écrase et nous rend trop petits à nos propres yeux : vis-à-vis d’un horizon semblable à celui de la mer, on est saisi par l’idée du vague et de l’infini, et les pensées se pressent, rapides, vagabondes sans se présenter sous aucune forme convenue, et dont on puisse se servir pour les communiquer. Il nous serait impossible de travailler, ou même de méditer sur un seul sujet avec un horizon aussi vaste ; notre imagination alors s’échappe et s’étend jusqu’aux bornes plus larges qui lui sont permises – et les rênes dont nous nous servons d’ordinaire pour la maintenir sur tel ou tel sujet perdent promptement de leur force par la longueur qu’il faut leur donner, ainsi qu’il est connu en physique, et ne tardent pas à être rompues.
Maurice et Hélène sont assis sous la tonnelle, près l’un de l’autre, les mains dans les mains, les yeux sur les yeux.
Jusqu’ici ils ont parlé de choses presque indifférentes ; il fait trop jour encore – derrière les peupliers, à travers leur feuillage, immobile alors – car le vent se tait en même temps que les oiseaux, à l’heure majestueuse où le soleil se couche – on voit encore une bande d’un or pâle ; au-dessus pèsent tristement des nuages gris ; au-dessus des nuages gris le ciel est bleu-clair et parsemé de petits nuages blancs en légers flocons.
Mais au zénith, le ciel est d’un bleu sombre et presque noir, et à l’horizon opposé, sur un fond noir commencent à scintiller les étoiles encore blanches.
C’est ce moment rapide, difficile à saisir, où le jour et la nuit se partagent notre horizon, le jour à l’ouest, la nuit à l’est ; la nuit s’avance et gagne du terrain, et à mesure que le ciel noircit, les étoiles se multiplient à l’infini, et perdent leur clarté blanchâtre, pour en prendre une plus intense et plus bleue.
Maurice et Hélène parlent peu, et chacun d’eux aimerait mieux ne pas parler du tout, tant est puissante l’influence de cette heure, où l’eau même semble rouler plus doucement sur le gravier, où l’on ne peut s’empêcher de parler plus bas, tant l’homme a peu de force contre le bonheur et s’en laisse écraser. S’ils disent quelques mots, c’est que ce ravissement inexprimable du cœur, qui se replie et se renferme dans la contemplation de son bonheur, chacun d’eux ne sait pas que l’autre l’éprouve en même temps, chacun croit que ce bonheur, il l’éprouve seul, et qu’il doit s’efforcer de le traduire en langage humain, pour le faire partager à l’autre.
Ces paroles inutiles, si pâles, si décolorées, ne sont qu’un effort impuissant que fait l’homme dans ces moments où l’amour lui fait entrevoir un bonheur plus grand que la nature, il voudrait confondre ainsi ses sensations avec celles de la femme qu’il aime ; il voudrait réunir les deux âmes, il voudrait que chacun pût jouir de son bonheur et de celui de l’autre, et s’identifier ensemble, se perdre l’un dans l’autre, comme deux gouttes d’eau, comme deux flammes.
Mais alors, comme l’ange déchu, c’est aux attributs de Dieu qu’il ose prétendre, en voulant confondre avec soi l’objet de son amour, en voulant tout renfermer en soi.
Ou peut-être, parcelle de la divinité, comme tout ce qui est, il aspire à se réunir aux autres parcelles.
Désir qui suit l’homme partout, et qui se manifeste dans tous ses amours, dans tous ses bonheurs, dans toutes ses souffrances.
Quand l’homme aime et désire la femme, quand il contemple le ciel et le soleil, quand il s’enivre du parfum des fleurs et du feuillage, ce sont autant d’amours qui tendent au même but, à se compléter, – comme les tronçons séparés du serpent tendent à se réunir.
Car on dit Dieu est partout, il fallait dire Dieu est tout – Dieu est l’air et le soleil, et les arbres, et les fleurs, et les hommes, et les terribles lions, et les crocodiles du Nil, et le vent, et les parfums que le vent recueille dans les prairies le soir.
Dieu est à la fois l’étoile qui brille au ciel et le ver luisant qui brille dans l’herbe.
Dieu est aussi cette herbe et les violettes qui l’embaument, ainsi que les cèdres du Liban et les plus hautes montagnes.
Dieu renferme tout en son sein, et surtout tous les amours ; ces amours si multipliés, dont chacun est si fort pour nous qu’il nous écrase – ces amours des papillons qui font ensemble frémir leurs ailes, et ressemblent à des églantiers dont les pétales se doublent par les soins du jardinier – ces amours de fleurs qui se fécondent en mêlant leurs parfums – ces amours des tigres qui rugissent et se donnent avec leurs dents blanches et aiguës, des baisers sous lesquels le sang ruisselle – ces amours harmonieux des oiseaux – et ainsi des demoiselles qui, semblables à des saphirs, à des topazes, à des émeraudes vivantes, se poursuivent et se caressent, emportées par le vent sur leurs frêles ailes de gaze.
Dieu a tout cela en lui, – Dieu est tout cela.
Et l’homme est une parcelle de Dieu ; et dans les moments où l’amour le grandit, alors ses yeux un instant s’ouvrent à la grandeur de Dieu, il la comprend, il la désire ; mais bientôt cet éclat trop fort l’étourdit, lui fait fermer les yeux, et il retombe comme foudroyé, et il reste ce qu’il était – parcelle de Dieu – sans avoir la conscience de ce qu’il est.
Nous ne vous dirons pas ce qu’éprouvèrent Maurice et Hélène dans cette soirée ; si vous avez des souvenirs, éveillez-les en vous représentant leur situation.
La nuit obscure, les arbres et leurs feuilles noires, parmi lesquelles brillent les étoiles l’air embaumé, la solitude, le silence et l’amour qui embellit tout cela, comme le soleil qui donne à tout la couleur, le mouvement et la vie.
Il s’éleva un vent frais. Hélène eut froid et demanda à rentrer. Maurice fut choqué qu’elle s’aperçût de cette incommodité ; lui qui fût resté toute la nuit sur le pic d’une haute montagne, couché sur la neige, sans savoir qu’il fît froid, pourvu qu’Hélène fût auprès de lui.
Il sentit qu’il fallait la quitter, et, comme elle s’appuyait sur son bras pour traverser le jardin, il marchait le plus lentement possible ; de temps à autre, s’arrêtait pour la regarder, soupirait, et recommençait à marcher.
– Pourquoi nous quitter ce soir ? pensait-il. Elle m’aime, elle est à moi ; pourquoi nous séparer quand nous sommes si heureux ensemble !
Cependant, il ne voulait rien dire, car, s’il eût demandé à Hélène à rester près d’elle, et qu’elle l’eût refusé, ce refus l’eût profondément blessé, et d’ailleurs tant qu’il n’avait rien demandé, il pouvait espérer ce qu’il désirait ; en parlant il craignait d’avoir trop tôt la certitude d’une séparation qui lui était si douloureuse.
Il attendait, et cependant tirait du moindre mouvement d’Hélène des inductions favorables ou contraires. Il remarquait si le côté de l’allée qu’elle prenait était plus près de la maison ou plus près de la porte qui conduisait dehors – en approchant, un léger frisson d’Hélène fut par lui interprété de deux manières différentes.
Elle partageait son regret de cette séparation.
Ou elle éprouvait cette émotion mêlée de crainte que toute femme ressent au moment de s’abandonner aux caresses de l’homme même qu’elle aime le plus.
Comme ils étaient arrivés au pied de l’escalier de pierre qui conduisait à la maison, Maurice s’arrêta, serra la main d’Hélène, et les yeux fixés sur les siens, avec un regard suppliant, il ne prononça qu’un mot :
– Hélène !
Mais, dans ce mot, il y avait et l’aveu de ses craintes et de ses désirs, et une prière éloquente.
– Qu’avez-vous ? dit Hélène.
– Faut-il nous séparer ? dit tristement Maurice.
– Et pourquoi ? répondit-elle ; me croyez-vous une femme coquette et sotte qui, considérant comme une défaite le moment où elle se donne à son amant, le retarde par mille petits artifices, et se donne en détail, aujourd’hui la main, demain les joues, ensuite le cou, puis les lèvres !
Pour de telles femmes, l’amour n’a pas d’excuse, puisqu’il est si peu puissant qu’il leur permet de semblables gradations ; ce sont d’ignobles créatures qui donnent facilement leur âme et marchandent pour donner leur corps.
Du moment où je vous ai dit : Je vous aime ! j’étais à vous, mon corps et mon âme, ma vie tout entière. Vous appartenir est un triomphe pour moi autant que pour vous ; loin de refuser de vous donner quelque chose, je voudrais être plus belle ; je voudrais réunir en moi les charmes de toutes les femmes, non par vanité, mais pour te donner plus de plaisirs : je ne mettrai pas ma gloire à te résister, mais à t’appartenir, mais à te voir heureux. Quand je t’aurai tout donné, je gémirai de t’avoir tout donné… mais parce que je n’aurai plus rien à te donner. Cherche, imagine, invente des bonheurs que je puisse faire pour toi, et ce sera moi qui serai heureuse et fière, et qui te remercierai.
Ils entrèrent dans la maison ; Maurice marchait en suspendant ses pas pour empêcher le parquet de crier. Une femme de chambre entra. Maurice voulut se lever pour qu’elle ne le vît pas, Hélène le retint doucement et donna quelques ordres sans aucun embarras.
On servit une collation : puis Hélène passa dans un cabinet où une autre femme la déshabilla ; ensuite elle entra avec Maurice dans sa chambre à coucher. – La femme de chambre plaça les bougies et se retira.
Maurice ne comprenait pas qu’Hélène ne prît pas plus de précautions. Il s’attendait à entrer la nuit mystérieusement, par-dessus les murailles, et c’était à la connaissance des domestiques qu’il passait la nuit dans la chambre d’Hélène.
Les bougies s’éteignirent, et la chambre ne fut plus éclairée que par la clarté douteuse que jetait la lampe d’albâtre suspendue au plafond.
Nous ne sommes pas ici pour nous amuser – mettons-nous à table.
ÉDOUARD FEREY.
Il y a certaines choses que nous regrettons des temps qui nous ont précédées.
Ce n’est
Ni la poudre,
Ni les paniers,
Ni les culottes,
Ni les boucles d’oraux souliers,
Ni les épagneuls,
Ni les carlins,
Ni les petits vers, sous la régence et sous Louis XV,
Ni les grands vers, sous Louis XIV et sous Napoléon-le-Grand ;
Nous regrettons les soupers.
Les autres repas sont la satisfaction d’un besoin, le souper seul est un plaisir. Il n’y a rien qui trouble le souper. On peut souper sans souci, et avec une entière nonchalance de corps et d’esprit. Au moment où vous soupez, la maison est close ; elle ne s’ouvre ni aux importuns, ni aux huissiers, ni aux parents. – Le reste de votre journée est renfermé avec vous ; – vous n’avez plus à sortir, votre plaisir n’est pas empoisonné par les affaires qui vont suivre, vous vous réjouissez à la fois d’être sorti des tracas de la journée et d’entrer dans votre lit.
Et vous pouvez ôter votre cravate.
Ainsi nous soupons – et nous prions nos deux ou trois amis de venir quelquefois souper avec nous.
Nous ne leur promettrons pas, comme Horace
À Mécène, chevalier romain,
un vin mis en bouteille à l’époque où ledit Mécène fut par trois fois salué des applaudissements du peuple.
Nous excluons de nos soupers toute idée de politique, de gloire ou d’ambition.
Ils auront, comme dit l’Allemand :
Un seul plat et un visage ami.
Et encore, de bonnes causeries sortant de cœurs ouverts ; de gais et de tristes souvenirs.
Des pipes – et du tabac, dont il ne nous appartient pas de faire l’éloge – à indiscrétion.
Richard trouva Maurice très occupé, ayant devant lui du papier, de l’encre et une plume – qu’il taillait depuis une demi-heure.
– Mon procès est perdu, dit Maurice ; tes lignes à pêcher me coûtent précisément, y compris les frais de justice et les dépenses de la route, 15 600 florins 30 kreutzers, et qui pis est, la plus ennuyeuse journée de ma vie que j’ai passée à *** pour les aller chercher. Je suis en train de calculer ce qui me reste pour vivre après la perte dudit procès ; mais je ne connais au monde rien d’aussi fatiguant et d’aussi difficile que de compter. On dit que dans l’état social on doit se rendre utile ou agréable ; tu ne peux guère m’être agréable en ce moment, mais tu peux m’être très utile.
Je vais établir mon actif et mon passif, et tu me feras les additions et les soustractions.
Richard prit la plume. Maurice fouilla dans un tiroir dont il tira plusieurs mémoires passifs.
– Je dois :
À mon tailleur, 418 florins ;
À mon bottier, 157 fl. 20 groschens ;
À mon chapelier, 60 fl. ;
À Josué l’usurier, 2 450 fl. ;
Pour intérêts de ladite somme, 4 900 fl. ;
Pour frais de poursuites exercées contre moi, 2 450 fl.
– C’est à peu près tout, dit Maurice en finissant le dernier papier.
– Passons à l’actif, dit Richard.
– Passons à l’actif, dit Maurice.
Il s’écoula dix minutes après lesquelles Richard dit :
– Tu sais que je t’attends.
– Écris en grosses lettres actif.
– C’est fait.
– Bien.
– Après ?
Après ? Attends un peu, je cherche.
Quelques minutes s’écoulèrent encore.
– Mais, dit Maurice, tu n’as pas fait l’addition du passif.
– Je vais la faire.
Ton passif se monte à 10 435 florins 20 groschens.
– Ah ! ah ! il faut maintenant que je t’explique pourquoi je fais ce travail. Je ne veux pas te faire travailler sans te dire ce que tu fais, et les causes de ce que tu fais, ainsi que l’on en use à l’égard d’un mercenaire.
– Et avec d’autant plus de raison, répliqua Richard, que probablement je travaille gratis.
– Voici mes raisons, dit Maurice, qui le plus souvent ne daignait guère écouter ce que disait Richard.
D’abord, je pose comme maxime fondamentale cet axiome :
Il faut être riche.
– Bien commencé, dit Richard.
Maurice poursuivit sans remarquer ou peut-être sans entendre cette interruption.
Il faut être riche.
J’entends par être riche, vivre sans aucune privation ; c’est-à-dire – tenir un équilibre juste et constant entre ses besoins ou ses désirs, et les moyens de les satisfaire. – En effet, la vie de privations est intolérable, quand on regarde, autour de soi, avec quel luxe et quelle apparente prodigalité procède la nature.
Les chèvres, les hommes et des chenilles vertes qui, plus tard, se transforment en papillons blancs, mangent les choux. Peu parviennent à monter en graines ; quand ils sont en graines, les oiseaux en mangent une partie, et cependant les choux ne manquent pas de se multiplier, et l’espèce n’en manquera pas. On cueille en fleurs une partie des cerisiers ; la plus grande partie des noyaux, c’est-à-dire, des graines destinées à la reproduction, est anéantie ou plutôt détournée de sa destination naturelle et on en fait du kirschenwasser. L’espèce des cerisiers ne paraît cependant pas diminuer, et le vent qui traverse la Forêt-Noire emporte encore au printemps le parfum amer de leurs fleurs.
Tandis que dans notre état de société, l’homme qui a prétendu tout perfectionner ne peut vivre sans vendre une partie de sa vie pour acheter sa subsistance. Les hommes mêmes qui passent pour riches ne prévoient ni leurs caprices, ni des besoins nouveaux, et quelle que soit leur fortune ils ont tellement agrandi leurs besoins qu’ils n’ont que justement de quoi les satisfaire ; tandis que – pour avoir assez il faut avoir trop.
C’est pourquoi lorsque je dis : il faut être riches, j’entends deux manières de le devenir. Quand on ne l’est pas ou par droit de conquête ou par droit de naissance.
Le premier est d’augmenter son revenu jusqu’à ce qu’il se trouve en équilibre avec les désirs et les besoins.
C’est le plus commun, le plus difficile, et le seul que l’on essaie.
Le second est de diminuer ses besoins et ses désirs, jusqu’à ce qu’ils se trouvent en équilibre avec le revenu.
Ce moyen est simple, facile, et personne n’y pense.
Le premier moyen est connu de tout le monde ; il faut se faire négociant, voleur, héritier, ou homme politique incorruptible. Je ne parlerai que du second.
Des dépenses que fait un homme, il faut retrancher :
1° Les dépenses qui ne sont pas pour lui ;
2° Les dépenses qui, étant pour lui, ne contribuent cependant en rien à son bonheur ni à ses plaisirs ;
3° Les dépenses qui, étant pour lui, et contribuant sous certains rapports à ses plaisirs, ne donnent cependant pas de plaisirs qui puissent balancer le travail et la sollicitude auxquels il faut se condamner pour les acquérir ;
4° Examiner si des plaisirs réels, et rachetant bien le travail qu’ils coûtent, peuvent se remplacer par des plaisirs gratuits et alors faire cette substitution.
Par exemple :
Nous allons procéder par ces retranchements sur mon passif que nous allons mettre en regard avec la pension annuelle que me fait mon père
10 435 florins 20 groschens.
1 000 florins.
La différence est de 9 435 florins 20 groschens.
– Tu as fait cette soustraction, dit Richard, avec une rare habileté ; mais comme dans l’année qui s’est écoulée, il faut compter les 1000 florins de ton père – que probablement tu n’as pas enfouis – il faut mettre en regard de cette somme de 1000 florins 11 435 florins 20 groschens que tu as dépensés dans l’année.
– Tu as raison ; donc ma différence se trouve de 10 435 florins 20 groschens.
Retranchons les dépenses inutiles de la première espèce.
Si je n’avais voulu briller aux yeux des autres, il m’eût suffi, pour me vêtir pendant toute l’année, de deux sarraux, l’un de toile, l’autre de drap, et de deux pantalons, le tout pour 30 florins.
De gros souliers, deux casquettes de cuir m’eussent coiffé et chaussé toute l’année, 30 florins.
L’argent de Josué a été employé en soupers, en gants, en voitures, en fantaisies ; les fantaisies et les soupers appartiennent aux dépenses de la première espèce. Les voitures à celles de la troisième espèce, c’est-à-dire aux dépenses qui, contribuant en quelque sorte à nos plaisirs, ne donnent pas des plaisirs tels qu’ils balancent la sollicitude qu’ils coûtent. Retranchons l’argent de Josué. Ensuite, pour mon logement et ma nourriture personnelle, une chambre de 50 florins par an, et par jour deux repas pour une pièce de 24 kreutzers.
– Cela fait 230 florins, dit Richard.
– Total, pour ma dépense d’une année ? dit Maurice…
– 290 florins, dit Richard.
– Donc, continua Maurice, avec les 1000 florins de mon père, j’eusse eu de reste ?
– 710 florins.
710 florins à consacrer à mes caprices personnels, j’eusse été riche, et encore n’avons-nous pas fait subir à mes dépenses les quatre sortes de retranchements que j’ai indiquées.
Quand j’ai dit : on doit être riche, c’est que je suis convaincu qu’il dépend de l’homme de n’être jamais pauvre.
– Mais, dit Richard, tout homme ne possède pas un revenu de 290 florins.
– Alors il faut adapter à ses dépenses les deuxième et troisième sortes de retranchements, et en dernier recours la quatrième espèce, c’est-à-dire supprimer rigoureusement toutes les choses coûteuses, plaisirs ou nécessités qui peuvent être remplacés par des plaisirs et des nécessités gratuits.
Par exemple, sur les côtes de la mer, en Bretagne, la mer apporte des coquillages, des forêts giboyeuses offrent des animaux pour la nourriture de l’homme, quelques peaux des bêtes dont on se nourrit servent de vêtements.
Et on peut être logé pour 5 ou 6 florins par an.
– Mais, dit Richard, beaucoup de gens ne possèdent pas en revenu ces 5 ou 6 florins, et il est probable que dans un pays où on peut être logé pour cette somme, l’argent est extrêmement rare, et qu’il est plus difficile de gagner ces 6 florins qu’ailleurs 500.
– On pourrait à la rigueur se construire soi-même une cabane ou consacrer un peu de temps à se faire un petit revenu avant de se retirer ainsi. Un homme qui a quelque éducation peut gagner à une occupation quelconque 1000 florins dans une année. Nous avons calculé que les dépenses d’une année, dépenses qui pourraient être considérablement diminuées, ne se montaient qu’à 290 florins ; donc en trois mois un homme peut, après avoir payé ses dépenses, avoir à lui 150 florins, ce qui fait un revenu de 7 ou 8 florins pour toute sa vie.
– Fort bien, dit Richard, mais ce serait là une triste vie.
– Elle te paraît telle parce que tu y cherches les plaisirs qui occupent la tienne, et que tu es niaisement semblable à l’enfant qui ne croit pas qu’il y ait d’autre terre au-delà de son horizon, au sauvage qui pense que le soleil est éteint quand il n’en est plus éclairé.
Même telle que tu la conçois, ce serait une vie moins ridicule que celle du bureaucrate, qui vend sa vie à d’autres, et ne garde pour lui que le temps du sommeil, temps qui peut à chaque instant être limité par une ordonnance ministérielle, temps pendant lequel on ne se sent pas vivre, c’est-à-dire, pendant lequel on ne vit pas ; moins ridicule que celle des hommes qui travaillent toute leur vie pour faire fortune, et n’obtiennent, pour résultat de leur dépendance, de leurs fatigues, de leurs privations, qu’une fortune inutile, une bonne table quand ils n’ont plus de dents, des forêts quand ils n’ont plus de jambes, des propriétés qui s’étendent au loin, quand ils n’ont plus d’yeux.
Gens qui travaillent misérablement toute leur vie, pour subvenir aux frais d’un riche enterrement, et payer le cercueil de plomb dans lequel ils ont l’espoir de pourrir quinze jours plus tard.
Mais cette vie est tout autre que tu la vois. Ce qui occupe la vie, ce sont :
Pour quelques hommes, les passions ;
Pour d’autres plus faiblement organisés ou fatigués, les plaisirs.
Eh bien ! il y a dans cette vie que tu es libre d’appeler sauvage, des plaisirs, que j’ai éprouvés, plus suaves qu’aucun de ceux que donne la vie sociale.
L’aspect du ciel, des arbres, de la terre ;
Les harmonies naturelles du vent et de l’eau.
Les parfums des fleurs et des feuilles.
Tout cela grandit par l’habitude – contrairement aux plaisirs de la vie sociale – et étend notre vie, qui s’immisce, par un effort divin, à toutes ces diverses existences.
Et encore cette vie est remplie par des passions, plus fortes sans doute que le jeu ou l’ambition.
La chasse, passion si puissante, que le chasseur, pour la satisfaire, est toujours prêt à risquer insoucieusement sa vie.
L’indépendance absolue, qui mêle un noble orgueil à tout ce que fait l’homme, à tout ce qu’il éprouve, qui se marque dans son regard et dans sa démarche, qui assaisonne ses repas simples, qui donne du charme à ses privations et même à ses souffrances ;
Et encore, la contemplation, la rêverie ;
Et surtout, la paresse, la plus voluptueuse de toutes les passions, la seule qui n’apporte ni fatigue ni désespoir.
– Monsieur le rhéteur, dit Richard, permettez-moi de vous arrêter ici. Vous avez parlé des passions, et vous avez éludé l’amour.
Souffrez, sophiste de mauvaise foi, que je répare cet oubli prémédité, et que je le rappelle à votre mémoire complaisante.
Dans cette vie sauvage, j’use de l’autorisation que vous m’avez libéralement accordée ; les liens de quelque durée sont les seuls possibles ; il faut donc une sorte de mariage. Que fera d’une femme votre homme riche de 7 florins par an.
– Je t’ai dit qu’il n’y avait d’autre dépense que pour le logement ; le même peut servir à tous deux.
Mais nous n’avons raisonné que sur une situation d’extrême pauvreté ; songeons un peu combien de gens, qui pourraient réaliser cent ou deux cents florins de revenu, languissent dans la misère, au milieu des plaisirs tout dispendieux qu’offre la vie sociale, et pourraient être riches, en changeant de pays et en faisant subir à leur budget les opérations que je t’ai indiquées.
– Et penses-tu qu’il soit si facile de quitter son pays, sa patrie ?
– La patrie est la terre qui nous nourrit. La patrie est tellement un mot, qu’il manque tout son effet si on emploie un synonyme moins sonore, ce que tu as senti toi-même en ne te contentant pas du mot pays.
L’amour de la patrie…
– Arrêtons, Maurice, dit Richard ; c’est assez pour le moment d’une dissertation, et je te quitte.
– Nous n’avons pas compté mon actif.
– Ce sera pour un autre jour.
– Tâche d’y penser, parce que ce calcul a quelque importance. – Je songe à me marier.
– Contre qui ?
– Ceci pourrait amener une dissertation.
– La curiosité me fera braver la dissertation.
– Eh bien ! ce soir, à onze heures, ici.
– J’y serai.
Richard alla à la salle d’armes, où son ami refusa de l’accompagner.
Maurice alla chez Hélène.