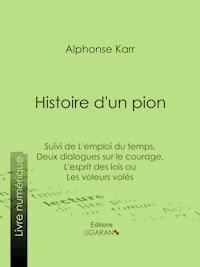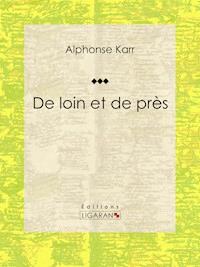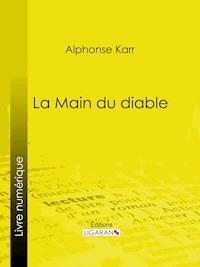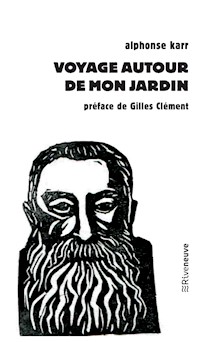
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Riveneuve éditions
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
Le départ d’un ami pour un lointain voyage est l’occasion, pour celui qui reste, de s’engager dans la rédaction d’une longue correspondance, exaltant les aventures et les émerveillements du voyage immobile, ou presque. Juste en bas de chez soi : dans son jardin dont on sait, depuis Voltaire, qu’il faut le cultiver pour gagner en sagesse et en paix. Description de l’infiniment petit comme la vie minuscule des insectes ou de l’infiniment grand comme les ciels et les saisons, réflexions sur la nature des choses et celle des hommes, l’ouvrage est à la fois une ode à l’écologie, à la culture en sciences naturelles et à la pleine conscience sociale et politique. Avec l’humour du moraliste. Totalement actuel !
À PROPOS DES AUTEURS
Jean-Baptiste Alphonse Karr (1808-1890) est journaliste et romancier. Ami de Victor Hugo, il est l’auteur d’une soixantaine d’ouvrages. Républicain, le coup d’État du futur Napoléon III l’oblige à s’installer à Nice, où il loue une propriété agricole et ouvre un magasin de fleurs, fruits et légumes. Il écrit sur l’art des jardins de sorte qu’une poire, un bambou et un dahlia portent son nom. Ardent défenseur des animaux, il devient président de la Ligue populaire contre la vivisection en 1882.
Gilles Clément est jardinier, paysagiste et botaniste. Il a enseigné à l’École nationale supérieure du paysage de Versailles et au Collège de France. Il a élaboré une quinzaine de parcs et jardins et est l’auteur de nombreux ouvrages : Le Jardin planétaire (avec Claude Eveno, L’Aube, 1997, 1999) ou Je chemine avec... Gilles Clément (avec Sophie Lhuillier, Seuil, 2020).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 557
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
Préface
« Il paraît qu’autrefois les arbres et les plantes avaient avec les hommes toutes sortes de bonnes relations qui ont été interrompues je ne sais trop pourquoi ni comment : il serait difficile de dire qui a eu les premiers torts. »
Cette entrée en lecture de la lettre XLV donne le ton : on parle des relations entre les êtres vivants sur notre petite planète. Nous sommes au « jardin », les plantes sont à l’honneur mais leur lien aux animaux et aux humains est tel qu’on ne peut envisager de les isoler du contexte dans lequel elles se déploient.
Immersion au cœur de ce que nous appelons aujourd’hui un écosystème. Tel est ce « voyage au jardin » auquel Alphonse Karr ajoute la dimension humaine en s’adressant à un ami dans chacune de ses lettres et en invitant le lecteur à jouer au jeu de la découverte du vivant par une série d’observations qui nous permet de retrouver notre regard d’enfant. Dans l’une de ses dernières missives, il formule ce que l’on vit intensément à la lecture de ses textes : « Ce voyage autour de mon jardin, si je le publiais, ferait plus pour la vulgarisation de l’entomologie et de la botanique que le plus gros et les meilleurs livres compilés par les érudits ». Oui, ce voyage est une vraie leçon pédagogique des sciences naturelles, applicable à tous et à tous les âges.
Au fil de ses lettres, on mesure combien l’auteur détestait les savants. Il les fait apparaître comme de simples nomenclateurs incapables de vivre la moindre émotion, asséchés par le savoir glacé de la science sans jamais vivre l’aventure heureuse du jardin et, plus généralement, celle de la découverte. Il va même jusqu’à leur attribuer de fausses certitudes : « … Un savant ne dit jamais je ne sais pas, il préfère l’erreur à l’ignorance ». Il utilise pourtant le nom savant des plantes et des insectes et parle latin pour se faire entendre à une époque où cette langue universelle — espéranto encore à l’œuvre aujourd’hui — faisait partie des bases ordinaires de l’érudition. Il se méfie du jargon scientifique et rejette les mots inutiles : « Pourquoi appeler une sorte d’acacia inerme, au lieu de l’appeler sans épines, qui a le même sens et n’a que le défaut d’être plus clair ? »
Cette remarque sur le principe de vulgarisation du savoir concernant le vivant, établi par l’auteur en plein milieu du XIXe siècle, est encore valable aujourd’hui. L’enseignement abordant ces sujets fondamentaux (et de grande urgence en notre temps) a disparu au profit d’un accès à une technologie renforçant l’illusion de la maîtrise en maintenant les humains dans un niveau d’ignorance avancée sur les questions ordinaires du vivant. Alphonse Karr serait en accord avec Simon Hureau, auteur d’une bande dessinée récente où l’on assiste à une intelligente fabrication d’un jardin en ville tandis que dans la rue deux gamins tentent d’écraser un cérambyx qu’ils confondent avec un scorpion. Mais pourquoi faut-il écraser le scorpion ? Question que poserait sans doute l’auteur de ce voyage en insistant sur la nécessité de s’émouvoir pour apprendre.
Ainsi parle-t-il d’une mouche en lui donnant son nom officiel. Il écrit à propos du diptère au corselet vert : « … cette pierrerie vivante s’appelle chrysis. J’ose à peine respirer dans la crainte de la faire s’envoler ; je voudrais la tenir dans les mains pour être sûr de la voir plus longtemps ». Il peut parler des galles, ces maisons à insectes mal appréciés, en expliquant leur rôle dans l’écosystème et faire apparaître la beauté dans ce qui est rejeté par une esthétique de la bienséance.
Il peut se hasarder en critique politique à propos des symboles et révéler que la fleur de lis n’est autre que celle de l’iris. Il a raison. Qui aurait l’idée d’aller se couvrir d’un drapeau à fleur d’iris des marais, jaune et commun comme un gilet ?
Face à l’église, il ne se gêne pas plus en expliquant que la prolifération des sphinx tête-de-mort en Bretagne en 1730 ne relevait nullement d’une colère céleste et cite avec ironie le discours des pères de Trévoux sur le sujet : « Le public a toujours droit de s’alarmer, parce qu’il est toujours coupable, et tout ce qui lui rappelle la colère d’un Dieu est respectable » ! On se croirait face à une épidémie de covid où la bienséance citoyenne résulte d’une stratégie de la peur dans un monde étrange face au comportement imprévisible des virus. Alphonse Karr avait décidément quelques années d’avance. Avec un regard sur le vivant qui l’éloigne de la stricte poésie tout en respectant les valeurs de la rime ou celles des figures symboliques. Pour lui, La Fontaine « connaissait les hommes, mais ne connaissait pas les animaux sous la figure desquels il les voulait faire paraître ».
Il nous emporte sur des non-chemins. La multitude des rencontres en ces bords de routes improbables nous amène à penser que le trajet n’a pas de fin. Pour un peu on ferait le tour de la Terre et comme la Terre est ronde, cela n’en finirait pas. Il le dit à la manière d’une excuse : « Lorsque je vois les fleurs apparaître chacune à leur tour autour de moi, je crois presque voyager ». Cela rejoint le principe du « cheminement par incitation » où le voyageur (le vrai, pas le touriste à selfies) dessine un parcours involontaire en se rendant d’un lieu qui l’attire à un autre qui l’étonne sans que le chemin soit tracé. D’où le sentiment d’un vrai voyage dont on ne peut mesurer la durée.
Mais pour Alphonse Karr ce voyage existe aussi dans l’absolue immobilité : « Avez-vous vu dans votre journée autant de choses singulières que j’en ai aperçues sans changer de place et couché sur le dos dans l’herbe ? Demain je m’étendrai sur le ventre ». Leçon à retenir : souhaiter bon voyage aux personnes couchées dans l’herbe, les yeux ouverts prêts aux moindres étonnements devant la profusion de vie à petite échelle.
Alphonse Karr s’émerveille du pouvoir des semences, il aborde la dormance des graines, la résistance au temps de ces minuscules organes de reproduction qui assurent une vie pour demain, il vante les vertus de l’ortie, aliment tonique, amendement utile au jardin pour renforcer l’immunité des plantes cultivées, mais aussi terre d’accueil aux chenilles de vanesses dont il fait la description en s’émerveillant. Sans doute aurait-il été choqué par la loi d’orientation agricole française de 2006 qui interdit l’usage des PNPP (produits naturels peu préoccupants) dont fait partie le purin d’orties. Simple loi d’interdiction d’accès à la gratuité : n’importe qui peut fabriquer cette substance sans dépenser un centime. L’auteur insiste sur le jeu compliqué que les humains s’infligent à eux-mêmes, il décrivait avant l’heure la stupidité du principe de croissance : « Les hommes, non contents de deux ou trois besoins réels que la nature leur a imposés, s’en créent chaque jour de nouveaux, et épuisent tout leur génie à inventer de nouveaux moyens d’être pauvres et misérables ».
On peut lire les lettres de ce voyage au jardin en appréciant le savoir et la poésie de l’auteur mais il est difficile d’en extraire la dimension politique tant elle surgit avec insistance, sans vraiment dire son nom. Je recommande la lecture à haute voix de la lettre XXXV qui s’achève par ces mots : « Il a quitté sa belle chaumière et ses beaux arbres et son soleil, et ses tapis d’herbe si verte et le chant des oiseaux, et l’odeur des chênes. Il est devenu riche ! Il est devenu riche ! Le pauvre homme ! »
Jamais un tel constat n’a pris autant de sens qu’en cette époque où nous vivons une tension extrême entre les gestes destructeurs du vivant et ceux qui tentent de le protéger. L’aventure du merle tué au fusil de chasse par son ami Edmond illustre la folie de ce jeu de mort, aujourd’hui largement soutenu par nos gouvernants qui auraient sans doute qualifié Karr de dangereux ayatollah défenseur de la vie sur Terre.
En s’immergeant dans le cours des lettres d’Alphonse Karr comme on se jetterait à l’eau d’une rivière douce, on se sent emporté par une logique de vie où tout apparaît évident par la seule force du courant. On est dans le constat et non dans l’imaginaire, même si la transcription du vécu s’enrichit des émotions et d’une poésie chargée d’un anthropocentrisme raisonné ou d’un animisme ancestral. Le mot nature peut disparaître. Tout est lié. Il ne servira plus à séparer les humains des autres vivants sur cette planète.
Lisons les lettres, partons en voyage. Jetez votre GPS à l’eau, suivez votre regard.
Étonnez-vous !
Gilles ClémentLa Vallée le 23 août 2020
Lettre I
Vous souvient-il, mon ami, du jour où vous partîtes pour ce long et beau voyage dont les préparatifs vous occupaient depuis si longtemps ?
J’arrivai le matin pour passer quelques instants avec vous, ainsi que j’en avais l’habitude ; j’ignorais que ce jour fût celui de votre départ, et je restai surpris de l’air inusité qu’avait votre maison ; tout le monde paraissait inquiet et affairé ; vos domestiques montaient et descendaient rapidement. Une élégante calèche de voyage était tout attelée dans votre cour. Au moment où j’entrai, le postillon avait déjà placé une de ses grosses bottes sur l’étrier d’un des deux chevaux ; un de vos gens, monté en courrier pour commander les relais, tourmentait son cheval qui piaffait sous lui.
Arrivé près de vous, je vous trouvai distrait et préoccupé ; vous parûtes faire un effort pour répondre à mes questions et m’adresser quelques paroles ; vous sembliez agité comme un oiseau qui va s’envoler.
Vous me dîtes adieu en me serrant la main, puis vous montâtes dans la voiture ; Arthur, votre valet de chambre, monta derrière ; vous fîtes un signe, et le courrier partit au galop. En même temps, le postillon sortit de la cour et fit bruyamment claquer son fouet en manière de fanfare.
Les voisins étaient aux fenêtres, les passants s’arrêtaient ; vous me fîtes encore adieu d’un signe de main, et vous dîtes au postillon : Partez !
Les chevaux prirent le galop et ne tardèrent pas à disparaître au détour de la rue.
Pour moi, je restai debout, étourdi, stupéfait, triste, mécontent, humilié, sans savoir précisément pourquoi.
Les voisins refermèrent leurs fenêtres, les passants continuèrent leur route ; votre portier fit crier sur ses gonds la porte cochère, et j’étais encore là, immobile, dans la rue, ne sachant ni que faire, ni que devenir, ni où aller ; il me semblait que la seule route qu’il y eût au monde était celle que vous suiviez, et que vous l’emportiez avec vous.
Cependant, je crus m’apercevoir qu’on me regardait avec étonnement, et je pris au hasard, — pour m’en aller plutôt que pour aller quelque part, — le côté opposé à celui par lequel vous aviez disparu.
Je ne tardai pas à me demander où j’allais, et cette question m’embarrassa à un certain point ; les promenades me paraissaient tristes et les gens maussades : je pris le parti de rentrer chez moi.
Chemin faisant, je commençai à penser de vous d’assez mauvaises choses ; je vous avais trouvé l’air presque dédaigneux, vous sembliez flatté de l’attention qu’excitaient votre départ et surtout votre train ; vous paraissiez laisser là votre rue, votre maison et votre ancien ami, comme on laisse des choses usées et dont on n’a plus que faire.
Graduellement je laissais germer dans mon cœur des sentiments presque haineux à votre égard ; mais heureusement je les étouffai bien vite, quand je découvris que ce n’était rien autre chose que de l’envie.
Tout bonheur excite un peu de haine : on ne demande pas mieux que de se figurer que ceux qui en jouissent ont envers nous quelque tort grave qui nous permette de donner un nom un peu plus noble à ce sentiment bas et honteux dont le véritable nom est l’envie, et de l’appeler juste ressentiment, fierté légitime, dignité blessée.
Une fois que j’eus reconnu le monstre, j’en triomphai bien vite, et je vous eus promptement justifié. Il ne me fut pas aussi facile de me justifier moi-même à mon propre tribunal.
Certes, le diable n’aurait guère de prise sur nous, s’il nous présentait les amorces qu’il nous tend sous leur véritable nom.
Rentré chez moi, j’enviais encore votre bonheur ; mais je ne vous l’enviais plus, et vous étiez redevenu pour moi un ami excellent et sûr, aussitôt que je me fus mis raisonnablement à ne plus chercher en vous ces proportions chimériques que l’on impose à un pauvre Pylade, sans s’occuper jamais d’examiner si l’on est soi-même pour un autre ce qu’on exige qu’un autre soit pour vous : en un mot, chacun veut avoir un ami, mais on ne s’occupe guère d’en être un.
Seulement, comme vous échappiez à ma mauvaise humeur, je m’en pris au sort, et je me plaignis amèrement de ma mauvaise fortune, qui ne me permettait pas de partir comme vous pour aller voir d’autres pays, d’autres hommes, d’autres climats, et je m’aperçus de ma pauvreté, à laquelle jusque-là je n’avais guère fait d’attention.
Et quoi ! me disais-je, serai-je donc toujours comme cette chèvre que je vois attachée à un piquet, au milieu d’un champ ; elle a brouté déjà toute l’herbe qui est dans le cercle que sa corde lui permet de parcourir, et il faut qu’elle recommence à tondre la luzerne déjà raccourcie et semblable à du velours.
En parlant ainsi, j’étais appuyé sur le balcon d’une fenêtre basse qui donne sur mon jardin, et je regardais machinalement devant moi ; le soleil se couchait ; mes yeux d’abord, et mon âme ensuite, furent bientôt captivés par ce magnifique spectacle.
Au plus haut du ciel, du côté du couchant, étaient trois bandes de nuages.
La plus haute était formée d’une sorte d’écume en flocons, grise et rose.
La seconde était en longues teintes d’un bleu noirâtre, légèrement glacé d’un jaune de safran.
La troisième était faite de nuages gris, sur lesquels se balançait une fumée jaune clair. Au-dessous était comme un grand lac d’un bleu vif, pur et limpide.
Au-dessous de ce lac s’étendait un nuage gris avec une frange de feu pâle.
Au-dessous de ce nuage, un autre lac d’un bleu un peu affaibli.
Au-dessous, un nuage étroit d’un gris pareil à celui de la cendre chaude d’un volcan. Au-dessous, un nouveau lac d’un bleu verdâtre comme certaines turquoises, profond et limpide comme les autres.
Au-dessous, de gros nuages dont la partie supérieure était blanche, glacée de feu pâle, et l’inférieure d’un gris sombre, avec une frange du feu le plus éclatant.
Là, dans une épaisse vapeur orange, se couchait le soleil, dont on ne voyait plus qu’un point rouge de sang.
Puis quand le soleil eut disparu tout à fait, tout ce qui était jaune dans le tableau prit les nuances de rouge correspondantes ; le bleu pâle ou verdâtre devint d’un azur plus plein et plus sombre.
Et tout semblait, comme moi, admirer ces éternelles magnificences.
Le vent avait cessé d’agiter les feuilles des arbres ; les oiseaux ne se disputaient plus les places sous l’épaisse feuillée, on n’entendait pas un insecte bourdonner dans l’air ; les fleurs, je le croirais, avaient fermé leurs riches cassolettes : rien ne cherchait à occuper ni à distraire les sens.
Je pensai alors que, à quelque vingt lieues de là, dans votre calèche, avec votre courrier et votre postillon devant, et votre valet derrière, vous ne voyiez pas un plus splendide spectacle que celui qui s’étalait à mes yeux, et que sans doute vous en jouissiez avec moins de recueillement et de transport.
Et je songeai à toutes les richesses que Dieu a données aux pauvres ; à la terre, avec ses tapis de mousse et de verdure, avec ses arbres, ses fleurs, ses parfums ; au ciel, avec ses aspects si variés et si magnifiques ; à toutes ces éternelles splendeurs que le riche ne peut faire augmenter pour lui, et qui sont tellement au-dessus de ce qui s’achète.
Je songeai à la délicatesse exquise de mes organes, qui me permet de goûter ces nobles et pures jouissances dans toute leur plénitude.
Je rappelai encore combien j’ai peu de besoins et de désirs : la plus grande, la plus sûre et la plus indépendante des fortunes.
Et, les mains jointes et serrées, les yeux levés au ciel, qui s’assombrissait par degrés, le cœur plein de joie, de sérénité et de reconnaissance, je demandai à Dieu pardon de mes plaintes et de mon ingratitude, et je le remerciai de toutes les richesses qu’il m’a prodiguées.
Quand je m’endormis le soir, j’avais fort grande pitié de ces pauvres riches.
Vale.
Lettre II. Stephen
Comme le matin j’étais à ma fenêtre, j’aperçus, dans un angle, une toile d’araignée. Le chasseur, qui avait tendu là ses filets, était occupé à réparer des avaries causées, la veille au matin, par quelque proie d’une grosseur imprévue ou d’une résistance désespérée. Quand tout fut en état, l’araignée, qui était deux fois grosse et lourde comme la plus grosse mouche, marcha sur sa toile sans briser une maille, et alla se cacher dans un coin obscur et se mettre à l’affût. Je la regardai longtemps ; deux ou trois mouches, volant à l’étourdie, se prirent dans les rets perfides, se débattirent en vain ; l’implacable Nemrod arriva sur les captives et les suça sans miséricorde ; après quoi elle refit une ou deux mailles rompues, et retourna à son embuscade.
Mais voici une autre araignée plus petite, pourquoi a-t-elle quitté sa toile et ses embûches ? Hélas ! c’est un mâle, et un mâle amoureux, il ne songe plus à la chasse ; il est semblable au fils de Thésée.
Mon arc, mes javelots, mon char, tout m’importune.
Il s’approche et il s’éloigne, il désire et il craint. Le voici sur le premier fil de la toile de celle qu’il aime ; effrayé de tant d’audace, il recule et s’enfuit, mais c’est pour revenir bientôt. Il fait un pas, puis deux, et s’arrête.
Vous avez vu des amants timides, vous l’avez été vous-même, si vous avez aimé réellement. Vous avez frémi de terreur sous le regard pur et innocent d’une jeune fille ; vous avez senti votre voix trembler auprès d’elle, et certains mots que vous vouliez et que vous n’osiez dire, vous serrer la gorge au point de vous étrangler. Mais jamais vous n’avez vu un amant aussi timide que celui-ci, et il a pour cela de bonnes raisons. L’araignée femelle est beaucoup plus grosse que le mâle, ainsi que cela est à peu près général dans les insectes. Si, au moment où le mâle se présente, son cœur à elle a parlé, elle cède, comme tous les êtres, à la douce influence de l’amour, elle s’adoucit comme la panthère, elle se livre à la douceur d’aimer et d’être aimée, et de se le laisser dire ; elle encourage son timide amant, et sa toile ne devient plus pour cet amant aimé, que l’échelle de soie des romanciers.
Mais, si elle est insensible, si son heure n’est pas encore venue, elle s’avance lentement néanmoins au-devant du tremblant Hippolyte qui cherche en vain dans ses traits s’il doit craindre ou espérer. Puis, quand elle est à quelques pas de l’amoureux, elle s’élance sur lui, le saisit et le mange.
Certes, c’est alors que les plus anciennes et les plus ridicules métaphores inventées par les amoureux cessent d’être des métaphores, et prennent un sens réel et effrayant.
Voilà un amoureux qui a le droit de se plaindre des rigueurs de sa belle ennemie.
Voilà un amant qu’on n’accusera pas d’exagération s’il glisse dans l’aveu de ses sentiments cette question dont on a un peu abusé : « Faut-il vivre ou mourir ! » ou cette phrase : « Si vous repoussez mon amour, ce sera l’arrêt de ma mort. »
Celui-ci cependant fut moins malheureux ; la belle s’avança de son côté, il l’attendit quelques instants dans une visible anxiété : mais, soit qu’il eût aperçu dans sa démarche quelque signe inquiétant, soit que la coquette ne sût pas bien composer sa physionomie, ce que je ne pus distinguer à cause de ses proportions, soit qu’elle laissât voir dans son air plus d’appétit que d’amour, ou encore que l’amoureux ne fût pas atteint d’une de ces flammes intenses qui font braver tous les dangers, il prit la fuite avec une telle rapidité que je le perdis de vue, ainsi que fit sans doute son inhumaine, car elle retourna tranquillement se cacher dans son embuscade attendre d’autres proies.
J’avais déjà assisté à de semblables scènes, car j’ai passé une grande partie de ma vie seul et à la campagne, et j’ai de tout temps étudié les mœurs des insectes ; mais, cette fois, le petit drame dont je venais d’être spectateur me laissa une impression particulière et me fit penser à vous.
Certes, me dis-je, c’est une singulière inquiétude de l’esprit que l’amour des voyages, et les voyageurs sont d’étranges gens qui s’en vont à de grandes distances, et à grands frais, pour voir des choses nouvelles, sans avoir pris la peine de regarder à leurs pieds ni sur leurs têtes, où il se passe tant de choses extraordinaires et aussi inconnues qu’on le puisse désirer.
Le voilà parti, continuai-je en pensant à vous ; il peut bien faire le tour du monde sans rencontrer un genre d’amour aussi étrange que celui dont je viens d’être témoin à ma fenêtre.
Sous quelque partie du ciel qu’ils demeurent, de quelque façon qu’ils s’habillent ou ne s’habillent pas, les hommes vivent sur quatre ou cinq passions toujours les mêmes, qui ne varient pas dans le fond et très peu dans la forme.
Nulle part l’amour ne lui présentera un drame aussi singulier que celui qui vient de se passer sous mes yeux.
Dans cette touffe de mousse verte comme l’émeraude, chatoyante comme le velours, et grande comme la paume de la main, il y a des amours, des haines, des combats, des transformations et des miracles qui nous sont inconnus et que nous n’avons jamais regardés.
Bien plus, dans les grandes choses et surtout dans ce qui regarde l’homme, la nature semble s’être astreinte à des règles presque invariables, tandis que dans les fleurs et dans les insectes, elle paraît s’être livrée aux plus étranges et aux plus ravissantes fantaisies.
Bizarre manie que celle qui fait que la plupart des hommes ferment les yeux sur tout ce qui les entoure, et ne les daignent ouvrir qu’à cinq cents lieues de leur pays.
Eh bien ! m’écriai-je, et moi aussi je vais faire un voyage, et moi aussi je vais voir des choses nouvelles et extraordinaires, et moi aussi j’aurai des récits à imposer !
Faites le tour du monde, moi je vais faire le tour de mon jardin.
Je vous attendrai ici, mon ami, vous me retrouverez sous mon figuier ou sous un de mes chèvrefeuilles, et je vous ferai avouer qu’il y a une grande et terrible punition pour les voyageurs comme pour les amants inconstants ; — pour les voyageurs l’arrivée, pour les inconstants le triomphe ; — car ils voient alors combien se ressemblent tous les pays et toutes les femmes.
Qu’allez-vous voir là-bas, et comme vous serez fier, dans votre première lettre, si toutefois vous pensez à m’écrire, de me raconter que vous avez vu des femmes tatouées et peintes de diverses couleurs, avec des anneaux dans le nez.
Comme je vous dirai : Eh quoi ! mon bon ami, pourquoi couriez-vous si loin ? que n’alliez-vous à deux rues de votre maison ? Rien ne vous eût empêché de regarder votre belle-sœur qui, à l’exemple de cent autres femmes que vous connaissez, et dont chacune est à la fois peintre, original et portrait, se met du blanc et du rouge sur le front et sur les joues, du noir au coin des yeux, du bleu pour faire ressortir certaines veines, et se passe des anneaux dans les oreilles, comme vos femmes sauvages s’en mettent dans le nez. En quoi est-il beaucoup plus drôle de percer un cartilage qu’un autre, et cela vaut-il d’aller si loin ?
Je sais bien que vous verrez là-bas des escrocs et des courtisanes, des imbéciles, des hypocrites, des orgueilleux, des égoïstes, des envieux, des mendiants, mais n’avez-vous donc pas remarqué qu’il y en a également quelques-uns ici ?
Ou bien est-il si difficile d’avoir en ce pays-ci ou faim ou soif, ou trop chaud ou trop froid, que vous pensez à aller ainsi au loin.
Est-il quelque peste, ou quelque fièvre, ou quelque lèpre inconnue à notre pays, que vous sentiez le besoin d’avoir ?
Ou êtes-vous si ennuyé des mouches qui nous impatientent ici l’été, que vous fassiez deux mille lieues pour être piqué par des moustiques ?
Tout à vous.
Lettre III. Stephen
J’ai encore songé, presque toute cette nuit, à vous et à vos voyages, et j’en suis arrivé à ne plus vous comprendre. Connaissez-vous donc bien ces mouches qui brillent et bourdonnent autour de vous, ces fleurs qui s’épanouissent et parfument l’air, ces oiseaux qui chantent, ces feuilles qui frémissent, cette eau qui murmure ? les avez-vous tous regardés chacun une fois seulement, et chacune des parties qui les composent ? les avez-vous suivies de leur naissance à leur mort ? avez-vous vu leurs amours et leurs hyménées, avant d’aller au loin voir des choses que vous n’avez pas vues ? Pour moi, j’ai eu ce matin une grande joie dont je vais vous faire part.
J’ai acheté, il y a trois ans, un tapis ruineux pour le mettre dans mon cabinet de travail ; c’est ainsi que j’appelle une chambre assez bien arrangée, où je m’enferme parfois pour ne rien faire et ne pas être interrompu. Ce tapis représente des feuillages d’un vert sombre parsemés de grandes fleurs rouges. Hier, mes yeux sont tombés sur mon tapis, et je me suis aperçu que les couleurs en étaient fort passées, que le vert en est devenu d’un verdâtre assez laid, que le rouge est fané d’une manière déplorable, et que la laine est râpée et montre la corde sur tout l’espace qui conduit de la porte à la fenêtre, et de la fenêtre à mon fauteuil au coin de ma cheminée. Ce n’est pas tout ; en dérangeant une énorme et pesante table de bois sculpté, j’ai fait un accroc au tapis. Tout cela m’a effrayé à un certain point ; j’ai fait recoudre la déchirure, mais je n’ai pu rendre la fraîcheur au feuillage ni l’éclat aux fleurs rouges. Mais ce matin, en me promenant au jardin, je me suis arrêté devant la pelouse qui en est à peu près le milieu.
À la bonne heure ! me suis-je dit, voilà un tapis comme je les aime ; toujours frais, toujours beau, toujours riche. En effet il m’a coûté soixante livres de graines de gazon, à cinq sous la livre, c’est-à-dire quinze francs, et il est à peu près du même âge que celui de mon cabinet, qui m’a coûté cent écus. Celui de cent écus n’a subi que de tristes changements ; il est aujourd’hui pauvre, et plus pauvre qu’un autre de toute sa splendeur ternie, râpé, honteux, rapiécé. Celui-ci devient chaque année plus beau, plus vert, plus touffu. Et avec quel luxe il change et se renouvelle ! Au printemps, il est d’un vert pâle et semé de petites marguerites blanches et de quelques violettes. Un peu après, le vert devient plus foncé, et les marguerites sont remplacées par des boutons-d’or vernissés. Aux boutons d’or succèdent les trèfles rose et blanc. À l’automne, mon tapis prend une teinte un peu jaune, et au lieu du trèfle rose et du trèfle blanc, il est semé de colchiques qui sortent de terre comme de petits lis violets. L’hiver, il est blanc de neige à éblouir les yeux. Puis, au printemps, comme dans l’automne, on a quelquefois marché et dansé dessus, comme il est un peu écrasé, déchiré, il se raccommode de lui-même, de telle façon qu’on ne peut plus retrouver ses blessures ni même leurs cicatrices ; pendant que mon autre tapis reste là avec ses éternelles fleurs rouges, qui ne font qu’enlaidir chaque jour, et avec ses déchirures mal recousues.
Mon Dieu ! que je suis donc riche !
M’écrirez-vous comme vous me l’avez promis ? Moi, je vous écrirai mon voyage ; je ne sais trop où vous l’envoyer, vos lettres me diront où et quand je puis le faire. Mais qu’allez-vous donc voir là-bas que vous ne puissiez voir ici ? Je vais essayer de me décrire, comme de votre part, quelque pays lointain. Voyons :
« Le ciel est gris comme une lourde coupole de plomb, la terre est couverte d’un linceul de neige ; les arbres livrent aux vents aigres leurs noirs squelettes ; à leurs pieds naissent et végètent les champignons vénéneux ; les fleurs sont mortes ; l’eau glacée est immobile entre ses rivages sans herbe. Ceux qui tiennent absolument à appeler les fontaines des miroirs ou les bergères contemplent leurs naïfs attraits et arrangent leur simple parure, ceux qui ne voient dans la nature que ce qu’ils ont lu préalablement dans les livres, sont obligés de dire que leurs poétiques miroirs sont tournés du côté du vif argent. Quelques sapins, dans leur feuillage triste et sombre, donnent asile seulement à quelques oiseaux muets et hérissés par le froid, qui se disputent affamés les fruits laissés sur les arbres sans feuillage, les baies pourpres de l’aubépine, les baies écarlates des sorbiers, les baies orange du buisson-ardent, ou celles noires du troène, ou bleuâtres du laurier thym.
« Il n’y a dans l’air ni chant d’oiseaux, ni bourdonnement d’insectes, ni parfum de fleurs.
Le soleil ne reste chaque jour que quelques heures à l’horizon ; il se lève et se couche dans de pâles et tristes lueurs. »
Quel est ce pays ? Si c’était vous, mon bon ami, qui m’écrivissiez ces lignes, vous appelleriez ces tristes climats la Norvège avec ses neiges et ses glaces. Pour moi, ce pays c’est mon jardin l’hiver, c’est mon jardin dans six mois ; je n’ai qu’à attendre.
Je n’ai pas besoin non plus d’aller chercher à travers mille dangers, et, qui pis est, mille ennuis, les riches pays où l’on adore le soleil ; j’attendrai quelques jours, et le soleil me fera chercher l’ombre et la fraîcheur. Il y aura des instants où les fleurs se pencheront languissamment, où on n’entendra dans les herbes séchées que les cris monotones de la sauterelle, où l’on ne verra dehors que les lézards.
Alors les nuits seront fraîches, douces et embaumées ; les arbres en fleurs et pleins de rossignols exhaleront des parfums et des mélodies célestes. Dans les gazons brilleront les lucioles, les vers luisants comme des violettes de feu.
Vous m’écrirez tout cela de quelque contrée de l’Amérique ; moi, je vous l’écrirai après-demain de mon jardin. Les saisons qui se renouvellent sont les climats qui voyagent et qui me viennent trouver. Vos longs voyages ne sont que des visites fatigantes que vous allez rendre aux saisons, qui d’elles-mêmes seraient venues à vous. Mais il est un autre pays, une ravissante contrée qu’on chercherait en vain sur les flots de la mer ou à travers les montagnes. En cette contrée, les fleurs n’exhalent pas seulement de suaves parfums, mais aussi d’enivrantes pensées d’amour. Chaque arbre, chaque plante y conte, dans un langage plus noble que la poésie et plus doux que la musique, des choses dont aucune langue humaine ne saurait même donner une idée. Le sable des chemins est d’or et de pierreries ; l’air est rempli de chants auprès desquels ceux des rossignols et des fauvettes que j’entends aujourd’hui me semblent des coassements de grenouilles dans leurs marais fangeux. L’homme y est bon, grand, noble et généreux.
Toutes les choses y sont au rebours de celles que nous voyons chaque jour ; tous les trésors de la terre, toutes les dignités réunies seraient un objet de risée si on venait les offrir en échange d’une fleur fanée ou d’un vieux gant oublié sous une tonnelle de chèvrefeuille.
Mais qu’est-ce que je vous parle de chèvrefeuille ! Pourquoi suis-je forcé de donner les noms de fleurs que vous connaissez aux fleurs de ces charmantes régions. Dans ce pays, on ne croit ni à la perfidie, ni à l’inconstance, ni à la vieillesse, ni à la mort, ni à l’oubli qui est la mort du cœur. L’homme n’y a besoin ni de sommeil, ni de nourriture ; d’ailleurs un vieux banc de bois est là mille fois plus doux que l’édredon ailleurs ; le sommeil y est plus calme et plus rempli de rêves charmants. L’âpre prunelle des haies, le fruit fade des ronces y ont une saveur si délicieuse, qu’il serait ridicule de les comparer aux ananas des autres régions. La vie y est plus douce que les rêves n’osent l’être dans les autres pays. Allez donc chercher ces poétiques contrées !
Hélas ! en réalité, c’était un mauvais petit jardin dans un affreux quartier, quand j’avais dix-huit ans, quand j’étais amoureux, et quand celle que j’aimais y venait, un instant, au coucher du soleil.
… J’ai si longtemps aiméUn tout petit jardin sentant le renfermé.
Et d’ailleurs, ne faisons-nous pas dans la vie un voyage terrible et sans relâche ? N’est-ce donc rien que d’arriver successivement à tous les âges, d’y prendre et d’y laisser quelque chose ? Tout ce qui nous entoure ne mange-t-il pas chaque année ? Chaque âge n’est-il pas un pays ? Vous avez été enfant, vous êtes jeune homme, vous deviendrez vieillard. Croyez-vous trouver entre deux peuples, quelque éloignés qu’ils soient l’un de l’autre, autant de différences qu’entre vous enfant et vous vieillard ?
Vous êtes dans l’enfance ; l’homme y a les cheveux blonds, le regard assuré et limpide, le cœur allègre et joyeux ; il aime tout, et tout semble l’aimer ; tout lui donne quelque chose, et tout lui promet bien plus encore.
Il n’y a rien qui ne lui paie un tribut de joie, rien qui, pour lui, ne soit un jouet. Les papillons dans l’air, les bluets dans les blés, le sable des rivages, la luzerne des champs, les allées vertes des bois, tout lui donne des plaisirs, tout lui promet tout bas des bonheurs mystérieux.
Vous arrivez à la jeunesse ; le corps est souple et fort, le cœur noble et désintéressé. Là, vous brisez violemment vos jouets de l’enfance ; vous souriez avec amertume de l’importance que vous y avez attachée, parce que vous trouvez alors de nouveaux jouets que vous traitez avec le même sérieux ; c’est le tour de l’amitié, de l’amour, de l’héroïsme, du dévouement, vous avez tout cela en vous, vous le cherchez chez les autres. Mais ce sont des fleurs qui se fanent, et elles ne fleurissent pas en même temps dans tous les cœurs. Chez celui-ci, elles ne sont qu’en bouton ; chez celui-là, elles sont depuis longtemps passées. Vous réclamez hautement l’accomplissement de vos désirs, comme vous réclameriez de saintes promesses. Il n’y a pas une fleur, pas un arbre qui ne vous semble vous avoir trahi.
Mais vous voici arrivé à la vieillesse. On y a les cheveux gris ou blancs, ou une perruque ; les belles fleurs dont nous parlions y portent leurs fruits inattendus : l’incrédulité, l’égoïsme, la défiance, l’avarice, l’ironie, la gourmandise. Vous riez des jouets de la jeunesse, parce que vous en trouvez là encore d’autres que vous prenez encore au sérieux : les places, les croix, les cordons de diverses couleurs, les honneurs, les dignités.
Car il ne sert de rien à l’homme qu’il vieillisse,
À chaque âge, il arrive ignorant et novice,
Sur nos derniers hivers et sur notre âge éteint,
La sagesse versant une lumière pâle,
Brille comme la lune aux doux rayons d’opale,
Aux heures de la nuit où l’on ne fait plus rien.
Les jours et les années sont des traits que la mort nous lance. Elle vous a réservé ses plus pénétrants pour la vieillesse ; les premiers ont tué successivement vos croyances, vos passions, vos vertus, vos bonheurs. Maintenant, elle tire à mitraille ; elle a abattu vos cheveux et vos dents, elle a blessé et affaibli vos muscles, elle a touché votre mémoire, elle vise au cœur, elle vise à la vie.
Alors tout vous est ennemi — dans la jeunesse, les belles nuits d’été vous apportaient des parfums, des souvenirs, de ravissantes rêveries ; elles n’ont plus pour vous que des rhumes et des pleurésies.
Vous haïssez les gens qui sont plus jeunes que vous, parce qu’ils doivent hériter de votre argent ; ils héritent déjà de votre jeunesse, de vos croyances, de vos rêves, de tout ce qui est déjà mort en vous.
Les hommes, presque tous, ne savent pas vieillir
Et, comme certains fruits, pourrissent sans mûrir.
Dites-le moi, sommes-nous aujourd’hui ce que nous étions hier, ce que nous serons demain ? N’avons-nous pas à faire sur nous-mêmes, chaque jour, de singulières observations ? Ne nous offrons-nous pas à nous-mêmes un spectacle curieux ?
Allons, je commencerai mon voyage demain, et je me mettrai en route ; car je finirais par trouver que c’est encore trop se donner de mouvement que de faire le tour du jardin.
Vale.
Lettre IV
Je suis en route, mon bon ami, et deux choses déjà m’embarrassent. D’abord, je ne sais pas bien à quelle distance précise du point de départ il faut être, pour avoir le droit de se servir dans le récit de ce prétérit emphatique qui donne tant d’importance aux voyageurs : Nous partîmes, nous cinglâmes, nous vîmes, nous aperçûmes, nous bûmes, etc.
Ai-je bien le droit d’employer ce langage qui est la vraie langue des voyages ? Et si je ne l’emploie pas, mon voyage sera-t-il un vrai voyage ?
Seconde difficulté : dans les récits que, sans doute, vous me faites en même temps que j’écris pour vous mes voyages, vous avez sur moi un avantage inappréciable. Si à quelque narration un peu extraordinaire, à quelque description surnaturelle, je m’avise d’un oh ! oh ! ou d’un geste d’incrédulité ou même d’admiration mêlée de défiance, vous me répondrez : Allez y voir ! C’est à trois mille lieues d’ici. Vous savez bien que je ne le ferai pas. Si, au contraire, je vous étonne par quelque chose d’inusité ou de prodigieux, je n’ai pas la même ressource ; je ne puis que vous dire : Regardez vous-même, c’est à droite ou à gauche, c’est sur ce rosier qui est au bout de l’allée, ou c’est sur cette pervenche qui est à vos pieds ; ou, dérangez-vous un peu, ce que je vous raconte est dans la mousse sur laquelle vous marchez : vous écrasez ma preuve. Je n’ai donc à vous dire que la vérité, tandis que vous, persuadé qu’on croit toujours que les voyageurs mentent, vous ne vous renfermerez pas dans une vertu qui ne vous rapporterait aucun honneur, et qui vous ferait simplement accuser de sécheresse et de pauvreté d’imagination.
J’ai vu votre costume de voyage, mon cher ami ; je vous dois la description du mien : c’est une vieille robe de chambre de velours noir que vous me connaissez, avec un bonnet pareil et des pantoufles de maroquin jaune ; je ne suis point armé.
Je sors de mon cabinet de travail à six heures moins un quart ; le soleil monte à l’horizon ; ses rayons scintillent comme une poussière de feu à travers les feuilles de grands sorbiers, et viennent colorer ma maison d’une teinte douce mêlée de rose et de safran ; je descends trois marches :
Nous voici en Chine.
Vous m’arrêtez à mon premier pas avec un sourire de dédain. Ma maison est entièrement tapissée par une glycine. La glycine est un arbrisseau grimpant et sarmenteux qui a un feuillage à peu près semblable à celui des acacias, et duquel pendent de nombreuses et grandes grappes de fleurs d’un bleu pâle, qui exhalent la plus suave odeur. Cette magnifique plante vient de la Chine : peut-être l’admirez-vous là-bas quand je la contemple ici.
Je ne crois pas exagérer, même pour vous, quand je vous dirai que je trouve cela mille fois plus beau que les plus riches palais, cette maison de bois toute verte, toute fleurie, toute parfumée, qui, tous les ans a plus de verdure, plus de fleurs et plus de parfums.
Sous le toit qui avance est un nid de roitelet, un tout petit oiseau ou plutôt une pincée de plumes brunes et grises comme celles d’une perdrix, qui court sur les vieux murs et fait de mousse et d’herbe un nid qui a la forme d’une bouteille. Je te salue, petit oiseau, qui seras mon hôte pour cette année ! sois le bienvenu dans ma maison et dans mon jardin ! soigne et élève ta nombreuse famille, je te promets paix et tranquillité ; on respectera ton repos, et surtout ta confiance. Il y a de la mousse là-bas, auprès de la fontaine, et dans les allées des brins d’herbe de la pelouse récemment fauchée. Le voilà sur le bord de son nid, il me regarde avec ses beaux yeux noirs ; il a peur, mais il ne se sauve pas.
Le petit roitelet n’est pas le seul hôte de ma vieille maison.
Entre les solives, l’intervalle est rempli par des moellons et du plâtre. Sur la façade, qui est exposée au midi, il y a un trou dans lequel vous ne feriez pas entrer le tuyau d’une plume : c’est encore là une demeure, c’est encore là un nid ; il appartient à une sorte d’abeille qui vit solitaire. Voyez-la revenir de la provision ; ses pattes postérieures sont chargées d’une poussière jaune qu’elle a prise sur les étamines des fleurs ; elle entre dans ce trou : quand elle en sortira, elle n’aura plus de pollen aux pattes ; avec du miel qu’elle sait dégorger, elle en aura au fond de son nid fait une pâtée savoureuse.
Voici peut-être son dixième voyage d’aujourd’hui, et elle n’est pas près de se reposer.
Tous ces soins sont pour un œuf qu’elle a pondu, pour un œuf qu’elle ne verra jamais éclore ; d’ailleurs, ce qui sortira de cet œuf, ce n’est pas une mouche comme elle, c’est un ver qui ne se métamorphosera en mouche que quelque temps après.
Cependant elle l’a caché dans un trou, et elle sait précisément de combien de nourriture il aura besoin pour arriver à l’état d’accroissement qui précède la transformation en mouche. Cette nourriture, elle va la chercher, et elle l’assaisonne et la prépare. La voici partie.
Mon Dieu ! quelle est donc cette autre petite mouche si brillante qui marche sur la maison ? Son corselet est vert et son abdomen est d’un rouge de pourpre ; mais ces deux couleurs sont si éclatantes, que je suis fâché de n’avoir pas de mots plus splendides pour les exprimer que les noms d’une émeraude et d’un rubis joints ensemble.
Cette jolie mouche, cette pierrerie vivante, s’appelle chrysis. J’ose à peine respirer dans la crainte de la faire envoler ; je voudrais la tenir dans les mains pour être sûr de la voir plus longtemps.
C’est aussi une mère de famille ; elle aussi doit pondre, d’où sortira un ver qui deviendra une mouche semblable à elle, mais qu’elle ne verra jamais.
Elle aussi, elle sait la nourriture qu’il faudra à son enfant ; mais, plus richement vêtue que l’abeille, elle ne sait pas comme elle ramasser le pollen des fleurs ni en faire une pâte avec du miel.
Elle n’a qu’une ressource, et cette ressource, elle est déterminée à l’employer ; elle ne reculera ni devant la fourberie ni devant le vol pour assurer la subsistance de son enfant ; elle a reconnu l’abeille solitaire ; elle va pondre dans son nid ; son œuf à elle doit éclore plus tôt que celui de la véritable propriétaire : alors l’intrus mangera les provisions si péniblement amassées pour l’enfant légitime qui, lorsqu’il naîtra à son tour, n’aura plus qu’à mourir de faim.
La voici au bord du trou ; elle hésite ; elle se décide ; elle entre.
Elle m’intéresse ; elle est si belle ! L’autre aussi m’intéresse ; elle est si laborieuse ! Mais la voici qui revient à travers les airs : on dirait un guerrier couvert d’armes ciselées et d’une cuirasse dorée ; elle bourdonne. La chrysis a entendu ce bourdonnement, qui est pour elle le son terrible de la trompette guerrière. Elle veut s’enfuir, elle sort ; mais l’autre, justement irritée, se précipite sur elle et la frappe de sa tête. Elle froisse et déchire la gaze miroitante de ses ailes, et la jette sur le sable, où elle tombe étourdie et inanimée. L’abeille entre alors dans son nid, dépose et prépare ses provisions ; puis, encore émue de son combat et de sa victoire, elle repart à travers les airs. Longtemps je la suis des yeux, mais enfin elle disparaît.
La pauvre chrysis n’est cependant pas morte ; elle se relève, se secoue, se trémousse, essaie de s’envoler ; mais ses ailes lacérées ne le lui permettent plus. Comment fera-t-elle alors pour échapper à la fureur de son ennemie ?
Il ne s’agit pas pour elle de s’enfuir ; il s’agit de déposer son œuf dans le nid de l’abeille et d’assurer l’avenir de son petit, car l’abeille est revenue trop vite Elle monte en gravissant péniblement : par moments les forces lui manquent ; elle est forcée de s’arrêter ; mais enfin elle arrive elle entre elle est entrée ! Cette fois, l’intérêt est pour elle. Tout à l’heure elle n’était que belle, maintenant elle est bien malheureuse ! Je sais qu’on pourrait faire une longue plaidoirie pour l’autre ; je ne voudrais pas avoir à les juger. Ah ! elle ressort elle s’enfuit ! Mais elle est heureuse, elle a réussi ! Maintenant je me sens fort touché pour l’abeille.
La pauvre abeille continue à apporter des provisions pour son enfant, qui cependant mourra de faim ; elle fait de nouveaux voyages aux fleurs qu’elle aime ; elle va se poser sur les chatons du saule, sur les fleurs blanches de l’arbousier, ce bel arbre toujours vert dont les fleurs ressemblent à celles du muguet, et dont les fruits sont des fraises ; elle s’arrête aussi sur les fruits de l’if, ce pauvre arbre si tourmenté dans les jardins, dont on a fait des boules, des carrés, des vases, des cigognes ; arbre bon enfant, qui se prête à tout, et dont naturellement on a tant abusé.
Si je voulais regarder l’un après l’autre et suivre toutes les mouches qui brillent au soleil sur ma maison, les insectes qui se cachent dans les fleurs de la glycine pour en sucer le miel, et les insectes qui s’y insinuent pour manger ceux-ci ; les chenilles qui rampent sur les feuilles, et les ennemis de ces chenilles et de ces papillons ; vous dire leur naissance, leurs amours, leurs combats, leurs métamorphoses ; peut-être seriez-vous revenu avant que j’eusse fait un pas : mais je ne veux dans ce voyage m’arrêter qu’aux choses qui frapperont ma vue, sans recherches, sans travail, sans étude. Quittons donc la vieille maison de bois, et suivons au hasard cette allée tortueuse.
Voici la julienne blanche avec ses longs rameaux de fleurs : pour jouir de son parfum, il faut se pencher sur elle : ce n’est que le soir qu’elle l’exhale au loin. Cette fleur était une des fleurs préférées de la malheureuse reine Marie-Antoinette. Elle fut renfermée dans la plus mauvaise chambre de la Conciergerie : c’était une chambre humide et infecte. Là, dans la même pièce, un gendarme, dont elle n’était séparée que par un paravent, ne la quittait ni jour ni nuit. La reine n’avait pour vêtement qu’une vieille robe noire et des bas qu’elle ôtait, restant les jambes nues, pour les raccommoder elle-même. Je ne sais si j’aurais aimé Marie-Antoinette, mais comment ne pas adorer tant de misère et de malheur ! Une femme, son nom n’est pas assez connu, une bonne, une excellente femme, trouva un bonheur et un luxe à donner à celle qu’il était défendu de nommer autrement que veuve Capte. Madame Richard, concierge de la prison, lui apportait chaque jour des bouquets des fleurs qu’elle aimait : des œillets, des juliennes, des tubéreuses. Elle changeait ainsi en parfums les miasmes putrides de la prison. La pauvre reine avait autre chose à regarder que les murs humides de son cachot. Madame Richard fut dénoncée, arrêtée et mise en prison ; mais on n’osa pas cependant la poursuivre davantage pour sa sainte idée, et on la relâcha.
Plus tard, Danton dans son cachot, s’écriait : « Ah ! si seulement je pouvais voir un arbre ! »
La julienne reste la fleur de Marie-Antoinette ; aux deux autres se rattachaient déjà des souvenirs plus anciens.
Le grand Condé, détenu à Vincennes, cultivait des œillets.
L’odeur des tubéreuses passait autrefois pour être mortelle aux femmes en couches. Mademoiselle de la Vallière, étant encore fille d’honneur, se trouvait dans ce cas ; la reine qui avait quelques soupçons, devait le lendemain passer par son appartement, où elle avait prétexté une indisposition pour rester couchée. Mademoiselle de la Vallière fit remplir sa chambre de tubéreuses.
Vale.
Lettre V. Sur un rosier
J’ai failli ne pas m’arrêter devant ce rosier : j’aime beaucoup voir les roses, mais je n’aime pas en parler. On a tant abusé des roses ! Les Grecs ont dit cinq ou six jolies choses sur les roses ; les Latins ont traduit ces six jolies choses et y en ont ajouté trois ou quatre. Depuis ce temps, les poètes de tous les pays et de toutes les époques ont traduit, copié et imité ce qu’avaient dit les Grecs et les Latins, sans rien ajouter de leur cru. Ils ont même continué à appeler le mois de mai le mois des roses, sans songer que les roses fleurissent plus tôt en Grèce et en Italie que dans nos pays, où presque toutes les roses attendent le mois de juin pour s’épanouir.
N’êtes-vous pas ennuyé comme moi des amours éternelles du papillon et de la rose, amours qui du reste ne sont pas vraies ? Les papillons se posent sur les roses comme sur toutes les fleurs, mais la rose est loin d’être une des fleurs qu’ils préfèrent. N’êtes-vous pas ennuyé, comme moi, des teints de lys et de rose dont on affuble les femmes ce qui serait hideux ? N’êtes-vous pas ennuyé comme moi des belles qui sont des roses ; en un mot de toutes les fadeurs, de toutes les sottises dont ces pauvres roses ont été le prétexte ? Je trouve honteux que nos poètes ne connaissent pas mieux la nature et toutes les splendeurs éternelles dont Dieu a doté notre séjour. Je n’en sais presque pas un qui n’ait montré, par la manière dont il parle et des fleurs, et des arbres, et de l’herbe, qu’il n’a jamais pris la peine de les regarder. Écoutez-les : ils se renferment dans trois ou quatre généralités banales qu’ils ont lues et qu’ils répètent en synonymes.
Ce sont des prairies émaillées de fleurs.
De quelles fleurs ? de quelles couleurs sont-elles ? Et au printemps, et à l’automne, tout cela ne change jamais. Quelques-uns plus audacieux disent qu’elles sont de mille couleurs.
Les bords fleuris des ruisseaux !
Sont-ce les mêmes fleurs que celles qui émaillent les prairies ? On n’en sait pas davantage. Le zéphyr qui se joue dans des bosquets ; le même zéphyr caresse la rose à demi éclose.
Ceux qui écrivent en vers ne connaissent que la rose à demi éclose, à cause de la rime. Un novateur, il y a quatre cents ans, a risqué fraîche éclose ; et on s’en est tenu là.
Tenez, voyez là-bas, d’un beau feuillage aigu comme des épées, voyez s’élever une longue tige portant d’un seul côté un bel épi de fleurs roses ou blanches, c’est un glaïeul. Les poètes en parlent quelquefois, mais ils n’en savent qu’une chose, c’est que cela rime à tilleul : ils ne manquent jamais de les réunir, de mettre des glaïeuls sous les tilleuls, ce que je ne ferais pour rien au monde dans mon jardin ; mes pauvres glaïeuls s’en trouveraient fort mal. C’est un grand bonheur qu’ils ne mettent pas les tilleuls sous les glaïeuls ; cela rimerait aussi bien.
Revenons à la rose. Nous ne l’appellerons pas Reine des fleurs : nous éviterons tous les lieux communs dont elle a été l’objet et dont elle a triomphé ; regardons-la seulement, et disons ce que nous voyons. Il n’est pas de pays qui ne possède des roses, depuis la Suède jusque sur les côtes d’Afrique ; depuis le Kamtchatka jusqu’au Bengale, jusque sur les montagnes du Mexique, la rose fleurit dans tous les climats, dans tous les terrains ; c’est une des grandes prodigalités de la nature.
Le rosier devant lequel nous nous arrêtons est couvert de fleurs blanches.
D’autres ont des fleurs depuis le rose le plus pâle jusqu’au cramoisi et au violet foncé, depuis le blanc jaunâtre jusqu’au jaune le plus éclatant et à la couleur capucine. Le bleu est la seule couleur que la nature lui ait refusée. Il y a très peu de fleurs bleues.
Le bleu pur est un privilège qu’à quelques exceptions près, elle n’a accordé qu’aux fleurs des champs et des prairies. La nature est avare de bleu : le bleu est la couleur du ciel, elle ne la donne qu’aux pauvres, qu’elle aime avant tous les autres.
Les botanistes, qui ne font aucun cas, ni de la couleur, ni des parfums, prétendent que les roses doubles sont des monstres. Comment appellerons-nous les botanistes ? Nous ne finirons pas ce voyage sans nous arrêter un peu aux botanistes.
Ce rosier a été un rosier sauvage, un églantier qui se couvrait, dans quelque coin d’un bois, de petites roses simples, composées chacune de cinq pétales. Un jour, on lui a coupé la tête et les bras, puis on a fendu la peau d’un des moignons qu’on lui avait laissés. Entre l’écorce et le bois on a glissé un petit morceau d’écorce d’un autre rosier, sur lequel était un bourgeon à peine indiqué.
Depuis ce jour, toute sa force, toute sa sève, toute sa vie, sont consacrés à nourrir ce bourgeon. La blessure s’est fermée, mais on voit encore la cicatrice. L’églantier n’a plus de fleurs à lui, c’est un esclave qui travaille pour un maître superbe. Cette belle touffe de feuilles, de fleurs, ce ne sont ni ses feuilles ni ses fleurs.
Prenez garde cependant ; voici, sur sa tige verte, au-dessous de la greffe, un bourgeon rose qui commence à poindre. Ce bourgeon deviendra une branche ; cette branche lui appartient. Oh ! alors la nature a repris tous ses droits, le tyran qui est en haut le beau rosier, le rosier cultivé, attend en vain le tribut qu’on lui a payé jusqu’ici ; la sève ne monte plus jusqu’à lui, elle est pour ce cher rejeton ; il n’y en a pas trop pour lui.
Mais le jardinier s’est aperçu de cette tentative de rébellion ; il a coupé le prétendant, et tout est rentré dans l’ordre. Cependant, quelques jours après, de nouveau la tête du rosier s’alanguit, la pourpre du roi se décolore, le feuillage jaunit et se fane, et pourtant la tige de l’églantier est lisse et unie. Cherchez bien, le pauvre esclave est ingénieux et obstiné ; il a glissé sous la terre un drageon, et c’est loin de là qu’il lui a permis de voir le jour. Allez à deux pas, à trois pas ; derrière cette giroflée, dans le silence et à l’ombre, s’élève un petit rosier. Il ressemble à ce qu’était son père ; comme lui, il a des tiges flexibles et des feuilles étroites. Attendez un an, et il deviendra un églantier. Froissez son feuillage, il exhale une odeur d’ananas particulière à une espèce d’églantier ; c’est ainsi qu’était son père quand il avait des branches et des feuilles à lui. Le voici en bouton, le voici en fleurs.
Mais le despote que nous avons laissé là-bas est mort, et d’une mort horrible : il est mort de faim. L’esclave révolté qui le portait a conduit depuis longtemps par-dessous terre toute sa sève à son fils bien-aimé. Cette belle couronne de roses doubles s’est desséchée ; lui-même, son esclave, est malade et mourra bientôt, car il n’a rien gardé pour lui ; mais il meurt libre, il meurt vengé. Il laisse un rejeton jeune, fort et vigoureux, sur lequel s’épanouiront les petites églantines des bois.
Notre rosier blanc n’est pas dans cette situation : l’églantier qui le porte et le nourrit paraît s’être résigné à son sort, bien plus, on le dirait fier de son esclavage. Il y a bien d’autres esclaves que lui qui ne pensent plus à rompre leurs chaînes quand elles sont dorées. Notre églantier semble s’enorgueillir de sa belle couronne.
Mais quelle émeraude se cache dans le cœur de la rose ! L’émeraude est vivante, c’est une cétoine ; c’est un insecte plat et carré, avec des ailes dures comme celles d’un hanneton, et éclatantes comme une pierre précieuse, retournez-le, son ventre est d’une couleur encore plus belle ; c’est une autre pierrerie, plus violette que le rubis, plus rouge que l’améthyste. La cétoine ne vit guère que dans les roses. Une rose est sa maison et son lit. Elle se nourrit de feuilles de roses ; quand elle a mangé sa maison, elle s’envole et en cherche une autre ; mais elle préfère les roses blanches à toutes les autres. Si, par hasard, vous la trouvez sur une autre rose, c’est un grand hasard ; elle y est mal logée, mal couchée. Elle doit vous inspirer la pitié que vous ferait ressentir un banquier ruiné, obligé de demeurer au quatrième étage, et de manger, pour tout festin, la soupe et le bouilli ; elle en est triste et humiliée, mais il faut bien vivre. Il y a des gens qui se résignent à pis que cela.
Une vingtaine de mouches, d’espèce et de couleur différentes, sont posées sur différentes parties du rosier, mais je n’y fais aucune attention ; elles sont là par hasard, elles voyagent comme vous, elles flânent comme moi. Je ne m’occupe que des naturels du pays, je retrouverai les autres ailleurs ; nous ne sommes pas encore près de quitter notre rosier, car voici qu’il s’y passe d’étranges choses.
Où êtes-vous, mon bon ami ? Je n’en sais rien, mais je doute fort que le pays où vous êtes arrêté soit aussi riant que mon rosier : que ses habitants soient aussi jolis, aussi brillants, aussi heureux surtout que les habitants de mon rosier ; et n’est-ce rien que de voir des êtres heureux ? Mais, à coup sûr, vous n’y voyez rien d’aussi extraordinaire que ce que je vois en ce moment.
À l’extrémité des jeunes pousses du rosier sont des myriades de très petits insectes, d’un vert un peu rougeâtre, qui couvrent entièrement la tige et semblent immobiles ; ce sont des pucerons qui sont nés à une ligne ou deux de l’endroit où ils sont aujourd’hui, et qui ne s’aventurent pas à faire un pouce de chemin dans toute leur vie. Ils ont une petite trompe qu’ils enfoncent dans l’épiderme de la branche, et au moyen de laquelle ils sucent certains sucs dont ils se nourrissent. Ils ne mangeront pas le rosier, ils sont plus de cinq cents rassemblés sur un pouce de tige ; et ni les feuilles ni la branche ne paraissent en souffrir beaucoup. Presque chaque plante est habitée par une espèce de pucerons différente des autres :
Ceux du sureau sont d’un noir velouté, ceux des abricotiers sont d’un noir vernissé, ceux du chêne sont couleur de bronze, ceux des groseilliers sont nacrés ; il y en a sur l’absinthe qui sont tachés de blanc et de brun, sur l’oseille des champs, de noir et de vert, sur le bouleau, de noir et d’une autre nuance de vert, sur le troène, d’un vert presque jaune, sur le poirier, couleur de café.
Tous ont une vie aussi calme. On a peine à rencontrer un puceron assez inquiet, assez vagabond pour passer d’une branche sur l’autre. On en voit quelquefois s’emporter au point de faire le tour de la branche qu’ils habitent, mais tout porte à croire que c’est dans l’effervescence d’une jeunesse orageuse, ou sous l’empire de quelque passion ; ces débordements sont extrêmement rares. Quelques-uns, cependant, ont des ailes, mais ces ailes ne leur viennent que dans un âge mûr, et ils n’en abusent pas. Le seul soin sérieux qui paraisse occuper la vie des pucerons, est de changer de vêtement. Ils changent, en effet, de peau quatre fois avant d’être des pucerons parfaits ; à peu près comme nous autres hommes nous essayons d’habitude deux ou trois caractères avant de nous fixer à un, quoique d’ordinaire on en garde trois toute sa vie : un que l’on montre, un que l’on croit avoir, un que l’on a réellement.