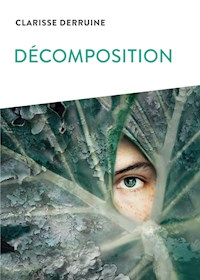
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ker
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Ce printemps-là, il se passe des choses étranges : les mauvaises herbes se répandent dans les rues, la mousse s’immisce dans les jointures, les champignons quittent leurs sous-bois…
Bientôt, les premiers murs s’effondrent.
Silvio assiste, impuissant, à la dissolution de sa ville, de sa famille et de ses liens avec les autres. Alors que sa sœur s’efforce de reconstruire, il tente de comprendre ce qui les attend. Si les immeubles s’écroulent en même temps que les esprits, que restera-t-il à sauver ?
Comment accepter de perdre un monde pour en construire un nouveau ?
Un conte à la fois tragique et merveilleux, subtil constat de la déliquescence d’un univers familier, sur fond de révolution végétale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 176
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Avant-propos
Clarisse Derruine est lauréate du prix Laure Nobels1 2020-2021.
Elle a terminé l’écriture de ce roman à l’âge de 24 ans.
Avec grande écoute et subtilité, l’auteure a parachevé son texte initial sur la base des conseils judicieux du jury adulte de la Fondation Laure Nobels, de Fidéline Dujeu, Isabelle Blockmans, Claude Nobels et Xavier Vanvaerenbergh. Nous les en remercions chaleureusement.
Nous adressons nos plus vives félicitations à Clarisse.
Le Conseil d’Administration de la Fondation Laure Nobels
1 La Fondation Laure Nobels finance la publication et la promotion d’œuvres littéraires en français, écrites par de jeunes auteurs belges. Pour déterminer les bénéficiaires, la Fondation soumet les manuscrits présentés par les jeunes à la lecture critique d’un jury indépendant. Composé d’experts en littérature, celui-ci évalue l’originalité et la qualité des textes proposés. Chaque année, un lauréat est récompensé par le Prix Laure Nobels. Les années impaires, celui issu du groupe des 15-19 ans, et les années paires, celui issu du groupe des 20-24 ans. Chaque année, un deuxième lauréat est récompensé par le Prix Jeune Public Brabant wallon de la Fondation Laure Nobels, créé en partenariat avec le Brabant wallon qui souhaite ainsi susciter l’écriture et promouvoir la lecture, notamment auprès des jeunes. Chaque prix consiste à introduire l’œuvre sur le marché de la littérature, selon toutes les normes professionnelles en vigueur dans le monde du livre. Plus d’infos : www.fondationlaurenobels.be
Pionniers
Je suis né dans les ruines encore debout d’une civilisation en disgrâce. J’ai grandi dans les mauvaises herbes qui grouillent à l’ombre des vestiges flamboyants, j’ai marché entre les tours rongées de soleil et de pluie, j’ai lutté sur les fondations pourries des géants. J’ai construit un monde et j’en ai abandonné un autre.
Ma sœur a toujours trouvé que j’en faisais trop.
Elle a peut-être raison.
1
Silvio avait huit ans la première fois qu’il fit le rapprochement entre l’état de son père et celui des murs. Dans les deux cas, c’était étrange et beau. Dans les deux cas, cela se propageait lentement à l’orée des regards, comme le font les mauvaises herbes. L’inhabituel devenu ordinaire sans un bruit. Était-il le seul à l’avoir remarqué ? Il ne posa pas la question, pas même à Solène. De manière générale, il préférait chercher les réponses par lui-même.
C’était le début du printemps et la ville se nimbait d’une texture de sous-bois. Des jours chauds et humides qui clouaient les habitants à l’ombre sur les tapis de mousse verte ; un air plus lourd et parfumé chaque nuit. Il semblait que jamais il n’y aurait plus belle époque à vivre pour un enfant de huit ans.
Par cette chaleur, les ruelles désertées résonnaient d’appels silencieux à les emprunter et à suivre leurs méandres jusqu’au bout, où l’asphalte meurt dans le brouillon vert et gris de la ville qui s’estompe. Mais comme chacun sait, une rue n’a pas de fin, elle sinue et se jette dans un boulevard qui ne cesse de s’enrouler sur lui-même. Le quartier regorgeait ainsi d’aventures cachées, du moins pour ceux qui savaient y débusquer les murets fourmillant de lézards et les ravins d’herbes sauvages. Pour les fins observateurs – et Silvio en était un – rien n’était semblable d’un coup d’œil à l’autre. Il partait sur les traces des modifications survenues depuis ses explorations de l’été passé : ici, un ruisseau – à peine un filet d’eau sale – serpentait entre les pavés disjoints ; là, un bouquet de fougères était apparu au fond d’une ruelle. Parfois, lorsque la brise ensoleillée soufflait sur les pavés, Solène quittait ses manuels et l’accompagnait, tanguante et délicate, quelques pas en arrière. Un œil noir sur quiconque regardait son frère de travers, un autre dans lequel dansaient les formules. Un troisième pour surveiller où elle posait les pieds lui aurait été utile. Elle trébuchait souvent.
Les journées coulaient lentement et chacune débordait sur la suivante. Des semaines, des mois pouvaient passer ainsi et se fondre les uns dans les autres jusqu’à ce qu’un jour, on s’aperçoive qu’une ère avait pris fin. Sans même avoir remarqué qu’elle avait commencé.
Ce printemps-là, Solène avait souvent accompagné Silvio dans ses explorations. Comme à son habitude, il ne posait pas de questions. Il ne lui demandait pas si elle souhaitait vraiment l’aider à établir son inventaire. Il ne cherchait pas à savoir si elle fuyait la maison, ni pourquoi. Il appréciait sa présence tranquille, son enthousiasme à gravir les talus, et les pensées qu’elle partageait avec lui, comme si une décennie ne les séparait pas. Comme si, en quittant la maison pour le suivre, Solène se débarrassait sur le pas de la porte de leurs dix ans d’écart pour les réenfiler au retour, quelques heures plus tard. Silvio en était heureux et pourtant, il sentait que cela ne durerait pas. Il y a des ères que l’on voit passer même quand on a huit ans.
Il était vrai qu’une telle différence d’âge ne sautait pas aux yeux, contrairement à l’air de famille. Ce n’étaient pas les cheveux clairs et courts de l’une, foncés et plein d’épis de l’autre, ni la démarche sautillante de Silvio, quand Solène déraillait deux fois par kilomètre. C’étaient les yeux, foncés comme la nuit. Et les traits du visage, sombres et aiguisés comme le fusain sur papier à grain épais. Les taches de rousseur, aussi, qui explosaient autour des narines en nuées de postillons solaires.
L’inventaire occupa Silvio plusieurs semaines, et jamais la préparation d’un exposé ne lui avait semblé si importante. Pourtant, il savait que l’école n’attendait guère plus qu’un résumé illustré des activités printanières de ses élèves – Jan qui raconterait les livres qu’il avait lus, et Julia qui parlerait de la piscine à vagues de son grand-père à la Capitale. Mais peut-être Silvio avait-il exagéré l’ampleur du travail afin de mobiliser l’attention et le temps de sa sœur. Ou peut-être aimait-il avoir trouvé une raison de déambuler dans tous les sens avec son cahier, comme s’il n’y avait rien de plus important que ce travail scolaire.
Autour de chez Silvio, les maisons alignaient leurs escaliers en colimaçon, leurs balcons de fer forgé et leurs châssis écaillés aux couleurs vives ; les façades étaient prévisibles comme un décor de théâtre usé. Au-delà de ce labyrinthe résidentiel, vers le cœur de la ville, la mer d’ardoise et de terre cuite des toitures laissait place à des bâtisses de plus en plus hautes et à des immeubles massifs. Silvio n’avait pas le droit de marcher seul aussi loin. Sa sœur, elle, s’y rendait tous les jours pour les cours. Solène lui avait certifié que là-bas, il y en avait beaucoup moins que dans leur quartier, mais elle ne savait pas observer. Pas comme lui. Car Silvio les trouvait partout.
Jusqu’à présent, il en avait répertorié une dizaine d’espèces, et chacune reposait, soigneusement décrite et dessinée, dans son cahier à spirales. Il en avait numéroté les pages et ses notes débordaient dans la marge : son écriture gigantesque d’enfant dévorait le papier, et il voulait que les cinquante derniers feuillets restent blancs – pour plus tard, quand une vraieaventure lui tomberait dessus et qu’il aurait besoin d’un vraijournal de bord.
En attendant, faute de péripéties, il traquait ces flaques organiques et rugueuses qui tachaient l’écorce et les pierres ; il les chassait dans les gouttières et les jointures. Ce n’était pas difficile : elles étaient partout, de toutes les formes, de toutes les couleurs. Tellement présentes qu’elles en devenaient invisibles.
Il y avait celles qui s’étiolaient en choux vert pâle, ridés et aplatis sur le bois spongieux. On aurait dit de minuscules nénuphars. Celles qui ressemblaient à des bulles de peinture jaune sale sur la pierre. D’autres qui recouvraient les troncs d’un manteau vert tendre, parsemées de microscopiques tourelles souples comme des antennes d’escargot. Celles qui se répandaient en mares de rouille épaisse et sableuse. Celles-là, il n’osait pas les toucher. Il y avait les poilues, les piquetées, les arachnéennes, les ramifiées blanches comme de la dentelle. Les rabougries qui se desséchaient au soleil, grises et dures comme du corail, et les cotonneuses, gonflées d’humidité. Il y avait des espèces colonisant allègrement les pavés de la place publique et d’autres, plus discrètes, qui s’épanouissaient dans l’ombre. Sa trouvaille préférée était de celles-là. Une forêt miniature, composée d’arbres tubulaires de quelques millimètres s’évasant en trompettes vers le ciel, qui ne poussaient qu’au creux des souches pourries et dans l’humus des coins ombragés.
L’inventaire progressait. Silvio repérait régulièrement d’autres espèces à répertorier et de nouvelles terres à explorer. Solène l’aidait à écrire les mots difficiles et à tracer les schémas de ces assemblages organiques. Elle les appelait lichens. Elle n’était pas certaine du terme, mais hasarder un joli mot pour les désigner lui avait valu un regard impressionné de Silvio. Lichen ce serait donc. Pour leur père, il s’agissait sans aucun doute des saloperies qui dégueulassent le toit. C’était ce qu’il avait craché tout bas le jour où il avait sorti l’échelle pour aller voir avec Silvio ce qui se passait sur leur toiture, afin de compléter le chapitre des espèces domestiques. Sur les tuiles ravagées de mousses et de matières en décomposition, il avait découvert un océan tout sec de dépôts verdâtres, et aussitôt entrepris de déloger les indésirables. Sans grand succès.
Silvio ne l’avait pas pris personnellement. Il savait que l’intérêt de son père pour l’exposé était sincère, du moins l’était son envie de l’aider. Cela lui rappelait qu’à son âge, il avait fait un herbier, ou peut-être était-ce son frère, il ne savait plus, où pouvait-il bien être, il faudrait qu’il aille voir au grenier.
Beaucoup de choses étaient des saloperies pour son père. Les saloperies de chantierstoujours en retard, les saloperies de conneriesqu’on passait sur les écrans, cette saloperie de piano encore désaccordé. Quand le père voyait le fils ouvrir des yeux ronds en entendant ce genre de vocabulaire, il lui adressait un large sourire, Non, j’ai dit salopette, tu n’as pas bien entendu, et il clignait de l’œil.
À compter de ce jour, le père de Silvio se lança dans une guerre sans merci contre les envahisseurs. Cela n’aurait pas été bien grave si ces saletés ne s’accompagnaient pas de plantes grimpantes qui, lancées à l’assaut des toitures de toute la rue, le rendaient fou de rage. Non seulement elles opposaient une résistance agaçante à toute forme d’arrachage, même par surprise, mais elles avaient l’audace de revenir s’installer aussi vite que la poussière après un coup d’aspirateur. Mais le vrai problème du père, ce n’étaient ni les lichens, ni les plantes grimpantes. Ni même le piano. C’était le temps.
Il y en avait beaucoup trop.
Le temps n’avait pas toujours semblé aussi long, aussi lent. Et lourd. Il y avait eu un temps où il n’y en avait jamais, et c’était très bien comme ça. C’était un temps d’astronaute : lorsque celui-ci décolle et voyage à de hautes vitesses pour revenir à son point de départ, il s’aperçoit que son jumeau resté au sol est devenu plus vieux que lui – c’est que durant la séparation, leur temps respectif ne s’écoulait plus de la même façon. Ainsi, le père partait de la maison quelques heures, quelques jours pour le travail et lorsqu’il revenait sur le sol familial, il s’apercevait que des mois, des années avaient passé. Ses enfants avaient grandi, sa femme avait vieilli. Comment était-ce possible ? Tout ce temps, il ne le voyait pas s’écouler. En son absence, les siens vivaient des siècles et lui, il n’avait. Jamais. Le. Temps.
Ce qui éclusait le temps paternel à l’époque, c’était le grand projet ferroviaire. Et tous ses petits. Le programme était né avant lui et pourtant, depuis qu’il l’avait rejoint des années auparavant, il en était peu à peu devenu le géniteur. Il devait sans cesse s’absenter. Souvent à l’autre bout de la ville, souvent à la Capitale, parfois dans sa propre tête. Il se déplaçait pour superviser de gigantesques chantiers qui engloutissaient les hommes et l’argent. Il voulait voir de son vivant le réseau achevé jusqu’à la dernière maille, et la multitude de travaux terminés jusqu’à la dernière gare. Mais les chantiers, les uns après les autres, s’étaient arrêtés. Les problèmes techniques, accumulés. L’argent, tari. Les hommes, fatigués.
Il restait les plans et les idées. Bien alignés, bien calculés, bien pensés. Sur le papier, c’était beau à pleurer. Il n’y avait pas de place pour les budgets trop serrés, les retards successifs, les nappes phréatiques imprévues, les études de sol défavorables, les problèmes structurels, les calculs de planning. Régler ce genre de questions n’était ni beau, ni amusant. Les réunions d’équipe s’étaient espacées. Sa vie entière avait été mise en sourdine. Il attendait. De manquer de temps à nouveau. Aucun autre projet n’arrivait à l’intéresser. On n’envoie pas un astronaute en orbite autour d’un carrousel, c’est du gaspillage de talent.
On lui avait dit que c’était juste une question de temps. Juste une interruption à duréeindéterminée. « Mais du temps, j’en ai, prenez-le, prenez tout », avait-il envie de hurler. Il avait souvent envie de hurler. Quand cela lui arrivait, il se mettait à jouer à la place. C’était plus joli. Quand sa famille entendait le piano chanter, lui écoutait avec application ses propres hurlements.
Il s’était donc mis à jouer de plus en plus souvent. La musique imprégnait toute la maison. Il était doué, il devint excellent. Mais au fur et à mesure qu’il maîtrisait les partitions, il perdait les mots. Et les jours où il ne jouait pas, c’était pire. Le silence retentissait avec force à tous les étages. C’était un silence malsain, de ceux qu’on subit après l’explosion d’un bruit si dérangeant que les tympans ne reçoivent plus qu’un sifflement. Dans ces moments-là, la maison entière retenait son souffle.
Cela lui laissait encore trop de temps. Alors, il avait déclaré la guerre aux lichens du toit, au lierre sur les murs et à la végétation qui s’entêtait à cacher la couleur des briques, les lignes claires et pures des façades et brouillait l’identité constructive et c’est une injure à l’architecture de la ville, tu ne vois pas ?
Non, Silvio ne voyait pas.
*
Quand vint le jour de l’exposé, un entrelacs de fougères fines comme du tulle et délicatement ciselées avait élu domicile dans tout ce que le quartier comptait de fissures. De sa classe, au rez-de-chaussée, Silvio voyait le bout de leurs frondes dépasser le rebord des fenêtres. Les plus jeunes feuilles, pas encore dépliées, s’enroulaient en crosses vertes – en points d’interrogation, avait dit Jan – et semblaient s’apprêter à frapper au carreau. Cela donnait à la cour de récréation un air de Crétacé supérieur qui le ravissait.
À la fin de l’été, un mince tapis de mousses et de lichens recouvrait la plupart des toits de la ville.
2
Le départ eut lieu un matin où le ciel s’était levé gris et cotonneux. Un matin brumusculaire, avait dit Jan – il inventait toujours des mots quand il était stressé.
Je n’avais jamais fait le chemin à pied. La dernière fois que nous nous étions rendus à la Capitale, nous avions pris le rectilien, mais en cette saison, il roulait essentiellement pour le fret et le courrier. Obtenir un siège aurait coûté plusieurs semaines d’attente et de salaire. À pied donc.
De toute façon, je préférais marcher. Le chemin était clair, ce que je devais faire aussi. Mettre un pied devant l’autre. Recommencer. Toute cette partie de ma vie, d’ici à la Capitale, était écrite. C’était prévu, c’était rectiligne. Je me voyais déjà, loin à l’horizon, marcher le jour d’après, et le suivant, et le suivant.
*
Ils avaient éclos dès le début de l’automne.
Ceux qui savaient où chercher les trouvaient déjà en toute saison, mais cette année-là fut différente. Était-ce leur taille, était-ce leur nombre ? Bientôt, plus personne ne s’étonna de les voir déborder des lieux humides et déserts. Ce n’était pas un problème. On s’habituerait. Qu’est-ce que ça changeait, en définitive ? Il y en avait que ça n’intéressait déjà plus. D’autres que cela intriguait. Et enfin, ceux qui s’inquiétaient.
Les sporophores se multipliaient en grappes depuis le fond des terrains vagues jusqu’au pied des bancs publics. C’est ce que rapporta la presse étrangère et le temps que l’information percole, on voyait, partout sur le continent, des colonies de champignons émerger des caves et ramper sur les arbres bien taillés des avenues.
Et puis, il y avait les mauvaises herbes – coriaces et envahissantes ces temps-ci – et la couverture des lichens qui, déjà, faisait partie du paysage urbain – mais n’avait-elle pas toujours été là ? Les interstices des rues piétonnes étaient saturés de bryum argenté. Désormais, on ne pouvait plus trouver un véhicule dont le pare-brise et les rainures de portières soient dépourvus de cette mousse irisée qui s’incrustait au gré du vent.
« C’était inévitable, dirent les experts lorsqu’on les interrogea au sujet des champignons. Nous n’avons rien vu, parce qu’il n’y avait rien à voir ! Le mycélium se glisse en profondeur dans le sol ou au cœur des joints d’un mur, et vit ainsi de nombreuses années sans qu’on le remarque. Il grandit et envahit une zone de plus en plus étendue, sur plusieurs kilomètres carrés parfois, jusqu’au jour où il est assez enraciné pour se reproduire. Il se met alors à former des sporophores – c’est-à-dire, le chapeau du champignon. »
La mère de Silvio s’obstina un moment à arracher les têtes de champignons dès qu’elles apparaissaient. Elle se résigna lorsqu’elle comprit que rien ne pourrait les empêcher de revenir et que leur présence était, tout compte fait, inoffensive. Comme dans la plupart des foyers, on se mit à les récolter pour les manger.
Quant à son père, il s’absentait désormais souvent. Quelqu’un d’autre prenait alors sa place. Il lui ressemblait trait pour trait, mais ce n’était pas lui. Silvio n’était pas dupe : d’abord, l’inconnu ne parlait pas et se noyait des heures dans le fond d’un verre. Des jours dans une fissure au plafond. Des semaines dans la déclinaison d’un accord en sol mineur.
Mais quand le père revenait… Alors, il était vraiment là. C’était comme s’il avait vudes choses extraordinaires, il revenait la tête et les yeux pleins de songes et de monstres. Le piano crachait à nouveau des notes, le chantier ferroviaire était au cœur de tous ses discours et il remontait sur le toit pour insulter mousses et lichens.
Il remplissait chaque journée de suffisamment de vide pour qu’elle laisse place à la suivante. Et à celle d’après. Le temps que les travaux ferroviaires reprennent.
– Tu vois, expliqua-t-il un jour à son fils, pour moi, c’est un signe, cette histoire de champignons. Un signe que le réseau adviendra quoi qu’il arrive. Viens, je vais te montrer quelque chose d’incroyable.
Silvio était enchanté que son père soit là et d’humeur à lui montrer quelque chose. Il aurait pu lui mettre des boutons de manchette sous le nez que le garçon aurait exulté.
Silvio regarda son père sortir un classeur d’une étagère. Il l’ouvrit et le feuilleta un instant ; claquement des anneaux métalliques, odeur de vieux papier. Le père sortit des plans et les étala devant lui.
– Tu vas voir, c’est fascinant.
Il pointa du doigt ce qui ressemblait à une carte nationale.
– Là, au centre, c’est la Capitale. Nous sommes ici, sur ce rond plus petit, qui représente Vervilles. Là, tu reconnais Bordemure avec ses canaux et là, c’est Dylle. On y habitait avec ta mère avant la naissance de Solène, tu le savais ? Sur cette carte, tu vois toutes les villes du pays représentées par un point plus ou moins grand en fonction de leur taille. Les plus petites sont ici, là et là : Coxelle-Nord, Coxelle-Ouest et Bruis-les-Bois. À peine des confettis. Le problème consiste à relier tous ces endroits de manière efficace.
Le regard de Silvio se posa sur le long trait noir qui serpentait depuis le bas de la feuille jusqu’au coin supérieur droit en passant par une dizaine de points alignés. Il le reconnut et le suivit du bout du doigt.
– Oublie le rectilien, Silvio, dit aussitôt son père sur un ton grave. Il ne sert qu’à couper en deux un territoire gigantesque en isolant ceux qui n’habitent pas dans son sillage. Le nouveau réseau Intercités, lui, ne laissera personne sur le côté. Regarde. Chaque ville importante devra être connectée aux autres. Mais les cités secondaires doivent également faire partie du réseau. Et plus elles sont peuplées, plus il faut augmenter la fréquence de passage. Enfin, un circuit parallèle aux lignes principales doit être opérationnel en cas de problème. Sachant cela, tu n’imagines pas le nombre de combinaisons possibles qu’on peut dessiner. Des centaines de réseaux hypothétiques ont été tracés.
Il feuilleta le classeur et sortit un autre plan qu’il déplia avec précaution.
– Voilà. C’est une image d’archive de la solution historique du tracé final, validée des années avant que tu viennes au monde.
Chaque point-ville était désormais relié aux autres par des traits fins. D’autres, plus épais, convergeaient vers la Capitale. Le réseau s’étalait sur la carte, évident et complexe. Il poursuivit :
– Cette solution-là, ce n’est pas un architecte qui l’a dessinée. Ni un urbanologue, ni un ingénieur ferroviaire. En fait, ce n’est même pas un humain.
Silvio ouvrit de grands yeux. Il sentait que c’était la réaction attendue.





























