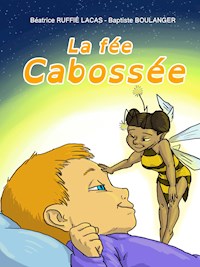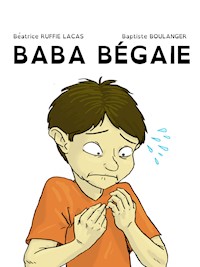Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Les Bas-Bleus
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Une romance moderne à l'héroine sarcastique et attachante !
Maîtresse à la vie comme à l’école, Camille déteste au moins autant les enfants que l’engagement amoureux. Trentenaire au caractère bien trempé, elle vole de bras en bras, avec une nette préférence pour les hommes mariés afin d’être certaine de ne pas s’attacher. Pourtant, sa rencontre avec Stéphane, directeur d’une école d’art, va mettre à mal ses certitudes. De petits bonheurs en déceptions, elle va alors se rendre compte que Stéphane n’est pas du tout celui qu’il prétendait être.
EXTRAIT
J’ai enfilé une petite robe bleu pâle qui met mes formes en valeur sans les mouler, et je joins à ma tenue un joli foulard anthracite, assorti à mes ballerines. J’ai beau faire des efforts de tenue, je sais très bien que ma mère trouvera toujours quelque chose à redire sur ce que je porte. Pourtant, à chaque fois, je fais de mon mieux. Et, à chaque fois, j’ai droit à un de ses petits tacles verbaux :
— C’est terriblement gras ce que vous mangez dans ces cantines scolaires, non ?
— Singulière, ta robe, elle était soldée, j’imagine ? Tu as dû faire une affaire !
— C’est étrange la génétique, tout de même, quand je pense qu’à ton âge on me prenait tout le temps pour un mannequin…
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Bref, j'ai passé un bon moment de lecture avec ce roman car Camille a su me faire rire grâce à cette auto dérision qui la caractérise. Elle prend la vie comme elle vient et ne se soucie pas du regard des autres. - blog The Lovely Teacher Addictions
À PROPOS DE L'AUTEUR
Pas-tout-à-fait-quadra, presque-plus-trentenaire, Béatrice Ruffié Lacas vit dans le Sud de la France, avec ses quatre enfants et son mari. Après avoir exercé pendant plusieurs années le métier de chargée de communication, elle a choisi, il y a trois ans, de se diriger vers l’écriture. Elle a publié depuis une quinzaine de nouvelles dans des anthologies, un recueil personnel et différents ouvrages destinés à la jeunesse. Elle se lance aujourd’hui dans la romance contemporaine avec le plus grand plaisir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
1Vraiment, vraiment de la veine
— Madame, madame ! Rowan, il a fait caca !
Je lève les yeux de mon cappuccino et observe la petite tête blonde qui m’apostrophe. Keyla ou Léa. Ou bien Lila ? Depuis trois ans, c’est la mode des prénoms en A pour les filles et, forcément, je m’y perds. Fort à propos, je marmonne un « ah » peu engageant pour la faire fuir, puis replonge mon nez dans mes corrections, en me disant qu’il faudrait absolument penser à installer une solide barrière électrique à la lisière de la salle des profs.
— Vous pouvez venir, madame ?
Je hausse un sourcil, agacée. Ce n’est pas à mon tour de surveiller la récréation cette semaine. Et, franchement, la vie des intestins de Rowan, je m’en tape comme de ma première diarrhée. Je m’apprête à expliquer cela — poétiquement — à la blondinette en A qui me fait face, quand elle ajoute, d’un air ravi :
— Au milieu de la cour, madame, hein. Puis sur son frère, en plus.
OK, elle a gagné, je me lève. Je ferme les yeux une demi-seconde pour essayer de me rappeler qui est précisément Rowan et quelle est la classe qu’ils m’ont encore refilée cette année. Les CM2. Je pose à regret ma tasse sur la table et pars à la recherche dudit Rowan, d’une collègue et du directeur. Ça va encore être une grande année…
Je suis professeure des écoles. Titre ronflant qui désigne une institutrice, anciennement maîtresse et plus véritablement matonne. Titre qui s’accompagne, pour ma part, de la mention « contractuelle », ce qui signifie que je suis sans établissement fixe, et que je me cogne à peu près tout ce dont les autres ne veulent pas. Les charmants bambins dont j’ai la charge sont âgés de deux à dix ans. Parfois douze, mais ça, c’est quand ils ont redoublé deux fois, chose qui, dans notre système éducatif, est désormais quasi impossible. Bref, ça, c’est quand j’ai vraiment, vraiment, trop de la veine. Chaque année est un nouveau challenge : de nouvelles classes, de nouveaux niveaux, de nouveaux collègues. Quand j’ai commencé à enseigner, je rêvais d’obtenir une place fixe dans le même établissement, chaque année. J’ai d’ailleurs passé — et raté — le concours à plusieurs reprises, puis j’ai fini par abandonner. Avec le recul, je crois pouvoir affirmer que, finalement, ce nomadisme ne me déplaît pas tant que ça. À chaque rentrée détestable, j’ai la chance de pouvoir me dire que cela ne durera qu’un an, au plus. Souvent beaucoup moins. Et j’ai conscience que beaucoup de mes collègues n’ont pas cette aubaine. Avant d’aller plus loin, je tiens à dire que je n’ai pas fait ce métier par vocation. D’ailleurs, je ne connais personne qui soit dans ce cas-là. L’appel mystique auquel les parents aimeraient se raccrocher, c’est un peu l’histoire du monstre du Loch Ness : on y croit ou pas mais, en attendant, personne ne l’a encore jamais vu « en vrai ». Ma vocation, personnellement, c’est qu’après des études en fac d’histoire de l’art et presque deux ans de chômage, j’ai dû trouver un moyen de gagner ma vie autrement qu’en servant des hamburgers. À ce moment-là, bien sûr, j’ignorais qu’au bout de cinq ans de métier, je toucherais moins dans la grande famille de l’éducation que dans celle de Ronald.
« Tu dois beaucoup aimer les enfants » est la phrase que j’entends le plus souvent. Je hoche alors la tête d’un air poli, signifiant par-là que c’est une évidence d’aimer les enfants, oui, bien sûr, surtout en tant que professeur des écoles, amené à travailler avec eux toute la journée. Je ne connais pas un seul médecin à qui l’on dit « Tu dois beaucoup aimer les gens malades » ou une femme de ménage à qui l’on dirait « Mais tu adores la crasse, toi, dis donc ? » Mais pour les instits, c’est un fait, tu dois aimer ça. Vous voulez la vérité ? Je les déteste. Ils sont petits, bêtes et souvent méchants. Parfois même TRÈS méchants. Ils ne contrôlent ni leur attention ni leurs mouvements, et, dans les petites classes, ils ne contrôlent même pas leurs sphincters. Souvent, ils puent. Parce que leurs parents ne les lavent pas tous les jours. Parce qu’ils se sont tartinés de poisson pané à la cantine, parce qu’ils se sont pissés dessus ou parce qu’ils ont vomi. Il faut savoir qu’ils vomissent tout le temps, parfois parce qu’ils sont malades, mais le plus souvent parce qu’ils ont essayé de se mettre les doigts au fond de la gorge… pour voir. Et puis ils crient. Sans arrêt. Parce qu’ils sont contents. Parce qu’ils sont en colère. Parce qu’on leur a pris un jouet. Parce qu’ils sont fatigués. Non, vraiment, les enfants, c’est chiant. Alors, pour faire ce métier, ce qu’il faut vraiment aimer, ce sont les vacances. Parce que, sans elles, tu ne tiens pas.
Rowan a été puni ; ses parents seront convoqués dans la semaine. En attendant, il finira sa journée chez la directrice, qui pourra profiter jusqu’à l’arrivée de ses géniteurs de ses cris et supplications. Bon débarras. Quant au petit frère, dont le blouson était barbouillé de merde, il a été décrassé et renvoyé chez sa maîtresse, et je remercie tous les dieux que, pour cette fois, ce ne soit pas moi. Ma classe de cette année se compose de vingt-six élèves. Dix filles et seize garçons. Peu de redoublants, beaucoup de bonne volonté. Dommage que je ne sois là que pour six mois, je crois que je vais bien m’y plaire. Pendant que les mômes travaillent sur leur fiche de lecture, je les observe à tour de rôle, en tentant d’imaginer leurs parents. Je fais ça chaque année. Souvent, les enfants leur ressemblent, même si, quelquefois, on a des surprises. J’imagine déjà que ma blondinette en A aura une maman très coquette, fan de marques et de vernis à ongles. Et que le grand dadais un peu concon qui mâchouille son crayon en bout de rang a un papa footballeur ou au moins sportif, vu les maillots de sport aux couleurs plus ridicules les unes que les autres qu’il arbore jour après jour. J’aurai mes réponses dans quelques heures. Ce soir, c’est ma première rencontre avec les parents. Si je suis plutôt à l’aise avec les mouflets, je suis régulièrement en détresse avec les parents, surtout les mères, qui me prennent en général pour une ravissante idiote. Je suis loin d’être conne, mais il faut dire, sans me vanter, que je suis plutôt pas mal. Grande, brune, j’ai des cheveux longs qui tombent jusqu’aux fesses, des yeux marron en amande et des cils naturellement noirs que je maquille à l’orientale. Tout près de mes lèvres, on devine un minuscule grain de beauté. Sous l’Ancien Régime, on aurait nommé cette mouche une friponne. Ça me va bien. Si mon visage attire les regards, je dois avouer que le reste de ma petite personne ne fait rien pour les laisser glisser. Je suis taillée en huit, avec une poitrine correcte et une taille fine. Mais mon atout majeur est dans mon dos : j’ai un beau cul, sur lequel tous les types se retournent systématiquement. Un postérieur de nana, ferme et accueillant. Bref, en général, les papas m’apprécient pas mal, eux.
À côté de la place laissée vide par Rowan, il y a un drôle de gamin, aussi beau que dissipé. C’est un métis à la peau très brune et aux yeux clairs. Je me demande à quoi ressemble son père. Je m’imagine déjà un grand black, avec un fessier d’enfer et des abdos en béton. Il faut dire que, depuis une semaine, ma libido est au régime sec. Ma dernière histoire s’étant soldée par une humiliation publique, j’ai préféré freiner la machine. Mais là, j’ai bien peur qu’elle ne s’encrasse, et je suis si affamée que je serais capable de manger n’importe quoi. Il y a deux jours, j’ai même été tentée de rappeler Connard, mon ex, juste pour voir si une dernière virée sous la couette ne le tenterait pas. Heureusement, je me suis abstenue. Je ne tiens pas à ce qu’une autre vidéo vantant mes exploits sexuels passe sur YouTube. Pas que j’aie à en avoir honte, loin de là, mais l’inspection n’apprécierait pas ! Je jette un œil à ma montre : encore une heure avant la fin des cours. Le temps de ramener les marmots à la grille, j’aurai à peine un petit quart d’heure pour aller me boire un café avant que les parents ne déboulent. Je note mentalement que je remettrai aussi un peu de rouge à lèvres. Au cas où.
— Madame, j’ai fini !
— Moi aussi !
— Moi aussi !
— Faites-moi voir ça… Denis, viens, tu passes au tableau pour la correction.
L’intéressé se redresse en soupirant et m’implore avec son regard bleu d’eau. Il a vraiment des yeux magnifiques, ce gosse. J’ai hâte de rencontrer son père !
C’est le septième couple que je reçois. À croire que, dans cette banlieue, il n’y a plus un seul homme qui ait le droit de sortir seul le soir. Madame est espagnole et s’exprime avec un accent chantant, doux à mes oreilles. Elle sourit tout le temps, avec les yeux surtout. Elle m’explique à quel point sa petite fille est intelligente. Un peu feignante peut-être, mais elle a de réelles possibilités, elle me l’assure. Je crois même qu’elle me parle de son fort potentiel et de sa précocité. Je ne supporte plus ce terme. Dans chaque école où je suis passée, j’ai vu des parents persuadés d’avoir un enfant surdoué, qui s’ennuie à l’école parce qu’il y est trop fort. Si parfois, c’est bien vrai, hélas, le plus souvent, leurs prétendus génies ne sont que des tanches un peu plus malignes que les autres pour dissimuler leur inactivité cérébrale. Monsieur, lui, est un de ces êtres de bureau, que l’on croise sans jamais les remarquer : costume mal taillé, cravate à rayures et chaussures mal assorties. Je ne me souviens plus de sa profession, mais je l’imagine sans peine comptable ou gestionnaire. Il ne parle pas et se contente de m’observer timidement à travers ses petites lunettes à la monture démodée. Il s’efforce de ne pas regarder mes seins ni ma bouche, et il me fait presque de la peine avec ses petits clignements d’œil gênés. Je ne le rassure pas. Habituellement, les hommes comme lui aiment les institutrices à chignon, avec un col blanc et une jupe longue. Mon léger décolleté et mon rouge à lèvres un peu trop brillant ne rentrent pas dans son schéma.
Quand ils s’éloignent enfin, je pousse un soupir de soulagement. La mère de famille nombreuse qui les a précédés m’a donné un mal de tête épouvantable. Enfin, surtout ses jumeaux, qui n’ont eu de cesse de hurler pendant toute la durée de notre entrevue. Je doute d’ailleurs qu’elle ait entendu quoi que ce soit au sujet de son aîné, tant les deux morveux s’égosillaient. Pourtant, le premier n’était déjà pas facile, je ne sais pas pourquoi elle a persisté. Il est presque 18 heures. J’entends que, dans les classes voisines, la plupart de mes collègues ont déjà déserté les lieux. Je dois me rendre à l’évidence : ce n’est pas encore ce soir que je vais manger à ma faim. D’habitude, c’est lors de ces réunions que je rencontre mes conquêtes masculines. J’ai la chance d’avoir une longueur d’avance : je connais leur situation familiale et leur profession. J’ai même quelquefois droit à certains détails croustillants de la part de leur progéniture, du type « papa, il dort tous les soirs sur le canapé » ou « quand maman n’est pas là, papa voit des copines secrètes ». Les enfants sont une source intarissable d’information. Je regrette d’ailleurs de ne pas pouvoir ajouter les cases « longueur du pénis » ou « préférences sexuelles » sur le formulaire de rentrée, ça m’arrangerait bien.
Les parents de Denis ne sont pas venus. Dommage. C’est quand je m’apprête à quitter la salle que le visage de Romuald s’invite dans l’encadrement de la porte. Je suis assise et ça ne sert à rien, mais c’est un réflexe : je rentre le ventre. Romuald est le professeur des CP et, quand je suis arrivée dans l’école, j’ai immédiatement flashé sur lui. À la première réunion de l’équipe pédagogique, il ne m’avait pas encore serré la main que j’imaginais déjà tout ce qu’il pouvait me serrer et dans quelles positions.
— T’as fini ?
— Oui, je crois… Et toi ?
— Depuis un moment ! On rentre ensemble ?
— J’arrive !
Ma réponse a été un vrai cri du cœur ; du coup, pour faire bonne figure, j’essaie de faire celle qui range ses petites affaires consciencieusement et qui n’est pas pressée le moins du monde de partager un métro avec lui. En réalité, je suis prête à partager beaucoup de choses avec lui, mais je m’abstiens de les lui dévoiler. Pour l’instant.
À cette heure tardive, toutes les rames sont bondées. Être prof, c’est aussi avoir le privilège de ne pas avoir à supporter chaque soir les transports en commun aux heures de pointe. Et croyez-moi, ce n’est pas pour me déplaire. Romuald, galant, m’a laissée passer avant que les portes ne se referment, et je n’ai pas pu résister au plaisir de me coller contre lui. Il est grand. Ma tête arrive juste au niveau de son menton mal rasé. Autant, je ne suis pas pour les hommes à barbe, autant ce petit côté rebelle me met dans tous mes états : j’imagine très bien comme ce petit picotement pourrait être agréable sur certaines parties sensibles de mon corps. Je profite de chaque coup de frein pour me rapprocher encore un peu, même si ma posture n’a rien de confortable. Cambrée au maximum contre sa cuisse, je rentre tellement le ventre que je suis presque en apnée. Mais, malgré mes efforts, Romuald ne semble pas avoir remarqué quoi que ce soit. Depuis le début du trajet, il me parle de son fils de quatre ans, prénommé Nestor, qui semble être le centre de son monde. Je m’abstiens de lui dire que son gosse a un prénom de majordome, et je le regarde déblatérer ses exploits la bouche ouverte, apparemment captivée. Intérieurement, je me fais un petit bilan présexe : je me suis rasé les jambes le matin même et je porte un tanga en soie noire qui, même s’il n’est pas de première jeunesse, pourra faire illusion le peu de temps que je vais le porter. D’autant qu’avec Romuald, j’ai l’intention de m’en débarrasser très, très vite. Un nouveau coup de frein me projette contre ma proie. Cette fois, j’en profite pour me raccrocher à lui franchement, les mains collées à ses fesses. Ce n’est quand même pas de ma faute si je suis plus petite. Aucune réaction. Imaginez la scène : moi, cambrée comme Arielle Dombasle, en équilibre sur la pointe des pieds, les mains dans son dos, et lui qui continue, l’air de rien.
— Nestor, il est vachement tonique, tu vois. C’est un gamin toujours en mouvement, qui a besoin d’exercice.
— Mais moi aussi… je murmure d’une voix engageante.
Romuald stoppe net et me regarde comme si j’étais une extraterrestre. Cette fois, je comprends qu’on n’est définitivement pas sur la même longueur d’onde. Il nous reste deux stations à traverser ensemble, et je sens que mon tanga prend l’eau. Pour rien, en plus. Je décide d’y aller — encore ! — un peu moins en douceur.
— T’es marié ?
Romuald sourit béatement.
— Pas encore.
Je me demande si je dois prendre ça comme une ouverture. En général, je ne couche qu’avec des types mariés. Je suis spécialisée dans les parents d’élèves et je n’ai pas pour habitude de me taper mes collègues. Pas que je me mette des limites, loin de là. Mais les instituteurs que j’ai essayés étaient souvent des types assez ennuyeux au lit. La pédagogie en classe, OK, mais faire un schéma détaillé à chaque cuni, très peu pour moi.
— C’est prévu pour quand ?
— Pour septembre prochain !
Si j’étais son dernier amuse-gueule ? Je lui fais un sourire que j’espère sexy, et bombe mon torse contre le sien. La plupart des voyageurs ayant déserté le wagon à la dernière station, ce coup-ci, mon message est on ne peut plus clair. Mais comme je suis une fille sympa, je le laisse m’embrasser en premier. Faut pas brimer le mâle « dominant ».
— Éric et moi, on est super contents, ça fait longtemps qu’on attendait ça.
Je rembobine. Mon sourire sexy, ma cambrure provocante et ma folle envie de faire des trucs, là, maintenant, tout de suite, sur les fauteuils dégueulasses du RER B. En sortant à la station suivante, Romuald m’embrasse tendrement sur les deux joues, et le petit picotis me rappelle, s’il est besoin, à quel point j’ai besoin d’un homme.
En tournant la clé dans la serrure de mon appartement, j’entends mes voisins arriver et je me dépêche de rentrer à l’intérieur. Mme Aubert, la locataire qui vit sur le même palier que moi, est une vraie harpie. Son mari ne vaut pas mieux. Mais les regards admiratifs qu’il adresse à ma croupe me suffisent à lui pardonner, au moins autant que sa carrure de rugbyman. M. et Mme Aubert, c’est monsieur et madame Tout-le-Monde. La petite quarantaine, deux enfants, un de chaque catégorie, une Volvo, un chien et deux hamsters. En gros, tout ce à quoi j’essaie d’échapper depuis mon plus jeune âge. Physiquement, lui est plutôt pas mal. Ancien sportif, il a gardé des vestiges tout à fait honorables de ses jeunes années — et je ne dis pas ça seulement parce que je suis affamée, non, non, c’est vrai. Elle, c’est la ménagère de moins de cinquante ans dans toute sa splendeur : assistante de direction, empâtée, acariâtre, renfrognée et surtout totalement cinglée. À chaque fois qu’elle me croise, elle me sort une de ses diatribes antifonctionnaire, comme quoi je travaille trop peu, je suis trop payée, j’ai trop de vacances… J’en passe et des meilleures. Mme Aubert cristallise à elle seule tous les reproches qui peuvent m’être faits par la société, avec plus ou moins de pertinence, mais elle me les assène avec une telle délectation que ça la laisse au bord de la jouissance.
En moins de deux, me voilà à l’intérieur. Ma journée me semble avoir été suffisamment catastrophique sans que je me tape en plus cette vieille bique ! Je claque la porte de toutes mes forces — ça l’énerve ! — et balance mes clés sur la desserte de l’entrée, en même temps que je me débarrasse de mes chaussures. J’ai envie d’un bain chaud, de sels de douche parfumés et d’une bière bien fraîche. Là, tout de suite, une roteuse, ce serait parfait. Malheureusement, la détente attendra : j’ai encore douze évaluations à corriger avant demain, et il est déjà 19 h 30. La mort dans l’âme, j’attrape une casserole dans le placard de la cuisine et fais bouillir de l’eau. Ce soir encore, ce sera noodles et corrections.
2Matin chagrin
Une espèce de glas résonne dans ma tête. De deux choses l’une : sois je suis morte, soit ça ne va pas tarder. Le son est aigu, lancinant et s’amplifie progressivement jusqu’à me fracasser le crâne. La douleur est si forte que j’en ai la nausée. C’est la mort. La phase terminale, la curie, la… Péniblement, j’ouvre un œil, puis deux. Saloperie de réveil. Je m’étire comme un vieux chat paraplégique et je glisse au bord du lit pour appuyer sur le bouton du snooze, qui continue sempiternellement son devoir tant que je ne l’arrête pas. Oui, je sais ce qu’est un radio-réveil et, oui, je suis au courant que, de nos jours, on peut aussi se réveiller en musique. Le problème c’est que, moi, la musique, ça me rendort. Du métal au rap, en passant par la variété, j’ai tout essayé. Les beuglements des hardos m’apaisent, la voix nasillarde de Claude François m’attendrit, et même Joey Starr — qui a plutôt tendance à m’exciter en temps normal, mais en général pour de tout autres raisons — ne me donne pas plus envie de quitter mon lit que les deux précédents. Je n’ai donc pas d’autre solution que d’utiliser cet engin préhistorique et tortionnaire : le bipper, qui monte en pression jusqu’à un volume paroxysmique et ne s’éteint QUE quand j’ai appuyé dessus. Deux fois. Le son s’arrête enfin. Je baille à m’en décrocher la mâchoire et je rejoins la cuisine dans le noir. Je pourrais allumer le plafonnier, mais ça ne servirait pas à grand-chose. Le matin, tant que je n’ai pas avalé au minimum un café brûlant, je vis à tâtons. C’est comme ça.
Pendant que mon antidote s’égrène trop lentement dans la cafetière, j’ouvre le placard au-dessus de l’évier, histoire de dégoter un petit truc à grignoter. Il n’a rien à m’offrir, pas plus que le frigo avant lui. Il va vraiment falloir que je pense à aller faire les courses. Je lance un œil indécis et concupiscent sur le dernier bol de noodles, puis je me ressaisis. Le curry au petit-déjeuner ne me paraît pas être une bonne idée. Je décide que je me prendrai rapidement un pain au chocolat à la boulangerie du coin en me rendant à la station. En attendant que mon café refroidisse un peu, je ramasse les copies d’évaluations que j’ai laissées éparpillées au sol la veille. La première du tas est celle de Denis-yeux-bleus. Je me laisse choir sur le sofa, et la regarde une dernière fois avec amertume.
1. Conjuguer le verbe entre parenthèses à l’imparfait
Je (manger) des fraises.
Jé (manger) des fraise. C’été pa trop parfai.
Je (jouer) dans la cour.
Jé (jouer) dan la cour. Cété bien.
Tous les instits ont plus ou moins rêvé d’avoir dans leurs rangs le futur Prix Nobel de littérature, en envisageant des retrouvailles façon reality show à l’américaine, vingt ans après. Enfin, je suppose que les autres en rêvent aussi. Dans tous les cas, il semble que pour moi ce ne sera pas Denis. Je nous imaginais pourtant très bien tous les deux, en première page du Monde. Lui, trente ans tout ronds, le sourire ravageur du mec qui a réussi. Moi, soixante ans, mais j’en parais à peine quarante, on dirait sa grande sœur. Sa main sur mon épaule, nos regards complices : on vient à peine de se revoir, mais il est clair qu’il n’a pas pu résister à mon charme de femme mûre. Je ne suis pas seulement la vieille institutrice d’un Prix Nobel, non, je suis sa maîtresse dans tous les sens du terme. Un flash crépite devant nous, dans un froissement discret, et se répand sur mes pieds, dégoulinant et froid. Merde ! Mon café ! Je regarde l’heure affichée dans le salon : 7 h 43. Je dois être dans mon train dans moins d’un quart d’heure et je ne suis même pas douchée. Ma petite rêverie affalée sur le canapé semble avoir souffert d’une faille dans l’espace-temps. J’avale en quatrième vitesse le reste de caféine tiédasse, puis je me jette sous la douche et m’habille en vitesse, avant d’enfourner pêle-mêle tout mon bazar dans ma sacoche. Je souris furtivement en songeant que si l’un de mes élèves faisait pareil, il en prendrait pour son grade, et je sors en trombe de l’appartement. 7 h 58. La station est seulement au bas de la rue, mais la probabilité pour que je puisse attraper le prochain métro me paraît extrêmement mince. J’hésite entre m’allumer directement une cigarette pour attendre le prochain ou tenter le tout pour le tout. Tant pis, je cours. La vitrine de la boulangerie me fait de l’œil au passage, mais je résiste : cheveux au vent et sac qui bringuebale sur le dos, je me jette dans la bouche de métro comme une assoiffée sur un verre d’eau. Pour constater qu’elle est bondée. Je m’arrête, complètement essoufflée — il faut vraiment que j’arrête de fumer ! —, devant un écran bleu.
« Suite à un mouvement de grève… Oh merde… le trafic sera fortement perturbé tout au long de la ligne A du RER. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. » J’avais le temps de fumer une cigarette. J’avais le temps de manger un pain au chocolat. Je n’aurais jamais dû me presser. Voilà ce que je me dis en franchissant avec mes congénères les portillons béants de la station de métro. Ça court, ça crie, ça s’agite : un train est à l’approche ! Sans même chercher à comprendre, je me joins à la meute et file en me précipitant jusqu’au quai. Une vraie marée humaine inonde les lieux. Les gens se bousculent avec des regards offensifs, si près des rails que cela en est angoissant. Je suis en quatrième ligne. Autant dire que si je la joue civilisée, je n’ai aucune chance de mettre un pied dans le wagon, ni même d’en apercevoir la porte. Il y a un train, je ne sais pas s’il y en aura d’autres, donc je dois rentrer dedans. C’est ce que l’on se dit tous, et c’est une vraie scène animale qui se déroule à cet instant-là. Chacun a sa technique : celui-ci se colle à son voisin, celle-là tente de se faufiler, un autre avance avec un air benêt… Je ne suis pas la dernière à jouer des coudes. Planquée derrière un balèze en survêtement, dès que la porte s’ouvre, je choisis la technique du je-fonce-dans-le-tas, en repoussant sans remords les pauvres malheureux qui espéraient sortir à la station. J’entends quelques insultes au passage, mais je baisse la tête. Je pousse de tout mon corps, jusqu’à ce que je puisse atteindre une des barres à laquelle m’accrocher. Rapidement, la sirène retentit. Mais les portes ne se referment pas. Des personnes sont coincées au milieu, impossible de redémarrer. Le scénario se répète une ou deux fois. Des mots fusent, quelques mouvements diffus. Une bagarre semble sur le point d’éclater mais, finalement, la masse à l’intérieur du train éjecte ses parasites qui regardent du quai, hagards, leur butin leur échapper. Nous ne formons plus qu’un, serpent hostile à tout nouvel arrivant, obnubilé par un seul et unique but : arriver à temps au boulot. Je suis trop loin pour me tenir à la barre, mais je sais déjà que je ne vais pas tomber. Nous sommes si serrés dans ce wagon que même mes propres os ont l’air d’avoir rétréci. Je me ratatine. Mon nez est à hauteur d’aisselle du grand balèze. Ma sacoche est coincée quelque part derrière mon dos, entre une femme au popotin démesuré et un ado gothique. Je n’ai pas de changement : vingt-cinq minutes à tenir, et j’arriverai à l’heure. Peut-être même que je pourrai boire un café sur le pouce en salle des maîtres. Cette idée m’arrache un sourire, et je tente machinalement d’attraper mon livre dans mon sac. Évidemment, ma main ne rencontre que la hanche de ma voisine, et je ne peux aller plus loin. En croisant son regard noir, j’ai l’impression d’être Guy Georges. Je tente de rapatrier mon bras vers moi, mais l’espace qui lui était attribué a subitement disparu. Je le laisse pendre en l’air un moment, comme un pantin désarticulé, puis je force la voie vers ma poche de jeans, frôlant au passage la braguette de l’ado boutonneux, qui me considère avec un regard morne. Ça va être long.
Le train passe de longues minutes à chaque gare. Les voyageurs, toujours plus nombreux, tentent de monter à bord des wagons déjà pleins, et il faut toute la hargne de ceux qui sont déjà à l’intérieur pour les en dissuader. Mon gothique a réussi à extirper ses écouteurs de sa veste, et une musique apocalyptique se déverse depuis cinq minutes dans le wagon. Ma voisine râle en silence, ses supplications étant essentiellement composées de longs soupirs agacés et d’œillades assassines. J’ai presque envie de dire au gamin de monter le son pour ne plus l’entendre souffler. Ça commence à sentir le fauve : une subtile odeur de pieds, mêlée à celle de la transpiration et du tabac froid. Gerbant. J’essaie de me concentrer sur ma matinée et je me répète mentalement le déroulé du programme : correction des évaluations de français, récréation, mathématiques et quelques questions d’histoire sous forme de jeu. J’ai essayé de reprendre la trame du professeur qui me précédait, mais je l’ai quand même un peu améliorée. Même si, aux dires de tous, Mlle Lacapelle est une excellente enseignante, son idée de faire des cours quasi magistraux à des gamins de dix ans me laisse perplexe. Cela dit, la tête dans la feuille et le stylo dans les mains, au moins, ils sont occupés. Je dois avouer que mon apprentissage de la géographie par le mime hier a bien failli tourner au fiasco. Mais est-ce que je pouvais imaginer, moi, que les parents du petit Imanol étaient des séparatistes basques ? N’empêche que quand il a sorti ses ciseaux et qu’il s’est jeté sur son voisin, je n’étais pas fière.
Finalement, une grande partie de la rame descend à Châtelet, et j’en profite pour me glisser vers les strapontins. C’est sans conteste la meilleure place en cas de grève : on est debout, maintenu par le siège sans avoir à se soucier d’une main baladeuse, et on est tout proche de la porte pour pouvoir descendre. J’ai changé de covoyageurs. À côté de moi, un homme très chic, en costume et attaché-case, parle d’une voix agacée dans son oreillette Bluetooth, comme s’il était seul dans son bureau. Sauf qu’il ne l’est pas et, pour se faire entendre, il beugle comme un forcené. Je résiste à l’envie de jouer à la maîtresse et de lui expliquer qu’il dérange tout le monde. Mais, heureusement pour lui, mon attention est ailleurs. Juste en face de moi, sur les strapontins opposés, un joli brun, pas très grand, vient de croiser mon regard. Il a une barbe naissante, un blouson en cuir près du corps et un je-ne-sais-quoi d’attirant. Je dois dire aussi que le fait qu’il me dévore des yeux sans en avoir l’air n’est pas pour me déplaire et augmente assez sensiblement son sex-appeal. Amusée, je lui souris franchement. Il semble gêné, comme s’il n’était pas sûr que ce sourire lui soit adressé. Je soutiens son regard et je gonfle imperceptiblement le torse en relevant la tête. Je crois qu’il rougit. J’aime bien les types un peu timides. On ne peut pas être en plein self-control