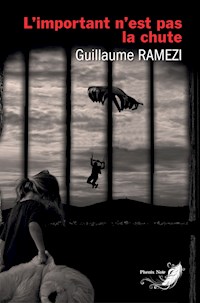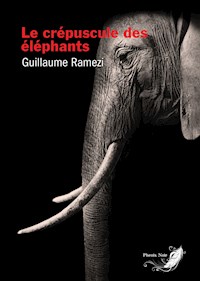Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: IFS
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Französisch
25 ans après le décès de son père emporté par un cancer, le docteur Mathias Brunel croit pourtant apercevoir le visage de son géniteur sur une chaîne info. L’homme est recherché pour terrorisme… Mathias se lance alors dans une traque hasardeuse et sa vie bascule. Il ne se doute pas des dangers qui l’attendent. D’autant qu’il met les pieds dans une organisation s’apprêtant à semer la terreur sur l’Occident… Mathias aura-t-il le courage d’aller jusqu’au bout ? Saura-t-il affronter les secrets qu’il veut percer ? Et vous, jusqu’où iriez-vous pour obtenir des réponses ?
Guillaume Ramezi propose avec ce premier roman un thriller d’espionnage captivant. Lauréat du : Prix du Balais de la Découverte 2018. Grand prix du salon de Nemours - Le Coquelicot Noir 2019. Prix Polar du salon de la Saussaye 2019. Sélectionné pour le Prix Sang pour sang polar de Saint-Chef (2e place).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 516
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À mes parents.
« Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents. »
Victor HugoActes et Paroles – Pendant l’exil
PREMIÈRE PARTIE : RÉMINISCENCE
PROLOGUE
Aujourd’hui, papa est mort.
Le soleil est maintenant couché depuis longtemps. Comme tous les soirs, ces derniers temps, le repas a été pris rapidement et maman s’est empressée de m’envoyer au lit afin de retourner veiller mon père. Cela fait cinq jours qu’il n’est plus sorti de leur chambre. Maman choisit soigneusement les moments où elle me laisse le voir. Certaines périodes sont apparemment trop dures à encaisser pour un jeune garçon de six ans.
Ce soir-là, je n’ai pas pu l’embrasser. « Il est trop faible », m’a dit maman, et je n’ai pu qu’entendre ses quintes de toux à travers la cloison qui séparait nos deux chambres.
Comme tous les soirs, j’avais malgré tout fini par m’endormir, mais cette nuit-là, une ambiance étrange régnait dans notre petit pavillon des Yvelines. Comme si un jour nouveau allait irrémédiablement se lever sur notre famille. Durant la nuit, les râles particulièrement forts de mon père m’avaient tiré de la quiétude tranquille de mon sommeil d’enfant. Je m’étais levé sur la pointe des pieds et, à pas de loup, j’avais entrouvert la porte de ma chambre pour voir ce qu’il se passait. Ma mère semblait bien plus agitée qu’à l’accoutumée et ne vit pas la porte entrebâillée lorsqu’elle passa en trombe dans le couloir pour aller chercher le téléphone. L’esprit et les yeux embrumés par la torpeur de la nuit, je vis ses doigts trembler en composant deux uniques chiffres sur le cadran.
Après avoir donné son nom et son adresse, je l’entendis dire en sanglotant :
— Venez vite, venez vite, mon mari est en train de mourir.
Malgré mon jeune âge, je comprenais vaguement qu’il se passait quelque chose de grave, mais j’étais bien incapable d’en saisir réellement la portée. Le sommeil m’avait déjà, en partie, regagné.
Mécaniquement, j’avais refermé la porte et j’étais retourné dans la tiédeur rassurante de mon lit. À peine recouché au chaud sous ma couette, je m’étais rendormi en songeant à ce bien étrange cauchemar que je venais de faire.
Au petit matin, j’avais été surpris par le profond silence qui baignait la maison. Enfilant mes petites pantoufles, je m’étais avancé timidement dans le couloir. Guidé par les bruits de sanglots que je percevais, je m’étais approché de la porte du salon. Maman était là, pleurant assise sur le canapé. Lorsqu’elle m’aperçut, elle parvint à calmer ses pleurs et me fit signe d’approcher. Elle me serra longuement dans ses bras avant de prendre une grande inspiration pour réussir à me dire dans un souffle, la voix étranglée par l’émotion :
— Tu n’as plus de papa, mon garçon.
CHAPITRE 1 PARIS – VINGT-CINQ ANS PLUS TARD
L’hôpital était étrangement calme cette nuit-là.
Allongé sur le canapé de la salle de repos, Mathias Brunel songeait au patient de la chambre 24.
— Dites-moi la vérité, docteur, combien de temps lui reste-t-il ? lui avait demandé son épouse en fin d’après-midi.
Comme toujours dans ces moments-là, il avait botté en touche.
— Il faut garder espoir, madame Lelong, nous allons essayer un nouveau protocole. Il existe une nouvelle thérapie pour laquelle des essais cliniques vont démarrer. Je vais monter un dossier pour y faire participer votre mari.
Le texte avait toujours quelques variantes, mais le fond restait le même, asséné de manière de plus en plus mécanique au fil du temps. Il se surprenait parfois en entendant le ton monocorde de sa voix lorsqu’il s’adressait aux familles attristées en quête de réponses. « Patience », « courage » et « espoir » étaient les mots qui revenaient à chaque fois.
La vérité était pourtant beaucoup plus sombre. M. Lelong ne s’alimentait plus depuis plusieurs jours et les perfusions ne pouvaient suffire éternellement à le maintenir en état. Lors de ses rares moments de lucidité, le regard voilé par la morphine, il exprimait de plus en plus la volonté d’en finir. Aujourd’hui, il n’avait même pas ouvert l’œil.
Ce ne serait plus long. Les derniers résultats que Mathias avait récupérés en passant devant le laboratoire d’analyses ne laissaient planer aucun doute. Ses organes lâchaient les uns après les autres. Ses reins ne fonctionnaient plus que par intermittence, son taux de potassium ne cessait d’augmenter et atteindrait très vite le seuil critique. Son cœur ne le supporterait pas et la détresse laisserait place à un arrêt pur et simple. Pas de réanimation dans ces cas-là, ce serait la fin pour M. Lelong.
Vingt-quatre, quarante-huit heures tout au plus. C’était une certitude, il ne verrait pas la fin de semaine. Mais Mathias ne pouvait se résoudre à l’avouer à son épouse.
Cela faisait partie de la thérapie pour accepter la fin inéluctable. Les non-dits entre l’oncologue et les proches du mourant étaient préférables à une vérité brutale difficile à digérer. Du moins, c’était ce qu’il se plaisait à penser et cela l’arrangeait bien. Le courage qu’il demandait à ses patients lui faisait souvent défaut au moment fatidique.
D’ici vendredi, M. Lelong rejoindrait la liste des patients qu’il avait perdus, bien plus longue que celle de ceux qu’il avait sauvés. Ce sera un nouvel échec, mais cela ne l’empêchera pas de continuer à chercher sans relâche de nouveaux traitements, des protocoles plus efficaces, des moyens de détection plus précoces : trop fréquemment, la bataille était perdue d’avance. Quand les malades entraient dans son bureau, c’était souvent déjà trop tard. Ils auraient consulté ne serait-ce que quelques mois plus tôt, il aurait pu faire quelque chose, circonscrire plus rapidement la tumeur ou démarrer des traitements moins invasifs. Au lieu de ça, il était obligé de sortir l’artillerie lourde : remèdes de cheval, chirurgie profonde et autres radiothérapies aux dommages collatéraux importants. La spirale de la fin démarrait alors quasi instantanément : le patient s’affaiblissait de plus en plus et son corps peinait à lutter contre la maladie qui progressait, obligeant à toujours plus de médication. Cercle vicieux morbide et inéluctable. Jusqu’au point de non-retour où on ne parlait alors plus de traitements, mais de soins palliatifs.
Malgré tout, Mathias gardait toujours espoir, il en faisait une affaire personnelle. Depuis ce jour triste d’hiver où le cancer avait emporté son père, il s’était juré qu’il deviendrait médecin comme lui et que, d’une certaine façon, il aurait sa vengeance. Chaque patient qu’il sauvait était une petite victoire sur ce fléau qui avait plongé sa famille dans des abîmes de tristesse.
Non, demain, si M. Lelong était toujours là, il lui administrerait ce nouveau traitement. Il avait déjà vu, dans quelques rares cas, des situations désespérées s’inverser et des patients jugés condamnés entrer en rémission.
Il fut tiré de ses pensées par l’entrée d’Ahmed dans la salle de repos. Ahmed était de loin le meilleur infirmier de son service. Toujours serviable et à l’écoute, il avait ce don rare de mettre immédiatement les gens en confiance. Son visage doux et son ton harmonieux rassuraient les patients. Mathias travaillait avec lui depuis le début de son internat. Ils étaient rapidement devenus très bons amis et l’étaient restés quand il avait été titularisé. Les longues journées et nuits de garde en commun leur avaient permis de partager de nombreux centres d’intérêt. Au fil des années, Ahmed avait appris à le connaître et lisait en lui comme dans un livre.
— Toi, tu penses encore au vingt-quatre, lui dit-il en prenant un soda dans le petit frigo et en s’affalant dans un fauteuil.
Si sa compassion et son empathie naturelles lui permettaient d’être un accompagnant merveilleux, en particulier dans un service comme celui-ci, l’infirmier possédait également cette faculté, que n’avait pas le médecin, à segmenter les différents aspects de sa vie. Dès lors qu’il n’était plus avec les patients, il parvenait à s’en détacher très facilement et à passer à autre chose dans la seconde suivante.
Ahmed attrapa la télécommande de la petite télé d’un autre âge qui trônait dans un coin de la pièce et entama son habituel zapping, qui finissait toujours, à cette heure-là, sur la chaîne info.
Immanquablement attiré par le pouvoir hypnotique de la télévision, le regard de Mathias se posa sur les titres qui défilaient en bas de l’écran. Rien de bien différent des éditions précédentes. Les semaines se suivaient et se ressemblaient en ce qui concernait l’actualité locale et internationale : tragique incendie dans un squat parisien, mouvement social et grève dans les transports, disparition inquiétante d’un enfant dans le sud-ouest de la France, montée en puissance d’un groupe terroriste au Moyen-Orient, tremblement de terre en Asie… Les experts et spécialistes en tous genres se succédaient pour analyser ces différentes informations et leurs implications. Mathias allait les écouter attentivement en mangeant et Ahmed le savait. Il savait que quand son ami était sur le point de perdre un patient, peu de choses lui permettaient de faire un break. Les informations sur la bonne ou la mauvaise marche du monde en faisaient partie. Le rituel était immuable entre eux.
Mathias se leva pour aller chercher son plat préparé dans le frigo. Il tapota en passant sur l’épaule de l’infirmier qui ne réagit pas. Nul besoin de paroles. Il s’apprêtait à enfourner dans le micro-ondes un hachis Parmentier à l’aspect quelconque quand il entendit dans son dos Ahmed lui lancer dans un grand éclat de rire :
— Hey Math, t’as vu ça ? C’est ton portrait craché, ce mec !
Mathias jeta en souriant un coup d’œil à l’écran par-dessus son épaule. Il s’attendait à un visage défiguré ou à un animal étrange et informe. Ahmed était coutumier de ce genre de plaisanteries.
Pourtant, quand son regard se posa sur le téléviseur, Mathias se figea et laissa tomber la fourchette qu’il tenait dans la main droite.
Une photo s’étalait en gros plan en ouverture de reportage. Le bandeau défilant en bas de l’image annonçait que l’homme était identifié comme un certain Youssef Al Mansour, figure montante d’un groupe terroriste du Moyen-Orient, contre lequel un mandat d’arrêt international venait d’être lancé. Le reportage précisait ensuite que l’homme en question était suspecté par les services de renseignements d’être un Français parti rejoindre les rangs de cette organisation et était probablement impliqué dans plusieurs attentats ou tentatives récentes en Europe. Le visage qui s’affichait à l’écran, malgré une impression globale sévère et inquiétante, possédait tout de même une certaine douceur. On devinait des traits fins et harmonieux derrière une barbe fournie. Mais ce qui paralysait Mathias, c’était le regard de cet homme fixant l’objectif. Un regard gris-bleu, perçant et autoritaire, où scintillait une évidente intelligence. Mathias l’aurait reconnu entre mille. Il l’avait observé des centaines de fois. Et pas uniquement lorsqu’il fixait des prunelles en tous points similaires quand il se regardait dans la glace tous les matins.
CHAPITRE 2 ALEP – MÊME ÉPOQUE
Assis sur une chaise en osier, Al Mansour attendait patiemment, comme à l’accoutumée. L’expérience ne devrait plus durer très longtemps. Il sentait qu’il se rapprochait du but. Ses protocoles étaient de plus en plus précis et les résultats commençaient à devenir probants, même si pour certains de ses commanditaires l’attente avait assez duré. La formulation juste n’était sans doute plus très loin, il avait seulement besoin d’encore un peu de temps et de quelques essais cliniques pour l’affiner et être sûr de ne commettre aucune erreur.
Le monde allait bientôt changer radicalement de visage, songea-t-il avec un sourire légèrement mélancolique en observant la cité qui s’étendait à ses pieds.
Du toit où il se trouvait, il avait une vue imprenable sur la vieille ville. Al Mansour aimait Alep. C’était le symbole parfait. Elle avait souvent été le départ des changements d’ères, passant de main en main lors des multiples invasions ayant émaillé son histoire. Son positionnement lui avait toujours conféré un double attrait stratégique, tant militaire que commercial, et faisait d’elle une cible de choix pour les civilisations en mal d’expansion, tantôt par le nord, tantôt par le sud. Plus de quatre mille ans d’histoire s’étalaient à ses pieds. De son point de vue, Al Mansour pouvait admirer l’imposante mosquée et apercevait le grand pont-escalier donnant accès à la citadelle qui dominait la ville.
Malgré les affrontements permanents qui secouaient la région depuis plusieurs années, tout semblait calme à cette heure matinale. Seul l’appel du muezzin venait troubler le silence étonnant qui s’emparait parfois de la cité. La victoire n’avait pas encore choisi son camp. Le régime de Damas et les habitants se battaient bec et ongles pour qu’Alep ne tombe pas. Sa chute entraînerait inévitablement une cascade de conséquences désastreuses et couperait notamment les relations nord-sud, amputant la Syrie d’une grande partie de son territoire et de ses ressources.
Des ressources, ils en avaient, et de plus en plus. Leurs partenaires non officiels leur fournissaient à leur guise armes et munitions, et le harcèlement permanent mené par leurs troupes affaiblissait toujours plus les défenses de la ville. Peu importaient les pertes humaines, ils disposaient à foison de candidats venant du monde entier pour les rejoindre dans leur grand combat, embrassant aveuglément leur cause.
Alep finirait par tomber, songea-t-il en se levant et en jetant un dernier regard vers la citadelle ; c’était inévitable. Et ils disposeraient bientôt d’un moyen définitif pour faire pencher la balance, même si l’objectif principal était ailleurs et qu’il était trop tôt pour que la ville cède.
Il descendit la vieille échelle en bois qui permettait d’accéder au toit-terrasse et se dirigea vers une porte vermoulue à l’arrière du bâtiment.
Avant même le passage de l’ouverture, les odeurs d’huile d’olive et de laurier en provenance du petit immeuble se faisaient déjà très présentes. Al Mansour traversa la première pièce et se faufila entre les empilements de blocs de savons prêts à être expédiés.
C’était la première savonnerie dont il avait pris le contrôle quelques années auparavant. De nombreuses autres avaient suivi. Soutenu sans limites par son organisation et les fonds colossaux dont elle disposait, il avait progressivement pris le contrôle de la quasi-totalité de la production de savons d’Alep. Cela lui permettait d’arborer en façade toutes les caractéristiques d’un investisseur ambitieux et de pouvoir mener en parallèle ses recherches sans être perturbé.
Il passa dans la pièce suivante, où la pâte verdâtre finissait de sécher, étalée au sol. Les râteaux à découper qui permettaient de former les cubes depuis des décennies étaient alignés le long du mur. À cette heure-ci, ses employés n’avaient pas encore pris leurs postes. Pas ceux-là tout du moins.
Il se dirigea vers une porte au fond de la pièce. Elle donnait sur un étroit escalier en pierre, d’où montait une chaleur humide et étouffante à l’odeur âcre qui irritait immédiatement yeux et gorge. Il descendit rapidement la volée de marches et déboucha dans une grande salle voûtée. De part et d’autre étaient disposées de grandes cuves en cuivre enterrées à mi-hauteur dans lesquelles bouillonnait le mélange d’huile d’olive de seconde pression, de baies de laurier et de soude végétale, dans des proportions au secret bien gardé. Rien n’était écrit et les quantités et temps de cuisson étaient transmis oralement par les plus anciens savonniers quand ils jugeaient un de leurs jeunes collègues suffisamment digne pour perpétuer leurs traditions, souvent après plusieurs années de dur labeur au sein de l’atelier. C’était cette recette ancestrale qui faisait la réputation des savons d’Alep et qui allait bientôt lui permettre d’exporter ses productions partout dans le monde. L’Occident raffolait des produits orientaux quand il pouvait les acheter à des prix dérisoires pour les revendre une fortune sur les étals des magasins de luxe, dérive habituelle du capitalisme à outrance, qu’ils finiraient par regretter. Mais cela lui importait peu de se savoir ainsi exploité. La seule chose qui comptait était qu’il puisse essaimer ses savons de par le monde, quel qu’en soit le prix.
Assis sur une chaise au milieu de la pièce se tenait un homme inconscient. Entièrement nu, il avait les mains attachées derrière le dossier et son visage rougi et bouffi témoignait du traitement spécial qu’il avait déjà subi dans une de leurs cuves.
De chaque côté de la chaise se tenait un homme. Le premier, de type caucasien, les bras croisés, attendait la suite, totalement indifférent à ce qu’il se passait autour de lui. Le second, syrien d’origine, portait un seau d’eau croupie et s’apprêtait à en asperger le prisonnier.
— Est-il prêt ? demanda Al Mansour sans préambule.
— Nous n’attendions que vous, chef, lui répondit l’homme au seau.
— Très bien, réveillez-le.
Et il sortit de sa petite sacoche en cuir une maigre liasse de feuillets.
Le tortionnaire jeta l’eau douteuse au visage du prisonnier sur sa chaise. Celui-ci eut quelques spasmes, toussa à plusieurs reprises en gémissant et, alors qu’il semblait replonger dans les limbes de l’inconscience, le premier bourreau, qui n’avait jusque-là pas bougé, lui asséna une gifle magistrale qui l’aurait fait décoller de sa chaise s’il n’y avait été solidement attaché. Il se serait écroulé au sol avec son siège si le Caucasien ne l’avait pas retenu par ce qui lui restait de cheveux.
Le prisonnier eut une nouvelle quinte de toux. Des gouttes de sang se mêlaient à l’eau qui ruisselait le long de ses joues. Il finit par redresser la tête péniblement et tenta d’ouvrir les yeux. Ses paupières se soulevèrent lentement et Al Mansour constata que le malheureux avait commis l’erreur irréversible de les ouvrir quand ses hommes lui avaient plongé le visage dans une cuve de saponification. L’extrémité de la fine membrane qui couvrait ses globes oculaires avait été partiellement fondue par le liquide en ébullition et des cloques apparaissaient sur les cernes profonds qui le marquaient. Son regard ne reflétait plus aucune vie et ne renvoyait plus aucune expression. Brûlés par le mélange bouillant et attaqués par la soude, ses yeux s’étaient marbrés d’un voile blanc opaque. S’il percevait peut-être encore quelques flashs lumineux, il était désormais incapable de distinguer quoi que ce soit. À jamais. Cet homme ne verrait plus, et personne ne pouvait plus rien y faire.
Encore un gros gâchis, songea Al Mansour en soupirant.
Tout se serait passé différemment s’il avait accepté l’offre qu’il lui avait faite trois semaines auparavant. C’était un de ses derniers concurrents sur le marché du savon d’Alep. Il possédait une vieille entreprise familiale au nord de la ville et son carnet d’adresses, rempli par trente années d’efforts ininterrompus, lui assurait une part du gâteau non négligeable. Al Mansour ne voulait rien laisser au hasard. Il avait besoin d’une maîtrise totale des exportations. Aussi lui avait-il fait une offre honnête pour racheter son atelier et sa clientèle sans éveiller les soupçons. Flairant la bonne affaire et se retranchant derrière son attachement à l’affaire fondée par son grand-père, son concurrent s’était montré bien trop gourmand. Et alors qu’il commençait à un peu trop ébruiter la proposition, Al Mansour avait dû se résoudre à appliquer une de leurs méthodes moins conventionnelles, qu’ils réservaient habituellement aux riches héritiers pour alimenter leurs caisses noires à coups de demandes de rançon.
— Tu aurais dû accepter mon offre Ali, celle-ci sera beaucoup moins avantageuse pour ta famille, soupira-t-il en fixant un document sur un support d’écriture et en sortant un crayon de sa poche.
Il fit un léger signe de tête à l’un des deux gardiens qui, d’un geste vif, sortit une longue dague de l’étui qu’il portait à la ceinture et trancha d’un coup sec le lien en plastique qui retenait les mains d’Ali. Il prit ensuite le stylo que tendait Al Mansour, le lui mit dans la main et la positionna au bas du contrat.
— Tu sais ce qu’il te reste à faire, lui dit Al Mansour. Tu signes ce document et on te renvoie dans ton usine. Tes ouvriers te trouveront demain matin, inconscient, gravement brûlé et intoxiqué. Un accident bête, comme il en arrive souvent dans nos ateliers. Un peu d’inattention, une glissade, et tu es tombé dans une des cuves. Le temps de te débattre pour t’extirper du bouillon, c’était trop tard, le liquide avait déjà attaqué tes muqueuses. Ou alors, tu refuses de signer et, pour toi, ce sera terminé. Par contre, cela ne fera que commencer pour tes fils qui hériteront de tes responsabilités. Ils seront à ta place dès demain et, crois-moi, vous finirez par le signer cet acte de vente, acheva Al Mansour dans un regain d’énervement.
Il n’aimait pas en arriver là.
Il laissa planer un long silence pour que les images effectuent leur travail de sape dans l’esprit d’Ali. Celles de ses fils plongés dans les cuves bouillonnantes lui étaient bien sûr insupportables. Il ne pouvait pas laisser faire cela. Il n’avait plus le choix, il devait signer. Il leva la main tenant le stylo, qui avait fini par glisser du porte-document. Le plus petit des deux bourreaux replaça la pointe au bon endroit et, à contrecœur, Ali parapha le contrat qui le privait d’une grosse partie de son patrimoine.
Avec un léger sourire de satisfaction, Al Mansour récupéra le document signé et le remit dans sa sacoche.
— Voilà qui est plus raisonnable. Au moins, tu assures la sécurité de tes enfants.
Puis en se tournant vers les deux tortionnaires :
— Bien, emmenez-le en bas, il va encore nous servir un peu avant que l’on en termine.
Et il laissa ses hommes s’occuper de descendre Ali qui s’agitait en hurlant. Il venait de comprendre qu’ils n’avaient jamais eu la moindre intention de le laisser repartir. Son sort était scellé depuis le début, jamais Al Mansour ne prendrait le risque de laisser vivant un témoin susceptible de raconter quoi que ce soit de néfaste à son sujet.
CHAPITRE 3
Mathias était resté figé quelques minutes encore après la fin du reportage, la main toujours accrochée à la porte ouverte du micro-ondes.
Ahmed, qui avait fini par lever les yeux de son smartphone, avait bien essayé de lui soutirer quelques informations, mais il avait déjà la tête ailleurs. Le jeune médecin jeta la barquette de son repas sans même y avoir touché et se dirigea vers son casier pour enlever sa blouse et se rhabiller en civil, comme il aimait le dire quand il n’était pas à l’hôpital.
Sa garde était de toute façon finie depuis déjà plusieurs heures. Il prétexta un coup de fatigue passager et le besoin de rentrer se reposer pour prendre congé de son ami qui était de nuit cette semaine. Ahmed n’était pas dupe. Il le connaissait par cœur et avait l’habitude de le voir ruminer ses cas médicaux. Il comprenait bien qu’il s’agissait ici d’autre chose, mais il savait également qu’il ne servait à rien d’insister. Mathias ne lui confierait rien s’il ne l’avait pas décidé.
L’infirmier se contenta donc de lui dire :
— OK, repose-toi bien alors. J’espère que tu finiras par m’expliquer quelle mouche t’a piqué !
— Surveille bien M. Lelong, s’il te plaît, et bipe-moi si son état s’aggrave.
— Si son état s’aggrave, c’est plutôt la morgue qu’il faudra que j’appelle, ricana Ahmed.
Mathias soupira devant l’ironie de l’infirmier et se dirigea vers la petite porte munie d’un digicode et réservée aux employés. Cette sortie permettait d’accéder directement à la bouche de métro sans faire un détour d’au moins huit cents mètres par l’accueil de l’hôpital. Elle présentait également l’énorme avantage de ne pas passer devant le bureau du chef de service, qui semblait être toujours là, de jour comme de nuit, et qui n’aurait pas manqué de l’interroger longuement sur l’état de ses patients. Il était de ces gens qui avaient toujours une question à poser et qui la posaient toujours au mauvais moment. Mieux valait l’éviter ce soir, il ferait son compte rendu demain.
La nuit était déjà tombée quand le jeune médecin s’installa dans la rame. Il y rejoignit les quelques travailleurs anonymes aux visages inexpressifs qui n’avaient pas encore regagné leurs foyers. Mathias fut rapidement happé par le pouvoir hypnotique du métro et ferma les yeux pour profiter de ces instants perdus pour se requinquer.
La pensée de ce visage qui l’avait glacé quelques minutes plus tôt le sortit pourtant de ses rêveries. Il savait très bien où il devait aller, mais il était trop tard pour le faire aujourd’hui. Il devrait attendre le lendemain matin. Il n’était pas de garde, cela tombait bien. En temps normal, il serait quand même allé à l’hôpital, mais cette fois, il se contenterait d’appeler pour savoir où en était M. Lelong.
En sortant du métro, il prit un kebab en bas de chez lui, salua le vendeur qui le connaissait bien et monta directement dans son appartement.
Il jeta les clefs sur la console de l’entrée, laissa ses chaussures en plan sur le paillasson, à côté de ses baskets, et fila directement au salon.
Ce n’était pas la galerie des Glaces, mais Mathias aimait bien son logement. Il avait mis du temps à le dénicher et il était satisfait de sa trouvaille, même si le destin et la chance, si on pouvait le dire ainsi, y étaient pour beaucoup. Il avait soigné, il y avait trois ans, une vieille dame atteinte d’un lymphome. Le premier traitement s’était bien passé et elle était entrée en rémission. Elle était réapparue dans son cabinet quelques mois plus tard, profondément amaigrie et visiblement rongée par la maladie. En six mois, elle semblait avoir pris quinze ans.
Rechute foudroyante. C’est le terme qu’il avait employé après quelques examens complémentaires et cette fois, il n’y aurait malheureusement plus d’évolution favorable, avait-il ajouté lorsqu’il avait évoqué l’état de sa patiente avec Justine, sa fille.
Au fil des visites et des traitements, il avait d’ailleurs fini par sympathiser avec elle. De semaine en semaine, ils étaient devenus un peu plus que des amis. Un peu trop proches, même, selon les règles de déontologie de sa profession. Un soir de détresse, alors que le calvaire de sa mère touchait à sa fin, il avait invité Justine à dîner, puis à prendre un dernier verre. Une chose en entraînant une autre et l’alcool aidant, ils avaient fini la soirée chez elle dans une étreinte rendue torride par les vapeurs éthyliques qui les désinhibaient tous les deux. Il l’avait immédiatement regretté et, dès le lendemain matin, il lui avait expliqué que cela n’irait pas plus loin, qu’il avait eu un petit moment d’égarement et que cela ne devait pas se reproduire. Justine ne lui en avait pas voulu. Elle lui avait répondu qu’elle était parfaitement consentante, que c’était elle qui l’avait aguiché la veille et qu’elle avait juste cherché un peu de réconfort et de bon temps pour se changer les idées. Elle avait même ajouté dans un grand éclat de rire qu’il pouvait être rassuré, elle n’avait pas l’intention de l’épouser ! Mathias s’en était presque trouvé vexé, mais au moins, il n’aurait pas droit à un mini scandale dans les couloirs de l’hôpital.
Au cours de leurs longues discussions, Mathias avait évoqué ses interminables et infructueuses recherches d’appartement.
Quand sa mère eut rendu son dernier soupir, Justine lui proposa de venir visiter son appartement. Elle était fille unique et avait un salaire d’assistante de direction. Elle possédait déjà son propre logement et n’avait de toute façon pas les moyens d’en conserver un second. Compte tenu de la valeur estimée, elle dépassait très largement le plafond des abattements fiscaux et devait le vendre pour s’acquitter des droits de succession.
C’était exactement ce qu’il cherchait. Soixante-cinq mètres carrés dans Paris intra-muros, pas de gros travaux si ce n’est un léger rafraîchissement et un peu de décoration, un quartier populaire, mais stable et sans gros problèmes sécuritaires. C’était légèrement au-dessus de son budget, mais il avait consenti à quelques sacrifices et avait finalement réussi à convaincre son banquier.
Mathias posa son kebab sur le bar de la cuisine américaine pour aller se laver les mains. La vaisselle de la veille séchait encore dans l’évier. Des vêtements traînaient sur le dossier du canapé et des revues médicales se mêlaient à des magazines scientifiques entassés sur la table basse. Au milieu du salon trônait un écran à LED à la diagonale impressionnante. Haute fréquence, haute définition, 3D, le dernier cri en matière de téléviseurs. À ses côtés, une console de jeu récente et une dizaine de jeux vidéo empilés, certains n’étant même pas rangés dans leur boîte d’origine.
Le parfait appartement de célibataire.
Et c’était le cas. À trente-deux ans, Mathias continuait à se comporter en étudiant attardé et à courir d’aventure en aventure. Plutôt beau gosse, il n’avait jamais éprouvé de difficulté avec la gent féminine. Il était capable d’aborder sans complexe une fille qui lui plaisait dans la rue et savait aussi user des outils modernes – sites de rencontres et autres réseaux sociaux – pour parvenir à ses fins. Au grand dam de sa mère, il enchaînait donc les aventures d’un soir et ne parvenait pas à se fixer avec l’une d’entre elles. À ses yeux, aucune ne méritait qu’il s’attache.
Aucune, sauf Marie.
Marie, dont il avait un temps pensé qu’elle pouvait être la bonne. Avec elle, tout était différent. Elle le comprenait sans qu’ils aient besoin de parler. Quand il rentrait le soir après avoir perdu un patient, elle savait instinctivement comment réagir, et cela le rassurait. Sur leurs rares temps libres en commun, ils passaient des heures à se promener dans Paris sans destination précise. Ils éprouvaient le même plaisir simple à passer du temps ensemble. Ils se comprenaient et se complétaient, chacun devinant souvent les envies de l’autre. Dans leur intimité nocturne, il n’avait jamais connu extase plus forte que celle que lui procurait Marie. Là aussi, ils étaient à l’unisson, anticipant sans cesse leurs désirs mutuels. Tantôt mutine, tantôt fougueuse, elle était toujours capable de s’adapter aux circonstances et à l’ambiance du moment, ce qui la rendait encore plus désirable. Marie était même la seule qu’il eut jamais présentée à sa mère. Elles s’étaient immédiatement entendues. Une réelle complicité unissait les deux femmes les plus importantes pour Mathias. À tel point qu’il se sentait parfois exclu lorsque, lors de leurs repas dominicaux, un regard leur suffisait à éclater de rire après une de ses réactions. Il se renfermait alors, et elles riaient plus encore.
L’idylle avait duré un peu plus de deux ans. Puis, petit à petit, ils avaient commencé à s’éloigner. D’abord de manière imperceptible. Des petites attentions du quotidien qui disparaissaient les unes après les autres, des rendez-vous nocturnes de moins en moins réguliers et passionnés, des priorités professionnelles plutôt que leurs flâneries parisiennes. Marie était journaliste, une excellente journaliste, pour ce que pouvait en juger Mathias et d’après les échos qu’il avait pu glaner dans la profession. Au fil des années, à force de travail et d’acharnement, elle s’était fait un nom dans le métier. Elle avait commencé comme pigiste dans un grand journal à couverture nationale. Ses papiers avaient vite rencontré un certain succès, tant auprès des éditorialistes que des lecteurs, et le journal avait fini par lui confier des articles plus complexes nécessitant un investissement total.
Au même moment, Mathias avait terminé ses longues années d’internat et avait été titularisé. Et tandis que Marie insistait depuis plusieurs mois pour que leur relation passe à la vitesse supérieure, orientant même de manière régulière la conversation sur son désir de maternité, alors que Mathias sentait petit à petit ses défenses céder, ils avaient finalement vu leur couple s’étioler, happé par la frénésie du quotidien. Tant et si bien qu’un soir, après une de leurs énièmes prises de bec devenues trop fréquentes, elle avait fait ses valises et était partie. Elle allait s’engager dans une enquête longue et fastidieuse sur les filières de prostitution d’Europe de l’Est et devait s’absenter plusieurs semaines, plusieurs mois peut-être, pour mener ses investigations. Elle travaillait souvent en immersion totale pour écrire ses papiers, meilleur moyen de décrire la réalité au plus près, mais méthode la plus risquée pour sa santé physique et psychologique sur de tels sujets. Elle revenait souvent très marquée et, à chacun de ses retours, Mathias saisissait des ombres dans son regard qu’il ne voyait pas auparavant. Pour cette enquête, elle ne voulait pas s’encombrer en plus d’une relation compliquée à gérer à distance. Elle y avait cru, mais leur histoire ne menait nulle part, lui avait-elle dit, les larmes aux yeux, en quittant son appartement.
Il n’avait pas pu, pas su la retenir. Il n’avait trouvé ni les mots ni les gestes qui l’auraient convaincue de faire demi-tour. Pourtant, il savait qu’elle n’attendait qu’un signe de sa part, comme un ultime test, une ultime preuve de son attachement. Il n’avait pas réagi.
Ils n’avaient plus eu de contacts pendant près d’un semestre. Après des mois de travail, elle avait publié un long article bouleversant, encensé par toute la profession. Son papier avait été repris par le Times en Angleterre et avait été cité dans plusieurs quotidiens américains, qui avaient tous salué la qualité de ses recherches.
Ils avaient fini par se revoir, d’abord juste pour un café alors qu’elle était passée à l’hôpital visiter un collègue souffrant. Et ils étaient finalement devenus d’excellents amis. Ils se voyaient régulièrement, partageaient leurs doutes et leurs peines, mais cela n’allait pas plus loin. Elle n’avait plus la même étincelle dans le regard quand elle le contemplait. Elle ne parlait jamais de son long séjour entre l’Ukraine et la Pologne, mais, depuis son retour, les ombres étaient bien plus présentes dans ses yeux. Ses traits s’étaient durcis et elle avait perdu une partie de cette insouciance que Mathias aimait tant. Ce voyage l’avait définitivement changée et avait laissé en elle des traces visibles et indélébiles pour qui, comme lui, savait l’observer. Il leur arrivait quand même, de temps à autre, de passer la nuit ensemble. Pour l’hygiène, comme elle aimait lui dire avec un sourire coquin.
À côté du téléviseur que Mathias venait d’allumer, il avait conservé une photo d’eux – enlacés devant une mer déchaînée s’attaquant au granit des côtes bretonnes – prise lors d’une de leurs trop rares escapades. Il aimait contempler cette photo, qu’il ne cacherait pour rien au monde malgré les remontrances systématiques et plus ou moins directes de ses conquêtes, qu’elles soient jalouses ou non. Aucune n’arrivait à la cheville de l’étincelante jeune femme sur le cliché.
L’apparition à l’écran du visage qu’on aurait presque pu prendre pour son sosie, malgré l’évidente différence d’âge, le sortit de ses rêveries. Il réécouta attentivement le même reportage, mais on n’y apprenait en définitive pas grand-chose.
Quelques éléments avaient fuité du côté des services de renseignements français. Ils suspectaient l’homme d’avoir rejoint la Syrie depuis longtemps pour gonfler les rangs d’un groupe terroriste local qui avait pris une ampleur bien trop grande aujourd’hui. Son identité réelle restait un mystère et il était probable que son apparition en une des journaux télévisés avait pour unique but de récolter un maximum de témoignages de gens pensant le reconnaître. Parmi les dizaines d’appels farfelus, de paranoïaques croyant y voir le voisin qu’ils avaient toujours trouvé louche ou de théoriciens du complot jurant qu’il s’agissait d’un membre des forces spéciales, il y avait toujours quelques informations intéressantes méritant d’être creusées. C’est ce que lui avait appris Marie : les enquêteurs possédaient des techniques et questions simples permettant de faire un tri immédiat et d’identifier les déclarations dignes d’intérêt.
L’homme, disaient-ils, faisait partie d’une branche en plein essor prônant la lutte sans limites sur le territoire occidental, la guérilla urbaine et les attentats les plus meurtriers possibles. Ce groupe était suspecté d’avoir fait dérailler un train de banlieue à Londres le mois dernier, provoquant ainsi la mort de quarante-cinq personnes et en blessant des dizaines d’autres. Il avait également ouvertement revendiqué un attentat à la voiture piégée sur le vieux marché d’Istanbul quatre mois auparavant et dont le bilan officiel dépassait les cent vingt victimes. Enfin, les services officiels le soupçonnaient de préparer des actions de grande envergure, dont l’homme sur la photo pourrait être une pièce maîtresse.
Le présentateur était déjà passé à un autre sujet : les résultats de football dans les principaux championnats européens. C’était l’actualité moderne : une juxtaposition de dizaines d’informations sans aucune espèce de gradation et sans gestion de priorité. Le scoop était retranscrit en l’état, brut. L’important était surtout d’être le premier à le repérer sur les réseaux sociaux et à le mettre à l’antenne. Quitte à faire fi de toutes les vérifications nécessaires et à commettre d’énormes bourdes éditoriales en publiant de fausses informations.
Mathias, lui, voulait en savoir plus. Il extirpa sa tablette de l’amoncellement de magazines et lança le nom du terroriste présumé sur plusieurs moteurs de recherche. Après une demi-heure de lecture, il n’était pas plus avancé. L’homme était apparemment haut placé dans l’organisation terroriste, sans toutefois en être un des leaders. Il semblait être apparu aux yeux du monde assez récemment, sans qu’on ne sache quoi que ce soit sur son histoire ni sur son passé, et aucune autre photo n’était disponible. La seule que l’on retrouvait sur tous les sites spécialisés était celle qui venait d’être présentée par les chaînes d’infos en continu.
Mathias éteignit sa tablette et resta songeur un moment. Ce visage le perturbait toujours autant. Demain, il irait rendre visite à sa mère dans son petit pavillon des Yvelines.
CHAPITRE 4
Al Mansour observait toujours la chaise sur laquelle se trouvait Ali quelques minutes auparavant. Comme le sol alentour, elle portait les traces de la séance de torture qui venait de s’y tenir. Les taches de sang se mêlaient aux sécrétions que le malheureux n’avait pu retenir sous l’effet conjugué de la peur et de la douleur. Dans quelques minutes, ses hommes remonteraient pour effacer toutes les traces suspectes et, bien avant que les ouvriers de la savonnerie ne prennent leur service, il n’y paraîtrait plus. Comme à chaque fois, personne ne se douterait de rien.
Al Mansour secoua la tête en soupirant et se dirigea vers le fond de la pièce. Il passa l’angle où venaient de disparaître Ali et ses deux hommes de main et déboucha sur un long couloir sombre. Un bric-à-brac insensé s’entassait le long des murs : outillages de découpe, vieux fers à marquer, cuves en cuivre en partie percées et hors d’usage, et bennes à déchets remplies de fabrications ratées. Personne ne souhaitait se lancer dans le ménage de cette zone et cela l’arrangeait. Il se gardait bien de donner des directives dans ce sens. Au fond du couloir, derrière une benne contenant des savons secs et cassants, probablement là depuis des années, se trouvait une petite porte en bois qui semblait n’avoir jamais été ouverte. Al Mansour appuya sur le loquet et poussa le panneau qui pivota sans un bruit sur des gonds parfaitement huilés. L’ouverture donnait sur un petit débarras où s’amoncelaient seaux et balais ainsi qu’une vieille caisse à outils sur une étagère branlante. Une partie du mur opposé était recouverte d’une tenture poussiéreuse représentant la vieille citadelle d’Alep à son heure de gloire.
Il s’avança vers le fond de la pièce et écarta d’une main le voilage. Derrière ce rideau improvisé se trouvait une double porte métallique avec, sur le côté, un petit boîtier électronique muni d’un clavier numérique, présence complètement anachronique dans ces murs multicentenaires. Al Mansour y tapa un code à cinq chiffres et un « bip » retentit en même temps qu’un voyant vert s’allumait sur le petit écran. Les bruits d’une machinerie qui se mettait en branle se firent entendre, à peine étouffés par les épais murs de pierre.
Le vacarme s’estompa au bout de quelques secondes et les deux panneaux finirent par coulisser pour laisser le passage. Al Mansour s’engagea dans l’ascenseur en relâchant l’étoffe qui revint à sa position initiale, rendant à nouveau invisible l’accès qu’il venait d’emprunter. Le panneau de commandes à l’intérieur ne comprenait que deux boutons : une flèche vers le haut et une vers le bas. Il activa la descente et ferma les yeux, songeur, en s’adossant à la paroi de la cage d’acier.
Le trajet ne dura que quelques secondes, à peine le temps de sentir quelques picotements au creux du ventre, caractéristiques des changements rapides d’altitude. La cabine se stabilisa et les portes se rouvrirent sur un nouveau passage verrouillé. Le point lumineux d’une petite caméra de surveillance clignotait au coin de l’étroit réduit, braquant son œil cyclopéen sur tout visiteur qui sortait du monte-charge.
Un nouveau code, tapé sur un autre clavier, permit à Al Mansour de franchir cette nouvelle étape pendant que les portes de l’ascenseur se refermaient.
Il déboucha sur une gigantesque salle voûtée, vestige antique des fondations d’Alep. Le long des murs en pierre, plusieurs cubes de verre étaient alignés de part et d’autre de l’unique accès à la salle circulaire. Ils étaient tous de construction identique. Pour y accéder, il fallait passer par un sas au-dessus duquel tournait un énorme ventilateur capable de générer, au besoin, une aspiration quasi immédiate de l’air s’y trouvant. Deux sprinklers au plafond permettaient également l’aspersion rapide d’un agent décontaminant. Un portant chargé de quelques combinaisons médicales étanches en constituait l’unique mobilier. L’équipement était relié par un épais tuyau à une centrale de ventilation qui isolait complètement son porteur de l’air de la pièce. Une fois cette antichambre franchie, les cellules de verre de quelques mètres carrés étaient toutes agencées tel un mini studio : un coin douche-W.C., une table spartiate en métal et un petit lit dans un coin. Certaines cabines étaient occupées, pas toutes. Les systèmes d’aération et d’aspiration de toutes les cellules se rejoignaient au plafond en un enchevêtrement énorme de tuyauteries qui disparaissaient dans l’ombre de la cave. À l’entrée de chaque pièce utilisée, un panneau tactile renvoyait un certain nombre de courbes et d’informations clignotantes rappelant les écrans d’une salle de réanimation.
Au centre de la salle trônait une immense estrade hexagonale, elle aussi pourvue d’un sas d’accès et ceinte d’épais murs de verre. À l’intérieur, on apercevait des paillasses chargées de tubes à essai et autres boîtes de Petri, ainsi que plusieurs armoires frigorifiques, des microscopes électroniques à balayage et des machineries impressionnantes dignes des meilleurs laboratoires de génie génétique.
Al Mansour posa sa sacoche sur un des bureaux situés au pied de l’estrade. Il alluma l’ordinateur qui s’y trouvait et, en attendant qu’il démarre, se dirigea vers le fond de la salle. Ses hommes étaient en train d’installer Ali dans un cube surmonté d’une petite plaque portant le numéro treize. La porte était ouverte, les essais n’avaient pas commencé et le protocole permettait pour l’instant un accès libre. Ali n’était plus agité. Résigné, il se laissait faire, attendant juste de savoir quelle fin lui était réservée, puisque celle-ci semblait maintenant inéluctable. Ils lui avaient fait prendre une douche et l’avaient obligé à enfiler un simple pyjama blanc.
— Servez-lui un repas et laissez-le se reposer, on ne commencera que demain, annonça Al Mansour tout en enregistrant quelques informations sur l’écran de contrôle de la cellule : nom du sujet, date, âge, corpulence… tout ce qui lui permettrait ensuite d’affiner ses études statistiques.
Puis, il se dirigea vers les autres cellules et entama sa tournée quotidienne, tel un médecin prenant soin de ses patients. Il ne s’arrêta pas devant le cube numéro douze, dont la porte était ouverte et l’écran de contrôle éteint et se rendit directement au pupitre du suivant.
Sur le grand écran de commandes s’affichait une multitude de chiffres, pour la plupart incompréhensibles aux non-initiés. Au centre de l’écran, un élément attirait immédiatement l’attention. Une alarme lumineuse clignotait en rouge devant une courbe parfaitement horizontale. Al Mansour ferma le message qui recouvrait une partie de l’écran et accéda au détail du graphique. Il remonta l’historique jusqu’au moment où le tracé se figeait. L’échelle temporelle plaçait l’événement une vingtaine de minutes plus tôt. Sur les divisions précédentes, le tracé présentait des pics réguliers qui allaient en faiblissant et en s’aplatissant, jusqu’à disparaître totalement. C’est là que le cœur du pensionnaire s’était arrêté.
Al Mansour consulta encore quelques résultats, puis entra dans le sas du cube numéro onze. Une fois à l’intérieur, il enfila une des combinaisons accrochées le long de la paroi. Il vérifia minutieusement toutes les fermetures garantissant son étanchéité et poussa un gros interrupteur carré avant de se placer au centre du réduit de verre. L’énorme soufflerie qui surplombait la pièce s’activa dans un grondement sourd. Pendant une minute complète, les ventilateurs aspirèrent bruyamment l’air et la moindre particule se trouvant dans le petit espace. En soixante secondes, l’atmosphère du sas d’accès avait été totalement renouvelée et débarrassée de tout élément susceptible de perturber l’équilibre, d’un côté comme de l’autre. La cellule était ainsi parfaitement hermétique et privée de tout contact avec l’extérieur.
Al Mansour attendit encore quelques secondes, le temps d’un dernier cycle de vérifications, et entendit le déclic signalant la libération du loquet électronique permettant l’accès à l’intérieur du cube.
Il poussa la porte et s’engagea dans la pièce exiguë. Une forme recroquevillée gisait sur le petit lit de camp. De grandes marques sombres tachaient les draps et le pyjama blanc du corps inerte. En s’approchant, Al Mansour constata que le sol était lui-même couvert de grandes flaques visqueuses sous le couchage. Il évita les mares rougeâtres et s’approcha de la couche.
Le corps allongé, visiblement un homme au vu de sa carrure, était tourné vers le mur, le visage contre la paroi vitrée. D’un geste sûr, Al Mansour l’agrippa par l’épaule et la hanche et le fit pivoter pour le mettre sur le dos. La raideur cadavérique commençait déjà à s’installer et il dut s’employer à le faire bouger. Malgré l’habitude, il ne put réprimer un léger haut-le-cœur quand le visage de l’homme lui apparut.
Par certains aspects, il ressemblait à tous les autres cadavres qu’il avait pu côtoyer jusqu’ici, dans cette vie comme dans la précédente : peau livide et froide et teint blafard semblable à celui d’une poupée de cire. Pas le genre de détails à surprendre un homme habitué à la vue des morts. Non, ce qui l’impressionnait à chaque fois, c’était le sang, les quantités de sang. Le t-shirt du malheureux n’avait plus rien de sa blancheur initiale. Une rivière pourpre semblait s’être déversée de sa bouche, se répandant sur son torse et les draps de son lit. Deux épaisses traînées déjà coagulées partaient de chacune de ses narines pour disparaître dans les plis de son cou. Ses oreilles semblaient également avoir servi de porte de sortie au liquide vital.
Le regard d’Al Mansour s’attarda alors sur celui de sa victime. Les yeux vides et sans vie fixant le plafond auraient presque pu paraître normaux, s’ils avaient été fermés… Ceux qu’il observait à cet instant n’avaient plus rien de naturel. Les pupilles dilatées à l’extrême ne permettaient même plus de distinguer la couleur initiale de l’iris. Mais le plus choquant, ce qui donnait son caractère démoniaque au regard cadavérique, c’était encore l’omniprésence du carmin qui les habillait. Il n’y avait plus un millimètre carré de blanc dans les yeux écarlates de cet homme qui avaient libéré en abondance des larmes de sang ayant laissé, le long de ses joues, de grandes traces d’hémoglobine séchée.
Al Mansour sortit de sa contemplation et, de manière très professionnelle, effectua une rapide inspection du corps. Pour terminer, il sortit d’une boîte blanche stérile qu’il avait apportée, une seringue et quelques tubes de prélèvements. Il ponctionna plusieurs éprouvettes, qu’il remit précautionneusement dans la boîte hermétique.
Une fois son inspection terminée, il ne s’attarda pas et se dirigea vers la sortie. Dans ce sens, une fois dans le sas d’accès verrouillé, l’aspiration ne s’enclencha qu’après la douche chaude et puissante jaillissant des sprinklers au plafond qu’il eut à subir. Il attendit patiemment la fin du processus et, après l’autorisation donnée par le système de surveillance, il remit la combinaison en place avant de ressortir à l’air libre.
Ses hommes patientaient, immobiles, devant les parois vitrées, attendant les ordres sans échanger un mot.
— Nettoyez-moi cette chambre, leur ordonna-t-il en passant devant eux sans même leur jeter un regard.
Il était absorbé par ses pensées, entièrement tournées vers la petite boîte étanche contenant les prélèvements sanguins qu’il tenait entre les mains.
Les deux hommes n’avaient pas besoin de plus d’explications, ils savaient parfaitement ce qu’ils avaient à faire. Ils n’en étaient pas à leur coup d’essai. Comme des dizaines de fois auparavant, l’un d’eux allait enfiler une combinaison pour entrer dans la pièce. En général, ils jouaient ce rôle au poker, le perdant de la partie de la veille se trouvant chargé de la tâche ingrate. Il emmenait avec lui un grand sac en plastique épais totalement imperméable dans lequel il faisait disparaître le corps exsangue du malheureux. Puis, dans un grand sac-poubelle de la même matière, il entassait les rares objets de la pièce : draps, oreiller, et même le mince matelas en toile. Après avoir scellé les sacs avec une pince chauffante, tel un charcutier, il repassait l’ensemble par le nettoyage intégral et avec l’aide de son acolyte qui attendait dehors, ils emmenaient le tout dans une pièce attenante, dont la porte discrète passait presque inaperçue derrière les cages de verre.
L’ensemble y était alors incinéré. Les hautes températures suffisaient à faire disparaître tout risque de contamination avant même que les emballages n’aient commencé à fondre. En quelques minutes, il ne restait plus aucune trace de ce qui était, il y avait encore quelques jours, un honnête travailleur, un malheureux sans-abri ou même un père de famille dévoué.
Cela faisait bien longtemps que les disparitions mystérieuses ne surprenaient plus personne à Alep. Les années de guerre et les déchirements des factions en présence laissaient tellement de coupables possibles qu’il était vain de s’acharner. Rares étaient les familles qui cherchaient leurs proches disparus. Résignées et craignant des représailles du pouvoir en place ou des demandes de rançon des assaillants, elles préféraient souvent taire les disparitions, se bornant à espérer que le captif parvienne seul à s’échapper et revienne sain et sauf. Ce qui n’arrivait jamais.
Cette situation convenait bien à Al Mansour. Il pouvait ainsi prélever à sa guise tous les sujets dont il avait besoin pour mener ses expériences. Au fil des mois et des années, il avait arrêté de compter les corps qui avaient fini en cendres dans son incinérateur. Hommes, femmes, et même enfants parfois. Jeunes, vieux, en bonne santé ou grabataires, tous les profils étaient passés par cette cave. Il avait besoin d’un maximum de données cliniques pour mener à bien ses projets.
Sans même se retourner, il ajouta :
— Nous aurons également besoin d’un nouveau sujet pour demain quand vous aurez terminé.
CHAPITRE 5
Mathias se leva plus tard que d’habitude, ce qui était chose rare. D’ordinaire, quand il n’était pas de garde, il en profitait en général pour aller courir longuement sur les bords de Seine. Mais aujourd’hui, c’était différent. Pas le temps pour son footing, mais pas la peine non plus de partir à l’aube. Sa mère n’avait jamais été une lève-tôt, c’était encore pire depuis qu’elle était à la retraite.
Bien que plus longue, sa nuit n’en avait pas moins été agitée, hantée par ce visage se penchant au-dessus de lui. Assis sur un tabouret haut, il songeait encore à ses rêves étranges en buvant son café. C’était bien l’homme qu’il avait aperçu à la télévision la veille, mais il avait quelque chose de différent. Les cheveux moins blancs et mordant un peu plus sur son front, des rides moins prononcées et une multitude de petits détails quasi imperceptibles lui donnaient une apparence plus jeune et plus familière.
L’horloge du four indiquait neuf heures et demie. Mathias avala la dernière gorgée de son café, posa sa tasse au milieu de la vaisselle de l’avant-veille séchant toujours dans l’évier et fila vers la salle de bains. Pas question d’aller voir sa mère sans être propre et rasé de près. Cela lui éviterait au moins les discussions inutiles sur son allure indigne de son rang, selon elle…
Une fois présentable, il attrapa ses clefs et sortit pour rejoindre son garage. Il louait un emplacement à deux pâtés de maisons, dans lequel il laissait moisir une vieille Peugeot. S’il n’y avait eu sa mère, il se serait débarrassé depuis longtemps de cette voiture. Il sortait rarement de Paris et, s’il devait voyager, les transports en commun étaient bien plus pratiques pour se rendre à l’aéroport ou à la gare. Pour couronner le tout, son tas de boue lui coûtait une fortune en entretien et en parking, alors qu’il ne le sortait guère plus qu’un dimanche sur deux pour ses visites habituelles. Seulement, sa mère habitait toujours leur modeste pavillon au fin fond des Yvelines, dans un coin particulièrement mal desservi. S’il ne mettait qu’une petite heure pour s’y rendre en voiture le week-end, il fallait multiplier son temps de trajet par quatre s’il devait emprunter métro, RER et TER. Et il devait encore finir les deux derniers kilomètres à pied.
Il était bientôt midi quand il se gara devant la petite maison. Il ne l’avait pas prévenue. Sa mère allait être surprise, mais il lui arrivait assez régulièrement de passer la voir à l’improviste. Comme d’habitude, elle lui reprocherait de n’avoir rien dit, de ne pas avoir au moins appelé en partant, et que donc elle n’avait pas grand-chose à lui offrir pour le déjeuner. Et comme d’habitude, elle trouverait dans son frigo de quoi lui préparer un véritable festin, bien trop pour un repas pour deux, et elle serait ravie.
Mathias sonna et entra directement comme il en avait l’habitude.
— Bonjour, maman, c’est moi ! lança-t-il en accrochant sa veste au portemanteau de l’entrée.
Sa mère apparut à la porte de la cuisine.
— Mathias, pourquoi ne m’as-tu pas prévenue que tu passais aujourd’hui ? Je n’ai rien préparé !
Malgré ses soixante ans passés, elle restait une très belle femme. Le temps et les épreuves ne semblaient pas l’atteindre à première vue. Mathias remarqua toutefois immédiatement qu’elle avait sensiblement maigri. Une profonde mélancolie émanait de son regard bleuté pour qui prenait la peine de l’observer attentivement. Après la mort de son mari, elle ne s’était jamais remariée et avait élevé seule son fils unique. Mathias s’était souvent demandé si elle avait, durant toutes ces années, rencontré d’autres hommes avec qui elle avait envisagé de refaire sa vie. En tout cas, elle n’en avait jamais rien montré. Par respect pour son père, sans doute, ou peut-être par peur de la réaction de son fils. Il n’avait pas toujours été tendre avec elle, et il lui avait fallu du temps pour se rendre compte du courage dont elle avait fait preuve pour faire face. Selon Nietzsche, ce qui ne vous tue pas vous rend plus fort. Peut-être… Mais ce qui ne vous tue pas laisse aussi de profondes cicatrices qui ne se referment jamais et qui sont souvent difficiles à surmonter, trop pour ceux qui ne sont pas suffisamment armés pour affronter leurs souffrances. Mathias ne le savait que trop.
Sa mère s’approcha de lui d’un pas léger et lui adressa un grand sourire en l’embrassant. Derrière l’habituel reproche, elle n’en demeurait pas moins toujours enchantée de le voir, même à l’improviste. Ses journées de retraitée étaient bien remplies – elle avait une vie sociale très active – mais une visite de son fils passait toujours avant le reste.
— Viens prendre un café à la cuisine, lui dit-elle en le prenant par le bras. Je vais voir ce que je peux te préparer de bon. Il doit me rester un tournedos.
Pendant qu’elle préparait le repas, ils discutèrent distraitement de choses et d’autres. Elle lui donna les dernières nouvelles de la famille, il fit mine de s’y intéresser. Elle lui demanda comment cela se passait à l’hôpital et s’il avait sauvé beaucoup de vies cette semaine. Il lui parlait rarement des patients qu’il perdait et s’étendait plus volontiers avec elle sur ceux qu’il parvenait à guérir. Cela la rendait extrêmement fière et elle racontait souvent autour d’elle, un peu trop à son goût, quel médecin formidable il était. Quelque part, c’était aussi sa vengeance à elle. Son fils œuvrait au quotidien pour éradiquer la maladie qui l’avait privée de l’homme qu’elle aimait. Rien ne pouvait plus la ravir.
De son côté, elle lui raconta sa semaine et sa dernière sortie avortée avec madame Michaud, sa voisine, qui s’était cassé le col du fémur en trébuchant sur un trottoir devant la boulangerie.
— Quelle plaie ces trottoirs, ils sont de moins en moins bien entretenus. La coiffeuse m’a dit que c’était la troisième fois ce mois-ci que les pompiers ramassaient quelqu’un dans cette rue. Et comme d’habitude, ce sont les anciens qui trinquent, conclut-elle en souriant.
Mathias avait déjà entendu cette histoire au téléphone en début de semaine, mais peu importait. Il écoutait religieusement sa mère et la taquinait de temps en temps :
— Fais attention la prochaine fois que tu achètes ton pain, ce sera peut-être toi la prochaine petite vieille que les secours emmèneront !
Mais ce jour-là, il n’y était pas vraiment. Il avait encore l’esprit tourné vers le visage de l’inconnu. Et elle s’en rendit compte inévitablement. Une mère sait toujours quand son enfant est préoccupé, quelle qu’en soit la raison. Il avait beau se persuader que ses émotions étaient invisibles et bien enfouies, elles restaient d’une évidente clarté pour celle qui l’avait mis au monde. Elle savait mieux que quiconque décrypter et comprendre tous ces petits signes imperceptibles.
— Quelque chose ne va pas mon chéri ? Tu as l’air soucieux, lui demanda-t-elle à brûle-pourpoint.
Elle n’était d’autant pas dupe qu’elle le voyait de temps à autre dans cet état d’esprit.
Sa mère ne lisait pas les journaux et regardait très peu la télévision. Elle préférait se tenir informée de l’actualité en discutant avec ses amies lors de leurs sorties quasi quotidiennes. C’était risqué, l’information subissant un premier filtre parfois loin d’être pertinent avec certaines d’entre elles ; mais en recoupant les différentes versions, elle parvenait toujours à avoir une vision au plus juste, qu’il s’agisse de l’état du monde, de la France, ou des derniers ragots du village. À bien y réfléchir, c’était peut-être plus efficace que de lire tous les matins le même journal à la ligne éditoriale très orientée. Et c’était à coup sûr bien plus judicieux que les moyens modernes utilisés par les générations actuelles. Réseaux sociaux et autres forums ne renvoyaient souvent qu’un flot monstrueux de révélations sans intérêt. Celles qui auraient mérité qu’on s’y arrête se perdaient dans la masse et n’avaient que rarement le traitement qu’elles nécessitaient. La course au buzz était devenue plus importante que la fiabilité du sujet. Peu importait si ce n’était pas vérifié tant qu’on était le premier à le répandre. Ces articles postés à la va-vite étaient ensuite suivis de leur litanie de commentaires plus ou moins haineux, laissés par des lecteurs aigris et limités, à qui on ne donnait plus les clefs pour décrypter ce monde en mouvement perpétuel. L’anonymat du clavier déliait les langues et libérait toutes les lâchetés. Peu importait la teneur du discours, personne ne savait qui le prononçait.
Mathias se demandait souvent, en parcourant ces forums et la liste des avis peu éclairés qui suivaient un article quel qu’il soit, sportif ou politique, si cela ne reflétait pas finalement l’état réel de la France et de ses pensées. Ou peut-être que les gens modérés et réfléchis ne perdaient juste pas leur temps à donner des opinions qui n’intéressaient personne. Peut-être était-ce juste là l’exutoire de ceux qui n’avaient rien à dire.
Aujourd’hui, en tout cas, il était très improbable que la mère de Mathias ait vu les reportages qui tournaient en boucle depuis la veille. Ce n’était donc pas la peine de l’inquiéter inutilement et de lui avouer ce qui le tracassait réellement.
— Non, non, tout va bien. Les derniers jours ont été un peu difficiles à l’hôpital, c’est tout.
Et il ne lui mentait pas en disant cela.
Pas complètement convaincue, elle jeta un œil vers lui par-dessus son épaule, comme pour jauger le niveau de vérité de ce qu’il venait de lui répondre. Elle n’insista pas et changea de sujet.