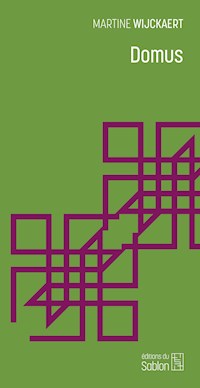
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Weyrich
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Domus, maison.
« Nous sommes à la maison » et « Journal d'Yvonne », deux récits du temps domestique, deux récits de maisons familiales saisies au travers d'une réalité anamorphosée. Deux maisons donc, l'une de peu, l'autre d'opulence, mais l'une comme l'autre territoire des vivants qui dansent avec des spectres, l'une comme l'autre territoire d'héritage et de transmission.
Domus, deux maisons, l'une où l'on doit tuer pour vivre, l'autre où l'on doit demeurer pour mourir. Des textes à la sauvagerie poétique, organique et crue – où des lumières insolentes jaillissent de la fange et de l’effroi. Des textes de résistance aux conformismes et normes aseptisées.
À PROPOS DE L'AUTEURE
Martine Wijckaert, née à Bruges le 27 août 1952, metteure en scène, auteure, pédagogue. En 1974, elle fonde le théâtre de la Balsamine où elle travaille toujours en qualité d’artiste associée. Elle vient à l’écriture par la scène, avec plusieurs textes dramatiques, ensuite et en parallèle, avec des textes à lire.
Table des Matières a reçu le prix Communauté française de la première œuvre publiée, en 2009. Le texte a également été sélectionné par la Convention Théâtrale Européenne au titre de meilleure pièce belge francophone.
Trilogie de l’enfer a reçu le Prix Triennal de Littérature dramatique en 2015.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 170
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Nous sommes à la maison
Prélude
Dans la forêt I
Trop vite, toujours trop vite, tu cours toujours trop vite dans les bois, mon enfant. Si vite que je te perds. Je te perds, mon enfant, moi qui n’ai plus le souffle de te suivre, stoppée net à l’orée du bois, avec les poumons claqués entre les mains. Je ne te vois plus. Toi qui dois déjà être là où le bois se dissout en larges et profondes forêts, mon enfant, à l’instant précis de l’éclair qui menace puis déchire le tableau. Alors, la clarté de l’éclair te montre, immobile devant toi, mon enfant, un cerf décoiffé. Le cerf te regarde, puis s’enfonce dans le réduit confidentiel de la futaie, sa demi-ramure t’avertit qu’il est temps, à présent, de rentrer à la maison.
Cependant, l’enfantine enfant ne rentrera pas à la maison. Le cerf décoiffé la laisse à deux genoux sur la terre des forêts.
Pareille indignité, si fâcheuse, si pitoyable, pareille indignité venue frapper le cerf, se murmure l’enfant désormais grelottante sur la terre des forêts. Et la nuit tombe, de la cime jusqu’à la terre des forêts. Viennent ensuite les bruits du noir de la nuit. L’enfant s’est remise en marche, son petit ventre vide depuis le midi gargouille ferme dans les bruits du noir de la nuit. Toujours en marche, à l’aveuglette, l’enfant arrache des touffes d’herbe et de mousse et les mange. Comme c’est âcre, se dit l’enfant, si âcre que j’ai besoin tout à coup de faire caca, oui c’est ça, je dois faire caca, c’est la mousse, c’est l’herbe qui filent grand train à l’intérieur de moi, juste le temps de m’accroupir avec la petite culotte sur les chevilles et tout ressort au son déchirant d’une grosse trompette. Il faut à présent que je me nettoie avec une petite flaque d’eau qui doit stagner quelque part dans une ornière, il faut chercher, accroupie en retenant avec soin ma petite culotte et le bas de ma jolie robe bleue.
Ainsi l’enfant cherche la flaque dans l’ornière, puis voit la flaque qui scintille dans le noir de la nuit et elle s’en approche, dodelinant comme un canard avec petite culotte sur les chevilles et bas de robe rabattu. Ainsi l’enfant plonge une main dans la flaque, asperge ensuite consciencieusement ses petites fesses souillées.
Un claquement sec tranche la nuit, emplit de terreur l’enfant, toute à ses ablutions. Dans le silence brutal qui succède au claquement, l’enfant en plein émoi bascule cul en terre, quelque chose l’a happée par derrière, quelque chose de glacé qui en se refermant avec un bruit de mâchoires lui mord le bas de la robe et avec ce bas, le bout le plus tendre et charnu de ses fesses fraîchement ondoyées. Aïe, aïe, aïe, mais le son du cri ne parvient pas à sortir de la gorge de l’enfant qu’une cuisante douleur transperce en une seule seconde des fesses jusqu’aux tempes ruisselantes.
C’est quoi cette chose glacée qui me mord et m’aspire en terre, je vois du rouge épais qui dégoutte sous moi et mon cœur y battre, mais c’est du sang, mon Dieu, du sang, mon sang bien en train de s’échapper de moi, par le bas, mon sang bouillonne sur les lèvres closes d’une sorte de gueule en ferraille qui s’est refermée sur mon derrière en m’en raflant un bout, je pourrais enfoncer le doigt dans le trou de ce qui me manque et d’où le sang file comme d’une source en crue.
Même dans la terreur, sois téméraire, enfant, se dit-elle, on ne meurt pas dans le noir de la nuit des forêts, même seule, même dévorée par des gueules en ferraille qui ne sont qu’abjecte manufacture humaine car un perfide et cruel piège à loups s’est refermé sur le plus tendre morceau de mon popotin dénudé, et je saigne d’abondance dans la tranchée des ornières sylvestres. Il faut bourrer la plaie avec un morceau de ma robe comme on bourre la bouche des morts avec de l’ouate.
Ainsi l’enfant s’applique à cette tâche, elle se soigne, farouchement, elle s’ensauvage. Elle est comme une petite pygmée toute blanche, en pagne bleu ensanglanté dans le noir de la forêt.
Un nouveau claquement sec percute la nuit, un claquement sec qui laisse derrière lui un silence opaque, un silence d’extinction absolue, se dit la petite pygmée toute blanche, c’est comme si le monde entier avait succombé et me laissait seule dans une morgue désaffectée. Même dans la terreur, même blessée jusqu’au sang jaillissant, sois téméraire, enfant, se redit-elle, et continue, continue au travers des ténèbres en comprimant bien fermement ta fesse trouée.
Ainsi la petite pygmée blanche progresse à nouveau, elle claudique avec sa fesse trouée qui la transperce de longs traits fiévreux. Un halo butinant flageole loin devant elle, c’est une bulle de lumière qui va et vient entre les verticales des troncs hissés tandis que la morgue désaffectée se remet à bruire faiblement depuis cette bulle de lumière. D’abord de minuscules grincements, puis des bruits de batte que l’on assènerait sur une viande morte, puis encore l’expulsion gluante d’une flatuosité consistante semblant choir sur le sol. L’enfant s’avance vers cette scène qui se déploie dans une minuscule clairière. Il y a là, insoupçonnable, une minuscule clairière avec une maisonnette, couleur de pisse, se dit l’enfant. Une maisonnette assez moche avec une porte entrouverte et une fenêtre aux carreaux cassés, une maisonnette assez moche avec un lampion allumé à l’angle dans une myriade d’insectes déboussolés. À travers la fenêtre aux carreaux cassés, d’autres lumières saccadent, des bruits humains parviennent, chaotiques. Mais à l’extérieur de la maisonnette, dehors, contre la façade couleur de pisse, dehors et tout seul, la tête en bas et demi-couronnée, le cerf décoiffé est suspendu. Un long trait béant lui a ouvert le ventre, des testicules jusqu’au larynx, l’amas nacré et alvéolé de ses intérieurs violentés gît en tas luisant sur le sol, à l’aplomb de son mufle.
La petite pygmée toute blanche s’élance au-devant de ce qu’elle ressent comme un terrible sacrilège, elle empoigne respectueusement la masse de viscères, la glisse à l’intérieur du cerf, lui souffle dans les narines. Le ressusciter, se dit-elle, mais comme cette biologie est lourde et complexe, la vie ne revient pas, la vie ne revient plus, voici que de la panse ouverte tout retombe au sol et se livre au désordre de la mort, sous l’œil vitreux de la bête qui me regarde avec une larme confite au bord de la paupière, sa dernière larme, nourrie d’indignité et de solitude. Ainsi soliloque l’enfant, agenouillée devant la mort, au milieu de la nappe gluante de son sang qui s’écoule de l’orifice de sa petite fesse trouée. Quelle libation, se dit encore l’enfant, mon sang gorgé de globules et de paillettes vibrionnantes de vie se mélange aux humeurs mortes du cerf décoiffé, si cela continue d’abondance, je vais mourir à mon tour, vidée, muée en viande blanche prête à l’emploi. Je vais mourir à genoux, dans la clairière à la moche maisonnette couleur de pisse, je vais mourir prosternée devant les abats d’une bête frappée d’indignité et de solitude, je vais mourir, je deviendrai une sainte, je deviendrai une martyre. Même dans la terreur, enfant, dans la terreur du sang versé en vain, même alors donc, sois téméraire, laisse ton petit corps frissonnant s’évanouir en douceur dans le noir de la nuit. Et ne rentre plus jamais à la maison, tu es désormais trop faible pour y songer.
La maison, du reste, est hostile ; cette maison, la maison que tu partages avec la maman et le papa a toujours été hostile, hostile et blafarde, froide, disgracieuse, remplie de coins, faite de bric et de broc avec de minuscules fenêtres bien trop hautes pour y voir quoi que ce soit au-dehors, la maison est vilaine, la maison est mesquine, mal peinte, mal carrelée, la maison est emplie de solitude et de très vieilles personnes qui la hantent régulièrement, armées de leurs passe-droits. Ainsi, se dit encore l’enfant pygmée, tu ne rentreras plus jamais à la maison mais tu te livreras au martyre dans le noir de la nuit des larges et profondes forêts, ton sang fraîchement perdu guérira le mal d’indignité, réchauffera la solitude, toutes les solitudes iniques du monde cruel. Dans la maison où siègent la maman et le papa en compagnie de très vieilles personnes munies de passe-droits, nul ne remarquera ton non-retour, des soupers et des nuits passeront innombrables dans un silence équanime, ton non-retour sera identique à ta présence diaphane d’antan, absente, recroquevillée dans les plis cachés de ta serviette brodée du sceau des morts.
Ainsi pense l’enfant pygmée, toujours agenouillée devant la mort, sang écarlate et abats nacrés confondus, ainsi médite-t-elle en compagnie de la bête frappée d’indignité, quand jaillit soudain de la fenêtre aux carreaux cassés une meute dentée et hurlante, un paquet musculeux de chiens débondés, flaireurs de sang, vire sec dès l’atterrissage en direction de l’enfant prosternée, ces chiens déchiquètent son pagne protecteur, avant de lui lécher avidement le cul, s’immiscent de leur truffe et de leur langue dans la mortelle blessure, en extirpent la fièvre maligne, bousculent l’enfant et avalent en une bouchée gourmande et surexcitée les abats nacrés du cerf décoiffé. Rex, Butor, Diane, Terminator, ici, nom de Dieu, ici, au pied, entend l’enfant.
Une vieille chasseresse et un vieux chasseur paraissent à l’embrasure de la porte de la moche maisonnette couleur de pisse. Il leur manque des dents, l’enfant le voit car ils gueulent sur les chiens, ils sont sales et mouchetés de sang séché, le sang de la bête frappée d’indignité, se dit l’enfant, le sang de l’éviscération. Même dans la terreur, enfant, face aux criminels dépeceurs qui gardent sous leurs ongles de minuscules reliques biologiques de bête frappée d’indignité, sois téméraire et tiens-toi droite, de saisissement ne fais pas pipi mais soutiens le regard des tueurs, sois debout dans la clairière, prête à en découdre car voici que ces rats édentés portant treillis et coutelas s’avancent vers toi sur leurs jambes ruinées ; brutaux et invalides, ils sentent la chair crue et la terre. Ils te dévisagent, ils enfoncent un bout de doigt dans la carnation molletonnée de ton avant-bras, ils tiennent leur coutelas et, comme si tu n’entendais pas ce qu’ils baragouinent entre eux, ils te traitent de sagouine glabre, de vierge égarée nue hors du cocon familial, d’innocente en escarpins qui a perdu sa robe et sa culotte dans la forêt, de petite effrontée baratineuse de légendes et de philosophies foireuses, les pieds pris dans le tapis de son propre jeu dont elle ne sortira qu’en pièces détachées et, portant toujours les coutelas, ils chaloupent vers le cerf pendu, lui détachent la tête, le charcutant à grands coups. La tête choit, son unique bois se brise net, valdingue un tantinet en l’air et retombe à terre. L’irréversibilité de l’état où se trouve désormais le cerf est écrite au sol, dans les arabesques complexes de ses andouillers, le destin de l’enfant aussi, son martyre est caduc, sa sainteté refoulée, devant la vérité vraie d’une viande pendue, qu’il ne restera plus qu’à dépiauter, avant de la consommer, quartier après quartier, sur un gril chauffé au rouge.
N’aie aucune crainte, petite innocente en escarpins, ainsi s’adressent à l’enfant la vieille chasseresse et le vieux chasseur, nous ne te tuerons pas, nous ne te violerons pas, nous ne te dévorerons pas vivante, nous sommes des pauvres que la forêt abrite en son sein spartiate, nous sommes la réalité du monde. Dans le monde, il y a des riches, aussi des demi-riches dont tu es issue, fugueuse du logis en lotissement que le papa et la maman ont fait construire à grands efforts et à moindres frais de l’autre côté de la forêt pour faire en petit ce que les riches font en grand, large et ostentatoire, enfin il y a des pauvres qui sont la réalité du monde. Toi, petite vierge égarée, tu cherches inlassablement la réalité du monde en faisant le mur par-dessus l’enceinte de ton jardinet familial, tu fouilles dans le cru et l’humus non arable, tu inventories l’empreinte des bêtes, tripotes les têtards dans la mare, tu te souilles avec volontarisme, tu inventes des histoires où tu sauves le vivant et le monde terrestre à mains nues et sans culotte, tu te prosternes devant le cerf frappé d’indignité, tu lui offres ton sang en rémission. Car dans la maison que tu partages avec le papa et la maman, la vie est désolante d’insignifiance, le silence complexe, la solitude aride. Maudite, t’es-tu souvent dit tout bas, la vie est maudite avec le papa et la maman qui sont mornes comme des cache-pots, prudents comme des serrures, humbles, économes comme des thermostats fixés sur 17,5 degrés. Maudite encore soit la vie dans le commerce forcé de ces très vieilles personnes qui usent régulièrement de leurs passe-droits pour hanter la maison du papa et de la maman, en y important du sucre, du savon et des napperons brodés qui s’entassent dans les armoires dites intégrées, selon les termes de l’architecte qui affirmait au papa et à la maman que cela était distingué, racé et très moderne, rationnel et bon à vivre. Tu t’es mise à écrire dans ta tête l’histoire de la honte qu’il faut poignarder pour vivre, dans le hachoir de la cuisine tu as mouliné sans sourciller la génétique des familles, tu as inventé des demeures exquises, pleines de mystères accueillants et de sexe amoureux, des nuits magnifiques qui serpentent étoilées dans des jardins où le sauvage côtoie la rigueur horticole, tu t’es remise au monde par conception immaculée. Droit devant, enfant, sans savon ni tartines, tu t’es taillée dans la sauvagerie toute relative des forêts claquemurées entre réseau autoroutier et lotissements de moyenne fortune, la bouche pleine de gestes héroïques pour réparer l’indignité, réchauffer la solitude.
À présent, tu es ici, sans robe ni culotte, devant nous. Nous sommes sales, notre vie est sale, nous jetons nos plastiques usagés dans le ruisseau de la forêt spartiate et bouffons du gibier braconné, nous chapardons du matériel communal pour rafistoler notre gîte qui fuit de partout, nous nous torchons à mains nues et les tiques des genêts nous tombent dessus à chaque printemps pour nous sucer le sang, notre sang est avarié, nous sentons très mauvais, nous collons, tout ce que nous touchons colle, nos dents nous font mal, puis tombent, nous couchons avec nos chiens, nous les voyons s’enfiler à tire-larigot, se gratter jusqu’à faire vibrer le plancher pourri, nous leur gueulons dessus, les frappons parfois avec un bout de tuyau, nous recueillons l’eau de pluie dans un fût rouillé, nous y trempons nos coutelas sanglants et la buvons au creux de nos mains noires d’encre, nous tombons malades et nous soignons en restant couchés comme des bêtes dans un coin, nous ne copulons plus mais récitons de temps en temps et à voix haute des bouts de texte restés en mémoire, un mode d’emploi pour de l’électroménager ou un poème du temps de la petite école où petits pauvres et petits riches se confondaient dans un même tablier gris, avant-hier nous avons démoli à coups de bêche un intrus administratif qui enquêtait sur nous puis nous l’avons enterré en contrebas.
Nous ne te ferons aucun mal. Ainsi, tu ne nous dénonceras pas, tu ne dénonceras pas les pauvres de la forêt spartiate qui n’ont ni serrures ni armoires intégrées pour protéger leur logis. Tu seras désormais la complice immaculée des pauvres qui restaurent la barbarie en tuant et en pillant. Les pauvres descendront sur les lotissements et sur les villes, armés de fourches et de chiens, ils dévoreront le contenu des frigidaires, frapperont à mort qui s’y opposera, emporteront les pulls et les fourrures. Les pauvres voleront aussi les livres, ils les liront mille fois, apprendront à les comprendre, combleront les mystères inaccessibles de l’écrit en leur inventant de nouveaux sens, ainsi ils se bâtiront une nouvelle dignité, avec de la bonne viande, de bons médicaments et des textes remplis de mots mirifiques.
Tu pensais nous tuer. En arrivant ici, innocente enfant démunie, en arrivant ici dans notre clairière polluée de toutes nos exactions, tu pensais bel et bien nous tuer puisque nous avions abattu et éviscéré le cerf frappé d’indignité. Tu pensais nous tuer parce que tu estimais injuste ce qui est simplement juste, car l’indignité tue l’indignité, l’indignité se nourrit de l’indignité. Ainsi donc, tu pensais nous tuer mais tu ne le feras pas. Nous te nourrirons avec la chair du cerf frappé d’indignité, nous te réchaufferons aux braises qui auront grillé cette chair, nos chiens qui t’ont sauvée en te suçant des fesses la fièvre maligne te serviront de reposoir dans la clairière où tu dormiras sous les étoiles blêmes, non loin de l’intrus administratif fraîchement enterré. Tu te fortifieras au contact de l’indigence qui a fait de nous de dangereux invalides. Elle te construira une sainteté plus rugueuse, te plantera au cœur une mission sauvage à laquelle tu vaqueras désormais avec une odeur de bête fauve mais tes yeux demeureront purs comme de la glace millénaire.
Enfant, tu pensais nous tuer et tu ne le feras pas. Regarde, nous t’avons nourrie, nous t’avons réchauffée et à présent, nous te donnons, à toi seule, le bois acéré du cerf frappé d’indignité. En t’en retournant chez toi, tu le planteras dans le ventre familial et ainsi, tu entreras dans la réalité du monde.
Première Suite Feu
Dans la maison I
Trop vite, toujours trop vite, enfant, tu cours toujours trop vite dans les bois. Si vite que tu me sèmes. Tu me sèmes et moi, je n’ai plus de souffle. Encore à l’orée du bois, stoppée net avec les poumons claqués entre les mains, je ne te vois plus. Tu dois déjà être là où le bois se dissout en larges et profondes forêts, à l’instant précis de l’éclair qui menace puis déchire le tableau. La clarté de l’éclair te montre, immobile devant toi, un cerf décoiffé. Le cerf te regarde, puis s’enfonce dans le réduit confidentiel de la futaie, sa demi-ramure t’avertit qu’il est temps à présent de rentrer à la maison. Tu y seras avant moi qui demeure encore à l’orée, avec les poumons claqués entre les mains.





























