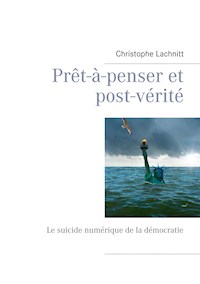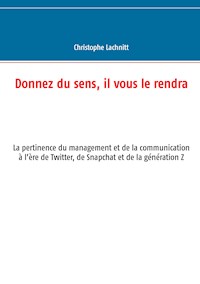
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Bildung
- Sprache: Französisch
Le sens qu’une entreprise véhicule – volontairement ou involontairement – influence l’action de ses parties prenantes pour le meilleur ou pour le pire. C’est encore plus vrai à l’ère de Twitter, de Snapchat et de la génération Z. Aujourd’hui, en effet, l’information est plus abondante, la médiatisation plus impatiente, la conversation plus pétulante et la perception plus fluctuante que jamais. Dans cet ouvrage, Christophe Lachnitt explore le rôle du sens dans le management, la communication et le marketing. Il partage sa conviction que seule une entreprise porteuse de sens favorise à la fois le développement de sa performance et celui de ses collaborateurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 171
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
A toutes celles et tous ceux
qui m'ont appris,
ébloui, contredit.
Avec l'amour,
la transmission est
le plus beau don
de soi et de sens.
Un tas de pierres cesse
d'être un tas de pierres
dès qu'un seul homme
le contemple avec, en lui,
l’image d’une cathédrale.
Antoine de Saint-Exupéry1
1Pilote de guerre, 1942.
TABLE DES MATIERES
- Avant-propos -L’empire du sens
Nous restons tous interdits devant si peu de sens.
Depuis la nuit des temps, l’homo sapiens cherche à comprendre la signification de son passage sur terre. Cette quête inextinguible nous distingue d’ailleurs de tous les autres êtres vivants. Elle influence, souvent consciemment, plus souvent encore inconsciemment, toutes nos activités. C’est pourquoi l’empire du sens sur notre vie recèle un immense réservoir de création de valeur pour les entreprises2 qui savent le cultiver. Ce potentiel s’exprime particulièrement dans deux domaines : le management et la communication3.
Tous deux valorisent un même ressort : l’Homme est un animal social. Il a besoin d’appartenir à des communautés – mot très à la mode dans l’univers numérique mais réalité sociologique ancestrale. Le psychologue Abraham Maslow positionne d’ailleurs le besoin d’appartenance juste derrière les besoins physiologiques et de sécurité dans sa hiérarchie des motivations humaines.
Ce sentiment d’appartenance se cimente et se pimente grâce à un sens partagé. Celui véhiculé par les entreprises repose principalement sur une raison d’être, des valeurs et une vision de l’avenir. Incidemment, alors que l’abolition numérique des distances physiques expose les distances culturelles, les marques sont de nos jours souvent plus aptes que les autres organisations à fédérer des individus d’origines, opinions et croyances différentes.
Une entreprise4 n’est pas seulement un fournisseur de produits et/ou services. Elle est d’abord une collectivité humaine qui doit faire adhérer ses collaborateurs à un objectif commun et fidéliser ses clients. Le sens qu’elle véhicule permet aux collaborateurs de comprendre pourquoi et pour quoi ils travaillent et aux clients de se forger une perception dépassant les seuls critères commerciaux (qualité, prix…). Il nourrit également la confiance sans laquelle il ne peut y avoir de relations créatrices de valeur entre une entreprise et ses parties prenantes.
Le sens joue un rôle plus important encore aujourd’hui que nous vivons dans le règne de l’éphémère, ce que j’appelle “la civilisation Snapchat“, du nom de cette application mobile permettant de partager avec ses proches des images qui s’autodétruisent après quelques secondes. Sous l’effet de l’ubiquité temporelle et spatiale de l’information numérique, les perceptions se créent et s’estompent souvent sur-le-champ.
Le sens, lui, perdure et coalesce les parties prenantes d’une entreprise. C’est aussi vrai, en interne, pour ses collaborateurs que, en externe, pour les acteurs de son écosystème (clients, actionnaires, partenaires, grand public, institutions publiques, ONG…).
* *
*
Le sens véhiculé au sein d’une entreprise influence largement le type de motivation qui anime ses collaborateurs. Or les effets respectifs d’une motivation intrinsèque (l’adhésion à un projet, l’amour de son activité, la stimulation intellectuelle…) et d’une motivation extrinsèque (la recherche d’une récompense financière, l’évitement d’une sanction…) sont très différents. En particulier, celle-là favorise beaucoup plus puissamment que celle-ci l’engagement dans le travail.
Plus important – et étonnant – encore, il a été démontré que les individus qui sont animés d’une double motivation intrinsèque et extrinsèque sont moins investis et performants que ceux qui ne sont mus “que“ par une motivation intrinsèque5. Les entreprises doivent donc tout mettre en œuvre pour que les effets extrinsèques inévitables du travail de leurs collaborateurs ne deviennent des éléments de motivation.
Or le sens est le plus fort vecteur de motivation intrinsèque. Il représente de ce fait la ressource ultime pour maximiser l’épanouissement et l’investissement des individus dans leur travail.
Amy Wrzesniewski, Professeur de management au sein de l’Université de Yale et spécialiste du sens dans le milieu corporate, classe ainsi les collaborateurs en trois catégories6 :
- ceux pour lesquels l’activité professionnelle représente un travail. Le sens de ce travail est de leur permettre financièrement de pratiquer les divertissements dans lesquels ils trouvent leurs plus grandes satisfactions ;
- ceux qui considèrent l’activité professionnelle comme une carrière. Le sens de cette carrière est de leur permettre d’atteindre le statut social auquel ils aspirent ;
- ceux, enfin, qui envisagent l’activité professionnelle comme une vocation. A leurs yeux, cette vocation a un sens en elle-même – et non en ce qu’elle permet – car elle contribue au bien commun.
Les recherches d’Amy Wrzesniewski ont démontré que, dans toutes les professions7, les individus se répartissent généralement en trois tiers correspondant à ces catégories. Mais ceux qui abordent leur travail comme une vocation sont à la fois plus investis et plus heureux que les autres.
Au moins deux autres études ont quantifié cette valeur ajoutée :
- les entreprises dont les collaborateurs comprennent et adhèrent à la mission, aux valeurs et aux objectifs bénéficient d’une rentabilité supérieure de 29% en moyenne à celle des autres
8
;
- les personnes qui trouvent du sens dans leur travail sont 1,7 fois plus heureux et s’y investissent 1,4 fois davantage que les autres
9
.
Pour donner du sens, les entreprises doivent fonder leur management et leur communication sur des contenus plus inspirants que les traditionnels stratégies opérationnelles et objectifs financiers, lesquels génèrent très rarement un profond sentiment d’appartenance.
A cet égard, l’exemple d’I.B.M. est éclairant.
En 2011, lors d’une conférence à l’Université Columbia (New York), Sam Palmisano, alors PDG du Groupe, retraça le perpétuel renouvellement de celui-ci depuis sa création. Il souligna que l’histoire corporate abonde d’entreprises qui connurent un grand succès initial mais furent incapables de le reproduire parce qu’elles s’accrochèrent au produit qui leur valut cette bonne fortune. A l’inverse, les sociétés qui se réfèrent à des valeurs ont davantage de chance de prospérer sur la durée.
De fait, I.B.M. a toujours accordé la primauté à la satisfaction du client, au développement de relations à long terme avec ses parties prenantes et à l’innovation. Cette approche a permis au Groupe de se réinventer à plusieurs reprises. Ce fut par exemple le cas en 2005 quand il vendit ses activités d’ordinateurs personnels à Lenovo alors même que le PC portable ThinkPad, utilisé par des millions de personnes à travers le monde, était l’élément le plus reconnaissable de la marque. Mais I.B.M. ne pouvait pas se permettre de demeurer dans des activités à faible marge s’il voulait continuer à investir, conformément à ses valeurs, dans l’innovation.
Jeff Bezos, fondateur et PDG d’Amazon, adopte la même approche. Interrogé sur son groupe, il le décrit toujours en lui donnant du sens et non en citant ses activités, ses positions sur ses marchés ou ses objectifs comme le font la grande majorité des autres dirigeants d’entreprise.
Pour Bezos, trois éléments définissent Amazon :
- l’obsession du client plutôt que celle de la concurrence ;
- la volonté d’inventer, quitte à ne pas être compris ;
- la détermination à déployer une vision à long terme.
Ces principes imprègnent le fonctionnement d’Amazon depuis sa création. Interrogé en 2014, lors de la Conférence Ignition, sur le niveau de dépendance d’Amazon à son égard, Jeff Bezos mit d’ailleurs en exergue leur puissance au sein du Groupe : “beaucoup des traits qui font l’originalité d’Amazon sont désormais ancrés dans ses gènes. En fait, si je voulais changer la culture du Groupe, je ne le pourrais pas. Par exemple, si je décidais demain qu’Amazon doit lancer moins de projets pionniers pour davantage suivre ses concurrents, j’échouerais“.
Edouard Herriot disait que la culture est ce qui reste quand on a tout oublié. Appliquée à une acception différente du mot culture, cette citation correspond également au monde corporate. La culture d’une entreprise, en effet, est ce qui reste à ses collaborateurs une fois qu’ils ont tout oublié des règles managériales et opérationnelles qui la régissent.
Amazon et Jeff Bezos nous donnent un exemple du test ultime de la prégnance du sens d’une entreprise. Si les valeurs et principes d’action survivent à la disparition de leur créateur, ils constituent réellement une culture, c’est-à-dire ce qui reste aux collaborateurs une fois qu’ils ont tout oublié, y compris la présence de leur patron emblématique. Si ces valeurs et principes d’action disparaissent avec leur initiateur, ils représentaient au mieux le résultat d’une imitation pavlovienne du leader, au pire l’expression d’un management par la peur.
Amazon n’est jamais apparu dans le classement des “100 entreprises américaines où il fait le meilleur travailler“ constitué depuis 199810. Seules treize entreprises y ont d’ailleurs figuré chaque année depuis sa création. Parmi elles, on trouve la chaîne de distribution alimentaire bio américaine Whole Foods Market.
Le sens qu’elle donne à son activité est entièrement tourné vers l’être humain. Sa raison d’être est de promouvoir une alimentation saine et elle met en œuvre ce que son fondateur, John Mackey, appelle un “capitalisme conscient”11. Celui-ci se définit par le fait d’accorder le même niveau d’importance aux intérêts de ses trois principales parties prenantes : actionnaires, clients et collaborateurs. C’est une approche en rupture avec celle de la majorité des entreprises au sein desquelles les intérêts des actionnaires et des clients prévalent.
Quel qu’il soit, le sens qu’elle donne à son activité constitue l’identité fondamentale de toute entreprise. C’est un attribut ignoré ou honoré. C’est un patrimoine figé ou vivant. C’est un actif ou un passif. Mais, dans tous les cas, il n’y a pas d’entreprise sans sens, qu’il soit le résultat volontaire d’une introspection – comme dans le cas d’I.B.M., Amazon et Whole Foods Market – ou le fruit involontaire de l’influence incoordonnée de ses dirigeants et collaborateurs successifs.
Dans une grossière métaphore hégélienne, on pourrait donc affirmer que le sens assumé par une entreprise en prenant conscience d’elle-même lui permet de passer du statut d’objet à celui de sujet.
C’est la mue que le club de football américain des San Francisco 49ers accomplit au début des années 1980 alors qu’il était le plus mauvais des Etats-Unis. Bien que le sport professionnel soit l’un des secteurs où l’exigence de résultats rapides est la plus forte (de la part des dirigeants, des fans et des sponsors), Bill Walsh, le nouveau coach des 49ers, passa sa première année à donner du sens à l’activité de tous les membres du club, des standardistes aux joueurs. Il en fit dans la foulée la meilleure équipe de l’histoire du football américain.
Walsh est devenu, au même titre que les PDG de certains grands groupes, une référence du management outre-Atlantique où sa vision et son approche sont enseignées dans les plus grandes universités.
Il a toujours prêché que le sens doit prévaloir sur tout le reste dans l’animation d’une organisation et qu’un leader est d’abord un pédagogue : “la culture précède les résultats. En effet, les champions se comportent comme des champions avant de remporter des titres. Le système de valeurs d’un leader détermine autant son succès que son expertise. Au-delà d’un standard de performance et d’une méthodologie, un dirigeant doit propager ses convictions, ses valeurs et sa philosophie. Un club sportif et une entreprise ne sont pas des objets inanimés. Ce sont des organismes vivants qu’il faut nourrir, guider et développer“12.
Or une recherche13 menée l’an dernier par une équipe de la Faculté de médecine de Baylor (Houston) a montré que, précisément, nous percevons les entreprises comme des êtres sociaux et non comme des objets inanimés. La vision de Bill Walsh vaut donc autant pour le sens communiqué par une entreprise à ses collaborateurs que pour celui qu’elle projette vers son écosystème.
C’est évidemment une approche illusoire pour les entreprises qui ne séduisent les talents qu’avec un appât financier. L’incitation économique, motivation extrinsèque par excellence, projette le sens le plus volatil et le moins émotionnel qui soit14. Les entreprises qui s’en remettent à cet expédient ne doivent pas s’étonner que les mercenaires qu’elles emploient les quittent lorsqu’elles sont moins opulentes. Leurs dirigeants finissent généralement comme le roi de Patagonie.
Un autre enjeu majeur lié au sens véhiculé par les entreprises auprès de leurs collaborateurs a trait à l’horizontalisation croissante de la vie professionnelle.
Celle-ci revêt trois formes principales :
- l’abolition de toutes les frontières – réelles et symboliques – entre les vies interne et externe de l’entreprise. Il n’est plus possible de conduire une communication interne différente de celle menée en externe comme c’était encore le cas il y a quelques années. Désormais, tout ce qui se fait en interne se sait en externe. Cette tendance n’ira que croissant avec l’intégration dans les entreprises des membres de la génération Z
15
habitués à narrer leur vie quotidienne par le menu sur les réseaux sociaux ;
- le changement des relations entre les parties prenantes de l’entreprise
16
. La désintermédiation produite par la généralisation des technologies numériques bouleverse profondément ces relations : elles deviennent toujours plus horizontales
17
, collaboratives
18
et continues
19
. Dans ce contexte, le manager doit, plus que jamais, convaincre plutôt que contraindre et la communication interne passer de l’énonciation à la conversation pour mobiliser. En outre, la révolution numérique rend l’information mêmement accessible à tous les collaborateurs et donnera de fait la prééminence et le pouvoir aux leaders qui la partagent plutôt qu’à ceux qui la contrôlent ;
- le retournement – impulsé par les mutations relevées au point précédent – du rapport entre manager et collaborateur, marqué par l’évaluation de plus en plus fréquente de celui-là par celui-ci. Le site américain Glassdoor
20
, où les dirigeants d’entreprise sont notés par leurs employés, en est aujourd’hui l’illustration la plus visible. Mais, ici aussi, l’arrivée sur le marché du travail de la génération Z donnera une dimension encore plus grande à ce phénomène – quatre millions d’étudiants notent chaque mois outre-Atlantique leurs professeurs d’université sur le site Rate My Professors
21
. Incidemment, on retrouve ce même retournement d’autorité dans la vie publique. Il a été théorisé par le chercheur Steve Mann avec le concept de “sousveillance“
22
. Alors que, auparavant, l’Etat surveillait les citoyens, désormais, les citoyens “sousveillent“ l’Etat grâce notamment aux caméras dont sont équipés leurs
smartphones
. C’est ainsi que fut par exemple rendue publique la vidéo de l’étouffement d’Eric Garner, un citoyen innocent, par des policiers dans une rue de New York le 17 juillet 2014.
Enfin, dans un monde aussi quinteux que le nôtre, les entreprises doivent représenter un facteur de stabilité afin de fournir à leurs collaborateurs la sécurité psychologique dont la majorité d’entre eux ont besoin pour s’épanouir et s’investir. Le sens permet de mettre en perspective les mutations souvent anxiogènes qui accompagnent l’adaptation permanente aux marchés.
Le risque, cependant, est que les entreprises, de plus en plus conscientes de ce conundrum, n’approfondissent pas le sens qui les guide et abusent d’une communication en trompe-l’œil à ce sujet.
C’est ce que semble indiquer une analyse de Factiva23 selon laquelle les termes “mission“, “objectif supérieur“ et “changer le monde“ furent prononcés 3 243 fois dans les communications financières réalisées outre-Atlantique en 2014 contre 2 318 fois l’année précédente, soit une augmentation de 40%.
Ces entreprises qui débagoulent artificiellement donnent raison à Herbert Hoover : “les mots sans action sont les assassins de l’idéalisme“.
* *
*
Le rôle du sens projeté par l’entreprise vers son écosystème est tout aussi important que celui qu’il joue auprès de ses collaborateurs.
Une marque n’est en effet rien d’autre que le sens perçu par ses publics. Elle incarne la garantie de certains bénéfices client (prix, innovation, service, qualité, image…). Lorsqu’on achète le produit ou le service d’une marque, on acquiert d’abord, souvent inconsciemment, la promesse des bienfaits qu’elle symbolise.
A l’exemple du travail d’Amy Wrzesniewski sur les individus, je répertorierais les entreprises en trois catégories eu égard à leur relation au sens :
- celles qui ne savent pas distinguer clairement leur offre de celles de leurs concurrents et communiquer tout aussi clairement cette différence. Elles ne sont pas conscientes du sens qui les guide et qu’elles véhiculent donc involontairement. C’est pourquoi ces marques sont celles qui ont le plus de mal à fidéliser leurs clients : le moindre changement sur leurs marchés les fragilise ;
- celles qui savent identifier la valeur ajoutée, voire la singularité, de leur offre par rapport à celles de leurs concurrents et la communiquer. Ces marques disposent d’acheteurs loyaux qui les apprécient pour leurs bénéfices client tant qu’elles sont capables de les offrir. Mais elles sont vulnérables face à une crise de crédibilité – qu’elle concerne l’un de leurs produits ou un enjeu
corporate
. Je classerais par exemple Intel, Pampers et Toyota dans cette catégorie ;
- celles qui savent rassembler leurs parties prenantes autour d’un sens qui leur confère une identité unique. Leurs produits et services ne définissent pas cette identité ; ils l’illustrent et bénéficient ainsi d’un supplément d’âme. Ces marques constituent des communautés composées de véritables fans qui y trouvent un signe de reconnaissance et de valorisation. La puissance de l’attachement émotionnel de leurs dévots est telle que ces marques – au premier rang desquelles figurent Apple, Disney et Harley-Davidson – semblent immunes contre les crises et les initiatives de leurs concurrentes. En effet, changer de référent induirait pour ces fans une altération de leur identité. Une étude d’une équipe de l’Université de l’Illinois
24
a d’ailleurs montré que certaines personnes qui s’identifient très fortement à une marque perçoivent une critique contre celle-ci comme une attaque à leur encontre. Elles assimilent un revers de cette marque à leur propre échec. Leur estime de soi s’en trouve affectée sans, extraordinairement, que leur dévotion à la marque concernée le soit. Notre besoin de cohérence cognitive nous fait décidément accomplir des prouesses psychologiques.
Plus les marques sont porteuses de sens, plus elles suscitent une adhésion puissante – marquante pourrait-on dire. Elles sont alors positionnées bien au-dessus des autres dans la hiérarchie de Maslow. Avoir un ordinateur Dell et “être Mac“, avoir une moto Honda et “être Harley-Davidson“ n’ont rien de comparable.
La typologie que j’ai esquissée nous montre également que, en communication comme partout ailleurs, la fidélité se mérite. Les marques qui donnent le plus à leurs publics sont celles qui obtiennent le plus en retour : le sens évite que leurs parties prenantes ne soient comme ces couples qui font matelas commun mais rêves à part.
A cet égard, le cas d’Apple mérite qu’on s’y arrête.
Lorsque Steve Jobs reprit la tête du Groupe en 1997, à seulement 90 jours de sa faillite, il centra ses premières interventions sur sa raison d’être. Chez lui, le sens l’emporta toujours sur la concupiscence, l’essence sur la croissance.