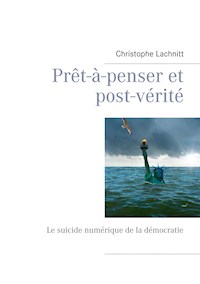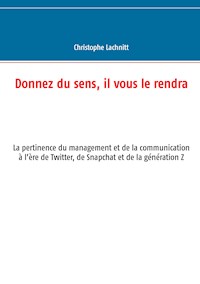Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Französisch
Génie gênant, la révolution numérique confronte chaque jour des organisations au choix entre sursaut et sursis. En effet, toutes les entreprises, demain, seront numériques. Les autres n'existeront plus. Dans ce livre, Christophe Lachnitt identifie des tendances de fond en matière de transformation numérique. Il réfléchit aux répercussions de celle-ci sur les vecteurs d'information ainsi que sur la communication et le marketing des entreprises, avant de mettre en perspective la refondation des relations entre marques, médias et publics. A partir de ces analyses, il propose des orientations stratégiques pour valoriser un environnement aussi déstabilisant que riche de promesses.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 357
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Le futur n’est pas un cadeau.
C’est un accomplissement.
Robert F. Kennedy1
1 Discours à l’exposition universelle de Seattle, 7 août 1962.
TABLE DES MATIERES
Introduction
Les aveugles et l’éléphant
De l’engrangement à l’engagement des audiences
Chapitre 1 - Le déséquilibre des pouvoirs
Chapitre 2 - Ce n’est pas la taille (de l’audience) qui compte mais la manière de s’en servir
Chapitre 3 - La révolution est un plat qui se mange froid
Les entreprises deviennent des médias
Chapitre 4 - Renoncer au renoncement
Chapitre 5 - Le détecteur de sincérité
Chapitre 6 - Dynamiser la communication sans la dynamiter
Economie de l’attention ou de la tension?
Chapitre 7 - Une espèce en voie d’apparition
Chapitre 8 - La lutte des places
Chapitre 9 - Trop faibles pour céder
Conclusion
De la communication globale à la communication totale
- Introduction -
Les commencements ont
des charmes inexplicables.
Molière2
2Dom Juan.
Les aveugles et l’éléphant
D’origine indienne ancestrale, la fable des aveugles et de l’éléphant3 relate l’aventure d’un groupe de non-voyants qui s’approchent d’un pachyderme pour l’étudier. Chacun d’eux touche une partie différente de l’énorme animal et ils se trouvent en complet désaccord – et en plein désarroi – lorsqu’ils comparent leurs impressions.
Cette parabole constitue une excellente métaphore des enjeux posés par la transformation numérique. En effet, beaucoup d’acteurs considèrent celle-ci de manière parcellaire en fonction du contexte dans lequel ils l’appréhendent.
Or, dès 2011, Marc Andreessen, cofondateur de Netscape4 puis de la société de capital risque Andreessen Horowitz, prophétisait que “le logiciel dévore le monde“5. Presque cinq ans plus tard jour pour jour, quatre entreprises numériques – par ordre décroissant Apple, Alphabet (ex-Google), Microsoft et Amazon – trustaient les premières places6 de l’indice Standard & Poor 5007.
La force symbolique de cet événement pourrait être trompeuse : il ne reflète pas tant l’économie des maîtres du numérique que la maîtrise du numérique sur l’économie. De fait, la suprématie de ces entreprises sur les marchés du numérique ne suffirait pas à justifier leur valorisation boursière. C’est leur rôle dans la dissémination du numérique auprès des individus et organisations dans les cinq continents8 qui leur confère une position exceptionnelle.
Depuis quelques années déjà, le numérique n’est plus un secteur. Il envahit toutes les activités humaines, qu’il révolutionne les unes après les autres. C’est pourquoi les entreprises, au lieu de déployer une “stratégie numérique“, doivent conformer leur stratégie globale au monde numérique. Partout, celles qui seront les plus promptes à envisager le numérique comme la nouvelle règle du jeu universelle prévaudront sur celles qui continueront de l’aborder comme une spécialité.
Demain, toutes les entreprises seront numériques. Les autres n’existeront tout simplement plus.
* *
*
L’acquisition, annoncée en juillet 2016, de Dollar Shave Club9, champion de la vente de rasoirs en ligne, par Unilever pour un milliard de dollars fournit une excellente illustration de cette nouvelle réalité.
A l’ère pré-numérique, le succès du leader mondial, Gillette, reposait sur le dynamisme de son organisation opérationnelle qui développait régulièrement de nouveaux produits plus rémunérateurs, la puissance publicitaire de sa marque qui garantissait l’attractivité de son offre et ses relations avec la grande distribution qui favorisaient l’exposition préférentielle de ses articles.
A l’ère numérique, le modèle de Dollar Shave Club est très différent :
- la gestion numérisée de sa chaîne logistique lui permet d’acheter ses rasoirs auprès d’un grossiste sud-coréen qui lui fournit des produits standard assez qualitatifs pour satisfaire ses clients sans l’entraîner dans une ruineuse course à l’innovation ;
- Dollar Shave Club s’est fait largement connaître avec sa vidéo de lancement, diffusée gratuitement sur YouTube où elle a été vue plus de 23 millions de fois, et développpe sa notoriété grâce au bouche-à-oreille de ses abonnés ;
- son modèle d’abonnement sur Internet lui évite de passer sous les fourches caudines des grandes enseignes, fidélise les consommateurs plus efficacement que les coupons de réduction et engrange les données-clients10.
A chaque étape, Dollar Shave Club réalise donc des économies substantielles par rapport à Gillette. C’est pourquoi la start-up peut vendre ses rasoirs à un prix sans équivalent tout en proposant à ses clients un service supplémentaire (l’acheminement à leur domicile).
Gillette n’est pas un acteur du numérique. Pourtant, comme toutes les entreprises désormais, elle voit son activité bouleversée par la révolution numérique.
Notons, à cet égard, que Dollar Shave Club a été acquis par un groupe extérieur au marché des rasoirs et non par l’un des géants de ce secteur. Il aurait certainement été difficile pour ceux-ci de renoncer aux marges rondelettes générées par leur modèle traditionnel11 et de prendre le risque d’une profonde transformation numérique. Mais ils s’exposent à un danger plus redoutable encore : l’éloignement de consommateurs attirés par la simplicité de l’expérience client12, les tarifs et l’appartenance communautaire offerts par Dollar Shave Club.
Souvent, les leaders, faibles de leurs certitudes, considèrent le numérique comme un simple levier et non comme la condition fondamentale de leur activité. Ce n’est d’ailleurs pas un phénomène nouveau : les fabricants de bougies n’ont pas dominé le marché des ampoules électriques. Les entreprises préfèrent généralement la préservation de l’acquis à la projection dans le maquis.
Or le rééquilibrage entre anciens et nouveaux modèles d’activité n’est pas seulement à l’œuvre dans l’univers des rasoirs13. Il ébranle un nombre croissant de marchés où, chaque jour, des organisations sont confrontées au choix entre sursaut et sursis14.
* *
*
Le numérique n’a que 10 000 jours15.
Mais la révolution qu’il engendre a déjà des répercussions comparables à celles des inventions de l’imprimerie, du télégraphe et de la machine à vapeur doublées du développement du réseau bancaire.
Dans son livre “The Age Of Spiritual Machines“16, le futuriste17 Ray Kurzweil théorisa la “loi du retour accéléré“ selon laquelle le progrès technologique est exponentiel. Il estime que l’équivalent des avancées effectuées au vingtième siècle a été accompli entre 2000 et 2014 puis va l’être de nouveau entre 2015 et 202118. Selon lui, le progrès technologique s’accélère à un rythme tel que le vingt-et-unième siècle sera mille fois plus fertile dans ce domaine que le vingtième.
De fait, l’ampleur des enjeux du numérique, de la métamorphose de tous les échanges19 à la révolution industrielle Internet20 en passant par la réinvention des interfaces homme-machine21, est sans précédent. La destruction créative chère à Joseph Schumpeter semble avoir trouvé avec lui son plus puissant vecteur.
Génie gênant, le numérique bouleverse les positions établies et impose une incessante remise en question aux entreprises, même lorsqu’elles pensent en maîtriser les codes. Certaines ne s’en remettent pas. Cependant, le solde net de la révolution numérique en matière de création d’emplois et richesses collectives sera largement positif à l’horizon qui convient à l’analyse de ce type de processus historique22.
“Vous ne pouvez pas faire la révolution en gants blancs“, proclamait Lénine23. Le numérique, peut-être la plus grande révolution de l’Histoire, démontre chaque jour le contraire. Il favorise en effet le déploiement de mutations pacifiques dans les champs politique, économique et sociétal. Malgré ses travers24, il représente une opportunité sans égale pour la communauté humaine considérée dans son ensemble comme pour les individus et organisations qui l’embrassent.
* *
*
L’écriture d’un livre sur la transformation numérique présente deux défis principaux.
En premier lieu, l’immensité et la diversité de ses conséquences excluent de prétendre l’explorer exhaustivement. Après avoir traité des effets du numérique sur le management et la culture d’entreprise dans mon précédent volume25, je me focalise dans celui-ci sur sa portée en matière de communication et marketing. Naturellement, chaque thème abordé ici mériterait un ouvrage dédié.
En second lieu, la rapidité et la volatilité des effets du numérique risquent de rendre soudainement caduque toute analyse publiée à son sujet. C’est pourquoi je tente de mettre au jour des tendances de fond qui transcendent l’écume des jours et dessinent l’avenir. Ces fragments sur la transformation numérique prolongent ainsi les réflexions que je publie quotidiennement sur mon blog Superception26. Prendre du recul permet aussi de prendre de l’élan.
Eclairé par 199 études de marché, recherches scientifiques et cas opérationnels27, je réfléchis dans les pages qui suivent aux répercussions de la transformation numérique sur les vecteurs d’information ainsi que sur la communication et le marketing des entreprises, avant de mettre en perspective la refondation des relations entre marques, médias et publics.
Ed Koch, maire emblématique et atypique de New York durant les années 1980, avertissait ses concitoyens de la manière suivante : “Si vous êtes d’accord avec moi au sujet de neuf sujets sur douze, votez pour moi. Si vous êtes d’accord avec moi à propos de douze sujets sur douze, allez voir un psychiatre“.
C’est une observation que je pourrais reprendre à mon compte concernant ce livre.
Bonne lecture.
Christophe Lachnitt
Octobre 2016
3 Sa version la plus célèbre est l’œuvre du poète américain du dix-neuvième siècle John Godfrey Saxe.
4 L’inventeur, en 1994, du premier navigateur Internet grand public (Mosaic Netscape 0.9) qui permit aux consommateurs de s’aventurer sur Internet au-delà des confins du service proposé par leur fournisseur d’accès.
5 “Why Software Is Eating The World“, Marc Andreessen, The Wall Street Journal, 20 août 2011.
6The New York Times, 6 août 2016, relatant un fait intervenu au soir de la séance boursière du 1er août.
7 Cet indice suit la valorisation boursière de 500 grandes entreprises américaines cotées au New York Stock Exchange ou au NASDAQ. Il se distingue de ce fait d’autres indices comparables par la diversité des secteurs d’activité dont relèvent les sociétés qui le composent.
8 Cetaines régions de la planète résistent encore à la déferlante numérique. Sans même aborder la Corée du Nord, il convient d’évoquer le cas de la Chine qui, d’ailleurs, ne résiste peut-être pas tant au numérique qu’à la liberté (libre concurrence, liberté d’expression…) comme ont notamment pu le constater à leurs dépens Yahoo!, eBay, Google, Amazon, Twitter, Facebook et Uber.
9 Dollar Shave Club, dont le motto est “Shave Time, Shave Money“, envoie mensuellement à ses abonnés l’équipement nécessaire à leur rasage en échange d’un versement modique (entre trois et neuf dollars selon le nombre et la qualité des lames).
10Stratechery, 20 juillet 2016.
11Stratechery, 20 juillet 2016.
12 Siegel+Gale publie chaque année un classement des “marques les plus simples” – celles qui facilitent le plus la vie de leurs clients – fondé sur une enquête d’opinion mondiale réalisée auprès de 12 000 consommateurs. La simplicité de l’expérience client revêt une importance croissante alors que le monde dans lequel nous vivons est toujours plus complexe. C’est pourquoi ces “marques simples” conquièrent la loyauté de leurs clients et génèrent de ce fait une meilleure performance financière que leurs concurrentes. En effet, 63% des consommateurs interrogés se disent prêts à payer davantage pour bénéficier d’une expérience client simplifiée et 69% sont plus enclins à recommander une marque qui offre une expérience client simplifiée. Ainsi les entreprises cotées positionnées dans le top 10 des marques les plus simples ont-elles surperformé les marchés boursiers de 214% en moyenne depuis la création de ce classement en 2009. Or Dollar Shave Club arrive en tête du classement 2016 des marques américaines qui améliorent les expériences client existantes ou en créent de complètement nouvelles (source : SimplicityIndex.com).
13 Ainsi, “Uber, la plus grande entreprise mondiale de taxis, ne possède pas de véhicules. Facebook, le média le plus populaire, ne crée aucun contenu. Et Airbnb, le premier fournisseur planétaire d’hébergement, ne dispose pas de biens immobiliers“ (Tom Goodwin, TechCrunch, 3 mars 2015). Certes, Uber détient désormais des voitures dans le cadre de son programme de véhicules sans conducteur mais l’esprit de cette citation reste totalement pertinent.
14 L’un des cas les plus intéressants et les plus spectaculaires à cet égard est l’industrie automobile.
15 Même si Internet et numérique ne sont pas totalement synonymes, le premier site Internet, une description du World Wide Web mise en ligne par Tim Berners-Lee, a été créé il y a un peu plus de 25 ans, le 6 août 1991.
16 1999.
17 Et cadre dirigeant de Google.
18Wait But Why, 22 janvier 2015.
19 De toute nature, de la communication interpersonnelle aux flux commerciaux.
20 Après la révolution industrielle et la révolution Internet est venu le temps de la révolution industrielle Internet. La première permit de gigantesques économies d’échelle dans la fabrication de biens grâce à la puissance de production des machines. La deuxième permit de gigantesques économies d’échelle dans le partage d’informations grâce à la puissance de traitement des systèmes informatiques. La troisième va combiner les deux premières pour faire converger les machines et individus avec un langage commun : les données contextuelles. L’Internet des objets est au centre de cette troisième révolution car ce sont les objets connectés qui recueillent et diffusent ces données.
21 Celle-ci concerne aussi bien les innovations matérielles (de l’ordinateur au smartphone à la réalité virtuelle) que l’émergence de l’intelligence artificelle comme un complément, et éventuellement un concurrent, de l’intelligence humaine.
22 C’est-à-dire plusieurs générations, comme dans le cas de la révolution industrielle.
23 Cette formulation, passée à la postérité, résume un passage d’un texte de Lénine, “Deux tactiques de la social-démocratie dans la révolution démocratique“, paru en 1905 : “Et les gens de l'Osvobojdénié, c'est-à-dire les représentants de la bourgeoisie libérale, veulent en finir avec l’autocratie sans rien brusquer, par la voie des réformes, en faisant des concessions ; sans léser l'aristocratie, la noblesse, la cour, précautionneusement et sans rien casser, aimablement et en toute politesse, en grand seigneur et en mettant des gants blancs“. Cette dernière pique fait référence à une audience accordée par Nicolas II à des leaders de l’opposition réformiste. L’un d’eux, Ivan Petrunkevitch, fondateur du Parti constitutionnel démocratique, ne portait pas de gants blancs et dut en emprunter à l’un des gardes du Tsar.
24 Des emails indésirables à la mobilisation des terroristes sur les plates-formes sociales et le web invisible (“deep web“).
25 “Donnez du sens, il vous le rendra” (mars 2015).
26www.superception.fr.
27 133 études de marché et recherches scientifiques et 64 cas opérationnels. Ils sont largement dédiés aux Etats-Unis, l’une de mes grandes passions et une terre d’innovation permanente dans les domaines couverts par ce livre.
- Première partie -
De l’engrangement
à l’engagement des audiences
Ce n’est pas Amazon
qui ébranle l’industrie du livre,
c’est le futur.
Jeff Bezos
Le 19 août 1858, The New York Times écrivait à propos du tout nouveau télégraphe transatlantique : “Pour ce qui concerne l’influence de la presse sur l’esprit et le moral du peuple, il ne fait, d’un point de vue rationnel, aucun doute que le télégraphe a eu un effet très pernicieux. Les informations qu’il diffuse sont superficielles, soudaines, sans filtre et trop précipitées pour être vraies. Ne forcent-elles pas l’esprit populaire à juger trop rapidement pour découvrir la vérité ? Le courrier nous arrive d’Europe en dix jours. Quel est le besoin de recevoir des bribes d’actualité en dix minutes ? Les nouvelles télégraphiques sont des plus triviales et dérisoires”.
Ces lignes décrivent parfaitement la vision que beaucoup ont aujourd’hui du numérique, et ce d’autant plus que nos usages médiatiques sont sans rapport avec ceux de nos devanciers du 19ème siècle. Ainsi, selon une étude d’eMarketer28, les adultes américains devraient-ils consacrer en moyenne 12 heures et 5 minutes par jour en 2016 aux médias, soit près d’une heure de plus qu’en 201129.
Ces données révèlent l’ampleur de la révolution qui bouleverse autant les pratiques des citoyens-consommateurs que le paysage médiatique. Cette révolution fait également émerger de nouveaux modèles de service et remet en cause les fondements du journalisme.
- Chapitre 1 - Le déséquilibre des pouvoirs
- Chapitre 2 - Ce n’est pas la taille (de l’audience) qui compte mais la manière de s’en servir
- Chapitre 3 - La révolution est un plat qui se mange froid
28 “US Time Spent With Media: eMarketer’s Updated Estimates For Spring“, juin 2016.
29 Mais ce temps médiatique augmente désormais beaucoup moins rapidement : il ne devrait gagner que 3 minutes entre 2016 et 2018. Cela semble indiquer qu’un point de saturation est en passe d’être atteint et que la progression du temps consacré à un média se fait aux dépens des autres.
- Chapitre 1 -
Le déséquilibre des pouvoirs
La révolution numérique suscite de nouvelles habitudes de consommation médiatique qui fragilisent davantage la presse écrite que la télévision et créent un déséquilibre des pouvoirs entre producteurs et diffuseurs de contenus.
- De nouvelles habitudes de consommation médiatique
- L’état très alarmant de la presse écrite
- Quel modèle économique pour la presse écrite ?
- La télévision, un colosse unijambiste davantage qu’un géant aux pieds d'argile
- Producteurs et diffuseurs de contenus, le déséquilibre des pouvoirs
De nouvelles habitudes de consommation médiatique
Avant de réfléchir aux conséquences stratégiques de la révolution numérique dans ce domaine30, commençons par dresser un état des lieux.
A cet égard, une première question s’impose : la surinformation numérique serait-elle un mythe ? L’image d’Epinal veut que le web noie les citoyens sous un tsunami permanent d’informations de mauvaise qualité. Ce n’est pas ce qu’ils ressentent, bien au contraire.
Tel est le principal enseignement d’un sondage31 réalisé par The Pew Research Center auprès d’un échantillon représentatif d’internautes américains adultes :
- 87% des participants affirment que le web et les téléphones mobiles ont amélioré leur capacité à apprendre de nouvelles choses ;
- 72% apprécient le fait d’avoir beaucoup d’informations à leur disposition contre 26% qui disent souffrir de surinformation ;
- 76% estiment qu’Internet permet aux Américains moyens d’être mieux informés contre seulement 8% qui sont d’un avis contraire.
A l’origine de cette potentielle surinformation, se trouvent évidemment les réseaux sociaux. Comme l’entrepreneur et capital-risqueur Chris Dixon le souligna dans un article32 qui fit florès, ils ont inversé la logique de consommation des contenus sur Internet.
Durant les années 2000, les internautes étaient concentrés sur la découverte d’informations et Internet essentiellement pratiqué de manière active (“pull“). Les moteurs de recherche étaient alors l’application emblématique. A contrario, les années 2010 voient la priorité accordée à une pratique passive (“push“) dans laquelle les internautes consomment les contenus qui leur sont proposés par leurs proches. Les réseaux sociaux sont désormais l’usage dominant.
Une étude33 du Pew Research Center permet de prendre conscience de leur niveau d’adoption. Réalisée aux Etats-Unis, elle présente l’originalité de rapporter l’usage des réseaux sociaux à l’ensemble de la population adulte et non à la seule population connectée à Internet comme c’est généralement le cas. A cet égard, il convient de noter que 15% des Américains ne sont pas (encore) reliés au web.
Les principales conclusions de cette recherche se présentent comme suit :
- 65% des adultes américains utilisent aujourd’hui les réseaux sociaux contre 7% en 2005 ;
- 90% des jeunes adultes âgés de 18 à 29 ans pratiquent les réseaux sociaux contre 12% en 2005 ;
- la proportion de seniors de plus de 65 ans qui s’adonnent aux réseaux sociaux a plus que triplé depuis 2010 et s’établit aujourd’hui à 35% de cette classe d’âge (contre seulement 2% en 2005).
La généralisation de l’usage des réseaux sociaux permet de rapprocher les êtres humains ou, du moins, de prendre mieux conscience de leur proximité. Ainsi Facebook a-t-il actualisé la théorie des six degrés de séparation. Celle-ci stipule que deux habitants de la planète qui ne se connaissent pas sont séparés l’un de l’autre au maximum par cinq personnes, soit six degrés de séparation.
Elle fut inventée en 1929 par l’auteur hongrois Frigyes Karinthy, démontrée concrètement outre-Atlantique en 1967 par le professeur de l’Université de Harvard Stanley Milgram et dénommée “six degrés de séparation” en 1990 par John Guare dans le titre de l’une de ses pièces de théâtre.
Dans un article publié sur son blog34, Facebook expliquait avoir analysé les données relatives à son 1,59 milliard de membres de l’époque et être arrivé à la conclusion que ce ne sont pas 6 mais 4,57 degrés (soit 3,57 personnes) qui séparent deux habitants de la planète choisis au hasard.
Cette proximité n’est pas la seule raison pour laquelle les réseaux sociaux favorisent notre bien-être.
Des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon (Pittsburgh, Pennsylvanie) et de Facebook ont sondé durant trois mois plus de 1 900 membres du réseau de Mark Zuckerberg habitant dans 91 pays35. Ils les ont interrogés sur leur état d’esprit et ont analysé leur activité sur Facebook.
Il en ressort que le bonheur des participants à cette étude augmentait lorsqu’ils recevaient en un mois 60 commentaires de plus que dans un mois normal, des personnes qu’ils apprécient, à propos des messages qu’ils mettaient en ligne sur Facebook. L’amélioration de leur bien-être était alors comparable à celle connue dans le cas de l’obtention d’un nouvel emploi ou la naissance d’un enfant. Incidemment, cet accroissement pouvait également être généré en commentant plus souvent les messages mis en ligne par leurs amis (ici aussi, le seuil fatidique s’établit à 60 commentaires supplémentaires par mois).
De leur côté, des scientifiques des universités de Californie (San Francisco), Claremont (Californie) et Toronto (Canada) ont montré36 que les individus qui mettent en ligne sur les réseaux sociaux des photos d’eux avec leur conjoint (ou compagnon/ compagne) se disent plus heureux dans leur couple et plus proches de leur partenaire que ceux qui ne s’adonnent pas à cette pratique.
Enfin, des chercheurs des universités de Wisconsin-Madison et Cornell ont découvert que les individus regardent souvent leur compte Facebook lorsqu’ils sont en manque d’estime de soi. Ce serait une manière inconsciente pour eux de “réparer” leur ego en consultant les messages – généralement positifs37 – qu’ils y ont publiés au sujet de leur vie et en y voyant les liens sociaux dont ils bénéficient.
Parallèlement à l’animation de notre communauté, les réseaux sociaux prennent une place de plus en plus importante dans le suivi de l’actualité par les citoyens-consommateurs.
Une étude38 menée outre-Atlantique par The Pew Research Center avec The John S. and James L. Knight Foundation dresse un constat éclairant à cet égard :
- 62% des adultes américains s’informent sur les réseaux sociaux (contre 49% en 2012) ;
- Reddit joue le plus grand rôle en matière d’information de ses membres : 70% de ses utilisateurs s’y informent, contre 66% de ceux de Facebook, 59% de ceux de Twitter et 31% de ceux de Tumblr ;
- cependant, rapportés à la population américaine globale, ces chiffres présentent un paysage différent : Facebook est une source d’information pour 44% des Américains contre 10% pour YouTube, 9% pour Twitter et 4% pour Instagram et LinkedIn ;
- 64% des internautes américains qui s’informent sur au moins une plate-forme sociale ne le font que sur un seul réseau, majoritairement Facebook, mais 26% utilisent deux réseaux dans cette optique et 10% trois ou plus ;
- même s’il existe des recouvrements, chaque réseau social tend à informer une catégorie de population assez spécifique.
* *
*
Au-delà de ce constat global, on observe des différences croissantes dans la manière dont les milléniaux et les baby boomers suivent l’actualité politique. C’est ce que signale une autre étude39 du Pew Research Center qui a interrogé plus de 3 000 Américains.
Cette enquête révèle que :
- 61% des milléniaux (nés entre 1981 et 199640) suivent l’actualité politique sur Facebook contre 37% qui s’informent en regardant les chaînes de télévision locale ;
- la proportion est inverse chez les baby boomers (nés entre 1946 et 1964), dont 60% privilégient la télévision locale et 39% Facebook ;
- elle est sensiblement égale chez les membres de la génération X (nés entre 1965 et 1980), dont 51% s’informent sur Facebook et 46% auprès de la télévision locale ;
- conséquence naturelle de ces usages et du fonctionnement de l’algorithme de Facebook qui s’attache à satisfaire nos attentes, les milléniaux voient davantage d’informations politiques sur leurs “murs” que les autres générations : 24% d’entre eux affirment qu’au moins la moitié des messages visibles sur leurs “murs” sont de nature politique contre 18% des membres de la génération X et 16% des baby boomers.
Les milléniaux, qui sont déjà majoritaires outre-Atlantique dans le monde du travail (devant la génération X) et vont bientôt le devenir dans la population globale, vont rapidement constituer le cœur des audiences – internes et externes – de toutes les entreprises. Il est donc crucial de bien comprendre leurs habitudes de consommation médiatique.
Un rapport41 du Media Insight Project nous fournit des données utiles dans cette optique :
- 85% des jeunes adultes américains (18-34 ans) interrogés affirment que s’informer revêt une certaine importance à leurs yeux et 69% suivent l’actualité chaque jour ;
- 87% ont payé pour consommer un service web (Netflix par exemple) dans l’année écoulée mais seulement 40% l’ont fait pour une application ou un abonnement en ligne de suivi de l’actualité (de manière contre-intuitive, les magazines et journaux sont mieux classés que les services web dans cette catégorie) ;
- 64% s’informent régulièrement lorsqu’ils sont connectés à Internet, ce qui fait du suivi de l’actualité la cinquième activité la plus populaire en ligne, derrière l’email, le contact avec ses amis, la consommation de musiques ou vidéos et l’information à propos de sujets d’intérêt ;
- ils suivent majoritairement l’actualité divertissante sur les réseaux sociaux (à l’exception de l’actualité sportive) et l’actualité sérieuse sur des sources d’information plus classiques (à l’exception des sujets religieux et sociétaux) ;
- ils ont recours aux moteurs de recherche et aux agrégateurs pour les informations pratiques ;
- Facebook domine : sur les 24 thématiques d’actualité testées dans le sondage, le groupe de Mark Zuckerberg est la première source d’information des milléniaux pour treize sujets et la deuxième pour sept ;
- 76% des personnes interrogées citent comme premier avantage de Facebook en matière de suivi de l’actualité la faculté de voir les sujets à propos desquels leurs amis s’expriment et échangent.
* *
*
Une autre tendance de fond de la nouvelle consommation médiatique est l’importance prise par les usages mobiles.
En moyenne, nous consultons nos smartphones 150 fois par jour42. Or l’une des différences majeures entre l’utilisation d’un ordinateur et la pratique d’un smartphone est que celle-là est intentionnelle tandis que celle-ci ne l’est pas : l’ordinateur répond à un objectif précis alors que le smartphone remplit nos moments creux43.
Selon une étude44 américaine de comScore, les équipements mobiles (smartphones et tablettes) phagocytent deux tiers du temps passé sur les médias numériques :
- la part des ordinateurs fixes dans l’attention numérique est tombée de 47% en 2013 à 35% en 2015 contre 65% pour les équipements mobiles (smartphones et tablettes) ;
- à eux seuls, les smartphones représentent plus de la moitié du temps passé par les Américains sur des médias numériques ;
- un cinquième des milléniaux – définis par comScore comme les jeunes adultes âgés de 18 à 34 ans – n’utilisent plus du tout d’ordinateur ;
- les 1 000 premiers sites web recueillent beaucoup plus de trafic depuis des mobiles que des ordinateurs (en moyenne 61% de plus). Leur audience mobile a doublé en deux ans.
Incidemment, le mobile domine également les usages immobiles.
Un autre rapport45 de comScore signale en effet que les équipements mobiles règnent en maîtres au domicile des internautes américains : les smartphones et tablettes représentent 54% des équipements connectés utilisés par les Américains chez eux.
De fait, c’est chez nous que nous sommes les plus mobiles car la commodité et l’interactivité que les smartphones et tablettes nous offrent leur confèrent un avantage décisif sur tous les autres équipements fixes.
Il convient d’ailleurs de noter l’absence des montres connectées dans cette étude, probablement parce qu’elles ne constituent pas (encore) un marché suffisamment important mais aussi parce qu’elles sont à ce stade moins attractives que les smartphones et tablettes en termes, précisément, de commodité et interactivité (voir aussi page →).
Tout impressionnantes qu’elles sont, les informations qui précédent ne doivent pas occulter le fait que notre pratique des équipements mobiles n’en est qu’à ses débuts. C’est ce qu’indique une recherche46 d’Ericsson : le volume de données que nous allons consommer sur nos smartphones devrait être multiplié par plus de six dans les cinq prochaines années. L’utilisateur moyen de smartphone consommera mensuellement 8,9 gigabits de données en 2021 contre 1,4 cette année. Le mobile est bien le Viagra des usages numériques.
Cette croissance résultera à la fois de l’augmentation du nombre d’utilisateurs de smartphones dans le monde et de l’extension de la couverture des réseaux mobiles les plus performants. Ces derniers permettent aux internautes mobiles de pratiquer des activités (photos, vidéos, jeux…) de plus en plus gourmandes en capacité de réseau.
Les applications mobiles dominent le monde numérique
Selon Flurry47, les utilisateurs américains de smartphones et tablettes passent en moyenne 3 heures et 40 minutes par jour sur ces appareils.
Cela explique que les applications mobiles représentent aujourd’hui plus de la moitié du temps passé en ligne (sur des équipements fixes et mobiles) par les internautes américains : 58% si l’on considère les applications utilisées sur smartphones et tablettes, 49% si l’on prend en compte les seuls smartphones (contre 33% trois ans plus tôt)48.
La répartition du temps passé en ligne outre-Atlantique se présente comme suit :
- applications mobiles sur smartphones : 50%,
- ordinateurs : 32%,
- applications mobiles sur tablettes : 9%,
- navigation Internet sur smartphones : 7%,
- navigation Internet sur tablettes : 2%.
En outre, les applications mobiles génèrent une énorme focalisation des usages Internet sur un nombre limité de plates-formes. En moyenne, les Américains consacrent ainsi 45% du temps qu’ils passent dans les applications sur leur smartphone à leur application favorite, 18% à leur deuxième et 10% à leur troisième.
Pour les marketeurs, cette évolution est synonyme à la fois de concentration et fragmentation de leurs vecteurs publicitaires : concentration car les publics canalisent leurs usages sur un nombre restreint de plates-formes et fragmentation car ces plates-formes sont forcément moins ouvertes qu’Internet.
Incidemment, cette concentration est d’autant plus dangereuse pour les médias que ceux-ci, en particulier les médias tout numérique, n’ont pas encore réalisé les fusions-acquisitions rendues impératives par les contraintes économiques présidant à leur développement.
Quoi qu’il en soit, le règne des applications mobiles profite à leurs créateurs : selon des données compilées par l’analyste industriel Horace Dediu49, les développeurs qui proposent leurs applications sur l’App Store d’Apple ont engrangé, pour la première fois en 2014, des revenus (25 milliards de dollars) supérieurs aux ventes de billets générées par l’industrie du cinéma américaine.
Les applications mobiles représentent d’ailleurs une activité numérique plus importante en volume que la musique, les programmes télévisés et les films (achat et location) réunis. L’industrie des applications crée également plus d’emplois qu’Hollywood : 627 000 aux Etats-Unis en 2014 contre 374 000.
Il faut dire qu’elle offre à la fois une barrière à l’entrée moins imposante et un marché accessible plus vaste.
De surcroît, les smartphones et tablettes ne sont plus les seuls vecteurs de mobilité connectée. Des drones aux voitures, la mobililité n’est plus une composante d’Internet. Elle est Internet.
L’analyste Benedict Evans, collaborateur de la société de capital risque Andreessen Horowitz, est l’un des spécialistes les plus réputés mondialement du secteur des technologies mobiles. En avril 2016, il présenta sa vision de ce marché lors du Changing Media Summit organisé par The Guardian.
Il mit alors en exergue que :
- 1,5 milliard de smartphones sont désormais vendus annuellement dans le monde contre ”seulement” 300 millions d’ordinateurs dans les années 2000 ;
- la croissance du marché des smartphones n’est pas terminée ;
- en 2020, 5 milliards de personnes pourraient détenir un smartphone ;
- le processeur d’un iPhone 6 contient 625 fois plus de transistors qu’un Pentium commercialisé en 1995. Chaque acheteur d’un smartphone acquiert donc un superordinateur de poche. En septembre 2014, lors du week-end de lancement de l’iPhone 6, Apple vendit environ 25 fois plus de transistors électroniques que tous les ordinateurs de la planète n’en comptaient en 1995 ;
- le prix d’entrée d’un smartphone Android est inférieur à 50 dollars et le réseau cellulaire mondial est de plus en plus ubiquiste : 70% de la population africaine sont ainsi couverts. La dernière barrière à l’entrée des consommateurs sur ce marché a trait au coût de l’accès aux données mobiles ;
- le smartphone est le premier produit technologique universel : il a vocation à être présent dans la poche de chaque habitant de la planète alors que l’ordinateur commença par être utilisé dans chaque entreprise puis, selon la formule de Bill Gates, dans “chaque foyer et sur chaque bureau” ;
- le smartphone constitue une plate-forme Internet plus riche, tout en étant plus facile à utiliser, que le PC grâce à ses senseurs, son interface tactile, sa géolocalisation et sa caméra ;
- en conséquence, le mobile est le nouvel écosystème technologique et va être le moteur de l’innovation dans les prochaines décennies ;
- de même que les tablettes sont les ordinateurs de ce nouvel écosystème, un drone est un smartphone qui vole ;
- les automobiles sont en passe de devenir des smartphones qui roulent et le développement de voitures sans chauffeur révolutionnera la manière dont nos vies et villes sont organisées. En effet, dans la plupart des villes, les aires de parking occupent entre 20 et 30% de l’espace utilisable et la plupart des voitures sont garées durant 95% du temps50.
Ainsi, comme l’affirme Benedict Evans, faire référence à “l’Internet mobile” est aujourd’hui aussi archaïque qu’évoquer la “télévision couleur”.
La prégnance des mobiles, au premier rang desquels les smartphones, dans nos vies pose la question du futur des contenus longs.
Une étude51 menée par The Pew Research Center avec The John S. and James L. Knight Foundation apporte une réponse encourageante à ce sujet. Elle s’est concentrée sur les temps respectifs passés par les internautes mobiles sur les contenus courts et longs52 à partir de données fournies par Parse.ly53 : 117 millions d’interactions mobiles avec 74 840 articles ont été examinées.
Or, malgré la taille plus petite des écrans mobiles et les plus grandes tentations d’activités multi-tâches offertes par les smartphones, les internautes mobiles consacrent en moyenne deux fois plus de temps aux contenus longs : 123 secondes contre 57,1 pour les contenus courts.
Evidemment, deux minutes représentent un temps limité pour réellement prendre connaissance d’un contenu long, et ce d’autant plus qu’il est probablement surestimé, Parse.ly mesurant le temps passé sur un contenu par intervalles de 5,5 secondes.
Cependant, il demeure que les contenus longs suscitent un temps d’engagement double des contenus courts, ce qui représente un motif d’espoir pour les médias dans le cadre de leur relation de
l’actualité et pour les marques dans l’optique de leurs actions de marketing de contenu.
En outre, cette étude montre que, même s’il y a beaucoup plus de contenus courts sur le web54, les nombres d’interactions avec des contenus courts et longs sont presque équivalents.
L’état très alarmant de la presse écrite
Ces nouvelles habitudes de consommation médiatique sont très préjudiciables pour la presse écrite. C’est peu de dire que celle-ci a raté le virage numérique, frôlant même la sortie de route.
Elle a en effet été prise d’une “myopie marketing“, selon le concept55 inventé en 1960 par Theodore Levitt alors qu’il enseignait au sein de l’Université de Harvard56.
Cette myopie conduit les dirigeants d’entreprise à se focaliser sur leurs produits et/ou services plutôt que sur la compréhesion des besoins réels de leurs clients. L’un des exemples donnés par Levitt concerne les sociétés de chemin de fer qui crurent que leur métier était le rail alors qu’il s’agissait du transport. Elles ne s’intéressèrent donc pas à l’essor des modes de déplacement alternatifs au rail, tels que l’automobile et l’aviation, et perdirent une grande partie de leur marché accessible.
La presse écrite commit la même erreur en considérant trop longtemps que son métier était de produire du papier et non des contenus alors même que ses clients s’éloignaient de ce mode de consommation et adoptaient de nouveaux usages numériques.
Le résultat fut encore plus dramatique que pour les sociétés de chemin de fer, comme le montre “L’état d’Internet“ présenté chaque année57 par Mary Meeker, l’ancienne analyste vedette de Morgan Stanley aujourd’hui associée au sein du fonds d’investissement Kleiner Perkins Caufield Byers.
Elle commente notamment à cette occasion un graphique montrant les parts respectives des différents médias en matière d’attention et de monétisation. Lors de sa dernière présentation en date58, elle souligna ainsi que la part d’attention médiatique de la presse écrite était restée stable à 4% en 2015, alors que sa part dans les investissements publicitaires avait légèrement décliné (de 18% à 16%). Cela signifie que la chute des revenus publicitaires de la presse est loin d’être achevée.
Dans le même temps, les investissements publicitaires sur mobiles sont passés en un an de 8% à 12% du marché publicitaire total – essentiellement au profit de Facebook et Google59. Mais ils sont toujours largement inférieurs au rôle joué par les mobiles dans les pratiques médiatiques des consommateurs (voir le graphique reproduit ci-dessous).
(CC) Mary Meeker
Au-delà de cette vue globale, trois rapports émanant respectivement du Pew Research Center, de Reuters et d’Edelman dressent un constat plus détaillé et tout aussi préoccupant de l’état de la presse.
Les principales conclusions du “State Of The News Media 2016“60 du Pew Research Center61 se présentent comme suit :
- 2015 a été la pire année depuis 2008 pour le déclin de la presse américaine en termes de revenus : elle a perdu 7% de sa diffusion quotidienne et 8% de ses revenus publicitaires ;
- cette tendance est d’autant plus grave que d’autres médias traditionnels se portent mieux outre-Atlantique : la télévision par câble/satellite a par exemple vu son chiffre d’affaires croître de 10% ;
- le nombre de journalistes employés à plein temps dans la presse écrite américaine s’élevait à 32 900 à la fin de l’année 2014, soit une baisse de 10% en un an et de 40% en dix ans. Les plans sociaux en cours dans ce secteur impliquent qu’il comptera bientôt moins de collaborateurs que celui de la télévision locale (27 600) qui est plus stable ;
- les grands sites d’information tout numérique bénéficient d’investissements de capital-risqueurs mais la plupart ne sont pas rentables opérationnellement ;
- les podcasts continuent de se développer même si seulement 21% des adultes américains écoutent un épisode de podcast au cours d’un mois donné et que 64% n’en suivent jamais ;
- le marché publicitaire numérique américain a progressé de 20% en volume en 2015 pour atteindre près de 60 milliards de dollars. Cela représente une croissance plus forte qu’en 2013 et 2014 ;
- mais cinq grandes plates-formes (Facebook, Google, Microsoft, Twitter et Yahoo!) en phagocytent 65% avec Facebook et Google qui se taillent la part du lion (cf. supra) ;
- ces plates-formes sont cependant dépendantes des médias d’information traditionnels pour leurs contenus. Réciproquement, ceux-là dépendent d’elles pour la diffusion de leur production éditoriale. De plus en plus, le suivi (reportages sur le terrain) et la relation (création de contenus) de l’actualité sont laissés aux médias d’information traditionnels alors que ces missions jouent un rôle clé dans le développement des plates-formes numériques. Or le suivi et la relation de l’actualité ne sont pas aisément monétisables sans la puissance de diffusion et curation desdites plates-formes. Cette évolution pose la question du rapport entre producteurs et diffuseurs de contenus, lequel va déterminer la capacité des citoyens-consommateurs à s’informer de manière idoine dans le futur (voir page →) ;
- le marché de la publicité sur mobiles a augmenté de 65% en volume en 2015 – alors qu’il connaissait des taux de croissance à trois chiffres les années précédentes – et représente désormais 53% du secteur de la publicité numérique et 17% du marché publicitaire total outre-Atlantique.
Les enseignements majeurs du “Digital News Report 2016“62, réalisé par l’Institut Reuters d’étude du journalisme de l’Université d’Oxford dans 26 pays à travers le monde, sont peut-être plus inquiétants encore car ils ont notamment trait à la défiance croissante du public à l’égard des médias d’information :
- la confiance dans la presse continue de s’éroder et les réseaux sociaux de gagner en influence dans les choix d’information des citoyens-consommateurs : seulement 45% des personnes interrogées par Reuters estiment pouvoir faire confiance “à la plupart des nouvelles la plupart du temps“ ;
- en outre, 41% des participants à ce sondage considèrent que les médias d’information sont fiables la plupart du temps et 34% ont la même opinion des journalistes ;
- dans presque tous les pays où cette enquête a été menée (à l’exception de l’Allemagne), une majorité des personnes qui s’informent sur les réseaux sociaux n’ont pas conscience de l’identité des médias qui ont produit les contenus qu’elles y consomment (je détaille ce phénomène en page →) ;
- plus les internautes sont jeunes, plus grand est le nombre de sources d’information numériques sur lesquelles ils suivent l’actualité : 17% des 18-24 ans en utilisent ainsi cinq ou plus, contre 11% des 55-64 ans et 8% des plus de 65 ans. Or, plus grand est le nombre de sources d’information des internautes, plus faible est leur niveau de confiance dans les médias d’actualité ;
- les médias en ligne ont supplanté la télévision dans le suivi de l’actualité chez les individus de moins de 45 ans. Parmi les 18-24 ans, les réseaux sociaux dépassent la télévision comme principale source d’information ;
- la consommation de vidéos numériques consacrées à l’actualité représente encore un comportement minoritaire à travers le monde : seulement 24% des personnes interrogées en regardent une par semaine ;
- malgré les développements de Snapchat dans ce domaine, les services de messagerie demeurent encore très faiblement utilisés à l’échelle internationale en matière de suivi de l’actualité. Les exceptions notables sont Kakao Talk et WhatsApp en Corée du Sud ;
- les données de ce rapport probablement les plus alarmantes pour les médias d’information63 sont celles qui révèlent que plus de citoyens se satisfont de recevoir des informations en fonction de ce qu’ils ont lu auparavant en ligne (36%) que des choix éditoriaux des journalistes (30%). Cette approche n’est pas dangereuse que pour les producteurs d’information. Elle l’est aussi pour la démocratie car elle reflète le rôle croissant de la “bulle de filtres” (voir aussi page →) : l’intelligence artificielle régissant les services qui nous sont proposés sur Internet est programmée pour nous faire plaisir à notre insu en allant, en particulier, dans le sens de nos opinions. Or la sagesse civique résulte du débat plutôt que de l’uniformité de la pensée.
Les résultats de l’enquête conduite par Edelman dans 28 pays à l’échelle internationale64 ne sont pas plus rassurants : 63% des participants affirment faire confiance aux moteurs de recherche pour la relation de l’actualité contre 58% aux médias traditionnels et 53% aux médias en ligne.
En clair, les internautes accordent davantage de crédit à Google News qu’à ses sources. On peut penser que ce résultat s’explique en partie par le fait que Google News sélectionne les contenus d’information les plus populaires.
Mais cette étude constitue une énième mauvaise nouvelle pour les médias d’information, et ce d’autant plus qu’elle signale que les journalistes disposent d’un niveau de confiance également médiocre sur les réseaux sociaux : 78% des internautes s’y fient aux nouvelles mises en ligne par leurs proches (amis ou famille) contre 65% aux experts académiques et 44% aux journalistes.
Une “Une” de presse écrite est-elle encore influente à l’ère numérique ?