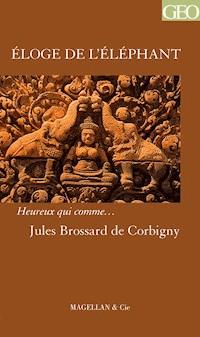
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Lebensstil
- Serie: Heureux qui comme…
- Sprache: Französisch
Suivez Jules Brossard de Corbigny dans un voyage merveilleux et étonnant à dos d'éléphant
En 1871, Norodom envoie une caravane, étrange et somptueuse, à Bangkok pour le retour des princesses cambodgiennes retenues par le roi de Siam. Jules Brossard de Corbigny (1841-1934), alors représentant de la France au Cambodge, en profite pour se joindre à la caravane et traverse ainsi à dos d’éléphant l’intérieur du Cambodge. Outre son témoignage exceptionnel sur le pays khmer, Brossard de Corbigny livre un éloge insolite de la monture des rois.
Récit publié dans la Revue maritime et coloniale en 1872 sous le titre De Saigon à Bangkok par l’intérieur de l’Indochine, notes de voyage – janvier-février 1871.
Une autobiographie envoûtante, tant par l'exotisme qu'elle propose que par le style captivant de l'auteur
EXTRAIT
Le royaume du Cambodge. – Au nord de la Cochinchine française, entre les cent et cent cinquième degrés de longitude est de Paris, existe un petit royaume dont la superficie pourrait être comparée à celle du Portugal. Il s’appelle le Cambodge, comme le grand fleuve qui le traverse du nord au sud. Phnom Penh, sa capitale, admirablement située au centre du pays, se trouve en même temps au sommet du delta qui fertilise de ses mille bras la basse Cochinchine, notre colonie de l’Extrême-Orient. Deux rois règnent sur le Cambodge, mais un seul y gouverne. Au premier roi appartient la couronne, le pays est à lui. Sur le théâtre de la politique, le second roi n’est qu’une doublure toujours prête à remplir le rôle principal, rôle qui lui-même n’exige guère d’études approfondies et ressemble en tout point à celui que le roi de Siam joue sur une plus grande scène, à Bangkok. Les mœurs, les lois, les usages, le costume des Cambodgiens sont, en effet, l’exacte copie de ce qu’on observe à Bangkok.
A PROPOS DE LA COLLECTION
Heureux qui comme… est une collection phare pour les Editions Magellan, avec 10 000 exemplaires vendus chaque année.
Publiée en partenariat avec le magazine Géo depuis 2004, elle compte aujourd’hui 92 titres disponibles, et pour bon nombre d’entre eux une deuxième, troisième ou quatrième édition.
A PROPOS DE L’AUTEUR
Jules Brossard de Corbigny était un officier de marine français. Né à Orléans le 14 avril 1841 et mort le 16 décembre 1934. Il accompagna dans sa mission en Annam et au Cambodge son frère Charles-Paul.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 155
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LA MONTURE DES ROIS KHMERS
Présenté par Émilie Cappella
Jules Brossard de Corbigny (1841-1934) était lieutenant de vaisseau avant d’être nommé, du 11 novembre 1870 au 1er janvier 1871, représentant du protectorat français au Cambodge. Son histoire se confond ensuite avec celle de son frère, dont il consigne les expéditions : Charles-Paul Brossard de Corbigny (1822-1900), ancien polytechnicien que l’on peut qualifier d’officier-diplomate, prend en 1875 le commandement d’une mission en Annam dont Jules est l’historiographe. Quant à la vie du cadet avant et après l’Indochine, son secret est peut-être enfoui dans les archives de Meung-sur-Loire, dans le Loiret, où il meurt en 1934.
Phnom Penh n’est encore qu’une ville naissante. En 1866, le roi Norodom a transféré sa capitale dans ce village où il a été officiellement sacré le 3 juin 1864, après la signature du traité franco-cambodgien qui place le Cambodge sous protectorat français pour le protéger des ambitions siamoises. En janvier 1871, fort de son indépendance face au puissant Siam, Norodom décide d’envoyer chercher les princesses de sa famille retenues par le roi de Siam à Bangkok. À cet effet, il apprête une caravane somptueuse de soixante-huit éléphants digne des Mille et une nuits. Jules Brossard de Corbigny, qui vient d’achever sa mission de représentant français à Phnom Penh, réside alors à Saigon. Mais le jeune homme de trente ans médite depuis longtemps un voyage dans « cette contrée encore déserte, sur nos cartes, qui s’étend de la vallée du Cambodge aux rives du Ménam », de sorte qu’il profite des relations nouées avec le roi du Cambodge pour se joindre à la caravane et traverser ainsi, à dos d’éléphant, l’intérieur du royaume. D’emblée, il rejette le rêve féerique associé à la caravane orientale et refuse de se laisser prendre au cliché littéraire de l’exotisme merveilleux : « Laissons donc croire que les princesses opprimées sont belles comme le jour ; que les princes de ces cours sont magnifiques et chevaleresques, et leurs ambassadeurs chargés de pierres précieuses et de talismans merveilleux. Quant à nous, habitués depuis longtemps aux réalités qui nous entourent, toute illusion est impossible, et nous ne voyons dans cette mission extraordinaire qu’une facilité de plus pour traverser un pays presque inconnu, et observer de près les mœurs des indigènes et de leurs curieuses montures. »
Du départ de Phnom Penh le 6 janvier à l’arrivée à Bangkok le 19 février, le récit de Jules Brossard de Corbigny offre un témoignage remarquable sur le pays khmer. Il s’attarde notamment sur la province de Battambang, conquise par Jayavarman II (821-850), fondateur de la puissance angkorienne. Il observe avec intérêt les moindres détails de la vie cambodgienne, ses mœurs, son économie, les usages des mandarins, des bonzes et des paysans ; il décrit la vice-royauté de Battambang, visite les pagodes, ruines et autres monuments khmers. Cependant, loin de prétendre à une vue d’ensemble, le diplomate en voyage laisse ce soin à ses collègues scientifiques, pour privilégier une vision fragmentaire selon un procédé agréable au lecteur : tout au long du périple, il recueille des observations et consigne de petites anecdotes auxquelles il donne un titre, découpant ainsi son texte en notices thématiques.
Le sujet récurrent de ce documentaire est le moyen de transport lui-même, c’est-à-dire l’éléphant. Là réside l’originalité du texte qui parcourt toute la gamme des affects, depuis la moquerie jusqu’au regret amoureux. Au début du voyage, en effet, la monture royale subit l’ironie de son passager sceptique : « Prenez sans crainte telle posture qui vous conviendra. Pourvu que vous ne soyez ni couché, vous n’auriez pas votre longueur, ni assis, vos pieds ballotteraient en dehors, ni debout, le dôme est trop bas, ni n’importe comment, vous pouvez vous mettre à l’aise : le palanquin bien attaché ne tombe jamais. » Mais le spectacle pittoresque de la caravane et les étonnantes mœurs éléphantesques séduisent bientôt le narrateur, qui finit par considérer les éléphants comme de véritables compagnons de voyage. Ainsi perd-il l’appétit et le goût d’écrire lorsque l’ambassade cambodgienne renvoie les éléphants et leurs cornacs chez eux, car elle quitte la route de terre pour rejoindre Bangkok par le fleuve.
Cet heureux éloge de l’éléphant d’Asie va néanmoins de pair avec un regard sarcastique sur les hommes, par une conversion du cœur ordinaire aux Occidentaux qui parcourent l’Asie à la fin du XIXe siècle. Les mœurs des éléphants y semblent, il est vrai, moins cruelles que celles des hommes.
L’orthographe des noms propres a été modernisée.Récit publié dans La Revue maritime et coloniale en 1872 sous le titre : « De Saigon à Bangkok par l’intérieur de l’Indochine, notes de voyage – janvier-février 1871 ».
ÉLOGE DE L’ÉLÉPHANT
Le royaume du Cambodge. – Au nord de la Cochinchine française, entre les cent et cent cinquième degrés de longitude est de Paris, existe un petit royaume dont la superficie pourrait être comparée à celle du Portugal. Il s’appelle le Cambodge, comme le grand fleuve qui le traverse du nord au sud. Phnom Penh, sa capitale, admirablement située au centre du pays, se trouve en même temps au sommet du delta qui fertilise de ses mille bras la basse Cochinchine, notre colonie de l’Extrême-Orient. Deux rois règnent sur le Cambodge, mais un seul y gouverne. Au premier roi appartient la couronne, le pays est à lui. Sur le théâtre de la politique, le second roi n’est qu’une doublure toujours prête à remplir le rôle principal, rôle qui lui-même n’exige guère d’études approfondies et ressemble en tout point à celui que le roi de Siam joue sur une plus grande scène, à Bangkok. Les mœurs, les lois, les usages, le costume des Cambodgiens sont, en effet, l’exacte copie de ce qu’on observe à Bangkok.
On ne pourrait donc raconter sur les mœurs du pays rien qui n’ait été dit déjà par les voyageurs à Siam, mais chaque peuple a son histoire. Celle du Cambodge contient des pages glorieuses, si on en juge par les ruines admirables disséminées dans ses anciennes possessions.
Victime des empiétements d’un voisin victorieux, le Cambodge ne serait plus aujourd’hui qu’une province siamoise si, en 1863, la France, établie depuis peu dans les mers de Chine, ne lui avait offert son puissant protectorat et conjuré de plus, les armes à la main, une révolution menaçante pour la sécurité de son roi.
L’amiral de La Grandière, gouverneur de la Cochinchine, mena à bonne fin cette double question de vie ou de mort pour le petit royaume, et opposa du même coup une frontière inviolable aux empiétements de Siam. Un traité définissait la nouvelle position du Cambodge ; son roi se déclarait indépendant de ses anciens envahisseurs et concédait à notre pavillon, auprès de son palais, le terrain nécessaire à l’établissement du délégué nommé par le gouvernement pour remplir auprès de Sa Majesté les fonctions de représentant du protectorat français.
Chargé pendant quelque temps de cette mission intéressante, nous avions pu sur les lieux mêmes préparer un voyage médité depuis plus d’une année. Combien de fois, en jetant les yeux sur l’atlas, n’avions-nous pas désiré savoir par nous-même quelle est cette contrée encore déserte, sur nos cartes, qui s’étend de la vallée du Cambodge aux rives du Ménam. Est-elle, comme on le dit, le lieu de passage de caravanes, de chariots allant vendre à Siam les produits de l’intérieur ? Pourrait-on y établir la ceinture électrique qui ne tardera pas à se fermer sur les deux hémisphères du globe terrestre1 ?
Ajouter à l’atlas un bout de route, le cours d’un ruisseau, un nom de village, est déjà un but qui vaut la peine d’être poursuivi. Quand ce tracé, ce fleuve, ce nom peuvent un jour servir de point de repère, de renseignement à une entreprise pratique, on n’a pas perdu sa peine. Joignez à cela la belle saison, une occasion de caravane exceptionnelle ; en voilà certes plus qu’il ne fallait pour faire hâter le jour de notre départ.
Départ de Saigon. – Le 4 janvier, au point du jour, nous prenions passage sur l’aviso le Bien-hoa, qui bientôt après faisait route pour Phnom Penh, où déjà se trouve rassemblée notre caravane d’éléphants à destination de Siam.
M. de Chaunac-Lanzac, officier d’infanterie de marine, partage avec nous les chances du voyage ; nous serons l’un pour l’autre d’un secours indispensable ; nous nous protégerons contre les caprices d’un soleil brûlant, toujours à craindre malgré différents séjours dans les pays chauds.
Nous avons aussi avec nous un médecin fort savant et point bavard. Sa science est basée sur l’expérience des praticiens de la colonie, et ne saurait être en défaut : le « médecin de papier », en un mot, contient dans ses quelques pages plus qu’il ne faut, espérons-le, pour les besoins de notre route. Un de nos amis, le docteur P***, de la marine, nous a fait compléter notre petite pharmacie, et grâce à lui, nous sommes devenus, en vingt-quatre heures, capables d’entreprendre les cures les plus hardies ; les terminer sera peut-être plus difficile.
Chacun, du reste, nous témoigne au départ les mêmes attentions : « N’oubliez pas ceci… J’ai fait mettre cela dans vos caisses… Prenez donc ma carabine, etc. » C’est seulement en partant pour un voyage comme celui-ci qu’on connaît bien ses camarades. Ceux de Saigon sont pour nous des amis empressés.
Grâce à son faible tirant d’eau, le Bien-hoa peut passer par les arroyos, ou canaux intérieurs : de cette façon, le trajet de Saigon à Phnom Penh s’effectue en deux jours sans autre relâche que My Tho, village important situé sur le Cambodge à la sortie des canaux communiquant avec Saigon. Le soir de notre départ, nous couchions donc à ce mouillage, et le lendemain, dès le point du jour, le petit vapeur reprenait sa route à travers les nombreux îlots du delta qu’on appelle la basse Cochinchine.
Aspect du fleuve. – Dans ces contrées, voisines des embouchures, rien n’est monotone comme l’aspect du grand fleuve. La vue se trouve toujours arrêtée par des îlots sans nombre, presque noyés et couverts d’éternels palétuviers d’un vert glauque. À de bien rares intervalles, les palmiers et les bananiers, si nombreux dans l’intérieur, ont conquis le rivage et protègent de leur ombre quelques cases isolées. Les villages, eux-mêmes, sont toujours en dehors de l’artère principale ; cette grande voie est déserte, mais pour peu qu’on remonte un des mille affluents, on ne tarde point à rencontrer quelque flottille de barques, à l’ancre, en train de charger le riz entassé dans les cases de la rive. À la marée favorable, ces bateaux sortiront de tous côtés à travers les îles, et s’en iront au fil de l’eau comme un vol d’oiseaux pêcheurs ; la barque de mer hissant ses voiles de paille prendra bientôt les devants pour porter sur la côte le riz et le poisson salé ; les petits bateaux, en guise de voile, tendront au vent quelque natte ou bien les moustiquaires de l’équipage, et s’en iront ainsi à la dérive vers un gros village de trafiquants.
Un peu au-dessus de Vinh Long, centre important de l’intérieur, les tristes palétuviers disparaissent peu à peu ; les cocotiers, les banians, les manguiers et les aréquiers surtout, qui les remplacent, indiquent de tous côtés de riches cultures et des jardins ; mais bientôt aussi, ils s’effacent à leur tour, et l’on revoit souvent, aux environs de Chau Doc, les horizons sans fin des plaines de hautes herbes, humides et désolées.
En continuant à remonter le fleuve, on franchit bientôt les frontières de Cochinchine pour entrer enfin dans le royaume du Cambodge ; peu à peu, les berges se relèvent, les joncs deviennent plus rares, et d’énormes manguiers s’avancent jusqu’au bord pour protéger de leur ombre les barques au repos. De temps en temps, une petite pagode de paille se dresse au pied d’un banian ; les cases, espacées de distance en distance, forment la haie le long des rives ; les champs cultivés descendent vers le fleuve, gagnant chaque jour sur les eaux qui se retirent la place d’une nouvelle rangée de mûriers ou d’indigotiers.
En voyant ici l’activité agricole portée vers les bords du fleuve jusque-là si déserts, on serait tenté de croire qu’on traverse un pays plus productif que la basse Cochinchine. Il n’en est rien pourtant ; la plupart des cultures viennent forcément se ranger, au Cambodge, le long du seul cours d’eau important du pays, tandis que, plus bas, la Cochinchine est recoupée en tous sens d’arroyos fertilisateurs, cachant, dans leurs méandres sans nombre, une grande richesse agricole en voie continuelle de développement.
Au Cambodge, au contraire, tout progrès est inconnu et l’on a sous les yeux, en suivant le cours du fleuve, la plus grande partie des cultures du royaume.
Après vingt-quatre heures de chauffe active depuis My Tho, notre aviso, laissant sur la droite l’artère principale, met le cap sur Phnom Penh et s’en va jeter l’ancre dans le bras du grand lac, devant le protectorat français.
Phnom Penh, capitale du Cambodge. – Il y a bien peu de villes bâties au bord de l’eau qui ne soient pour l’étranger, lorsqu’il met pied à terre, une source de désenchantements. Vu du pont du navire, l’aspect général d’un port se rehausse du reflet des eaux et s’encadre le plus souvent dans un paysage aux lignes grandioses ; mais à mesure qu’on approche des quais, l’effet d’ensemble s’efface peu à peu ; l’illusion s’envole et les détails mesquins, grossissant à vue d’œil, s’emparent bientôt de toute l’étendue du regard. À Phnom Penh, ce charme de l’aspect général est de bien courte durée ; vue de l’autre côté du fleuve, à l’arrivée, la ville semble en effet de quelque importance ; la pyramide, le palais neuf, la tour de l’horloge, les mâts de pavillon, se dégagent tout d’abord de la ligne obscure des cases de la rive ; les avisos du roi s’enlèvent en silhouettes légères sur la foule compacte des barques serrées contre le bord et l’on se croit en face d’une agglomération de quelque profondeur ; mais il faut bientôt rabattre de cette bonne impression. La capitale cambodgienne n’est qu’une double rangée de cases boiteuses déroulées près du fleuve sur une grande longueur, il est vrai, mais sans aucune profondeur.
Une seule rue, un chemin plutôt, sépare ces pauvres habitations construites, pour la plupart, avec des feuilles et du bambou ; sur le devant de la case, un petit étalage de vases en cuivre, de poteries communes, et de cotonnades européennes, masque au regard les profondeurs obscures où grouillent pêle-mêle avec les chiens, les porcs et les coqs de combat, les jeunes produits variés à l’infini de tous les croisements des races indochinoises.
Au beau milieu de la rue, les marchands ambulants étalent leurs petits paquets de cannes à sucre, leurs âcres fritures, ou quelque tourniquet de loterie que ne dirige pas seule la main du hasard, tandis que des chiens pelés fouillent avec ardeur les immondices accumulées le long des habitations. Tel est encore maintenant l’aspect du centre de la capitale cambodgienne, mais il est juste d’ajouter qu’une partie du quartier principal va être mise à bas pour faire place aux maisons à la chinoise qu’on bâtira prochainement aux frais de la couronne, et dont les revenus seront intégralement versés à la cassette royale (sauf les petits allégements qu’ils pourraient bien avoir à subir dans le trajet, entre les mains des percepteurs indigènes).
En avançant toujours vers le sud de la ville, on arrive bientôt en face du palais. Ici, au moins, on peut respirer à l’aise sans trop craindre les odeurs écœurantes qui tout à l’heure nous serraient à la gorge. La vue du fleuve n’est plus masquée par les cases, et près du bain des femmes de Sa Majesté, le vapeur le Gia-dinh apparaît tout à coup, entouré de satellites de moindre dimension. C’est ici l’ancrage de la flottille royale ; elle est au grand complet, et son aspect est fort convenable, grâce aux soins de quelques mécaniciens français chargés d’entretenir les navires et de diriger, en outre, de petits ateliers établis par eux-mêmes dans l’enceinte du palais, d’après les ordres du roi.
Le palais du roi. – L’habitation royale actuelle est toute provisoire ; c’est une réunion de grandes cases irrégulières faites de planches et de bambous. L’enceinte est vaste, formée de murs blanchis et coupés de grilles venues d’Europe.
Près de l’entrée, un pavillon de bois rehausse un peu l’aspect, plus que modeste, de la grande salle d’audience ; derrière celle-ci se trouvent les appartements particuliers et les habitations des femmes. Là ne pénètre guère d’autre étranger que le médecin du protectorat, appelé de temps en temps à donner ses soins à quelque dame de la cour. Au Cambodge, pourtant, les nombreuses femmes des hauts personnages ne sont point, comme dans l’Asie occidentale, les tristes recluses qu’un seul regard profane rendrait indignes ; les reines, dans les réceptions que le roi fait souvent aux étrangers, peuvent se tenir auprès de Sa Majesté, sur une estrade un peu plus basse, et prendre librement leur part à ces fêtes d’intérieur.
Soirée au palais. Théâtre. – Nous assistions, naguère encore, à une de ces soirées particulières que Sa Majesté avait eu la gracieuseté de commander à notre intention. Introduit dans la salle des danses, où déjà se trouvait réuni le personnel du palais, nous prenions place auprès du roi, pendant que l’orchestre indigène et les chœurs des femmes du harem attaquaient vigoureusement le morceau d’ouverture.
Malgré la monotonie du rythme et la voix tremblotante des chanteuses, on sent dans la musique cambodgienne une certaine inspiration primitive, un sentiment de l’harmonie, difficile peut-être à rapprocher de nos idées musicales, mais qui semble bien d’accord avec la vie calme et les mœurs insouciantes de l’auditoire. Quelques instruments à cordes, des espèces de guitares de différents tons, soutiennent le chant dominant d’une série de timbres argentins disposés en cercle autour du principal artiste. Un ou deux gros tam-tams ponctuent sourdement la mesure et des claquettes de bois dur leur répondent presque continuellement. Il y a aussi des espèces d’harmonicas dont les lames de bois et de fer résonnent deux à deux sous les marteaux voltigeant sans cesse au-dessus de leur table d’harmonie. Quant à la pièce qui se déroule pendant ce temps sous nos yeux, son principal intérêt réside pour nous dans l’originalité des costumes ; les couleurs en sont gaies et voyantes, et bien qu’elles soient presque effacées par les brochages dorés du tissu, l’ensemble de ces riches oripeaux prend aux lumières un aspect très riche et très brillant. Ces costumes de théâtre sont invariables pour toutes les pièces, qui elles-mêmes diffèrent fort peu entre elles. Elles sont toutes tirées des récits fabuleux de la mythologie bouddhique. Ce sont des espèces de ballets lentement cadencés racontant par des chants et des pantomimes les traditions les plus anciennes des livres indiens.





























