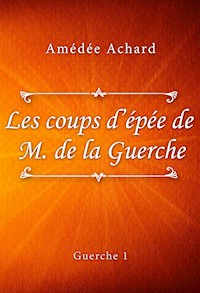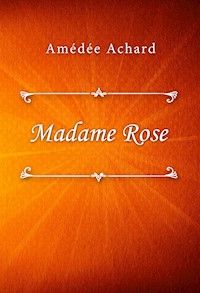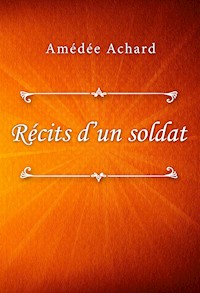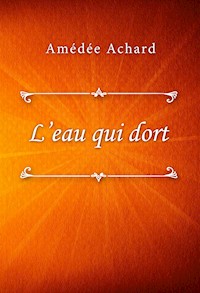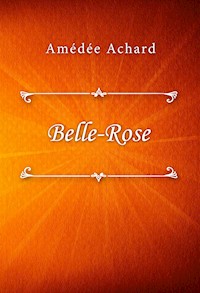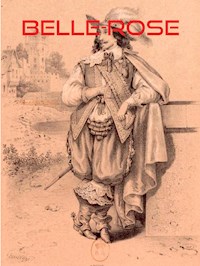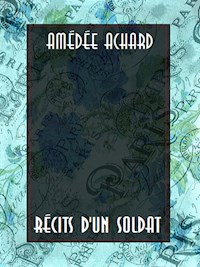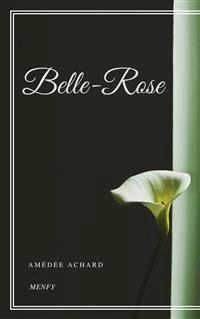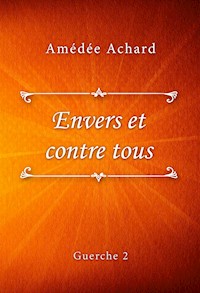
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La suite du roman
Les coups d’épée de Monsieur de La Guerche.
Das E-Book Envers et contre tous wird angeboten von Classica Libris und wurde mit folgenden Begriffen kategorisiert:
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright
First published in 1874
Copyright © 2022 Classica Libris
Chapitre 1
LES CONSEILS DU DÉSESPOIR[1]
La guerre de Trente Ans allait entrer dans cette période de furie qui devait promener tant de batailles et d’incendies au travers de l’Allemagne. C’était l’heure terrible où les meilleurs capitaines de l’Europe et les plus redoutés allaient se rencontrer face à face et faire de la mort la seule reine qui fût connue de l’Elbe au Danube, de la Poméranie au Palatinat. Deux figures dominent cette époque : Gustave-Adolphe, le héros de la Suède, et Wallenstein, le maître et l’épée du vieil empire germanique.
Combien d’événements qui devaient sortir de leurs tombes sitôt ouvertes !
C’est au milieu de ce déchaînement de toutes les colères, dans ce tourbillon de tempêtes sanglantes, que nous retrouvons les personnages qui figurent dans la première partie de ce récit, et que nous les suivrons dans leurs nouvelles aventures parmi les intrigues et les combats, ceux-là conduits par leurs rancunes et leur haine, ceux-ci par leur dévouement et leur amour. C’est donc avec Mademoiselle de Souvigny et Mademoiselle de Pardaillan, le comte de Pappenheim et le comte de Tilly, Jean de Werth et Mathéus Orlscopp, Madame la baronne d’Igomer et Marguerite, Magnus et Carquefou, Armand-Louis et Renaud, que nous allons de nouveau battre la campagne des rives de la Baltique aux champs de Lutzen, heurtant des villes et des châteaux, chemin faisant.
On se souvient sans doute que Monsieur de la Guerche et Monsieur de Chaufontaine, lancés à la poursuite de leurs fiancées, Adrienne de Souvigny et Diane de Pardaillan, avaient poussé leurs chevaux vers le camp du roi de Suède, auprès de qui ils espéraient trouver aide et protection.
Gustave-Adolphe était alors avec quelques milliers d’hommes dans les environs de Potsdam, où il s’efforçait, par les remontrances les plus éloquentes, appuyées de diverses pièces d’artillerie braquées contre la ville, de détourner son beau-père, l’électeur de Brandebourg, de l’alliance de Ferdinand. Il y avait pour lui une importance extrême à ne pas laisser, entre l’armée qu’il se proposait de conduire au cœur de l’Allemagne, et les rivages de la Suède, une province hostile dont les places fortes, en cas de revers, pussent mettre obstacle à son retour.
Les remontrances non plus que les plaidoyers de Gustave-Adolphe en faveur des princes protestants d’Allemagne, menacés dans leur indépendance par la puissante Maison de Habsbourg, n’avaient de prise sur le cœur astucieux de Georges Guillaume ; mais les pièces d’artillerie produisaient une meilleure et plus profonde impression sur son esprit. À mesure que leur nombre augmentait, l’électeur de Brandebourg se montrait de plus en plus disposé à traiter. Lorsque le roi de Suède, fatigué des longues hésitations qui lui faisaient perdre un temps précieux, prit le parti violent de diriger les bouches de ses canons contre le palais de son beau-père, celui-ci, convaincu désormais par l’excellence des arguments qu’on lui présentait, consentit sérieusement à négocier.
Malheureusement pour la cause que le roi de Suède était venu défendre en Allemagne, Gustave-Adolphe n’était pas seul au courant des pourparlers qui le retenaient tantôt sous les murs de Potsdam, tantôt sous les murs de Berlin. Le duc François-Albert savait jour par jour ce qui se passait dans les Conseils du roi, et jour par jour il en informait le général en chef de l’armée impériale. Le comte de Tilly, à peu près sûr que Gustave-Adolphe ne sortirait pas de son inaction forcée aussi longtemps qu’il n’aurait pas vaincu la résistance passive de Georges-Guillaume, voulut frapper un grand coup et résolut de s’emparer de Magdebourg, dont le prince-archevêque avait réclamé l’alliance suédoise, mettant sa petite armée sous le commandement de Thierry de Falkenberg, un des lieutenants du jeune roi.
Réunissant donc à la hâte les différentes troupes éparses dans les pays voisins, et pressé par la fougue du comte de Pappenheim, qui brûlait de se mesurer avec le héros du Nord, il se présenta subitement devant la ville libre, au moment où Monsieur de la Guerche et Renaud se rendaient auprès de Monsieur de Pardaillan.
Lorsque les deux gentilshommes entrèrent dans le camp suédois, la nouvelle que Magdebourg était menacé venait d’y parvenir.
Vingt-quatre heures après, un courrier arriva, annonçant que la ville était investie. Un autre messager l’accompagnait. Mais tandis que l’un, expédié par le prince Christian-Guillaume, archevêque protestant de Magdebourg, demandait le roi, l’autre, guidé par Carquefou, demandait Monsieur de Pardaillan, qu’il trouvait au lit, malade et souffrant.
Cette nouvelle inattendue, que Magdebourg était canonné, excita la colère du roi, en même temps que le message apporté par Benko jetait l’épouvante dans l’âme de Monsieur de Pardaillan. Gustave-Adolphe y voyait un échec à la cause pour laquelle il avait tiré l’épée ; le vieux huguenot ne pensait qu’à sa fille et à son enfant d’adoption exposées à toutes les horreurs d’un siège qui empruntait au nom de l’homme qui l’avait entrepris un caractère plus menaçant.
Le visage bouleversé par la terreur, Monsieur de Pardaillan appela auprès de lui Monsieur de la Guerche et Renaud et leur présenta le messager envoyé par Magnus.
– Elles n’ont échappé au danger le plus horrible que pour tomber dans un danger non moins redoutable ! dit-il.
– Dieu ne nous les a-t-Il rendues que pour nous les ravir encore ! s’écria Armand-Louis.
– Coquin de Magnus ! murmura Renaud, dire que c’est lui, et non pas moi !… N’importe ! je l’embrasserai de bon cœur, lorsque nous entrerons à Magdebourg…
– Entrer à Magdebourg ! interrompit Monsieur de Pardaillan ; avec qui donc comptez-vous y entrer ?
– Mais, j’imagine, avec le roi Gustave-Adolphe, et je prétends que les dragons de la Guerche soient les premiers à en passer les portes.
– Que parlez-vous du roi ! me verriez-vous si triste si Sa Majesté le roi levait son camp et marchait contre l’ennemi ?… Ah ! ne l’espérez pas ! Le comte de Tilly est seul devant Magdebourg, seul il y entrera.
– Ainsi, vous croyez que Gustave-Adolphe, ce prince à qui vous avez consacré votre vie entière, ne volera pas au secours d’une ville qui s’est donnée à lui ?
– Ah ! ne l’accusez pas ! Peut-il partir quand l’électeur, son beau-père, lui marchande une place forte, et se réserve peut-être la chance maudite de tomber sur les Suédois en cas d’échec et de les écraser pour obtenir une paix avantageuse de l’empereur Ferdinand ?
– Ainsi, vous pensez que Magdebourg ne sera pas secouru ? dit Monsieur de la Guerche, qui pâlit.
– Magdebourg ne le sera par personne, si ce n’est par moi.
Monsieur de Pardaillan fit un effort pour saisir ses armes et se lever, mais une douleur atroce le fit retomber sur son siège en gémissant.
– Ah ! malheureux ! dit-il : un père seul pouvait leur tendre la main, et ce père misérable est réduit à l’impuissance !
– Vous vous trompez, monsieur le marquis, dit Armand-Louis : Mademoiselle de Pardaillan et Mademoiselle de Souvigny, à qui ma foi est engagée, ne seront pas abandonnées parce que l’âge et la maladie trahissent votre courage : ne sommes-nous pas là, Monsieur de Chaufontaine et moi ?
– Certes, oui, nous y sommes ! s’écria Renaud, et nous vous le ferons bien voir !
Monsieur de Pardaillan, tout ému, leur saisit les mains.
– Quoi ! vous partiriez ? dit-il.
– Ce serait nous faire injure que d’en douter, répondit Monsieur de la Guerche. Avant une heure, nous aurons quitté le camp. Je vous demande la permission de voir le roi ; peut-être aura-t-il quelque ordre à me donner pour le commandant de Magdebourg.
– Je ne sais pas si nous sauverons la ville, dit Renaud : un secours de deux hommes, ce n’est pas beaucoup ; mais aussi longtemps que nous serons en vie, ne croyez jamais que Mademoiselle de Pardaillan et Mademoiselle de Souvigny soient perdues.
– Voilà un mot que je n’oublierai jamais ! s’écria le marquis.
Il ouvrit ses bras, les deux jeunes gens s’y jetèrent, et il les retint longtemps pressés sur son cœur.
Comme ils sortaient de la tente de Monsieur de Pardaillan, et tandis que Renaud s’essuyait les yeux, ils rencontrèrent Carquefou, qui astiquait le pommeau de sa rapière avec la manche de sa casaque de cuir.
– Monsieur, dit l’honnête valet en s’approchant de Monsieur de Chaufontaine, j’ai les oreilles longues, ce qui fait que j’entends même quand je n’écoute pas… Pourquoi avez-vous parlé tout à l’heure à Monsieur le marquis de Pardaillan du secours de deux hommes ? Ne me comptez-vous point, monsieur, ou à votre sens ne suis-je pas un homme tout entier ? On peut être poltron de naissance, poltron par caractère et par principe, et n’en pas être moins brave dans l’occasion. C’est ce que je me propose de vous démontrer quand nous serons sous les murs de Magdebourg. Cela dit, monsieur, permettez-moi d’aller faire mon testament ; car, pour sûr, nous ne reviendrons pas de cette expédition.
Armand-Louis, ayant laissé à Renaud le soin de tout préparer pour leur départ, se rendit chez le roi. Son nom lui ouvrit toutes les portes. Il trouva auprès de Gustave-Adolphe le duc François-Albert, qui semblait examiner des cartes et des plans étendus sur une table.
La vue du Saxon rappela à Monsieur de la Guerche les recommandations de Marguerite. Au sourire gracieux du duc, il répondit par un froid salut ; puis, élevant la voix :
– Je ne viens pas près de vous, Sire, pour les affaires de mon service, dit-il : un intérêt personnel m’y a conduit. Puis-je espérer que Votre Majesté voudra bien m’accorder quelques instants d’entretien particulier ?
Le duc fronça le sourcil.
– Je ne veux gêner personne, dit-il ; je sors, monsieur le comte.
Armand-Louis s’inclina sans répondre, et François-Albert s’éloigna.
– Ah ! vous n’aimez pas ce pauvre duc ! s’écria le roi.
– Et vous, Sire vous l’aimez trop ! dit Armand-Louis.
Le roi prit un air de hauteur :
– Si de telles paroles ne tombaient pas d’une bouche amie, reprit-il, je vous dirais, mon cher comte, que je suis seul juge de mes affections.
– Une personne dont Votre Majesté ne suspectera pas le dévouement, une femme qui priait pour Gustave-Adolphe le jour où la flotte quittait les rivages de la Suède, n’aimait pas non plus Monsieur de Lauenbourg : ai-je besoin de nommer Marguerite ?
Le roi tressaillit.
– Ah ! Marguerite vous l’a dit aussi ! s’écria-t-il ; je le savais ! il lui inspirait une sorte d’effroi ; personne autour de moi ne l’aime, ce pauvre duc, mais c’est mon ami d’enfance ; un jour je l’ai cruellement offensé…
– Croyez-vous, Sire, qu’il l’ait oublié ?
– Il suffit que je m’en souvienne pour que je lui pardonne d’y penser. Ah ! mon premier devoir est de tout tenter pour effacer la trace de cet outrage !
Gustave-Adolphe fit deux ou trois pas dans la salle que François-Albert venait de quitter.
– Quel sujet vous amène ici, que voulez-vous de moi ? reprit-il presque aussitôt.
Armand-Louis comprit qu’il ne fallait pas insister.
– Mademoiselle de Souvigny est à Magdebourg ; or, la diplomatie en ce moment suspend la guerre, les troupes impériales que commandait Torquato Conti ne tiennent plus la campagne et se dispersent dans toutes les directions ; ma présence ici est inutile ; je vais donc à Magdebourg, dit-il.
– À Magdebourg ! Que ne puis-je y courir avec vous ! s’écria Gustave-Adolphe.
– Et je viens demander à Votre Majesté si elle n’a pas quelque ordre à me donner pour Thierry de Falkenberg ?
– Dites-lui qu’il tienne jusqu’à la dernière extrémité, qu’il brûle sa dernière cartouche, qu’il tire son dernier boulet, qu’il défende la dernière muraille, qu’il meure s’il le faut ; foi de Gustave-Adolphe, dès que la liberté d’agir me sera rendue, j’irai lui porter le secours de mon épée.
– Est-ce tout ?
– Tout ! Ah ! dites-lui que si l’électeur de Brandebourg ne m’enchaînait pas ici, c’est avec moi que vous seriez arrivé !
D’un geste violent le roi froissa les cartes et les plans qu’on voyait sur la table.
– Si l’électeur Georges-Guillaume n’était pas le père d’Eléonore, reprit-il d’une voix sourde, voilà six semaines qu’il ne resterait pas pierre sur pierre de Spandau, et que mes cavaliers planteraient les piquets de leurs chevaux dans les rues de Berlin !
Armand-Louis fit un pas vers la porte.
– Excusez-moi, Sire ; mes heures sont comptées, dit-il. Je pars.
– Bonne chance alors, répondit le roi, qui lui tendit la main. Ah ! le plus heureux, c’est vous !
– J’ai maintenant une prière à vous adresser. Votre Majesté sait seule où je vais. Qu’elle veuille bien n’en parler à personne.
– Pas même au duc de Lauenbourg, n’est-ce pas ? répondit le roi avec un sourire.
– Au duc de Lauenbourg, surtout.
– Vos affaires sont les vôtres ; je me tairai, dit le roi avec une nuance de dépit.
Le duc François-Albert n’était pas dans la galerie qui précédait l’appartement du roi, mais Armand-Louis y découvrit Arnold de Brahé.
– Ah ! dit-il en courant à lui, le visage d’un ami là où je craignais de rencontrer une figure détestée… c’est une double bonne fortune !
Puis l’entraînant dans l’embrasure d’une fenêtre :
– Vous aimez le roi comme vous aimez la Suède ? reprit-il.
– C’est mon maître par la naissance, c’est mon maître aussi par le choix : ma vie et mon sang sont à lui.
– Alors, veillez sur Gustave-Adolphe.
– Qu’y a-t-il donc ?
– Il y a un homme que le roi aime et qui hait le roi.
– Le duc de Saxe-Lauenbourg ?
– Plus bas ! plus bas ! Quand cet homme sera dans la chambre du roi, soyez debout près de la porte, la main sur la garde de votre épée. S’il l’accompagne à la chasse, galopez auprès de lui. Si quelque expédition attire le roi loin du camp, ne perdez pas l’autre de vue. Qu’il sache bien qu’un cœur dévoué est là, et que des yeux fidèles surveillent toutes ses actions. Il est lâche, alors peut-être n’osera-t-il rien. Foi de gentilhomme, si je vous parle ainsi, c’est que j’ai de graves raisons pour le faire.
– Soyez sans crainte, je marcherai dans son ombre, je respirerai dans son air, dit Arnold, qui serra vigoureusement la main d’Armand-Louis.
Quand la nuit vint, trois hommes qui couraient à cheval étaient déjà loin du camp. Ils suivaient la route qui de Spandau se dirige vers Magdebourg.
– Ah ! disait le duc de Lauenbourg, qui n’avait plus revu Monsieur de la Guerche, si le capitaine Jacobus était ici, je l’aurais lancé sur les traces de ce maudit Français !
Chapitre 2
MAGDEBOURG
Si trois cavaliers ne pouvaient pas, sans un certain péril, franchir la longue distance qui séparait le camp suédois de la ville assiégée par le comte de Tilly, de bien plus grands dangers les attendaient aux approches du camp impérial. Une active surveillance était exercée autour de la ville par de nombreuses patrouilles de cavalerie qui ne permettaient à personne d’entrer à Magdebourg ou d’en sortir. Tout homme arrêté par elles avait grande chance d’être passé par les armes, et, le plus souvent, la balle d’un pistolet mettait fin à son interrogatoire avant qu’il eût eu le loisir de répondre. Un cordon de sentinelles relevées d’heure en heure achevait de rendre impossible toutes communications de la ville avec les campagnes environnantes. Ce n’était donc pas une entreprise aisée que de pénétrer dans Magdebourg, et, à cet égard, Armand-Louis non plus que Renaud ne se faisaient aucune illusion.
Le roulement lointain du canon leur apprit bientôt qu’ils n’étaient plus séparés de la ville que par une mince étendue de champs et de forêts. Ce bruit formidable sembla leur communiquer une ardeur plus vive, et ils poussèrent hardiment leurs chevaux en avant.
Au moment où ils débouchaient d’un bois dont le rideau couvrait la place, ils aperçurent de profondes colonnes d’infanterie qui s’avançaient contre la ville neuve, d’où montaient des nuages de fumée zébrés de flammes rouges. Des pelotons de cavalerie gardaient chaque route, cinquante pièces d’artillerie tonnaient dans la plaine, des chevaux libres couraient de tous côtés ; des cadavres, étendus dans les champs, indiquaient que des balles et des boulets avaient fait des victimes çà et là.
Au loin, les remparts de la ville se couronnaient de feu.
Les forts qui en défendaient les approches portaient à leur sommet le drapeau aux couleurs impériales.
– C’est un assaut qui se prépare ! dit Armand-Louis.
– Il y aura beaucoup de jambes cassées ce soir, murmura philosophiquement Carquefou, qui prudemment examina la mèche de ses pistolets.
Il connaissait trop bien son maître pour ignorer qu’un assaut ne se donnerait pas dans le voisinage sans qu’il s’en mêlât.
Comme si les trois chevaux eussent compris la secrète intention des cavaliers, ils continuèrent d’avancer lentement.
Les yeux de Monsieur de la Guerche ne perdaient rien de ce qui se passait autour de lui.
Les patrouilles de cavalerie et les sentinelles regardaient toutes avec une attention égale ce qui se faisait du côté de la ville.
En quelques minutes, Armand-Louis, Renaud et Carquefou eurent atteint la ligne que ces postes avancés traçaient autour de l’armée impériale. Quelques soldats renversés par la mitraille jonchaient un pli de terrain. Monsieur de la Guerche mit lestement pied à terre, et s’empara de la ceinture verte qui décorait le corps d’un officier.
– Ah ! voilà qui ne me paraît pas maladroit ! dit Monsieur de Chaufontaine, tandis que Monsieur de la Guerche roulait la ceinture autour de sa taille.
Il descendit de cheval, ainsi que Carquefou, et, cherchant autour d’eux, ils n’eurent point de peine à découvrir des objets semblables.
– À présent, de l’audace ! dit Armand-Louis.
– Et au galop ! poursuivit Renaud.
– J’en étais sûr ! s’écria Carquefou.
Excités par l’éperon, les chevaux partirent à fond de train.
Deux ou trois sentinelles tournèrent la tête, l’une d’elles abattit même son mousquet ; mais à la vue des ceintures vertes elle le releva.
Une patrouille de cavalerie devant laquelle passèrent les trois hardis aventuriers ne douta pas qu’ils n’appartinssent à l’état-major de l’armée impériale.
Plus loin, une compagnie de gens de pied se trouvait en travers d’une chaussée qu’il fallait suivre pour atteindre les faubourgs incendiés.
– Ordre du général comte de Tilly ! cria Monsieur de la Guerche, qui marchait le premier.
La compagnie ouvrit ses rangs, et il s’élança sur la chaussée, suivi de ses deux complices.
– J’ai cru voir les gueules de dix mille loups ! dit Carquefou.
Ils venaient de franchir le front de bandière du camp ; un nouvel élan les porta à l’entrée du faubourg, où se mêlaient confusément les bandes impériales ; des blessés se traînaient le long des murs, d’autres passaient en gémissant, ramenés par leurs camarades ; quelques balles perdues commençaient à faire sauter le plâtre des maisons autour d’eux.
– Eh ! l’ami, cria Monsieur de la Guerche à un lansquenet, enfonce-t-on les portes de la ville ?
– Les coups pleuvent, répondit le soldat, mais elles tiennent bon ! Ces maudits bourgeois font un feu d’enfer du haut de leurs remparts !
– En avant ! dit Renaud.
– Comme c’est récréatif ! murmura Carquefou : les balles de nos amis dans le nez, et les balles de nos ennemis dans le dos !
Ils se trouvèrent bientôt au premier rang des colonnes d’assaut. La mêlée était terrible, on se battait sous les murs mêmes de Magdebourg ; il était clair que le faubourg, que le comte de Tilly avait fait attaquer ce jour-là resterait au pouvoir des assaillants ; pour sauver une partie de la garnison, écrasée par des forces supérieures, l’officier qui commandait sur ce point de la ville venait de faire ouvrir une poterne. On voyait comme des flots d’hommes autour de cette poterne. Le fer et le plomb y faisaient de larges trouées ; mais, comme les vagues aux bords de la mer, d’autres flots succédaient aux flots disparus. Les vainqueurs voulaient entrer avec les vaincus.
Debout et maniant une hache d’armes avec la vigueur d’un bûcheron qui abat les arbres, Jean de Werth fendait la tête à quiconque se présentait devant lui : le capitaine avait fait place au soldat ; devant lui, n’était-ce pas la ville où Mademoiselle de Souvigny s’était réfugiée ?
– Jour de Dieu ! c’est fait de nous ! dit Carquefou, qui venait de le reconnaître.
Renaud fit un bond du côté de Jean de Werth, mais Carquefou le saisit à bras-le-corps.
– Monsieur le marquis, dit-il, oubliez-vous que nous sommes comme David dans la fosse aux lions ? Ne nous faites pas croquer avant l’heure !
Devant la poterne, encombrée de cadavres, et arc-bouté sur ses robustes jambes, Magnus faisait tournoyer autour de sa tête un mousquet dont il se servait comme d’une massue ; chaque fois que l’arme sanglante traçait un cercle, un homme tombait ; autour de lui le vide se faisait.
– Notre salut est là ! reprit Carquefou, qui de la main désignait Magnus aux regards de Renaud.
Mais la fièvre de la bataille enivrait Monsieur de Chaufontaine.
– Au diable cette guenille ! cria-t-il.
Et, arrachant sa ceinture verte, l’épée haute, il fondit sur un capitaine de lansquenets.
Déjà Monsieur de la Guerche était aux prises avec deux impériaux qui lui barraient le passage de la poterne.
Magnus l’aperçut ; un bond terrible le porta au milieu même des Autrichiens, et le mousquet tout rouge de sang abattit deux nouvelles victimes. Une poignée d’hommes déterminés l’avaient suivi. Le feu des remparts et des tours redoubla ; les assaillants reculèrent, et un large espace resta nu entre eux et la poterne.
– À moi ! cria Magnus.
Armand-Louis, Renaud, Carquefou, qui, tête baissée, frappait partout, le joignirent en un instant.
– À la poterne, à présent ! cria de nouveau Magnus.
– Il parle comme un sage ! grommela Carquefou, qui battait en retraite, l’épée au poing.
Mêlés aux débris de la garnison, un mouvement impétueux les poussa vers la poterne toute large ouverte, et derrière laquelle une troupe de Suédois se tenait prête à les recevoir. En ce moment, Jean de Werth les reconnut tous trois.
– Ah ! les bandits ! cria-t-il.
D’un coup d’œil il mesura la distance qui le séparait des fugitifs ; ils étaient trop loin déjà pour qu’il pût conserver l’espoir de les atteindre.
Se tournant alors vers une troupe de soldats qui l’entouraient :
– Feu ! cria-t-il.
Mais Armand-Louis, Renaud, Carquefou et Magnus venaient de franchir l’enceinte des remparts, les lourds battants de la poterne roulèrent sur leurs gonds, et quelques balles inutiles rebondirent sur les ais de chêne cuirassés de fer.
– Je crois qu’il était temps ! dit Carquefou.
Magnus ne perdit pas une minute pour conduire Armand-Louis et Renaud à la maison où il avait, dès son arrivée à Magdebourg, cherché un logement pour Mademoiselle de Souvigny et Mademoiselle de Pardaillan. Le temps n’était plus, où, inquiètes et curieuses, elles mettaient la tête à la fenêtre pour voir, à la moindre alerte, ce qui se passait dans la rue. Combien n’avaient-elles pas compté de pièces de canon traînées par des bourgeois ! combien de patrouilles, combien de compagnies courant pleines d’ardeur au combat, revenant des remparts mutilées et noires de poudre ! Le sifflement des bombes ou le passage des boulets les faisait encore frissonner, mais ne les effrayait plus. Elles savaient alors à quels périls le courage et la résolution de Magnus les avaient arrachées ; elles remerciaient Dieu et trouvaient les projectiles enflammés qui remplissaient la ville de ruines et de cendres moins terribles que Madame d’Igomer, moins redoutables que le couvent de Saint-Rupert.
Les heures s’écoulaient à parler de Monsieur de la Guerche et de Monsieur de Chaufontaine. Que faisaient-ils ? Vers quelles contrées les cherchaient-ils encore ? Le messager envoyé par Magnus les avait-il rejoints ? Certainement ils tremblaient plus qu’elles-mêmes. Elles pensaient quelquefois qu’elles ne pouvaient pas tarder à les revoir ; mais cette espérance si douce les remplissait tout à coup d’effroi. À combien de dangers ne seraient-ils pas exposés dans cette cité que tant de batteries foudroyaient ? Ne seraient-ils pas les premiers au feu ! Et, de plus, ceux qui dirigeaient contre Magdebourg cette pluie de fer ne s’appelaient-ils pas Jean de Werth et Henri de Pappenheim !
Le souvenir de ces deux implacables ennemis faisait pâlir les deux cousines.
– Fasse le Ciel qu’ils ne viennent pas ! disait alors Adrienne.
Mais les prières qu’Adrienne et Diane adressaient à Dieu étaient bien timides ; elles se sentaient bien seules, et si quelque balle renversait Magnus, que deviendraient-elles au milieu d’une ville livrée à toutes les horreurs et à tous les hasards d’un siège, et où elles n’avaient ni parents ni amis ?
Aussitôt que les salles préparées pour les blessés avaient reçu leurs hôtes ensanglantés, Mademoiselle de Souvigny et Mademoiselle de Pardaillan, mêlées aux femmes de la ville, s’employaient à secourir ceux qui étaient tombés en soldats. Leurs mains délicates s’étaient habituées au pansement des plus horribles plaies ; elles vivaient au milieu des cris et des gémissements, elles passaient de longues nuits entre des murs d’où les plaintes de l’agonie chassaient le sommeil. Qu’ils étaient loin alors, les souvenirs de Saint-Wast !
Cette pieuse tâche accomplie, et quand d’autres jeunes filles les remplaçaient au chevet des malades, elles rentraient chez elles et taillaient des bandes ou fondaient des balles.
À l’heure même où Monsieur de la Guerche et Monsieur de Chaufontaine paraissaient devant Magdebourg, Adrienne et Diane, après toute une nuit écoulée dans des hôpitaux visités à toute minute par la mort, venaient de céder la place à leurs compagnes.
Malgré le formidable retentissement de cette lutte qui ensanglantait l’une des portes de Magdebourg, Adrienne et Diane, retirées alors au fond d’une petite pièce dont les étroites fenêtres donnaient sur un jardin, causaient silencieusement avec leurs pensées. Toutes deux remplissaient de charpie une large corbeille placée à leurs pieds. Quelquefois leurs mains s’arrêtaient, un soupir gonflait leur poitrine, et pensives elles regardaient le ciel.
Les détonations de l’artillerie se succédaient de minute en minute ; une clameur qui s’élevait de la rue voisine leur apprenait tout à coup qu’on rapportait un blessé à sa famille. Alors elles tressaillaient et reprenaient leur travail pieux un instant interrompu par le rêve.
Cependant le silence s’était fait ; on n’entendait plus que par intervalle la décharge d’une pièce de canon qui répondait aux derniers efforts de la bataille. En ce moment, des bruits de pas retentirent dans la rue, et presque aussitôt le heurtoir de la porte tombait sur le bouton de fer.
– Entends-tu ? cria Adrienne, qui sauta sur sa chaise.
– C’est Magnus, répondit Diane, qui se sentait pâlir.
– C’est lui, reprit Mademoiselle de Souvigny, mais il n’est pas seul… Qui peut être avec lui ?… Qui peut venir ici ?
Cependant des pas précipités montaient l’escalier.
– Dieu bon ! tu n’as pas exaucé nos prières ! s’écria Diane.
– Ah ! tu les as reconnus comme moi… C’est Armand !
– C’est Renaud !
La porte s’ouvrit, et quatre hommes tout couverts de vêtements souillés de poudre et de sang se précipitèrent dans la chambre. Avant même qu’elles pussent jeter un cri, Armand et Renaud étaient aux pieds d’Adrienne et de Diane.
Incapable de se soutenir, Mademoiselle de Souvigny appuyait ses deux bras sur les épaules de Monsieur de la Guerche.
– Ah ! cruel ! lui dit-elle, vous avez donc voulu qu’à toute heure je tremblasse pour vous !
– Est-ce donc vivre que de vivre loin de vous ? s’écria Armand-Louis.
Mais alors Adrienne relevant son front vers le ciel :
– Vous savez si je l’aime ! reprit-elle avec l’exaltation d’une âme qui s’est donnée tout entière ; si c’est votre volonté de nous unir dans la mort comme nous étions unis dans la vie, que Votre saint nom soit béni et que Votre volonté soit faite, Seigneur !
– Viens çà, dit brusquement Magnus à Carquefou, Baliverne a fortement travaillé aujourd’hui… il est convenable que je cause avec elle.
– Et Frissonnante ne serait pas fâchée de se restaurer un peu, répondit Carquefou ; je la sens qui s’évanouit à mon côté.
Revenue de sa première émotion et plus maîtresse d’elle-même, Diane menaça Renaud du bout de son joli doigt. Il restait à genoux devant elle, immobile, tout interdit, muet.
– Je comprends que Monsieur de la Guerche soit revenu, dit Mademoiselle de Pardaillan d’une voix doucement railleuse, il suffit de voir son attitude auprès de Mademoiselle de Souvigny pour se rendre compte des motifs qui l’ont poussé, mais vous, pourquoi le suivre à Magdebourg ?
– Je ne sais pas, répondit Renaud troublé.
– Voyez-vous l’innocent ! Eh bien, si vous ne le savez pas, il faut vous en aller au plus vite ; le pays est malsain, il y pleut des balles, et le vent y est couleur de feu. Monsieur de la Guerche a le droit d’y vivre… Quelque chose l’y retient, et il consent à tout perdre pour rester avec ce quelque chose… Mais Monsieur de Chaufontaine !… Ah ! fi ! s’il lui arrivait une égratignure, comment nous en consolerions-nous jamais !
– Vous me renvoyez ? reprit Renaud, qui respirait à peine.
– Si vous n’avez point de bonnes raisons à me donner pour expliquer votre présence ici, il le faut bien !
– Mais, mademoiselle, je vous aime, je vous adore ! s’écria Monsieur de Chaufontaine hors de lui.
– En êtes-vous bien sûr ? répondit Diane d’un air grave.
– Si j’en suis sûr ? Mais je donnerais dix mille vies pour vous épargner une larme !… Mais je ne m’appartiens plus depuis que je vous ai vue !… Mais le château de Saint-Wast où vous m’êtes apparue a pris mon cœur et l’a gardé !… Je suis à peu près fou, c’est vrai…
– À peu près ? interrompit Diane avec un sourire.
– Fou tout à fait, si vous voulez… et quelque chose de plus avec ! Il n’est pas de sottises ni d’extravagances dont je ne sois capable ; on sait des jours où celui qui vous parle se conduit comme un sacripant. Ah ! bon Dieu ! quelle confession si je racontais tout ! Mettez tous les défauts et toutes les étourderies ensemble, c’est moi. Mais je vous aime, et au plus fort de mes folies, quand ma tête et mon cœur ont le mors au dent, si vous faisiez un signe, un seul, vous me verriez comme un enfant à vos pieds. Armand le sait bien, lui qui m’a vu. Demandez-lui ce qu’il pense de ma fièvre… J’ai pu croire dans les commencements que c’était un accès… Je n’ai rien épargné pour me guérir… oh ! rien ! mais rien n’y a fait, ni les voyages, ni les batailles, ni le temps, ni l’absence, ni ceci, ni cela, ni même les choses dont je ne parle pas… Qu’avais-je besoin de vous aimer, je vous le demande ? Mais cet amour est comme un clou sur lequel on frappe… Chaque jour il s’enfonce davantage… C’est comme un sort que vous m’avez jeté… Ma foi, j’en ai pris mon parti, et il faudra bien que vous en preniez le vôtre… À présent vous me verrez éternellement où vous serez, et si quelque jour, en punition de mes péchés – hélas ! ils sont nombreux – vous me chassiez de votre présence, j’irais je ne sais où, au pays des Indiens, je déclarerais la guerre aux Incas d’Amérique et je me ferais tuer dans quelque île barbare en criant votre nom aux sauvages de l’endroit.
– Eh bien ! dit Mademoiselle de Pardaillan, à présent que je suis au courant des raisons qui vous font agir, j’ai idée qu’un jour je m’appellerai Madame de Chaufontaine.
Renaud poussa un tel cri, que la maison en retentit. Il voulut se lever et fondit en larmes.
– Ah ! les bonnes larmes ! reprit Diane, qui lui tendit la main, il n’est pas de paroles qui les vaillent, et en les voyant couler, moi aussi, je puis vous dire, Renaud, que je vous aime et n’aimerai jamais que vous.
Chapitre 3
LES PROPHÉTIES DE MAGNUS
Dans la soirée, Monsieur de la Guerche se rendit auprès de Monsieur de Falkenberg, qui siégeait à l’Hôtel de Ville, et lui fit part de ce que le roi Gustave-Adolphe lui avait dit lors de leur rapide entrevue.
– Oh ! je tiendrai aussi longtemps que je le pourrai ! dit l’officier suédois, mais le pourrai-je longtemps ?
Il apprit alors à Monsieur de la Guerche que des symptômes de mécontentement commençaient à se manifester parmi les habitants de Magdebourg. Ceux-là regrettaient leur commerce anéanti ; ceux-ci redoutaient les conséquences d’un assaut si la fortune trahissait leurs armes. La place souffrait beaucoup du feu des assiégeants.
– Si je n’avais pas avec moi deux mille soldats de l’armée suédoise et un gros de volontaires déterminés à pousser la résistance jusqu’au bout, reprit Monsieur de Falkenberg, Magdebourg aurait déjà ouvert ses portes.
– Vous savez ce que le roi, votre maître, désire, répondit Armand-Louis : le mot capitulation ne doit pas être prononcé.
– Moi vivant, il ne le sera jamais. Ceci, je vous le jure, repartit Monsieur de Falkenberg.
Armand-Louis et Renaud parcoururent la ville et les remparts. Partout les traces des longs combats soutenus, des pans de murs écroulés, des maisons percées par les boulets, des tours éventrées, des ruines fumantes, une population morne, plus de chants ni de cris, des femmes et des enfants qui pleuraient dans les églises. Les faubourgs, envahis par les Impériaux, n’étaient plus qu’un monceau de décombres. Des flammes en sortaient çà et là.
Cependant, si l’enthousiasme des premiers jours était tombé, la défense n’en était pas moins énergique, pas moins vigilante. L’armée du comte de Tilly, maîtresse des forts et des faubourgs, avait fait des pertes cruelles ; les meilleurs régiments, si souvent menés à la victoire, étaient décimés ; bon nombre d’excellents capitaines avaient perdu la vie dans ces combats meurtriers. Nulle part la ceinture des murailles qui protégeaient Magdebourg n’était entamée. Son artillerie répondait sans faiblir au feu de l’artillerie autrichienne. Les généraux, qui sentaient les plus vieilles troupes hésiter dans leurs mains, commençaient à croire que jamais ils n’emporteraient cette ville rebelle de vive force.
Les ramener à l’assaut, après l’échec de la poterne, c’était exposer les armes de Ferdinand à une défaite dont les conséquences pouvaient être incalculables.
Un matin, après une longue série d’escarmouches qui avaient coûté la vie à un grand nombre d’assaillants, les sentinelles placées au sommet des plus hautes tours remarquèrent que différentes batteries qui la veille encore vomissaient la flamme et le fer contre la place, semblaient dégarnies de leurs engins destructeurs. Autour de ces batteries désertes, point de soldats.
Carquefou, qui était de garde près d’une poterne, suspendit une corde à un clou et se laissa couler dans le fossé.
– Ma foi ! tant pis ! dit-il à ses camarades, la peur le cède à la curiosité.
Quelques hommes résolus se répandirent à sa suite dans les faubourgs incendiés, et, se glissant de proche en proche derrière les pans de murs et le long des fossés, gagnèrent le front de bandière de l’armée impériale. Ses lignes ne serraient plus la ville si étroitement ; l’armée avait fait un mouvement de recul.
La nouvelle de cette retraite inattendue traversa Magdebourg avec la rapidité de l’éclair. Chacun sortit dans les rues ; on questionnait ceux qui avaient été en éclaireurs reconnaître les positions de l’armée du comte de Tilly.
– Je me suis timidement avancé jusqu’à l’emplacement de cette grosse batterie dont vous voyez les épaulements là-bas, sur ce monticule, dit Carquefou. Dieu sait si j’étais prêt à courir comme un lièvre à la première alerte !… Les fascines étaient renversées, les parapets abattus, les canons emportés : je n’ai vu qu’un rideau de cavaliers derrière un rideau d’arbres dans la plaine.
Cent bourgeois jetèrent leur bonnet en l’air.
– Ils s’en vont ! ils s’en vont ! cria-t-on de toutes parts.
Et les plus joyeux embrassaient leurs voisins.
– S’ils s’en vont, dit Magnus, le moment est venu de faire bonne garde.
On le regarda de tous côtés avec l’expression d’un grand étonnement.
– Comprenez donc ! les Impériaux battent en retraite ! reprit-on autour de lui.
– J’entends bien ; c’est pourquoi, si vous ne veillez pas jour et nuit, un beau matin les Croates seront dans Magdebourg.
Les bourgeois se mirent à rire.
– Les Troyens aussi riaient lorsque la fille d’Hécube parlait, dit Magnus, et cependant Troie fut prise et réduite en cendres.
Il voulut néanmoins se rendre compte de ce que Carquefou avait vu. Armand-Louis, qui pensait toujours au moyen de ramener les deux jeunes filles auprès de Monsieur de Pardaillan, l’accompagna, ainsi que Renaud, espérant que quelque route serait peut-être libre.
Ils suivirent longtemps les lignes de circonvallation, occupées la veille encore par les bandes impériales. Pas un ouvrage d’art qui ne fût abandonné.
– Un déserteur leur aura sans doute appris que nous n’avions pas les forces suffisantes pour nous en emparer et les garder, dit Magnus d’un air soucieux.
– Magnus ne croit à rien, pas même à la fuite ! répondit Renaud, qui rêvait déjà aux douceurs du voyage qu’il allait entreprendre avec Mademoiselle de Pardaillan.
– Le comte de Tilly n’a jamais fui, reprit Magnus. S’il recule quelquefois, c’est à la façon du tigre, pour mieux prendre son élan.
Tous trois poussèrent plus en avant, cherchant un passage ouvert ; mais, derrière une haie, ils découvrirent un cordon de fantassins ; dans l’épaisseur des bois, des escadrons de cavalerie ; sur tous les sentiers, des canons ; au milieu des villages et des fermes, des régiments ; point de traces de désordre, point de fourgon renversé, ni de pièce d’artillerie abandonnée. Chaque bouquet d’arbres, comme tout chemin creux, avait une sentinelle.
– L’armée impériale fait comme le loup quand il guette un agneau, dit Magnus.
– Et l’agneau, cette fois, s’appelle Magdebourg, n’est-ce pas ? répondit Armand-Louis.
Trois ou quatre coups de feu retentirent à l’instant, et trois ou quatre balles firent sauter un peu de terre autour d’eux.
– Voilà ma réponse, dit Magnus.
Ils rentrèrent dans Magdebourg, qu’ils trouvèrent en liesse. Des feux de joie brûlaient dans les rues, on perçait des tonneaux de bière et de vin, on dressait des tables ; les enfants chantaient et dansaient, toutes les portes s’ouvraient. Ce n’étaient partout que tapage et confusion. Quelques notables parlaient d’organiser un grand banquet à l’Hôtel de Ville, pour célébrer la délivrance de leur vaillante cité.
– Si vous n’obtenez pas de Monsieur de Falkenberg que ces bourgeois retournent sur les remparts, Magdebourg est perdu, dit encore Magnus.
Monsieur de la Guerche courut au palais du gouverneur.
Il le trouva rempli d’une foule immense. L’air retentissait d’acclamations. Les bourgeois, débarrassés de leurs armes, se félicitaient les uns les autres, les plus jeunes organisaient des danses sur la place publique. Armand-Louis eut grand-peine à pénétrer jusqu’à l’appartement où se tenait le capitaine suédois. Il le trouva en train de répondre aux dernières dépêches du comte de Tilly. Un bourgmestre, debout sur une table, en donnait lecture à haute voix aux magistrats et aux notables de la cité. Le ton en était extraordinairement modéré, bien que le général autrichien sommât encore la ville de se rendre.
– Le coq ne chante plus si haut ! dit l’un des auditeurs.
– Il commence à s’apercevoir que nos murailles ne sont pas en pain d’épices ! dit un autre.
– Le vieux coquin s’est enrhumé devant nos fossés ! reprit un troisième.
– Les médecins lui auront conseillé de changer d’air ! ajouta un voisin.
Le bourgmestre jeta d’un air superbe les dépêches sur la table, au milieu des éclats de rire et des quolibets de l’auditoire.
– Le comte de Tilly saura désormais ce que c’est que Magdebourg ! dit-il avec emphase.
– Et vous, Magdebourgeois, souvenez-vous du sort de Maestricht ! dit Magnus.
Tous les yeux se tournèrent vers le vieux soldat : un long frémissement parcourut l’assemblée.
– Un soir, Maestricht, il n’y a pas longtemps de cela, se crut sauvé, poursuivit Magnus : l’ennemi reculait, fatigué d’attaquer en vain ses remparts… le lendemain Maestricht était pris. Si vous ne voulez pas vous réveiller dans l’incendie et dans le sang, veillez, bourgeois !
Un messager entra, porteur de nouvelles. Il avait vu les régiments wallons du corps de Pappenheim en marche sur la route de Schœnbeck.
– Une portion nombreuse de l’artillerie s’ébranle pour les suivre, ajouta-t-il.
À ces mots, un grand tumulte éclata dans la salle. On ne pensait plus à ce qu’avait dit Magnus que pour le railler.
– Si vous êtes malade, ami, ne buvez pas, mais laissez-nous nous réjouir en paix ! lui cria le bourgmestre.
– Foin du hibou qui ne veut pas qu’on s’amuse ! dit un autre.
– Si vous avez peur à Magdebourg, camarade, partez pour Maestricht !
C’était à qui lancerait son mot ; mais, tandis que les uns parlaient, d’autres, qui avaient rendu visite aux caves de l’Hôtel de Ville, chargeaient les tables de bouteilles et de brocs.
– Bon appétit, messieurs, dit Magnus froidement. Je ne m’assiérai pas au banquet des funérailles.
Cependant Armand-Louis s’était approché de Monsieur de Falkenberg, et lui faisait part de ce qu’il avait vu et de ce qu’il redoutait. Le Suédois fronçait le sourcil et promenait ses regards autour de lui.
– Je sais, dit-il, je sais ! mais personne ici n’est en état de m’entendre. Le prince Christian-Guillaume lui-même, qui perdra la tête si Magdebourg est pris, parcourt la ville à cheval en habit de fête. Je m’estimerai heureux si je puis garder autour de moi quelques centaines d’hommes. La fièvre est dans l’air, elle a gagné jusqu’à mes soldats.
Et du doigt le capitaine lui fit voir sur la place des bandes de Suédois qui choquaient leurs verres contre ceux des bourgeois.
Monsieur de la Guerche et Renaud sortirent de l’Hôtel de Ville plus tristes qu’ils n’y étaient entrés. Magnus ne parlait plus. Chaque rue qu’ils traversaient leur présentait le spectacle d’une fête. Des musiciens, debout sur des tonneaux, raclaient leurs instruments et faisaient sauter les jeunes garçons et les jeunes filles. Des centaines de tables, dressées en plein air, recevaient des milliers de convives. Les passants étaient invités à s’asseoir et à boire. Tous les fourneaux flambaient. On ne voyait pas un verre vide. Les narines de Carquefou se dilataient ; il promenait amoureusement la main sur son estomac en passant devant les cuisines. Ici, il acceptait un verre de vin du Rhin jaune comme de l’or ; plus loin une aile de chapon rôti, dorée et croustillante.
Magnus le regardait de travers.
– Ils mangent et tu les imites, malheureux ! disait-il ; et demain les ennemis seront dans Magdebourg !
– C’est justement pour cela, répondait Carquefou ; je ne veux pas que les Autrichiens et les Croates trouvent un os à mettre sous la dent.
Et il fourrait dans ses poches ce qu’il ne pouvait pas avaler.
Quand vint la nuit, Magnus sella les chevaux de Monsieur de la Guerche et de Mademoiselle de Souvigny, et jeta sous leur nez un boisseau d’avoine.
Carquefou l’imita scrupuleusement.
– Il ne faut rien négliger de ce qui est bon, dit-il, ni le vin ni les précautions.
Et bientôt les chevaux de Monsieur de Chaufontaine et de Mademoiselle de Pardaillan n’eurent rien à envier à leurs voisins. Ils avaient la selle sur le dos et double provende dans leur auge.
Armand-Louis et Renaud se gardèrent bien de faire part de leurs craintes à leurs compagnes. Magnus pouvait se tromper dans ses prévisions, et il était tout au moins inutile de les faire vivre toute une nuit dans des alarmes que le matin se chargerait de dissiper ou de justifier. Ils se bornèrent à les engager à se tenir prêtes à partir aux premiers rayons du soleil levant.
Les réjouissances se prolongèrent bien avant dans la nuit. Les postes que Monsieur de Falkenberg avait eu soin de placer le long des remparts, pour avertir la garnison en cas d’alerte, se dégarnissaient petit à petit. Les soldats, encore fidèles à la consigne, mais fatigués par de nombreuses libations, s’endormaient les uns après les autres. Le silence succédait aux chants ; et bientôt on n’entendit plus, dans la ville livrée au sommeil, que le bruit vague et flottant que faisaient quelques bons bourgeois en cherchant leurs demeures d’un pas chancelant.
Même silence dans la campagne. Des feux de bivouac, qui s’éteignaient, piquaient çà et là l’horizon de leurs flammes fouettées par le vent.
Cependant, à cette heure indécise où de pâles lueurs se répandent dans le ciel et font sortir confusément de l’ombre les arbres et les maisons épars dans les plaines, une rumeur sourde s’éleva dans l’éloignement : c’était une rumeur lente, continue comme celle que ferait un corps de troupes en marche.
Magnus, à qui son inquiétude défendait le repos, et qui rôdait le long des portes, poussa une sentinelle du pied.
– N’entendez-vous rien ? dit-il.
La sentinelle prêta l’oreille une seconde et partit d’un éclat de rire.
– C’est la cavalerie croate qui s’en va ; bon voyage ! dit-elle.
Et, appuyant sa tête sur le dos d’un camarade qui ronflait, la sentinelle ferma les yeux.
Le même bruit roulait toujours dans l’espace. Un instant, il parut à Magnus que ce bruit s’éloignait.
« C’est quelque diablerie », pensa-t-il.
Une ligne blanche qui ondulait de l’autre côté de l’Elbe, lui fit croire, en effet, qu’un corps de cavalerie quittait le campement de l’armée impériale.
– Le comte de Tilly battrait-il véritablement en retraite ? murmura Magnus. On dit cependant que c’est un bon général, et je l’ai vu à l’œuvre.
Il monta sur la crête du rempart et regarda au loin.
Rien ne troublait la profonde tranquillité de ces campagnes dévastées ; pas un homme ne s’y montrait ; mais, en cherchant bien, Magnus crut distinguer, dans l’épaisseur d’un taillis dont les broussailles couvraient un pan de l’horizon, les mouvements incertains d’une troupe de soldats. Il lui semblait, en outre, qu’une ligne mince et noire, d’où sortaient quelques éclairs, rampait dans les sinuosités d’un chemin creux.
Le soleil se leva et inonda la plaine de ses rayons. Un homme parut alors au bout d’un sentier, courant à perdre haleine, sauta vivement dans le fossé, saisit des deux mains une corde qui pendait le long de la muraille, et grimpa sur le rempart avec l’agilité d’un chat.
Magnus se jeta au-devant de Carquefou, qu’il venait de reconnaître.
– On a bon appétit, c’est vrai, mais on a de bonnes jambes, dit Carquefou. L’idée m’est venue, à la nuit close, de faire un tour de promenade du côté du camp impérial. J’en sais le chemin, l’ayant fait en plein jour et à cheval ; je me suis donc glissé jusqu’au bord de l’Elbe, tout là-bas. Ah ! les coquins, ils sont tous sur pied !
– Les Impériaux ?
– Hé ! mordieu ! je ne parle pas des Suédois ! Artillerie, cavalerie, infanterie, tout marche à la fois ! J’ai reconnu Monsieur de Pappenheim à cheval, la cuirasse sur le dos, et derrière lui dix régiments. Les cavaliers ont le sabre au poing, les fantassins la pique ou le fusil sur l’épaule. Avant une heure, ils seront à Magdebourg.
– Et tu allais de ce pas… ?
– Chez Monsieur de Falkenberg.
– Tu es un homme, Carquefou !
– Qui sait ! qui sait ! J’ai eu peur d’être pris comme un lapin dans son terrier, voilà tout.
Déjà, et tout en parlant, ils gagnaient l’un et l’autre la rue voisine. Des tables et des bancs, au milieu desquels dormaient pesamment quelques bourgeois, les encombraient. Magnus et Carquefou en poussèrent quelques-uns du bout de leur pied.
– Aux armes ! criaient-ils, l’ennemi approche !
Deux ou trois hommes, tirés de leur sommeil, se mirent debout lourdement. L’un d’eux reconnut Magnus.
– Ah ! l’homme de Maestricht ! dit-il.
Et il se rendormit sur son banc.
– Ah ! les malheureux, qui ont des oreilles pour ne pas entendre et des yeux pour ne pas voir ! reprit Magnus.
Carquefou et lui précipitèrent leur course au travers de ces témoins d’une fête qu’un sinistre réveil allait suivre ; et déjà ils touchaient aux portes de l’Hôtel de Ville, lorsque le bruit d’une fusillade éclata dans l’éloignement.
– Ah ! trop tard ! dit Carquefou.
Mais, tirant son épée, Magnus bondit sur les marches du palais.
– Aux armes ! cria-t-il.
Chapitre 4
LA TORCHE ET L’ÉPÉE
Au cri poussé par Magnus, Monsieur de Falkenberg, qui veillait entouré de quelques officiers, sauta dehors. De nouvelles décharges de mousqueterie retentissaient coup sur coup dans la ville neuve. Le bruit du tocsin s’y mêlait déjà.
– Aux armes ! répéta le Suédois.
Et, rassemblant à la hâte une poignée de soldats et de volontaires qu’il avait sous la main, Thierry de Falkenberg se précipita à la rencontre de l’ennemi.
Comme il touchait à l’extrémité de la place, il rencontra Monsieur de la Guerche et Renaud qui battaient en retraite, excitant à la résistance une troupe de bourgeois surpris et repoussés par l’ennemi.
La vue des uniformes suédois donna du cœur aux vaincus. Ils s’arrêtèrent.
– En avant ! cria Monsieur de Falkenberg, qui se jeta le premier sur les Impériaux.
– En avant ! répétèrent Armand-Louis et Renaud.
Le bourgmestre éperdu avait suivi Monsieur de Falkenberg. Il aperçut Magnus qui brandissait Baliverne.
– Ah ! que ne vous ai-je cru ! dit-il.
– Le temps de pleurer n’est plus ; ferme à présent, et jouons de l’épée, dit le reître.
– Et plus tard nous jouerons de l’éperon, si faire se peut, reprit Carquefou.
Ils avaient devant eux les compagnies wallonnes, que le comte de Pappenheim avait menées à l’assaut, et qui du premier élan venaient de planter le drapeau aux couleurs impériales sur les remparts de la ville neuve, tandis que Jean de Werth, à la tête des régiments bavarois, fondait sur le côté opposé de Magdebourg.
L’attaque avait été conduite avec autant de promptitude que d’habileté ; après une retraite simulée, c’était un retour rapide et foudroyant. La tactique prévue par Magnus était du vieux comte de Tilly : l’exécution avait été confiée à ses plus hardis lieutenants, mais à la tête des meilleures troupes.
Presque sans coup férir, ils venaient de pénétrer au pas de course jusqu’au cœur même de Magdebourg, mais ils avaient rencontré Monsieur de Falkenberg et les Suédois.
Électrisés par leur exemple et celui de Monsieur de la Guerche et de Renaud, qui retournaient à la charge, les quelques soldats et les volontaires qu’ils avaient réunis rompirent les premiers rangs des compagnies wallonnes et les culbutèrent jusqu’aux remparts.
Mais de nouveaux cris s’élevèrent de l’autre côté de la ville ; le bruit sinistre de la fusillade s’y mêla plus rapide et plus retentissant de minute en minute, et un gros de fugitifs se jeta parmi les Suédois, remplissant l’air de clameurs d’épouvante.
Un homme qui avait la poitrine traversée d’un coup de feu tomba aux pieds de Monsieur de Falkenberg.
– Jean de Werth ! cria-t-il, et il expira.
Armand-Louis et Renaud se regardèrent.
Monsieur de Pappenheim en face ; derrière eux Jean de Werth. Leurs deux implacables ennemis réunis pour les vaincre. Ils pensèrent à Mademoiselle de Souvigny et à Mademoiselle de Pardaillan.
– Ce n’est plus l’heure de nous séparer, dit Monsieur de la Guerche à Renaud.
Puis, s’adressant à Monsieur de Falkenberg :