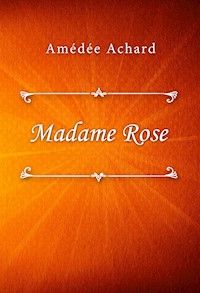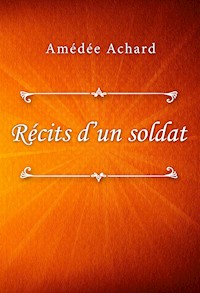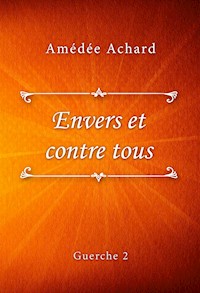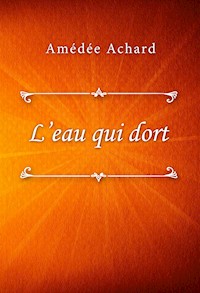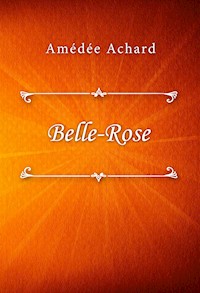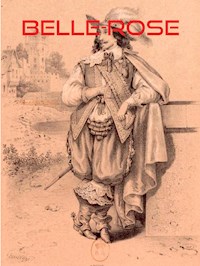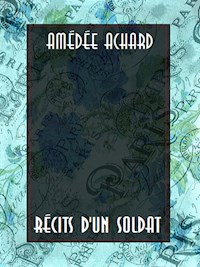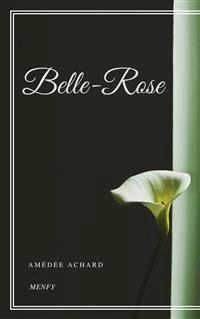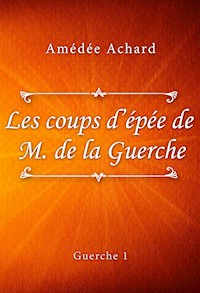
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Vers l’an de grâce 16..., il n’était pas, dans l’ancienne province de la Marche, d’ennemis plus irréconciliables, ni d’amis plus intimes, que le jeune huguenot Armand-Louis de la Guerche, et son voisin, le catholique Renaud de Chaufontaine. Lorsque, après la prise de La Rochelle par les troupes de Richelieu, Monsieur de la Guerche s’enfuit en Suède, chargé de documents précieux pour le roi Gustave-Adolphe, il retrouve dans des circonstances dramatiques son ami Renaud ainsi que la ravissante Adrienne de Souvigny. De multiples péripéties entraîneront alors les jeunes gens jusqu’au siège de Magdebourg, où l’histoire se dénouera à la satisfaction des héros, et par le châtiment de leurs adversaire.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Copyright
First published in 1863
Copyright © 2022 Classica Libris
Chapitre 1
CASTOR ET POLLUX
À l’époque où commence ce récit, vers l’an de grâce 16…, il n’était pas, dans toute l’ancienne province de la Marche, d’ennemis plus irréconciliables et tout à la fois d’amis plus intimes que le comte Armand-Louis de la Guerche et son voisin, le marquis Renaud de Chaufontaine. À dix lieues à la ronde, pas un bourgeois et pas un manant qui ne les connussent, pas de hobereau qui ne les eût rencontrés chevauchant de compagnie sur quelque roussin du pays, pas de maraudeur qui ne les eût surpris se livrant de furieuses batailles sur la lisière des bois. Ils fondaient ensemble les plus fameux héros de la mythologie et de l’antiquité. Le comte Armand-Louis et le marquis Renaud étaient à la fois Oreste et Pylade, Étéocle et Polynice. Ils seraient volontiers morts l’un pour l’autre, et ne passaient pas un jour sans se provoquer à d’interminables combats singuliers. Le temps qu’ils n’employaient pas à se rendre de petits services, ils le consacraient à se quereller. On débutait par des paroles affectueuses, on finissait par des coups terribles. Cela durait depuis le temps où Monsieur de la Guerche et Monsieur de Chaufontaine cherchaient des prunelles dans les haies et des noisettes dans les taillis.
La sympathie des deux jeunes gentilshommes provenait de la grande similitude d’âge, de goût, de caractère ; l’antipathie avait pour cause la différence de religion. Le comte Armand était huguenot ; le marquis Renaud bon catholique. Celui-ci se découvrait au nom de feu l’amiral Coligny ; l’autre tenait Monsieur de Guise pour un grand saint. On avait donc six heures par jour pour s’aimer et six pour se haïr. Le reste du temps appartenait à l’escrime, à la chasse, à l’équitation. On disait de Renaud que personne, dans la province, ne montait aussi bien à cheval, si ce n’est Monsieur de la Guerche ; et d’Armand-Louis, que nul gentilhomme de la contrée ne maniait aussi lestement l’épée, le poignard de merci, la pertuisane et l’arquebuse, si ce n’est Monsieur de Chaufontaine. Le comte traversait une rivière comme un cygne ; le marquis franchissait un ravin comme un chevreuil. Ils luttaient contre les mêmes taureaux : et si l’un ne connaissait pas de barrière qui pût l’arrêter, l’autre ne savait guère de fossés devant lesquels il eût reculé.
Quand on rencontrait le jeune Renaud à cheval, courant dans la campagne, c’est qu’il cherchait Armand-Louis ; quand on voyait le comte tête nue, passant comme un cerf à travers les bruyères, c’est qu’il allait au-devant du marquis. Peu après on les apercevait au bord d’un ruisseau, déjeunant d’un morceau de pain qu’ils arrosaient fraternellement d’un peu d’eau fraîche ; la chose faite, épuisés par la course, ils dormaient côte à côte.
– C’est Nisus et Euryale ! disaient les savants du pays.
Mais si le lendemain on entendait dans une clairière le bruit sourd d’une branche de chêne heurtant un bâton de cornouiller, les bergers du canton savaient que les deux inséparables étaient aux prises.
– C’est Achille et Hector ! reprenait-on.
Et personne ne songeait à intervenir dans la querelle.
Le huguenot et le catholique avaient presque même taille ; tous deux, grands, souples, lestes, vigoureux, tels que le peuvent être deux braves gars élevés dans la pleine liberté des champs, brûlés par le soleil, battus par la pluie, hâlés par le vent, accoutumés à braver la bise et la neige, à coucher sur la dure, à dormir à la belle étoile. L’un, blond, avec des cheveux bouclés à reflets d’or tombant sur un front de marbre ; l’autre, brun, avec une crinière de cheveux noirs dont les ondes luisantes assombrissaient les yeux sauvages et le teint basané ; Monsieur de la Guerche, pareil à cet Endymion pour lequel une déesse descendit de l’Olympe ; Monsieur de Chaufontaine, tel qu’un peintre de bataille aimerait à représenter le terrible maréchal de Montluc, revêtu de son harnais de guerre. Tout naturellement, Armand-Louis commandait tous les petits protestants du pays ; Renaud avait sous ses ordres les catholiques des dix clochers voisins, et les deux généraux ne manquaient pas une occasion de pousser les deux armées rivales l’une contre l’autre. Leurs qualités diverses se faisaient voir dans ces mêlées : Renaud, prompt à l’attaque, toujours le premier et le plus avant dans la mêlée, impétueux, hardi et loquace comme un héros d’Homère ; Armand-Louis, tenace, inflexible, rapide dans ses évolutions, et n’oubliant jamais, au plus fort du combat, qu’il était capitaine. Il manœuvrait ses jeunes soldats comme de vieilles bandes ; Renaud poussait droit devant lui et se fiait au hasard, qu’il appelait le dieu de la guerre ; mais, s’il comptait plus d’ennemis renversés, la victoire restait presque toujours à Armand-Louis, et le marquis, tout à coup isolé de ses régiments rompus et dispersés, était fait prisonnier sur le champ de bataille.
À quatorze ans, Monsieur de la Guerche lisait dans le texte latin les Commentaires de César, Monsieur de Chaufontaine, à quinze ans, se plongeait avec délices dans les étonnantes aventures de don Galaor et les chevaleresques épopées d’Amadis des Gaules.
Monsieur de Chaufontaine n’avait pas uniquement la prétention de vaincre Monsieur de la Guerche la dague au poing : il voulait encore le convertir. Pour atteindre ce résultat mirifique et arracher ainsi une âme aux griffes maudites du Malin, il se nourrissait par intervalles de lectures pieuses, d’oraisons et de thèses scolastiques dont il retenait au hasard quelques lambeaux. Quelquefois même il apprenait par cœur certains passages qui lui paraissaient d’une éloquence édifiante, et il les récitait aux arbres du jardin.
Un gros cerisier, dont il pillait dévotement les fruits, était chargé, dans ces occasions solennelles, de représenter Armand-Louis. Renaud l’accablait d’arguments victorieux ; l’arbre ne soufflait mot. Renaud, enchanté, redoublait ; et, la mémoire bourrée de citations, la bouche pleine de cerises, il prenait à témoin de son triomphe les poiriers et les pommiers d’alentour.
– Qu’as-tu à répondre, maudit parpaillot ? s’écriait-il. Quelle hérésie peux-tu opposer à cette dialectique ? Te voilà réduit au silence, vaincu, abîmé ; mais la perversité de ton âme est telle, empoisonnée qu’elle est par le souffle de Calvin, que tu t’obstines dans ton erreur ! Va donc périr dans la géhenne, réprouvé ! ce n’est pas moi qui intercéderai auprès des saints, que tu renies, pour sauver ton âme ! Vade retro ! Si tu brûles, in secula seculorum, ce sera bien fait !
Il déchargeait un coup de bâton sur le tronc du cerisier et partait pour chercher le véritable la Guerche, qu’il poursuivait d’arguments et bombardait de citations avec une véhémence que rien ne laissait.
Le plus plaisant était que, si on eût appris à Monsieur de Chaufontaine que le parpaillot son ennemi avait la fièvre au moment même où il le vouait aux flammes de l’enfer, on l’aurait vu changer de couleur et trembler comme une feuille.
À ces heures charmantes où l’aube s’éveille, il n’était pas rare d’entendre sa voix éclatante au bord d’une clairière devant laquelle il venait d’apercevoir Armand-Louis guettant les lapins.
– Viens çà, parpaillot du diable ; viens çà que je te pulvérise ! s’écriait-il. Viens confesser que tu n’es qu’un mécréant de la pire espèce ; je veux que ton hérésie morde la poussière, et te faire voir que tu es un misérable damné, prédestiné à la cuisine de l’enfer ! Viens, te dis-je, et que tous les huguenots tes cousins crèvent de dépit en voyant ta confusion !
Dès les premières syllabes de ce petit discours, Armand-Louis s’armait d’une gaule.
Il savait comment finirait l’homélie.
Armand-Louis ne se mêlait pas d’éloquence. Il répondait aux démonstrations du prédicateur imberbe par des sourires ; quelquefois même, au plus beau de son improvisation, il l’interrompait par un sarcasme. Renaud devenait pourpre.
– Ah ! tu railles, coquin ! À moi les armes temporelles ! Elles auront raison de ton impertinence ! disait-il alors.
Et les poings fermés il tombait sur l’auditoire ; mais l’auditoire, qui n’avait pas peur de l’excommunication, ne reculait pas devant le prédicateur.
Nous devons ajouter qu’au bout de cinq ou six ans mêlés de coups et d’oraisons, Armand-Louis n’était pas encore converti.
Dans leurs rencontres de tous les jours, Monsieur de la Guerche ne se montrait pas si prompt aux escarmouches que son adversaire Monsieur de Chaufontaine. On ne le voyait pas non plus éternellement occupé à battre la plaine ou les bois, en quête de perdrix et de lièvres, et cherchant querelle aux petits pâtres qui gardaient les brebis dans les landes. Il ne se montrait pas davantage amoureux de disputes théologiques ou friand d’aventures. Si autrefois, aux premiers temps de son adolescence, il était l’un des premiers à organiser une expédition dans le but glorieux de dépouiller de ses fruits le verger d’un monastère, ou de provoquer en champ clos la jeune population d’un village voisin, maintenant qu’une moustache naissante commençait à ombrager sa lèvre, on le surprenait errant seul à l’écart au fond des vallées. Quelquefois même il ne suivait pas ses camarades qui, armés de lignes et d’éperviers, livraient bataille aux brochets d’un étang et l’invitaient à partager leurs jeux. Il ne répondait plus avec le même élan aux provocations de Renaud. On l’avait vu déserter les leçons d’escrime d’un maître italien pour s’égarer dans un bois ; et si quelqu’un alors l’eût suivi, peut-être l’aurait-on vu graver deux lettres sur l’écorce fragile d’un bouleau, comme autrefois les bergers de Virgile.
Renaud souriait de pitié. Les petits catholiques se réjouissaient de ne plus avoir affaire au terrible général qui les avait vaincus si souvent ; les petits huguenots pleuraient sur leur capitaine.
– Il sait que le sort du démon terrassé par saint Michel lui est réservé ; il a peur de succomber sous mes coups, disait Monsieur de Chaufontaine, qui prenait de grands airs, et, modestement, se comparait à l’archange.
– Un moine lui aura jeté quelque sortilège, pensait un jeune calviniste naguère promu aux fonctions de lieutenant.
– Il rêve comme un savant !
– Il dort comme un abbé !
Hélas ! s’il rêvait sans cesse, Monsieur de la Guerche, ne dormait plus guère. Le sortilège qui l’avait terrassé, l’archange qui l’avait vaincu, c’était la compagne de ses premiers ans, Mademoiselle Adrienne de Souvigny. On peut presque dire qu’Armand-Louis l’avait toujours connue ; mais il ne la regardait que depuis quelques mois. Et, à présent qu’il la regardait, il ne pouvait se lasser de l’admirer.
Chapitre 2
LA GRANDE-FORTELLE
Depuis un grand nombre d’années déjà, Armand-Louis et Adrienne habitaient, sur les confins de la Marche et du Bourbonnais, un petit castel démantelé par les guerres de religion. Adrienne y était arrivée à une époque où Armand-Louis n’avait guère plus de huit ou dix ans. Mademoiselle de Souvigny n’en avait pas quatre alors. Un vieil écuyer la conduisait. Il y avait déjà quinze jours qu’ils voyageaient de compagnie, l’homme, sur un bon vieux cheval grisonnant, l’enfant, sur une mule fort paresseuse, mais plus maigre encore. On n’allait pas fort vite et l’on s’arrêtait bien avant la nuit, par crainte des malandrins et des coupeurs de bourses. L’écuyer avait été fort aise de rencontrer le château de la Guerche en son chemin, son intention étant de demander conseil à Monsieur de Charnailles, grand-père et tuteur d’Armand-Louis, lequel était un seigneur plein de sagesse et d’expérience.
Mademoiselle de Souvigny était orpheline, et on ne lui savait d’autre protecteur qu’un certain marquis de Pardaillan, qui était son oncle et qui résidait en Suède, où l’on assurait que le vicomte de Souvigny, père d’Adrienne, était mort, laissant une grande fortune. Après un repos de huit jours sous le toit de Monsieur de Charnailles, et force conversations, le vieil écuyer parla tristement de continuer le voyage. On boucla donc les valises et on donna double ration aux chevaux. Adrienne pleura beaucoup à la pensée de quitter un pays où l’on croquait de si belles pommes dans un si beau jardin, et d’abandonner un ami qui façonnait de si beaux jouets avec son couteau. Le soir elle s’endormit, le visage tout baigné de larmes, dans les bras de son petit cousin ; c’était ainsi qu’elle appelait Armand-Louis, Monsieur de Charnailles et feu Monsieur de Souvigny étant un peu parents.
Le grand-père, ému, regarda l’écuyer qui soupirait.
– Si nous leur donnions encore vingt-quatre heures ? dit-il.
– Le voyage est bien long !
– C’est pour cela : un jour de plus, un jour de moins, qu’est-ce ?
L’écuyer regarda l’enfant qui pleurait encore tout en dormant, et céda.
Le lendemain Adrienne ne manqua pas de se coucher dans les bras de son petit ami, comme si elle eût conscience du doux empire qu’avait son sommeil. Monsieur de Charnailles l’embrassa tendrement sur le front.
– Est-ce pour demain ? dit-il en regardant l’écuyer.
L’écuyer essuya le coin de ses yeux.
– Il le faut ! répondit-il ; la Suède est si loin !
– Qu’importe alors ? Vous n’avez pas promis, j’imagine, que vous arriveriez le 1er octobre à midi, ou le 15 novembre à huit heures ?
– Non certes !
– Alors partez un autre jour.
– Soit ! dit l’écuyer, qui frissonnait à la seule pensée des longues étapes qu’il avait à fournir.
Adrienne fit encore le lendemain ce qu’elle avait fait la veille, elle eut même cette inspiration, en dormant, de jeter ses bras autour du cou d’Armand-Louis. Le pauvre écuyer n’avait pas le cœur assez dur pour séparer une orpheline du seul être qui lui témoignât de l’affection ; à cette époque, d’ailleurs, les voyages étaient fort dangereux, fort incertains : on ne pouvait s’entourer de trop de précautions pour les entreprendre.
Le cheval gris boitait d’une jambe pour le moins ; la mule n’engraissait guère, bien qu’elle employât toutes les heures et toutes ses dents à manger l’avoine et le foin de Monsieur de Charnailles, en honnête bête qui se méfie de l’avenir. On ne sait guère ce que la Suède réservait à l’orpheline ; une halte ne pouvait en rien compromettre ses intérêts. Il fut résolu que l’on resterait encore une semaine au château, après quoi l’on partirait. Le vent eut le bon esprit de souffler bientôt après ; la pluie ne voulut pas être en reste et tomba comme si le bon Dieu l’eût chargée d’inonder la province.
– On ne part pas pour la Suède en temps d’orage, dit le grand-père : attendez jusqu’à la fin du mois.
– J’attendrai, dit le bon écuyer qui chauffait ses vieilles jambes dans la cheminée.
Adrienne lui sauta au cou. La neige succéda à la pluie, les chemins se trouvèrent défoncés ; on n’avait jamais entendu parler de voyageurs quittant le coin du feu pour courir les grandes routes au cœur de l’hiver ; Mademoiselle de Souvigny pouvait s’enrhumer.
– Restons, puisque la Providence le veut, reprit l’honnête écuyer.
Quand vint la saison nouvelle, Monsieur de Charnailles fit observer à son hôte que des bandes de malfaiteurs battaient le pays et qu’il n’était pas prudent d’exposer une personne qui lui était confiée à tous les dangers d’une lointaine expédition. Il fallait attendre que les gens du roi eussent pendu les coquins qui mettaient la contrée au pillage. Certainement alors il serait le premier à brider les chevaux et à donner le signal du départ.
– Vous parlez comme un sage, répliqua l’écuyer, qu’Adrienne regardait de ses yeux les plus caressants.
Ce signal promis, Monsieur de Charnailles se garda bien de le donner. Il était, à tout prendre, le parent de Mademoiselle de Souvigny, il avait donc le droit de veiller sur elle, de la protéger ; elle lui paraissait d’une santé délicate, il fallait lui donner le temps de se fortifier pour supporter le rude climat de la Suède : n’était-elle pas bien dans le château de la Guerche, aimée, choyée, entourée de ces mille tendresses que les vieillards prodiguent aux enfants dans lesquels ils se sentent renaître ? Certes elle n’avait pas le luxe que donne la fortune, un carrosse à sa porte, dix laquais dans son antichambre, des dentelles sur sa robe ! mais elle avait la joie, la santé, le bon air, la belle humeur, et la sagesse enseigne que ce sont des biens dont il faut savoir se contenter. En outre, Adrienne ne quittait plus Armand-Louis, Armand-Louis était son premier mot, Armand-Louis était le dernier : cela attendrissait l’écuyer.
Le temps et Monsieur de Charnailles firent si bien, qu’après avoir dû monter à cheval tous les matins pour gagner à travers l’Allemagne les bords de la mer Baltique, Mademoiselle de Souvigny était encore dans la Marche six ans après. Un soir, l’écuyer qui, par occasions, disait encore : « Nous partirons demain », s’endormit pour ne plus se réveiller.
Au moment de trépasser, il fit approcher Adrienne qui pleurait, et l’embrassant :
– Vous direz à Monsieur de Pardaillan, murmura-t-il, que ce n’est pas ma faute.
Puis se tournant vers Monsieur de Charnailles :
– Je vous la recommande… aimez-la comme votre enfant, dit-il.
Ce furent ses dernières paroles, Mademoiselle de Souvigny déclara qu’elle ne s’en irait plus, et voilà comment une orpheline qui devait rester seulement huit jours au château de la Grande-Fortelle, y demeura jusqu’à quinze ans.
Ce castel de la Grande-Fortelle était un bâtiment délabré, moitié château fort, moitié ferme, dont les murailles chancelantes occupaient le sommet d’un monticule à l’entrée d’un vallon semé d’étangs et de bois. Deux méchantes tours couronnées de créneaux lui donnaient de loin une apparence féodale que démentaient promptement les fossés à demi comblés, les étables adossées contre les remparts, les granges assises sur des débris de voûtes. Une métairie occupait l’emplacement du donjon. Telle quelle cependant, la Grande-Fortelle, dont on ne voyait que des vestiges, aurait encore pu soutenir l’attaque d’une bande de partisans, et bien défendue par une garnison d’hommes déterminés, la repousser.
On n’y voyait, en 162., que Monsieur de Charnailles, son petit-fils Armand-Louis, Mademoiselle de Souvigny, et une douzaine de serviteurs, valets de ferme, palefreniers et laquais. Ce n’était pas un corps d’armée à inspirer de grandes craintes aux maraudeurs qui erraient par troupes dans la campagne, mais un tel respect entourait le châtelain, qu’au premier son de la cloche d’alarme on aurait vu accourir tous les paysans et tous les hobereaux du voisinage, ceux-là armés de fourches, et ceux-ci d’arquebuses qu’on n’avait point déchargées depuis Monsieur de Mayenne.
Armand-Louis était l’unique rejeton d’une fille bien-aimée dont le mari, Monsieur le comte de la Guerche, était mort au service du roi sans laisser de fortune. Veuve à un âge où quelques-unes de ses compagnes n’étaient point encore mariées, la comtesse s’était réfugiée auprès de son père, Monsieur de Charnailles ; la tristesse l’avait bientôt fait disparaître, comme se dessèche et meurt un jeune épi brûlé par le soleil.
Toute l’affection du vieux châtelain s’était reportée sur le seul héritier de deux maisons qui avaient eu leurs jours de prospérité et d’éclat, mais que les coups de l’adversité renversaient l’une sur l’autre sans leur rien faire perdre de leur fierté.
Monsieur de Charnailles n’avait que de maigres revenus, et quelques pauvres débris d’une splendeur effacée par les discordes civiles, mais il employa toutes ses ressources à donner au jeune Armand-Louis la plus brillante éducation militaire. Il voulut qu’un gentilhomme qui entrait dans la vie avec le poids des deux écussons des la Guerche et des Charnailles à porter, sût tout ce que savaient à cette époque les plus habiles et les plus experts. Lui-même était un homme de savoir, ami des bons livres autant que de l’épée. Il façonna donc à son image l’âme de l’orphelin qui lui était confié, et lui enseigna, plus encore par son exemple que par ses leçons, que tous les biens de la terre ne sont rien en comparaison de l’honneur.
– Si tu peux, à l’heure de la mort, répéter le mot héroïque de François Ier : « Tout est perdu fors l’honneur ! » lui disait-il souvent, que Dieu te bénisse, mon fils, tu n’auras rien perdu.
À seize ans, Armand-Louis supportait toutes les fatigues sans faiblir ; une course de vingt lieues, à toute vitesse, à cheval, par des chemins affreux, n’était rien pour ce corps de fer ; à pied, il franchissait des distances qui eussent épuisé la patience d’un homme de forces communes ; si la lassitude se faisait sentir après une rude journée de chasse, il s’étendait sur la bruyère, soupait d’une croûte de pain et d’un verre d’eau, et dormait les poings fermés. Au matin, il était frais et dispos comme un oiseau surpris sur une branche par l’aurore. Il regardait en face les plus graves périls, se jetait sans pâlir dans les rivières les plus furieuses, disparaissait hardiment dans les chaumières en flammes, et n’avait point encore rencontré de bête enragée ou de bandit en armes capables de le faire reculer.
Monsieur de Charnailles souriait d’aise en passant sa main ridée sur ce jeune front.
Un matin il surprit son fils tout en sang. Armand-Louis s’était trouvé dans un hameau au moment où une bête endiablée s’était ruée sur les troupeaux qui rentraient du pacage ; armé d’une fourche, il n’avait pas craint de l’attaquer ; l’animal s’était rué sur lui, mais le brave enfant, tout déchiré par les ongles de la bête, n’avait lâché prise qu’après l’avoir tuée. Vainqueur, il tomba lui-même sur le corps palpitant de sa victime.
– Si Dieu te prête vie, tu seras un homme, lui dit le châtelain.
Les armes ne manquaient pas dans la Grande-Fortelle ; on n’avait qu’à choisir le long des murs de la grande salle : c’était un arsenal. Quant aux professeurs, il en passait chaque mois sur la route : officiers de fortune, soldats licenciés, reîtres regagnant leur patrie lointaine, aventuriers qui n’avaient que la cape et l’épée, n’hésitaient pas à demander l’hospitalité à la tombée de la nuit, et en retour du gîte qui leur était offert de bon cœur, ils enseignaient volontiers ce qu’ils savaient dans le maniement des armes. Le soir, devant une large cheminée où flambaient des tronçons de chênes, ils faisaient des récits de guerre et apprenaient à leur hôte comment un homme de cœur se tire des plus mauvais pas. Pas un étranger qui ne fût frappé de la bonne mine d’Armand-Louis, pas un gentilhomme qui ne fût charmé de sa politesse. Son air franc et résolu prévenait en sa faveur ; ce qu’on voyait après ne démentait pas cette première et bonne impression : c’était l’âme d’un héros dans le cœur d’un adolescent.
Monsieur de Charnailles avait vu les grandes guerres du temps de Henri IV, il avait combattu contre la Ligue et Monsieur de Guise ; il ne manquait pas, comme aiment à le faire les vieillards, d’en raconter les lointains épisodes, et cette histoire glorieuse d’un roi conquérant son trône, l’épée au poing, remplissait d’enthousiasme l’âme fière d’Armand-Louis. Il brûlait de se trouver, lui aussi, mêlé à ces bandes vaillantes qui font triompher le bon droit, et ce fut à cette fin de ce bien préparer au métier des armes qu’il enrégimenta plus tard les petits huguenots du pays pour les mener en guerre contre les catholiques commandés par Renaud de Chaufontaine, son voisin.
Chapitre 3
PREMIERS SOUPIRS
Donc étudiant un jour, guerroyant le lendemain, Armand-Louis avait atteint cet âge où le cœur bat plus vite, où une fleur qui s’échappe d’un corsage et qu’on ramasse en rougissant paraît le plus précieux de tous les trésors, où le visage pâlit tout à coup parce qu’on entend la voix d’une jeune fille. On sait qu’Armand-Louis avait regardé Mademoiselle de Souvigny et l’avait trouvée belle ; jusqu’alors il savait seulement qu’elle était bonne. Quand il l’eut vue, il n’osa presque plus la regarder, si ce n’est à la dérobée. Il faisait collection de tous les objets qu’elle perdait, et les serrait dans un coffret dont il portait toujours la clé sur lui. Sa voix tremblait quand il lui parlait. Quand elle appuyait sa tête sur l’épaule du pauvre adolescent, il avait des battements de cœur qui l’étouffaient. Que devint-il quand il entendit Renaud de Chaufontaine s’extasier un matin sur la beauté d’Adrienne qui, en ce moment, traversait d’un pied leste un méchant petit pont jeté sur une rivière ?
– Eh ! eh ! ajouta le catholique en riant, la voilà bientôt bonne à marier !
– Qui ? s’écria Armand-Louis éperdu.
– Eh ! parbleu ! Mademoiselle de Souvigny !
– Adrienne ?
– Oui, Adrienne.
Armand-Louis écumait de colère. Il saisit au vol le prétexte qui lui était offert de chercher querelle à son compagnon.
– Çà ! reprit-il, depuis quand, monsieur le marquis, vous permettez-vous d’appeler Mademoiselle de Souvigny par son nom de baptême ?
– La belle affaire, puisque je le sais !
– C’est déjà trop de le savoir. Mademoiselle de Souvigny n’est Adrienne que pour deux personnes, Monsieur de Charnailles et moi.
– Bon, l’habitude est prise, elle le sera pour un troisième, qui est son voisin s’il n’est pas son parent.
– Apprenez que je ne le souffrirai pas !
– Me gêner pour une parpaillote, allons donc !…
La dernière syllabe expirait dans la gorge de son ami que déjà Armand-Louis attaquait Renaud. La lutte fut longue, opiniâtre, furieuse, interrompue seulement par les exclamations de Monsieur de Chaufontaine. Cependant, brisés, moulus, exténués, ils demeuraient en face l’un de l’autre sans pouvoir se vaincre, Renaud toujours railleur, Armand-Louis exaspéré, mais tous deux hors d’haleine.
– Marier Mademoiselle de Souvigny !… la belle idée ! reprit celui-ci. Connaissez-vous, monsieur le marquis, quelqu’un dans ce pays qui aurait la prétention de l’épouser ?
– Eh ! morbleu ! je connais vingt gentilshommes à qui cette pensée a pu venir ! répliqua Monsieur de Chaufontaine qui souriait.
– Vingt est un chiffre, ce n’est pas un nom !
– Un nom ? eh bien ! d’abord il y a moi.
– Toi !
Le combat recommença, plus long, plus obstiné, plus ardent, bras contre bras, poitrine contre poitrine. Armand-Louis ne pliait pas, Renaud ne reculait guère ; les coups pleuvaient. L’un était pâle comme un mort, l’autre rouge comme le feu.
– Voyez-vous, le gourmand ? s’écriait le marquis toujours prompt à l’épigramme ; parce qu’il a une cousine jolie à croquer !… attrape ça, hérétique du diable !… il ne veut pas qu’on la regarde !… On a des yeux, vilain parpaillot, tu n’auras pas la demoiselle et tu auras les coups. Tiens, calviniste maudit, en voilà deux pour commencer ! Mets-la dans une boîte à coton, ton Adrienne, ça n’empêchera pas quelque bon gentilhomme de ma connaissance de la convertir… gibier d’enfer !
Chaque mot de ce petit discours où les invectives se mêlaient aux louanges produisait sur les nerfs et sur les muscles d’Armand-Louis l’effet d’un coup d’éperon sur un cheval emporté. Il sentait les flots de la haine envahir son cœur. Pour la première fois il éprouvait une envie sérieuse de tuer Renaud.
Les deux athlètes épuisés tombèrent sur l’herbe, Armand-Louis presque assommé, Renaud presque rompu.
– Finissons-en, dit celui-ci brusquement : demain je t’attendrai dans le val au Moulin à la tête de mes amis ; rassemble les tiens, ce sera une bataille comme celle que les Grecs livraient aux Troyens. Je tiens Mademoiselle de Souvigny pour aussi belle que la belle Hélène.
– Faisons mieux : arme-toi d’une cotte de mailles, prends une épée, une hache, un poignard ; j’endosserai une cuirasse, et tel que deux paladins, fer contre fer, demain nous nous exterminerons.
– Soit ! et si je te tue, comme j’en ai l’espoir, je ferai dire vingt messes pour le repos de ton âme… il n’en faudra pas moins pour te tirer de la chaudière !
Le lendemain, les deux chevaliers, armés de pied en cap, sous deux épais manteaux, dague au flanc, casque en tête, se rencontrèrent au petit jour dans la partie la plus déserte du val au Moulin.
– Fais ta prière et confesse-toi, dit Renaud.
– Recommande ton âme à Dieu, répondit Armand-Louis.
Ils se mirent en garde et le fer froissa le fer. Leur force était égale, leur adresse la même. Renaud raillait toujours et accompagnait chacun de ses coups d’une menace ou d’un avertissement. Armand-Louis combattait avec une fureur muette. Bientôt quelques gouttes de sang rougirent leur armure çà et là. Tout à coup, Monsieur de la Guerche porta à son antagoniste un coup si furieux d’estoc que Monsieur de Chaufontaine en eût été traversé si l’arme ne se fût brisée en éclats. Renaud chancelant répondit à cette attaque par un coup de hache désespéré qui frappa en plein le casque du huguenot. Armand-Louis ouvrit les bras, ferma les yeux et tomba lourdement.
– Ah ! mon Dieu ! je l’ai tué ! s’écria Renaud consterné.
Il jeta loin de lui la hache maudite, remplit son casque d’eau et en inonda le visage pâle de son ami. Armand-Louis ne remua pas. Renaud s’agenouilla auprès de lui ; il pleurait.
– Se peut-il que je l’aie frappé !… lui, mon vieux compagnon !… mon meilleur ami ! disait-il tout en arrachant pièce à pièce l’armure du blessé ; exécrable batailleur que je suis, je n’ai donc pas d’entrailles !… Si vraiment il expire, je ne m’en consolerai jamais !… Ah ! mon pauvre Armand-Louis, réponds-moi, parle-moi !… Je suis un animal féroce, c’est vrai ; mais je ne suis pas méchant !… J’aurais volontiers perdu la vie pour sauver ton âme… Que veux-tu que je devienne sans toi ?… Avec qui me disputerai-je ?… Contre qui me battrai-je ?… Veux-tu que je m’assomme ou que je m’étrangle ?… Ordonne, j’obéirai… Te plaît-il que je me fasse moine ?… J’irai faire pénitence au fond d’un cloître jusqu’à la fin de mes jours.
Armand-Louis poussa un profond soupir.
– Sainte Vierge ! il rend l’âme ! s’écria Renaud.
Et les mains jointes, il se mit à sangloter.
– Épouseras-tu toujours Mademoiselle de Souvigny ? murmura Armand-Louis qui ouvrait les yeux.
– Moi, épouser Adrienne ?… non, mille fois non !… Qu’elle soit jolie, charmante, bonne et faite à ravir, que m’importe ? je ne la regarderai plus et, si tu le désires, personne même ne l’épousera jamais, j’en fais le serment !… Et que diable veux-tu que je fasse d’une huguenote, moi qui suis bon catholique ?… As-tu seulement réfléchi à cela, étourdi ?… Donc reviens à la vie et promptement, sinon je me passe l’épée que voici au travers du corps.
Renaud tira son épée du fourreau, et tel qu’autrefois Pyrame sur le corps de Thisbé, il en appuya la pointe sur sa poitrine.
– Eh ! là ! là ! ne te hâte pas de mourir ! reprit Monsieur de la Guerche, je crois que j’en reviendrai !
Et, s’aidant d’une main, il souleva son corps à demi. Renaud lui sauta au cou.
– Je crois que le tranchant de ta hache a porté à faux, poursuivit Armand-Louis ; un instant, j’ai cru que j’étais mort.
– Jour de Dieu ! s’écria Renaud, si jamais je tire l’épée contre un la Guerche, et remarque bien que tu es le dernier du nom, je consens à devenir un abominable parpaillot comme toi !
Il ramena son ami un peu lentement à la Grande-Fortelle ; ils avaient une triste figure l’un et l’autre. Quand Mademoiselle de Souvigny aperçut Armand-Louis, elle pâlit et courut à lui.
– Qu’avez-vous ?… que vous est-il arrivé ? s’écria-t-elle.
Armand-Louis baissa les yeux et avoua qu’il avait failli perdre la vie dans un combat singulier contre Monsieur de Chaufontaine.
– Vous battre encore, et pourquoi ? reprit-elle.
– Parce qu’il vous appelait Adrienne et qu’il assurait que vous étiez en âge d’être bientôt mariée !
Mademoiselle de Souvigny rougit un peu.
– Et que vous fait cela ? ajouta-t-elle.
– Je ne sais pas.
– Ah ! fit Adrienne.
Si la terre s’était entrouverte devant Armand-Louis, il s’y serait précipité tête baissée. Il n’avait pas eu peur devant une hache avide de sang ; le regard d’une petite fille blonde le faisait trembler.
Armand-Louis évita de rencontrer Adrienne jusqu’à la fin du jour. Pendant le dîner il fut silencieux et n’osa lever les yeux sur sa cousine. Il se retira de bonne heure, et le sommeil ne venant pas, il prit un volume dans la bibliothèque de Monsieur de Charnailles, au rayon des romans de chevalerie.
« Renaud assure que c’est fort amusant », pensa-t-il.
C’était l’histoire de Tristan et de la belle Yseult. Bientôt la poitrine d’Armand-Louis se gonfla, son cœur se mit à battre, les pages succédaient aux pages ; tout à coup il ferma le livre :
– Ah ! mon Dieu, je l’aime ! s’écria-t-il.
Le mot qu’il venait de dire fit tressaillir Armand-Louis ; tout effaré, il cacha sa tête entre ses mains, craignant que le son de sa voix n’arrivât jusqu’à Mademoiselle de Souvigny. Le livre ouvert était auprès de lui ; mais qu’avait-il besoin d’y lire à présent ? La nuit s’écoula sans qu’il pût fermer les yeux, dans une longue suite de rêves que le souvenir et le nom d’Adrienne remplissaient. Mais ce secret qu’il venait de découvrir, sa conscience lui faisait un devoir de ne pas le garder. Dès les premières lueurs du jour il descendit au jardin et attendit Mademoiselle de Souvigny, tout ému, palpitant, mais heureux ; il trouvait les couleurs du ciel plus brillantes, le parfum des fleurs plus enivrant, le souffle de la brise plus caressant et plus doux. Bientôt il entendit le pas léger d’Adrienne ; il s’arma de courage, et alla au-devant d’elle.
– Chère cousine, lui dit-il, vous m’avez demandé hier pourquoi la proposition de Monsieur de Chaufontaine m’avait indigné, et je vous ai répondu que je ne le savais pas.
– C’est vrai.
– Je le sais à présent.
– Ah !
– Un hasard m’a fait lire dans mon cœur ; peut-être l’aveu que je vais vous faire excitera-t-il votre courroux… disposez de moi alors : quoi que vous ordonniez, j’obéirai !
Un léger coloris parut sur le front charmant d’Adrienne ; elle cueillit des fleurs d’une main tremblante, et, sans regarder Armand-Louis, elle se mit à les réunir en bouquet.
– Si j’ai voulu tuer Monsieur de Chaufontaine, c’est que je vous aime, poursuivit Armand-Louis tout pâle et tout tremblant. Ma vie était à vous et je l’ignorais ; à présent quelque chose me dit que jusqu’à mon dernier soupir je vous aimerai… Hélas ! je n’y pensais pas, parce que je vivais près de vous, dans l’air que vous respirez… Maintenant que je sais que d’autres peuvent aussi vous voir, vous aimer, rechercher votre main, à présent que je puis vous perdre, une terreur folle s’est emparée de moi. Un mot de Monsieur de Chaufontaine a fait ce miracle.
– Monsieur de Chaufontaine !… ah ! je le déteste ! dit Adrienne.
– Ne le détestez plus ! il ne vous épousera jamais, lui ! mais un autre, un inconnu ! Ah ! puissé-je ne jamais voir ce jour-là !… Vous savez tout, chère cousine ; ai-je besoin d’ajouter que pour vous mériter il n’est rien que je ne fasse ?
Adrienne leva les yeux : une flamme sincère les remplissait ; elle mit sa main dans celle d’Armand-Louis, et d’une voix émue et tendre :
– Mademoiselle de Souvigny s’appellera un jour la comtesse de la Guerche, dit-elle, ou elle ne sera jamais à personne.
– Dieu du ciel ! s’écria Monsieur de la Guerche.
Il ne put pas continuer : Adrienne venait de s’enfuir, laissant entre ses mains le bouquet qu’elle avait cueilli.
Que la campagne lui parut magnifique ce jour-là ! comme il comprenait le sens mystérieux des choses !… Armand-Louis se sentait transformé. Le cœur d’un homme battait en lui ; il entrait dans la vie par la porte radieuse de l’amour.
À cette époque qui devait laisser une trace si profonde dans sa vie, Mademoiselle de Souvigny traversait sa seizième année.
Ce fut alors qu’on vit Armand-Louis errer autour de la Grande-Fortelle et s’enfoncer dans les bois : mais il n’était plus seul, et quand un soupir de joie soulevait sa poitrine, un sourire lui répondait. Avec quelle assiduité ne suivait-il pas les leçons que lui prodiguait la prévoyance de Monsieur de Charnailles ! Il ne voulait rien ignorer de ce qui pouvait l’aider à faire son chemin dans le monde. Son but, son espérance, c’était Adrienne. Pour l’obtenir, pour la mériter, rien ne lui paraissait impossible. Par quel effort aussi, et avec quelle ardeur ne se rendait-il pas expert dans toutes les choses qui poussent un homme plus avant dans le métier des armes !
Cependant Monsieur de Chaufontaine tenait sa promesse ; si terrible que fût son envie de pourfendre un huguenot, il ne provoquait plus Monsieur de la Guerche. Il ne cessa pas toutefois de l’appeler parpaillot, sa théologie militante n’admettant pas de compromis de ce côté-là ; il est vrai que dans sa bouche ce sobriquet avait un son amical et quelque chose de caressant qui enlevait tout prétexte aux représailles. Le parpaillot se vengea de l’entêtement pieux de Renaud en lui donnant le surnom de ligueur.
– Ligueur ? je m’en vante ! répondit Renaud gaillardement.
Chapitre 4
OÙ CARQUEFOU FAIT SON ENTRÉE DANS LE MONDE
Jamais on ne vit Montaigu et Capulet, Guelfe et Gibelin, vivre en aussi bonne intelligence ; mais lorsque le Montaigu était las de demeurer en paix, étonné de n’avoir donné ou reçu, après huit jours d’attente, aucun horion, il déclarait la guerre à un certain grand garçon du pays qu’on appelait Carquefou, et les combats recommençaient de plus belle.
Ce Carquefou était à peu près de l’âge de Renaud, qui n’avait guère qu’un an ou deux de plus qu’Armand-Louis. Fils d’un arquebusier qui vivait maigrement de son travail dans un village voisin, il menaçait de devenir grand comme un peuplier, et c’était à sa manière le garçon le plus original qui fût à dix lieues à la ronde. Carquefou faisait profession d’avoir peur de tout.
– Des moutons aussi ? lui demanda un jour Renaud.
– Monsieur le marquis, ils ont des cornes, répondit Carquefou.
Sa maxime était qu’il fallait se méfier de ceci, de cela, et du reste.
– Qui ne s’expose pas se risque encore ! disait-il quelquefois en manière de sentence. Jugez des dangers que courent ceux qui s’exposent !
En conséquence, toutes les fois que l’occasion s’en présentait, Carquefou se battait comme un tigre.
Jamais on ne vit dans le Maine et l’Anjou, la Marche et le Berry, personnage dont la conduite fût moins d’accord avec les principes ; quand les paroles disaient oui, les actions répliquaient non. Un soir, on le vit partir avec une vieille arquebuse sur le dos et un formidable couteau de chasse au côté, il portait une brebis sur son épaule ; c’était pendant les neiges de l’hiver.
– Eh ! Carquefou, où donc vas-tu en cet équipage ? lui demanda un voisin.
Carquefou entrouvrit sa souquenille et fit voir qu’elle était garnie d’une paire de gros pistolets et d’un large poignard.
– Je fais le commerce des agneaux, et j’ai peur que les béliers ne me croquent ! répondit-il en pressant le pas.
Il avait de ces répliques extravagantes auxquelles on ne comprenait jamais rien. Aussi les malins du village assuraient-ils que ce nom de Carquefou qu’il tenait de son père était trop long des deux tiers ; il fallait supprimer Carque et laisser fou.
Au petit jour, on vit rentrer Carquefou pliant sous le poids de quatre ou cinq loups qu’il avait tués à l’affût. On s’empressa autour de lui.
– Ils ont mangé la brebis, fit-il, mais j’ai leurs peaux ; c’est un petit commerce que nous faisons entre nous : cinq loups pour un mouton ; les blessés ne comptent pas.
On en retrouva deux qui rendaient l’âme dans les bois.
– Allons ! dit Carquefou, les loups ont du bon : en voilà deux qui n’entraient pas dans le marché.
Renaud eut vent de cette extermination de loups.
– Ça, lui dit-il, tu n’as donc pas eu peur ?
– Au contraire, monsieur le marquis : c’est la peur qui m’a fait déguerpir de mon lit. Les hurlements de ces bêtes enragées m’empêchaient de fermer l’œil ; je tremblais au fond de mes couvertures ! C’est pourquoi j’ai pris la résolution de les assassiner pour éviter d’attraper la fièvre.
– Il fallait au moins me prévenir !
– Eh ! monsieur, si j’avais attendu seulement une nuit encore, on m’aurait trouvé mort dans ma chambre ! Les coquins criaient sous mes fenêtres ; la mort dans l’âme, je me suis armé jusqu’aux dents et chargeant un imbécile de mouton sur mes épaules, j’ai cherché un ravin noir propre à me cacher, et je m’y suis blotti en grelottant. Le mouton a eu l’imprudence de bêler ; les bandits à quatre pattes sont arrivés ; c’était à qui donnerait le premier coup de dent : j’ai visé dans le tas. Ah ! monsieur, au moment où j’ai lâché la détente, j’ai fermé les yeux, j’avais mis une poignée de clous et de ferrailles dans l’arquebuse ; la Providence a permis que la charge portât en plein dans le cœur de la bande. Tous les loups hurlaient à la fois ; j’ai cru que mon dernier jour était arrivé. J’ai risqué un œil : il y en avait deux par terre qui se débattaient, un troisième se mordait la queue ; ça m’a donné l’espoir que cet animal était contrarié ; de fait, il avait un gros clou dans le ventre, et ça le dérangeait. Un quatrième, un bon fils celui-là, m’a découvert de mon trou ; il a voulu venger son père qui expirait, et n’a fait qu’un bond jusqu’à moi, je lui ai cassé la tête d’un coup de pistolet : une politesse en vaut une autre, il n’a plus rien dit. Les parents des morts se sont consultés : il y en avait qui opinaient pour la retraite, c’étaient les miséricordieux et les rassasiés ; d’autres prêchaient pour la bataille ; ces messieurs voulaient manger du chrétien après avoir mangé du mouton. J’ai perdu la tête, et, sortant hors de ma cachette, je suis tombé au beau milieu du conciliabule, le pistolet d’une main, le poignard de l’autre ; une balle conduite par mon saint patron s’est logée dans la cervelle de l’orateur le plus bruyant, et j’ai joué de mon couteau sur le dos des autres. Les méchants ont pris la fuite. Il était temps, je ne tenais plus sur mes jambes… Ah ! vous savez, celui qui avait un clou dans le ventre ? le lâche ! il l’a emporté ; mais il en est mort : Bien dérobé ne profite jamais.
– C’est superbe ! répondit Renaud ; mais comment arranges-tu cette peur qui te dévore ?…
– Dévore est faible, interrompît Carquefou : elle me massacre.
– Massacre, soit ; mais enfin cette peur, comment l’arranges-tu avec cette vaillance qui te fait braver une troupe de loups dans un ravin, au milieu de la nuit, loin de tout secours ?
– C’est fort simple. Quand un péril me menace, ma terreur est si grande que je m’y précipite, la tête en avant, pour ne pas le voir.
– Voilà qui n’est pas logique, mon garçon ; raisonne un peu, s’il te plaît.
– Monsieur le marquis, je ne suis pas philosophe, moi : je suis poltron.
Cela dit, Carquefou n’en démordait plus. Poltron il était, poltron il restait.
– Eh bien ! dit Renaud, je prétends te corriger de ce défaut et te rendre courageux, bon gré mal gré.
– Oh ! que nenni ! répondit Carquefou ; il vous serait plus facile de faire une brebis noire d’un agneau blanc.
– C’est ce qu’on verra.
Et pour n’en pas avoir le démenti, et à défaut d’Armand-Louis, Monsieur de Chaufontaine choisit l’honnête Carquefou pour adversaire intime, quoique bon catholique.
Un mathématicien qui déjeune d’équations et soupe de logarithmes ne pourrait pas calculer le nombre de coups, taloches, gourmades et horions qu’ils échangèrent pendant six mois. Quand ils partaient, l’un suivant l’autre par les clairières, ils s’en allaient blancs, ils revenaient noirs ; Carquefou avait des bras de fer, mais Renaud avait des muscles d’acier. À bout de résistance et d’efforts, le fils de l’arquebusier finissait toujours par plier devant le gentilhomme ; mais il s’entêtait, et, chaque jour vaincu, chaque jour il revenait à la charge.
– Ce n’est pas que je sois brave, répétait-il obstinément, mais puisque vous avez entrepris mon éducation, il faut bien que je vous témoigne ma reconnaissance.
Un soir il faillit se casser les reins en tombant sur un lit de cailloux. Au cri poussé par Carquefou, Renaud, épouvanté, lui tendit la main.
Mais Carquefou était déjà sur ses pieds.
– Monsieur le marquis, je vous adore, dit-il. À présent, ne me tuez plus, je suis à demi corrigé.
Renaud, attendri, embrassa Carquefou.
– Pourquoi n’es-tu pas huguenot ! s’écria-t-il, j’aurais tant de plaisir à te convertir !
On était donc heureux aux environs de la Grande-Fortelle, comme aussi dans l’enceinte du château. Armand-Louis découvrait chaque jour de nouvelles grâces, des charmes plus séduisants à Mademoiselle de Souvigny. Nulle n’avait, à l’entendre, ce sourire aimable, ce regard lumineux, ce mélange de raison et de bonté.
Armand-Louis remerciait Dieu de l’avoir fait grandir dans une maison où tant de jeunesse et de beauté devaient un jour trouver asile. Renaud combattait à armes émoulues contre Carquefou qu’il assommait dévotement et consciencieusement chaque matin ; après quoi il chassait ou pêchait. Le soir, il rendait visite pacifiquement à son ami, qu’il trouvait étudiant ou suivant des yeux Mademoiselle de Souvigny, qui allait et venait dans l’appartement.
– Ah ! la vie est bonne ! disait Armand-Louis.
– Certainement, répondait Renaud.
Et il soupirait.
Alors, il regardait dans l’azur assombri les grands vols d’oiseaux voyageurs qui disparaissaient au loin.
– Qu’on serait heureux de couler son existence dans ces lieux charmants ! reprenait Armand-Louis. Ne te semble-t-il pas qu’il n’y manque rien ?
Un jour Renaud frappa du pied :
– Ah ! s’écria-t-il, il y manque quelque chose !
– Eh ! quoi ?
– Il y manque des aventures !
Chapitre 5
L’HOMME À LA CROIX ROUGE
Sur ces entrefaites, un soir, par un temps de pluie, une troupe de cavaliers frappa à la porte de la Grande-Fortelle en demandant l’hospitalité. Monsieur de Charnailles parut sur le seuil de la maison et donna des ordres pour que les chevaux fussent conduits à l’écurie et les cavaliers dans la grande salle.
Un quart d’heure après, les bêtes avaient de la litière jusqu’au ventre, les étrangers étaient assis autour d’une table qui pliait sous le poids des viandes et des brocs.
Le chef de cette troupe était un beau jeune homme qui paraissait avoir vingt-sept ou vingt-huit ans ; il portait un costume de velours, sauf le pourpoint qui était en cuir fauve ; la garde de son épée et celle de son poignard, magnifiquement travaillés, faisaient briller l’or et l’argent incrustés dans l’acier. Une chaîne d’or à lourds anneaux pendait sur sa poitrine ; des éperons de métal sonnaient sur ses bottes. Il avait grand air, le regard brillant et hardi, quelque chose d’imposant et de rude dans sa physionomie, le front large, les sourcils mobiles, la bouche expressive et hautaine, une forêt de cheveux bruns. Le français lui semblait familier, mais il le prononçait avec un accent étranger. Ses yeux s’arrêtaient quelquefois sur Mademoiselle de Souvigny et s’en retiraient lentement. Armand-Louis remarqua cette attention muette ; une première fois, il posa son verre sur la table ; la seconde fois, il fronça le sourcil. L’inconnu s’en aperçut. De nouveau il promena son regard altier de la jeune fille au jeune homme et sourit.
Cet étranger déplaisait décidément à Monsieur de la Guerche.
Vers la fin du repas, Monsieur de Charnailles se leva, un verre à la main, plein jusqu’au bord.
– Messieurs, dit-il, je vous souhaite la bienvenue chez moi. Vingt châteaux dans notre beau pays de France vous offriraient une hospitalité plus riche et plus abondante, aucun ne vous la donnerait de meilleur cœur. La maison est à vous. Si vous avez faim, mangez ; si vous avez soif, buvez ; si vous êtes fatigué, reposez-vous. Ce me sera une bonne fortune de vous garder longtemps. Je suis le comte de Charnailles ; j’ai fait la guerre en bon soldat sous le feu roi Henri IV de glorieuse mémoire. Voici Mademoiselle de Souvigny, ma parente.
– Ah ! Mademoiselle de Souvigny ! murmura l’inconnu qui la considéra plus attentivement.
– Et mon petit-fils, le comte Armand-Louis de la Guerche, un gentilhomme qui portera les armes comme son père, mort au service du roi.
Monsieur de Charnailles leva son verre et le vida jusqu’à la dernière goutte.
L’étranger l’avait imité, mais ne répondait pas.
– Si un motif que j’ignore ne vous permet pas de nous révéler votre nom, poursuivit le châtelain, je n’en veux pas moins inscrire votre visite au château de la Grande-Fortelle parmi les jours heureux de ma vie.
L’étranger se leva, et d’un air hautain :
– Cacher mon nom, et pourquoi ? dit-il ; il est de ceux qu’on peut avouer sans crainte, et je n’en sais pas qui puissent le surpasser en bonne renommée et en éclat ! Je m’appelle Godefroy Henri, comte de Pappenheim.
Monsieur de Charnailles s’inclina.
– De cette fameuse maison où la dignité de grand maréchal de l’empire d’Allemagne est héréditaire ? s’écria-t-il.
– Ah ! je vois que vous connaissez les illustres maisons d’Europe ! Le seul représentant des Pappenheim, à présent, c’est moi. Je traverse la France et retourne en Allemagne où la guerre qui s’est rallumée me rappelle.
– Encore la guerre ! s’écria Monsieur de Charnailles.
– Ceux de la religion prétendue réformée lèvent des troupes, engagent des capitaines, fortifient leurs villes et leurs châteaux, rassemblent des armes, et tout cela comme s’il s’agissait de résister aux invasions des Turcs. Les princes révoltés, les princes protestants veulent renverser le trône de mon gracieux maître l’empereur Ferdinand ! Avec l’aide de Dieu et de la sainte Vierge, nous disperserons leurs armées, nous saperons leurs villes fortes, nous tuerons leurs capitaines et nous agrandirons nos domaines aux dépens de ces mécréants !
– Je suis huguenot ! dit Monsieur de Charnailles tranquillement.
Une violente émotion se peignit sur le visage du comte de Pappenheim, et l’on vit apparaître sur son front, à l’angle interne des sourcils, deux glaives en croix, dont les lames pourpres tranchaient sur la pâleur mate de la peau. Cependant, sa bouche allait s’ouvrir pour lancer une menace ou un défi, lorsque son regard rencontra celui d’Adrienne. Soudain un sourire plissa ses lèvres.
– Vous êtes mon hôte, monsieur le comte, un jour Dieu jugera entre nous, dit-il.
Les deux glaives écarlates qui prolongeaient leurs pointes sur son front s’effacèrent lentement. Étonnés, les yeux de Mademoiselle de Souvigny interrogèrent silencieusement le comte de Pappenheim. Un mouvement d’orgueil enfla ses narines :
– Ah ! oui ! reprit-il, vous avez vu ces deux épées qui croisent leurs lames rouges sur mon front ? c’est le signe de ma race, le signe des Pappenheim ! Dieu a voulu imprimer sur notre front la marque ineffaçable de notre dignité. En Allemagne, quand un soldat voit passer les fils de notre maison, un regard lui dit qui nous sommes. Alors il tremble et se lève.
– Personne ne tremble ici, monsieur le comte ! Celui qui vous parle a vu des connétables, et l’épée des connétables de France vaut celle des maréchaux de l’empire d’Allemagne ; mais si nous ne tremblons pas, chacun de nous vous dira par ma bouche : « Restez, la maison est à vous ; partez, les portes sont ouvertes ! »
Malgré son arrogance, le comte de Pappenheim inclina la tête devant la dignité majestueuse de Monsieur de Charnailles.
Une heure après un page débouclait le ceinturon de l’étranger dans l’appartement d’honneur où le châtelain lui-même l’avait conduit.
– À quelle heure, demain, monsieur le comte, veut-il que j’ordonne à ses gens de préparer les chevaux ? dit le page.
– As-tu vu cette jeune personne qui était assise à table auprès de Monsieur de Charnailles, et qui, le soir, a chanté si doucement en s’accompagnant au luth ? lui demanda tranquillement le comte de Pappenheim.
– Oui.
– Eh bien ! nous resterons.
L’exclamation que Monsieur de Pappenheim avait laissé échapper au nom de Mademoiselle de Souvigny n’avait pas été perdue pour Monsieur de la Guerche. Le lendemain, il profita d’un instant où il était seul avec le comte allemand dans la salle des armes pour essayer d’avoir le sens de cette exclamation.
– Quand Monsieur le comte de Charnailles vous a présenté hier Mademoiselle de Souvigny, lui dit-il, il m’a semblé que ce nom ne frappait pas votre oreille pour la première fois ; me serais-je trompé ?
– Point.
– Ah !
– Voilà une belle arme, poursuivit le jeune étranger, qui jouissait de l’embarras d’Armand-Louis, et qui, d’une main curieuse, venait d’enlever une dague à une panoplie voisine.
– Très belle, répliqua Monsieur de la Guerche sans regarder rien. Peut-on vous demander où vous avez entendu parler de ma cousine, et par qui ?
– Sans contredit, je ne fais mystère de rien, vous le savez.
Et retournant la dague entre ses doigts :
– J’ai rarement vu travail plus beau, ajouta-t-il, c’est une dague de Milan ?
– Me permettez-vous de vous l’offrir comme un souvenir de votre passage dans ce château ?
– Merci, je n’accepte jamais rien ; j’achète ou je prends, répondit Monsieur de Pappenheim, qui repoussa l’arme dans son fourreau.
Il fit quelques pas dans la galerie, plus hautain qu’un empereur.
Monsieur de la Guerche le suivait des yeux, tout plein d’une sourde irritation ; mais le comte de Pappenheim était chez Monsieur de Charnailles.
La patience rentrait dans les devoirs de l’hospitalité.
– À propos, reprit tout à coup le comte Henri, ne me demandiez-vous pas tout à l’heure en quel lieu et dans quelles circonstances j’avais entendu parler de Mademoiselle de Souvigny ?
– Oui ; mais s’il ne vous plaît pas de parler…
– Eh ! vous savez bien le contraire ! J’ai longtemps voyagé, monsieur. Plus tard, quand vous aurez âge de soldat, peut-être verrez-vous beaucoup de pays : je doute que vous en parcouriez davantage. Or je me suis promené en Suède : c’est un royaume lointain et curieux, un peu livré aux glaces et aux ours. Cependant il s’y rencontre des gentilshommes. L’un d’eux, qui m’a accueilli, s’appelait Monsieur de Pardaillan.
– Ah ! fit Armand-Louis.
– Pardieu ! vous le connaissez peut-être : c’est un Français, un huguenot comme vous.
– Il est un peu de nos parents, mais je ne l’ai jamais vu.
– Tant pis ! Il a dans ses caves les meilleurs vins de France que j’aie jamais bus. C’est Monsieur de Pardaillan qui m’a parlé de Mademoiselle de Souvigny. Il m’assura qu’il l’attendait depuis quatorze ans.
– Douze, monsieur.
– Douze si vous voulez. Il m’apprit, en outre, que votre cousine avait une grande fortune en Suède ; or c’est une adorable personne, et je comprends qu’on la retienne en France.
Le rouge de la colère monta au visage d’Armand-Louis.
– Monsieur le comte !… s’écria-t-il.
– Qu’est-ce ? répliqua l’Allemand d’un air railleur ; Mademoiselle de Souvigny ne serait-elle point riche, ainsi que me l’a conté Monsieur de Pardaillan ? N’est-elle point dans ce château, où j’ai quelque souvenance de l’avoir saluée hier ?
Monsieur de la Guerche se mordit les lèvres jusqu’au sang.
– Puisque je n’ai rien dit qui ne soit vrai, ne nous fâchons pas, monsieur, croyez-moi, ajouta l’étranger.
Et reportant ses yeux sur les murs de la galerie :
– Vous avez là une belle collection d’engins de bataille, reprit-il froidement.
« Certainement, pensait Armand-Louis, j’aurai quelque jour l’agrément de tenir ce Pappenheim au bout de mon épée. »
Quand l’heure sonna de se présenter chez Monsieur de Charnailles et Mademoiselle de Souvigny, le comte Henri Godefroy changea subitement de manière et de langage.
Le railleur impertinent fit place au gentilhomme de grande maison. Il fut galant sans affectation et montra qu’il avait voyagé avec fruit. L’italien, l’espagnol ne lui étaient pas moins familiers que l’allemand et le français. Il connaissait, pour avoir été dans leur intimité, presque tous les souverains de l’Europe ; Mademoiselle de Souvigny paraissait l’écouter avec intérêt. Le comte Henri Godefroy mêlait habilement les anecdotes aux récits de ses lointaines pérégrinations. Il était peu d’événements considérables de l’histoire contemporaine sur lesquels il n’eût des renseignements curieux, peu d’hommes importants, capitaines ou ministres, auprès desquels il n’eût vécu. Il en faisait des portraits qui les mettaient en lumière. On devinait bien vite qu’il avait vu les cours et les champs de bataille, et que son intelligence avait largement profité de ces nombreux voyages.
« Ah ! je suis perdu ! pensa Armand-Louis ; que suis-je auprès d’un pareil homme ? »
Lui qui n’avait jamais haï personne, pas même son ennemi Renaud, le ligueur, il exécrait le comte de Pappenheim.
Le gentilhomme allemand était resté un jour à la Grande-Fortelle, il en resta deux, il en resta trois. Chaque matin, il apparaissait comme un astre, vêtu d’habits toujours nouveaux, des étoffes les plus belles, les velours, le brocart d’or et d’argent, le satin, et, parmi ces ajustements de grand prix, des flots de guipure et de dentelles si fines et d’un si merveilleux travail, qu’on n’en voyait pas de pareilles aux plus fières châtelaines de la province. Armand-Louis, qui détestait de plus en plus le comte Godefroy, s’étonnait que les valises d’un voyageur pussent contenir de si magnifiques vêtements et en si grand nombre.
Quelle piteuse mine ne faisait-il pas avec son pourpoint de drap usé et son manteau de grossière étoffe, auprès de ce grand seigneur, éblouissant, plus brillant qu’une chasse et tout couvert de broderies ! Ce qui augmentait son trouble, et donnait un aliment plus vif à son animadversion, c’était que quelque chose qu’il avait sur lui, une belle arme, des éperons, un ceinturon d’acier, rappelait toujours l’homme de guerre, et ne permettait pas de penser que ce beau jeune homme fût un dameret comme on en voit dans les antichambres des princes.
On avait dit à Monsieur de la Guerche, peut-être l’avait-il lu dans un roman de chevalerie, que les femmes se prennent par les yeux, et cela redoublait son tourment.
Un matin, l’entretien tomba sur l’escrime. On était en ce moment dans la galerie des armes où, en temps de pluie, le vieux seigneur de Charnailles aimait à se promener, comme un soldat blanchi sous le harnais aime à se retrouver au milieu des compagnons de ses jeunes années.
– Vous avisez-vous quelquefois de manier ces joujoux ? dit le comte Godefroy en regardant Armand-Louis.
Sans répondre, celui-ci sauta sur une rapière, et tombant en garde :
– S’il vous plaît de vous en assurer, dit-il, voyez !
Monsieur de Pappenheim prit à la muraille une arme de même taille, en fit ployer la lame, en examina la pointe et le tranchant émoussés.
– Un duel à armes courtoises, j’y consens, répondit-il.
Armand-Louis reprit :
– D’autres épées sont là, aiguës comme des aiguilles, mieux affilées que des couteaux de chasse ; s’il vous convient d’en user, reprit-il, ne vous gênez pas.
Il avait oublié Monsieur de Charnailles, qui se leva.
– Eh ! monsieur de la Guerche, s’écria le châtelain, vous venez de provoquer notre hôte, ce me semble ?
– Oh ! monsieur le comte, ne craignez rien ! répliqua le gentilhomme allemand : du premier duel de Monsieur de la Guerche je ne veux pas faire le dernier !
Une seconde après, le fer croisait le fer. Malgré sa jactance, Monsieur de Pappenheim reconnut dès la première passe qu’il n’avait pas affaire à un adversaire de force médiocre. Deux fois même il faillit être touché. Il fronça le sourcil, et on vit se dessiner en rouge, sur son front pâle, les deux glaives en croix. Alors il se ramassa sur lui-même, serra son jeu, en déploya toutes les ressources savantes, et tout à coup, évitant une attaque avec l’agilité d’une panthère, il fit tomber sa rapière de tout son poids sur le bras d’Armand-Louis.
L’épée de Monsieur de la Guerche échappa de ses mains et roula sur le parquet.
– Pardonnez-moi, dit alors Monsieur de Pappenheim, je craignais de vous fatiguer.
Vaincu, et devant Adrienne, Armand-Louis aurait désiré que la terre s’entrouvrît sous ses pieds ; mais déjà il étendait la main vers la muraille, lorsque Monsieur de Charnailles fit un signe :
– Assez ! dit-il.
Le regard du comte Godefroy croisa le regard d’Armand-Louis ; quelle arrogance orgueilleuse dans l’un, quel désir de vengeance dans l’autre ! Mais déjà Monsieur de Pappenheim se baissait, et ramassant l’épée que la main engourdie de son antagoniste n’avait pas su retenir, il la lui présenta avec toute la grâce d’un raffiné.
– Vous savez tout ce qu’on apprend aux écoles, dit-il ; il vous manque ce qu’on apprend sur les champs de bataille.
– Monsieur le comte de la Guerche, son père, le savait ; Armand-Louis le saura, dit fièrement Monsieur de Charnailles.
– Je le désire et je l’espère, répondit le comte allemand en mesurant de l’œil le cousin de Mademoiselle de Souvigny.