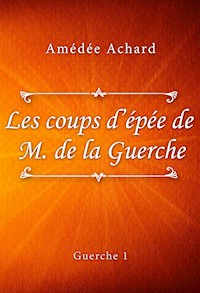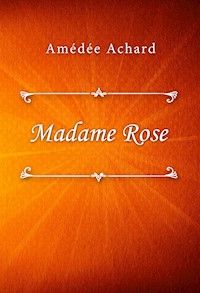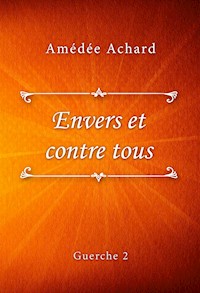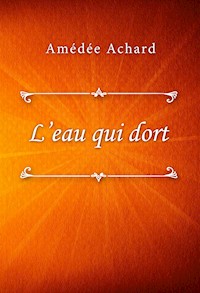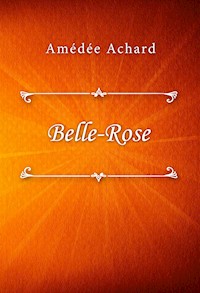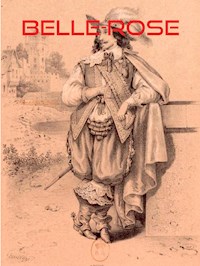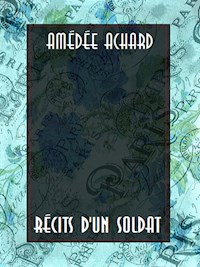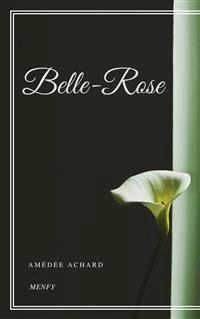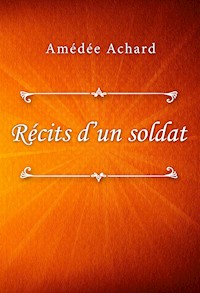
0,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Classica Libris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
En 1870, l’auteur est mobilisé à Chalons en Champagne. Il s’enrôle dans les 3e zouaves, compagnie active. Il est envoyé à Mézières puis à Sedan où il combat. La capitulation est signée et ils deviennent prisonniers de guerre. Il s’évade en Belgique, prend le train pour Paris et combat à nouveau dans la banlieue. Paris est protégé par des forts. Son bataillon est décimé. Un jour, il va à Paris et constate que la vie est paisible. Il retourne au front, livre de grosses batailles, puis l’armistice est signé, Paris se rend.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Amédée Achard
RÉCITS D’UN SOLDAT
Copyright
First published in 1871
Copyright © 2022 Classica Libris
Préface
Les pages qu’on va lire sont extraites d’un cahier de notes écrites par un engagé volontaire. Il n’y faut point chercher de graves études sur les causes qui ont amené les désastres sous lesquels notre pays a failli succomber, ni de longues dissertations sur les fautes commises. Non ; c’est ici le récit d’un soldat qui raconte simplement ce qu’il a vu, ce qu’il a fait, ce qu’il a senti, au milieu de ces armées s’écroulant dans un abîme. À ce point de vue, ces souvenirs, qui ont au moins le mérite de la sincérité, ont leur intérêt ; c’est un nouveau chapitre de l’histoire de cette funeste guerre de 1870 que nous offrons à nos lecteurs.
Première partie
Une armée prisonnière
1
Au mois de juillet 1870, j’achevais la troisième année de mes études à l’École centrale des arts et manufactures. C’était le moment où la guerre, qui allait être déclarée, remplissait Paris de tumulte et de bruit. Dans nos théâtres, tout un peuple fouetté par les excitations d’une partie de la presse, écoutait debout, en le couvrant d’applaudissements frénétiques, le refrain terrible de cette Marseillaise qui devait nous mener à tant de désastres. Des régiments passaient sur les boulevards, accompagnés par les clameurs de milliers d’oisifs qui croyaient qu’on gagnait des batailles avec des cris. La ritournelle de la chanson des Girondins se promenait par les rues, psalmodiée par la voix des gavroches. Cette agitation factice pouvait faire supposer à un observateur inattentif que la grande ville désirait, appelait la guerre ; le gouvernement, qui voulait être trompé, s’y trompa.
Un décret appela au service la garde mobile de l’Empire, cette même garde mobile que le mauvais vouloir des soldats qui la composaient, ajouté à l’opposition aveugle et tenace de la gauche, semblaient condamner à un éternel repos. En un jour elle passa du sommeil des cartons à la vie agitée des camps. L’École centrale se hâta de fermer ses portes et d’expédier les diplômes à ceux des concurrents désignés par leur numéro d’ordre. Ingénieur civil depuis quelques heures, j’étais soldat et faisais partie du bataillon de Passy portant le no 13.
La garde mobile de la Seine n’était pas encore organisée, qu’il était facile déjà de reconnaître le mauvais esprit qui l’animait. Elle poussait l’amour de l’indiscipline jusqu’à l’absurde. Qui ne se rappelle encore ces départs bruyants qui remplissaient la rue Lafayette de voitures de toute sorte conduisant à la gare du chemin de fer de l’Est des bataillons composés d’éléments de toute nature ? Quelles attitudes ! quel tapage ! quels cris ! À la vue de ces bandes qui partaient en fiacre après boire, il était aisé de pressentir quel triste exemple elles donneraient.
Mon bataillon partit le 6 août pour le camp de Châlons ; ce furent, jusqu’à la gare de la Villette, où il s’embarqua, les mêmes cris, les mêmes voitures, les mêmes chants. Des voix enrouées chantaient encore à Château-Thierry. Les chefs de gare ne savaient auquel entendre, les hommes d’équipe étaient dans l’ahurissement. À chaque halte nouvelle, c’était une débandade. Les moblots s’envolaient des voitures et couraient aux buvettes, quelques-uns s’y oubliaient. On faisait à ceux d’entre nous qui avaient conservé leur sang-froid des récits lamentables de ce qui s’était passé la veille et les jours précédents. Un certain nombre de ces enfants de Paris avaient exécuté de véritables razzias dans les buffets, où tout avait disparu, la vaisselle après les comestibles ; les plus facétieux emportaient les verres et les assiettes, qu’ils jetaient, chemin faisant, par la portière des wagons ; histoire de faire du bruit et de rire un peu. Des courses impétueuses lançaient les officiers zélés à la poursuite des soldats qui s’égaraient dans les fermes voisines, trouvant drôle « de cueillir çà et là » des lapins et des poules. On se mettait aux fenêtres pour les voir.
À mon arrivée à Châlons, la gare et les salles d’attente, les cours, les hangars, étaient remplis d’éclopés et de blessés couchés par terre, étendus sur des bancs, s’appuyant aux murs. Là étaient les débris vivants des meurtrières rencontres des premiers jours : dragons, zouaves, chasseurs de Vincennes, turcos, soldats de la ligne, hussards, lanciers, tous hâves, silencieux, mornes, traînant ce qui leur restait de souffle. Point de paille, point d’ambulance, point de médecins. Ils attendaient qu’un convoi les prît. Des centaines de wagons encombraient la voie. Il fallait dix manœuvres pour le passage d’un train. Le personnel de la gare ne dormait plus, était sur les dents.
Au moment où nous allions quitter Paris, nous avions eu la nouvelle de ces défaites, sitôt suivies d’irréparables désastres. Maintenant j’avais sous les yeux le témoignage sanglant et mutilé de ces chocs terribles au-devant desquels on avait couru d’un cœur si léger. Mon ardeur n’en était pas diminuée ; mais la pitié me prenait à la gorge à la vue de ces malheureux, dont plusieurs attendaient encore un premier pansement. Quoi ! tant de misères et si peu de secours !
Le chemin de fer établi pour le service du camp emmena les mobiles au Petit-Mourmelon, d’où une première étape les conduisit à leur campement, le sac au dos. Pour un garçon qui, la veille encore, voyageait à Paris en voiture et n’avait fatigué ses pieds que sur l’asphalte du boulevard, la transition était brusque. Ce ne fut donc pas sans un certain sentiment de bonheur que j’aperçus la tente dans laquelle je devais prendre gîte, moi seizième. L’espace n’était pas immense, et quelques vents coulis, qui avaient, quoiqu’au cœur de l’été, des fraîcheurs de novembre, passaient bien par les fentes de la toile et les interstices laissés au ras du sol ; mais il y avait de la paille, et, serrés les uns contre les autres, se servant mutuellement de calorifères, les mobiles, la fatigue aidant, dormirent comme des soldats.
Aux premières lueurs du jour, un coup de canon retentit : c’était le réveil. Comme des abeilles sortent des ruches, des milliers de mobiles s’échappaient des tentes, en s’étirant. L’un avait le bras endolori, l’autre la jambe engourdie. Le concert des plaintes commença. L’élément comique s’y mêlait à haute dose ; quelques-uns s’étonnèrent qu’on les eût réveillés si tôt, d’autres se plaignirent de n’avoir pas de café à la crème. Au nombre de ces conscrits de quelques jours si méticuleux sur la question du confortable, j’en avais remarqué un qui, la veille au soir, avait paru surpris de ne point trouver de souper dressé sous la tente.
– À quoi songe-t-on ? s’était-il écrié.
Les yeux ouverts, sa surprise devint de l’indignation. Le déjeuner n’arrivait pas.
– Si c’est comme cela qu’on nous traite, murmura-t-il, que sera-ce en campagne ?
Je ne doutais pas que ce ne fût quelque fils de famille, comte ou marquis, tombé du faubourg Saint-Germain en pleine démocratie. Un camarade discrètement interrogé m’apprit que le gentilhomme inconnu s’essayait la veille encore dans l’art utile de tirer le cordon. C’est, au reste, une remarque que je n’eus pas seul occasion de faire. Les exigences des mobiles de Paris croissaient en raison inverse des positions qu’ils avaient occupées : tous ceux qui avaient eu les carrefours pour résidence et les mansardes pour domicile poussaient les hauts cris. Le menu du soldat leur paraissait insuffisant ; les objets de campement ne venaient pas de chez le bon faiseur.
Le spectacle que présentait le camp de Châlons aux clartés du matin ne manquait ni de grandeur, ni de majesté. Aussi loin que la vue pouvait s’étendre, les cônes blancs des tentes se profilaient dans la plaine. Leurs longues lignes disparaissaient dans les ondulations du terrain pour reparaître encore dans les profondeurs de l’horizon. Un grouillement d’hommes animait cette ville mouvante dont un poète de l’antiquité aurait dit qu’elle renfermait le printemps de la grande ville : triste printemps qui avait toutes les lassitudes et la sécheresse de l’hiver avant d’avoir donné la moisson de l’été ! Mais, si le camp avait cette grâce imposante qui se dégage des grandes lignes, il présentait des inconvénients qui en diminuaient les charmes pittoresques. Des vents terribles en parcouraient la vaste étendue et nous aveuglaient de tourbillons de poussière ; à la chaleur accablante du jour succédaient les froids pénétrants des nuits. Une rosée abondante et glaciale mouillait les tentes, et, si l’on ne respirait pas au coucher du soleil, le matin on grelottait.
– Le gouvernement sait bien ce qu’il fait, disaient les mobiles ; nous sommes républicains, il nous tue en détail !
Le premier coup de canon tiré, la vie militaire s’emparait du camp. Les tambours battaient, les clairons sonnaient, et les officiers qui avaient eu cette chance heureuse d’attraper des fusils pour leurs bataillons, s’efforçaient d’enseigner à leurs hommes l’exercice qu’ils ne savaient pas. On voyait bon nombre de compagnies où, les fusils à tabatière manquant, on s’exerçait avec des bâtons. Les mobiles qui n’avaient que leur paye vivaient de l’ordinaire du soldat. Quant aux fils de famille, ils se réunissaient au Petit-Mourmelon, où l’on trouvait un peu de tout, depuis des pâtés de foie gras et du vin de Champagne pour les gourmets jusqu’à des cuvettes pour les délicats.
Je devais une visite au Petit-Mourmelon ; là régnait le tapage en permanence. Qu’on se figure une longue rue dont les bas-côtés offraient une série interminable de cabarets, de guinguettes, d’hôtels garnis, de boutiques louches, de magasins borgnes, de cafés et de restaurants, entre lesquels s’agitait incessamment une cohue de képis et de tuniques, de pantalons rouges et de galons d’or. On y faisait tous les commerces, la traite des montres et l’escompte des lettres de change. Çà et là, on jouait la comédie ; dans d’autres coins, on dansait. Ce Petit-Mourmelon, qui était dans le camp comme une verrue, n’a pas peu contribué à entretenir et à développer l’indiscipline. On y prenait des leçons de dissipation et d’ivrognerie. On s’entretenait encore à l’ombre de ces établissements interlopes de l’accueil insolent que les bataillons de Paris avaient fait à un maréchal de France. Des âmes de gavroches s’en faisaient un sujet de gloire. Peut-être aurait-il fallu qu’une main de fer pliât ces caractères qu’on avait élevés dans le culte de l’insubordination ; on eut le tort de croire que l’indulgence porterait de meilleurs fruits.
Un cœur un peu bien placé et sur lequel pesait le sang répandu à Reichshoffen devait être bien vite dégoûté de cette platitude et de ces criailleries. Parmi les jeunes gens que j’avais connus à Paris, et qui faisaient comme moi leur apprentissage du métier des armes, beaucoup ne se gênaient pas pour manifester leurs sentiments d’indignation et souffraient de leur inutilité. L’uniforme que je portais devenait lourd à mes épaules. Sur ces entrefaites, j’entendis parler du 3e zouaves, dont les débris ralliaient le camp de Châlons. Le colonel, Monsieur Alfred Bocher, se trouvait parmi les épaves du plus brave des régiments. Je l’avais connu dans mon enfance, mon parti fut pris sur-le-champ. Il ne s’agissait plus que de découvrir le 3e zouaves et son colonel.
Quiconque n’a pas vu le plateau de Châlons peut croire que la découverte d’un régiment est une chose aisée ; mais, pour l’atteindre, il faut avoir la patience d’un voyageur qui poursuit une tribu dans les interminables prairies du Far-West. C’était au moment où le maréchal de Mac-Mahon, plein d’une incommensurable tristesse, rassemblait l’armée qui devait disparaître à Sedan après avoir combattu à Beaumont. Partout des soldats et des tentes partout : un désert peuplé de bataillons. Déjà se formait ce groupe énorme d’isolés qui allait toujours grossissant. Les défaites des jours précédents élargissaient cette plaie des armées en campagne. Ils formaient un camp dans le camp.
Des tentes d’un régiment de ligne, je passais aux tentes d’un bataillon de chasseurs de Vincennes ; je tombais d’un escadron de cuirassiers dans un escadron de hussards ; je me perdais entre des batteries dont les canons luisaient au soleil. Si je demandais un renseignement, je n’obtenais que des réponses vagues. Enfin, après trois ou quatre heures de marche dans cette solitude animée par le bruit des clairons, j’arrivai au campement du 3e zouaves. Quelques centaines d’hommes y étaient réunis portant la veste au tambour jaune. Quand il avait quitté l’Afrique, le régiment comptait près de trois mille hommes. Le colonel Bocher était là, assis sur un pliant, entouré de trois ou quatre officiers à qui des bottes de paille servaient de sièges. Je me nommai, et présentai ma requête. – Savez-vous bien ce que vous me demandez ? dit-il alors ; c’est une longue suite de misères, de fatigues, de souffrances. Tous les soldats les connaissent : mais au 3e zouaves ce sont les compagnons de tous les jours. Mon régiment a une réputation dont il est fier, mais qui lui vaut le dangereux honneur d’être toujours le premier au feu. Si vous cédez à une ardeur juvénile, prenez le temps de réfléchir.
Ma résolution était bien arrêtée, le colonel céda. Il me remit une carte avec quelques mots écrits à la hâte, par lesquels il m’autorisait à faire partie des compagnies actives sans passer par les lenteurs et les ennuis du dépôt, et me congédia. Peu de jours après, j’étais à Paris, où je n’avais plus qu’à m’enrôler et à m’équiper. C’était plus difficile que je ne pensais. Rien n’avait été changé pour rendre plus rapides et plus faciles les engagements. Aucun tailleur de Paris n’a jamais employé ses ciseaux et ses aiguilles à couper et à coudre des vêtements de zouave. Quant au tailleur officiel du régiment, il habitait Mostaganem ; enfin, toutes les difficultés vaincues, ma veste sur le dos et ma feuille de route dans la poche, le 28 août, en qualité de zouave de deuxième classe au 3e régiment, je partis pour Rethel avec un billet qui ne me garantissait le voyage que jusqu’à Reims. Je n’avais d’ailleurs ni fusil, ni cartouches. Tout mon bagage se composait d’un tartan qui renfermait deux chemises de flanelle, trois ou quatre paires de chaussettes de laine et quelques mouchoirs. Ma fortune était cachée dans une ceinture, où, en cherchant bien, on eût trouvé un assez bon nombre de pièces d’or.
Il y avait dans le compartiment dans lequel j’étais monté, une femme enveloppée d’un manteau qui pleurait sous son voile et un ingénieur qui prenait des notes. Ma voisine m’apprit entre deux sanglots qu’elle avait un fils et un frère à l’armée. Elle n’en avait point de nouvelles depuis quinze jours. L’ingénieur voyageait pour la destruction des œuvres d’art, telles que viaducs, ponts et tunnels. Il en avait une centaine à faire sauter. C’était une mission de confiance. Son crayon voltigeait sur le calepin et il honorait quelquefois son voisin d’un sourire modestement orgueilleux.
La guerre et ses conséquences, la guerre et ses probabilités faisaient tous les frais de la conversation. On n’avait rien à apprendre et on parlait toujours. Chaque voyageur qui montait apportait son contingent de nouvelles. La plupart reposaient sur des renseignements fournis par le hasard. Ils ne mentaient pas moins que les dépêches. Le blâme avait plus de part à l’entretien que l’éloge. L’un attaquait l’état-major, un autre l’intendance. On improvisait des plans de campagne magnifiques qui n’avaient d’autre défaut que d’être impraticables. Leurs auteurs retournaient à leurs affaires çà et là ; celui-là dans son château, celui-ci dans sa boutique.
À la station de Reims, où l’on n’attendait pas encore le roi Guillaume, tous mes compagnons de route descendirent. Un officier d’artillerie, qui semblait avoir fait cent lieues à travers champs, monta, étendit ses jambes crottées sur les coussins, soupira, se retourna, et se mit à ronfler comme une batterie. Vers deux heures du matin, le convoi s’arrêta à Rethel. Il ne s’agissait plus maintenant que de découvrir le 3e zouaves. Il pleuvait beaucoup, et la ville était encore dans l’épouvante d’une visite qu’elle avait reçue la veille. Quatre uhlans avaient pris Rethel ; mais, trop peu nombreux pour garder cette sous-préfecture, ils étaient repartis comme ils étaient arrivés, lentement, au pas. Tout en discutant les chances du retour des quatre uhlans avec l’aubergiste qui m’avait accordé l’hospitalité d’une chambre et d’un lit, j’appris que le 3e zouaves était parti depuis trois jours. Personne ne savait où il était allé. Je voulais à la fois des renseignements et un fusil. La matinée s’écoula en recherches vaines. Point d’armes à me fournir, aucune information non plus. Sûr enfin que le chemin de fer ne marchait plus, et bien décidé à rejoindre mon régiment, j’obtins d’un loueur une voiture avec laquelle il s’engageait à me faire conduire à Mézières.
2
Nous n’avions pas fait un demi-kilomètre sur la route de Mézières, que déjà nous rencontrions des groupes de paysans marchant d’un air effaré. Quelques-uns tournaient la tête en pressant le pas. Leur nombre augmentait à mesure que la voiture avançait. Bientôt la route se trouva presque encombrée par les malheureux qui poussaient devant eux leur bétail, et fuyaient en escortant de longues files de charrettes sur lesquelles ils avaient entassé des ustensiles, quelques provisions et leurs meubles les plus précieux. Les femmes et les enfants, assis sur la paille et le foin, pleuraient et se lamentaient. Je pensai alors aux chants qui avaient salué la nouvelle de la déclaration de guerre, à l’enthousiasme nerveux de Paris, à cette fièvre des premiers jours. J’étais non plus à l’Opéra, mais au milieu de campagnes désolées que leurs habitants abandonnaient. La ruine et l’incendie les balayaient comme un troupeau. L’un de ces fugitifs que je questionnai au passage, me répondit que les Prussiens arrivaient en grand nombre : ils avaient coupé la route entre Mézières et Rethel, et me conseilla de rebrousser chemin. Cela dit, il reprit sa course.
De sourdes et lointaines détonations prêtaient une éloquence plus sérieuse au discours du paysan : c’était la voix grave du canon qui tonnait dans la direction de Vouziers. Je ne l’avais jamais entendue qu’à Paris pendant les réjouissances des fêtes officielles. Elle empruntait au silence des campagnes et au spectacle de cette route où fuyait une foule en désordre, un accent formidable qui faisait passer un frisson dans mes veines. Plus tard je devais me familiariser avec ce bruit. Une ferme brûlait aux environs, et l’on n’avait besoin que de se dresser un peu pour apercevoir derrière les haies les coureurs français et prussiens qui échangeaient des coups de fusil.
À six heures du soir, la voiture atteignit les portes de Mézières. Mon premier soin fut de me rendre à la place où je voulais, comme à Rethel, obtenir tout à la fois un fusil et des renseignements sur le 3e zouaves ; mais le désordre et le trouble que j’avais déjà remarqués à Rethel n’étaient pas moindres à Mézières. Un employé près duquel je parvins à me glisser après de longs efforts, me jura, sur ses dossiers, que personne dans l’administration ne savait où pouvait camper dans ce moment le régiment que je cherchais. Il n’y avait plus qu’à trancher la question du fusil. Mon insistance parut étonner beaucoup l’honnête bureaucrate. Prenant alors un air doux : – Je comprends votre empressement à servir votre pays, reprit-il, c’est pourquoi je vous engage à partir pour Lille.
– Pour Lille ! pour Lille en Flandres ?
– Oui, monsieur, Lille, département du Nord, où l’on forme un régiment qui sera composé d’éléments divers très bien choisis. Vous y serez admis d’emblée, et là certainement vous trouverez enfin ce fusil qu’on n’a pu vous procurer ni à Rethel, ni à Mézières. D’ailleurs il y a des ordres.
L’entretien était fini ; la voix de l’autorité venait de se faire entendre. Pour un volontaire qui avait rêvé de se trouver en face des Prussiens quelques heures après son départ de Paris, elle n’était ni douce, ni consolante. Au lieu de la bataille, le dépôt ! L’oreille basse, je poussai devant moi tristement à travers les rues. Des militaires portant tous les uniformes les encombraient, allant et venant, sortant du cabaret pour entrer chez les marchands de vin. Il y avait comme du désenchantement dans l’air.