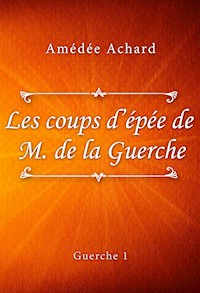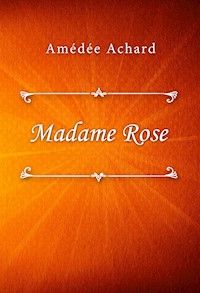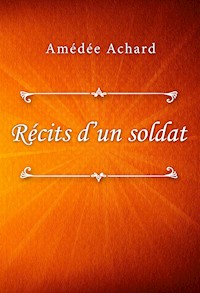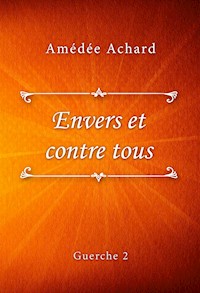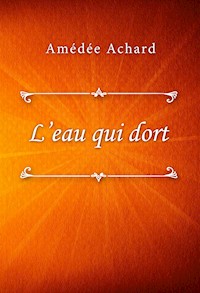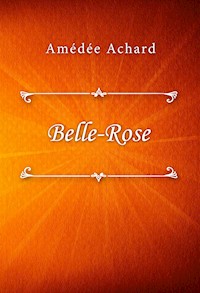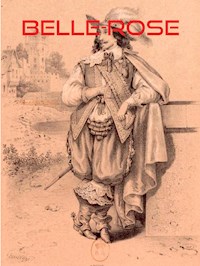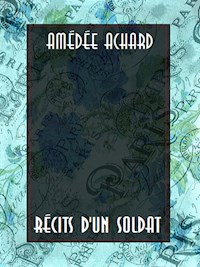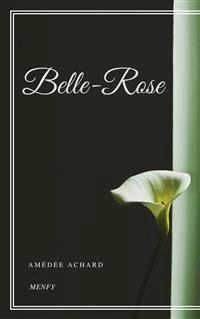Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "On voyait en 184... à Paris, dans la rue Miromesnil, un vieil hôtel que de récentes constructions ont fait disparaître, et qui, depuis plus de vingt ans, semblait menacer ruine ; mais tel qu'il était, solidement bâti en fortes pierres de taille noircies par les pluies de cent hivers, il aurait bravé les efforts du temps, si un matin la spéculation ne l'avait jeté par terre. Cet hôtel, élevé jadis par un président à mortier du Parlement, se composait alors d'un..."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
● Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
● Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 331
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
On voyait en 184… à Paris, dans la rue Miromesnil, un vieil hôtel que de récentes constructions ont fait disparaître, et qui, depuis plus de vingt ans, semblait menacer ruine ; mais tel qu’il était, solidement bâti en fortes pierres de taille noircies par les pluies de cent hivers, il aurait bravé les efforts du temps, si un matin la spéculation ne l’avait jeté par terre. Cet hôtel, élevé jadis par un président à mortier du Parlement, se composait alors d’un grand bâtiment à toits mansardés, précédé en retour de deux ailes moins hautes, dont le rez-de-chaussée, disposé pour les écuries et les remises, encadrait une vaste cour où l’herbe verdissait entre les pavés. Un jardin où s’allongeaient deux allées de tilleuls taillés en forme de charmilles, entre lesquelles s’étalaient carrément quelques plates-bandes fermées par du buis, s’étendait derrière l’hôtel. Tout alentour de ce jardin monotone montait pesamment un grand mur tapissé de lierre, dont les épais rameaux étouffaient à demi une vigne énorme qui donnait encore, malgré son grand âge, quelques pampres, et çà et là en automne une douzaine de grappes de gros raisins que des bandes de moineaux se disputaient. La cour allait si bien à l’hôtel et l’hôtel au jardin, qu’ils avaient comme un air de ressemblance et de parenté. On ne concevait pas que l’un n’appartînt pas à l’autre, et tous trois ensemble, également vieux, également tristes, également solennels, se complétaient, comme la perruque, le rabat et la canne à bec-de-corbin complétaient jadis la toilette d’un magistrat. Ils avaient cette harmonie que donne le temps. Une série d’appartements hauts, larges, incommodes, magnifiquement décorés, dont rien n’avait pu éteindre les dorures, en occupait l’intérieur ; un perron de cinq marches, flanqué de vieux éteignoirs de tôle plantés dans la muraille, à droite et à gauche, conduisait de la cour au rez-de-chaussée, où d’immenses salons, disposés en enfilade, ouvraient leurs portes-fenêtres sur le jardin, qui était de plain-pied avec l’hôtel. Les chambres à coucher étaient au-dessus. On y arrivait par un large escalier de pierre à rampe de fer ouvragé, dont la cage aurait pu servir de cadre à une maison. Le bruit des pas y réveillait de longs échos qui grondaient sous les plafonds. Le propriétaire de l’hôtel avait conservé les ferrures dorées des fenêtres, les antiques portes de bois à riches moulures, les corniches, les trumeaux, les voussures, les grandes glaces coupées en deux morceaux et encadrées de superbes boiseries sculptées avec un art curieux ; mais le mobilier rappelait un peu toutes les époques et toutes les modes. À côté d’un boudoir où une marquise de la cour de Sceaux n’aurait pas dédaigné de promener ses mules, un salon offrait un spécimen des formes inventées par le directoire. On pouvait voir dans la pièce voisine les cols de cygne, les sphinx et les griffes de lion chers aux tapissiers de l’empire, et plus loin des sofas, des fauteuils, des tabourets du plus pur style Louis XVI, garnissaient un réduit qui semblait dérobé aux appartements de Trianon. Mme de Châteauroux, la princesse de Lamballe, Barras, le général Augereau et Cambacérès auraient pu se rencontrer dans ce singulier hôtel sans en être surpris. Certaines chambres présentaient plus particulièrement encore le spectacle de cette variété. L’acajou, le bois de rose, le palissandre, le citronnier s’y coudoyaient, fraternellement recouverts, ici de lampas et là d’étoffe de Perse ; des rideaux de taffetas accompagnaient des tapisseries de haute lisse. Le tout ensemble néanmoins avait grand air ; on parlait bas malgré soi en traversant ces grandes pièces, qui inspiraient le respect, et où l’on sentait la durée et la tradition.
À l’époque où commence ce récit, l’hôtel de la rue Miromesnil était occupé par M. des Tournels, un riche maître de forges, sa femme et ses deux filles, Berthe et Lucile. Depuis quelques années déjà, le maître de forges avait quitté ses vastes établissements et ses belles forêts de la Bourgogne pour se consacrer exclusivement à l’éducation de ses filles, qu’il s’entêtait à ne vouloir pas mettre dans un couvent. Il avait à cet égard des principes arrêtés, et croyait que l’excellence et le nombre des professeurs, l’émulation qui naît de l’agglomération des élèves, la règle et l’uniformité dans l’enseignement, ne sauraient remplacer ce qu’on gagne en bons exemples, en saine morale, au contact tendre et quotidien de la mère et de la famille. Madame des Tournels partageait de tous points les opinions de son mari, et on peut dire que, depuis le jour de leur naissance, Berthe et Lucile n’avaient jamais passé plus d’une heure loin des yeux de cette excellente femme. Sa vie se résumait dans ses deux enfants. On ne pouvait voir M. et madame des Tournels sans être étonné de la grande différence qui existait physiquement et moralement entre deux personnes si profondément unies par la plus étroite et la plus absolue affection. Le maître de forges, grand, vigoureux, solide, armé de bras robustes et de jambes infatigables, intrépide chasseur autrefois, avait sous un front large et puissant, des yeux noirs et fermes dont il était presque impossible de soutenir le regard. Tout dans cette physionomie ouverte et rude indiquait l’excessive énergie du caractère, servie par des organes que la maladie n’avait jamais effleurés, comme si elle eût craint de se briser dans une lutte inutile contre un homme dont les membres semblaient avoir été taillés dans le cœur d’un chêne. Au contraire, madame des Tournels, petite, mince, blonde, avec des attaches fines, un corsage grêle, la voix douce, le regard timide, quelque chose de plaintif dans l’apparence, silencieuse et comme recueillie en elle-même, disparaissait tout entière dans l’ombre de son mari. En posant un peu durement sa large main sur cette épaule délicate, on pouvait craindre qu’il n’anéantît d’un seul coup la frêle créature qu’il avait à son côté ; mais pour elle ce taureau avait des soins, une mansuétude, des prévenances, en quelque sorte des caresses de petit chien et des câlineries d’enfant qui touchaient par la constance et la douceur de leurs témoignages. Les plus vieux amis de la maison ne se rappelaient pas qu’il y eût eu par hasard un nuage entre eux. Il faut dire aussi que madame des Tournels, heureuse et reconnaissante, s’appliquait en toutes choses à plaire à son mari. Elle y avait peu de mérite, l’aimant de tout son cœur, disait-elle, et sachant aussi qu’elle était avec ses filles sa seule pensée et son unique préoccupation : peut-être même passait-elle avant Berthe et Lucile dans les affections de M. des Tournels ; mais c’était une nuance dont seule elle avait conscience, et que, par un sentiment indéfinissable, elle cherchait à ne pas voir. Elle n’aimait pas davantage à faire étalage de l’empire qu’elle avait sur son mari, et mettait autant de soins à le cacher que d’autres à montrer leur petite influence ; cependant, douée d’un sens très droit et d’un sentiment exquis du juste et de l’injuste, il lui était arrivé de s’en servir deux ou trois fois dans des circonstances où sa voix avait été obéie avec la plus entière et la plus aimable promptitude.
À ce moment de sa vie, riche, entourée de l’estime et de l’affection, non seulement des siens, mais encore de tous ceux qui l’approchaient, et comblée de tous les biens qu’elle pouvait souhaiter, madame des Tournels succombait sous le poids d’un chagrin qui la minait sourdement. Elle avait perdu un fils, son premier-né, à l’âge de vingt-six ans, au moment où il venait de recevoir ses épaulettes de capitaine. Atteint par la balle d’un Arabe, la blessure qui l’avait emporté saignait encore au cœur de la mère et tarissait les sources mêmes de la vie goutte à goutte, comme s’épuise une fontaine brûlée par les ardeurs trop longues de l’été. Ce fils était son Benjamin, l’élu de ses entrailles ; mais les révélations soudaines qu’elle avait eues de cette préférence, à la suite d’une maladie pendant laquelle l’enfant avait failli mourir, l’avaient attristée, en quelque sorte même froissée dans la partie la plus intime de son être, et la femme selon l’Évangile s’en était punie en témoignant d’abord à son fils une tendresse plus avare et en consentant ensuite à son éloignement. À la mort de Jean, elle se raidit contre son désespoir pour qu’on n’en devinât point l’effroyable profondeur ; cette douleur constante était encore accrue par cette pensée, que si elle avait moins aimé ce fils, elle ne se serait pas condamnée à lui voir embrasser une carrière qui, en le séparant d’elle, le faisait courir au-devant de mille dangers. Il ne fallait pas non plus que M. des Tournels, frappé dans son orgueil de père, ne trouvât plus sous sa main le cœur simple, bon, dévoué, dans lequel il était accoutumé à puiser ses meilleures consolations. Elle se releva donc pour le soutenir ; mais la plaie était vivante en elle, et la violence de l’effort hâta sa course vers le tombeau. Quand elle expira, il y avait déjà dix années que M. des Tournels habitait Paris, et ses deux filles étaient également en âge d’être mariées.
L’aînée, Lucile, avait près de vingt ans ; Berthe, un peu plus de dix-huit. Lucile était brune, Berthe d’un châtain clair tournant au blond avec des reflets couleur d’or près des tempes. Elles étaient grandes et sveltes l’une et l’autre ; mais c’était là le seul point de ressemblance qu’on remarquât entre elles. Leur existence à toutes deux, séparées qu’elles étaient par un petit nombre de mois, quinze ou dix-huit, avait été pareille à deux ruisseaux qui, partis du même horizon, traversent les mêmes campagnes. La même tendresse les avait abritées, et il n’était pas jusqu’alors un chagrin, une distraction, une surprise, un voyage, un plaisir, un travail, qu’elles n’eussent partagés. Entre ses deux filles, madame des Tournois avait tenu dans un juste équilibre les deux plateaux de la balance ; mais si Lucile le croyait, Berthe allait plus au fond et le savait. Elle savait aussi que la pensée de sa mère regardait au-delà dans le passé, et qu’il y avait dans un coin de son cœur une déchirure sur laquelle la cicatrice ne se ferait jamais. Un jour madame des Tournels surprit Lucile dans un coin, les yeux rouges.
La jeune fille boudait, parce que sa sœur venait de recevoir une belle montre d’or de son parrain et qu’elle en désirait une semblable. Madame des Tournels l’attira sur ses genoux :
– Tu en auras une, dit-elle, tu sais bien que je t’aime autant que Berthe.
– C’est vrai, dit Berthe avec une certaine amertume ; Jean n’est plus là.
Madame des Tournels tressaillit et devint pâle. Sa fille cadette se jeta dans ses bras.
– Ah ! reprit-elle, je donnerais tout mon sang pour qu’il pût t’embrasser encore !
La mère la serra sur son cœur :
– Cruelle enfant, ne parle plus ainsi, murmura-t-elle avec des larmes dans les yeux.
Berthe le jura et tint parole ; mais ces quelques mots avaient suffi pour que la pauvre femme comprît qu’elle n’était plus seule à posséder son secret.
Cette perspicacité profonde, qui se montrait par éclairs vifs et inattendus, n’était pas le seul trait singulier d’un caractère où tout semblait en désordre et confusément mêlé, le bien comme le mal, la passion comme l’indifférence, la résolution aussi bien que l’apathie, l’emportement ainsi que la patience. Personne n’y voyait bien clair au fond, pas plus les professeurs de Berthe que son père. La seule chose qui faisait nettement saillie était une sorte d’entêtement farouche qui la rendait tout à coup pareille à la pierre, et que rien ne pouvait vaincre, si ce n’est parfois un flot de tendresse faisant irruption tout à coup ; mais le flot ne venait pas toujours, et on ne savait jamais quelle parole, quel hasard ou quelle bagatelle en ferait jaillir la source mystérieuse. M. des Tournels, qui combattait cette tendance à l’obstination de toutes ses forces, ne la signalait point cependant sans un secret plaisir ; c’était pour lui comme le germe d’une persévérance et d’une fermeté qui, bien dirigées, et sous l’empire de certaines circonstances, pouvaient porter de beaux fruits. Ce qu’il aimait moins, c’était le perpétuel contraste qu’on remarquait dans l’humeur de Berthe : un jour gaie et le lendemain triste, paresseuse à l’excès ou plus active qu’une abeille, tapageuse et remuante comme une toupie d’Allemagne qui ronfle et court partout, et l’heure d’après immobile et rêveuse comme une nonne en contemplation ; un matin bonne, soumise et prompte à l’obéissance, prodigue, vidant ses poches et ne sachant à qui donner ; le jour suivant âpre, revêche, quinteuse, prête à fermer sa main comme son cœur. Certains accès de violence et d’emportement inexplicables duraient parfois plus d’une semaine sans que rien pût en modifier les témoignages ; elle était acerbe et malfaisante comme un fruit vert ; le regard était aigre, la parole acide. La semaine écoulée, Berthe tombait dans de longs silences et de grands accablements qui n’avaient pas moins de durée, et dont elle sortait bizarrement par des réveils soudains.
Pourquoi M. des Tournels, qui l’observait sans cesse et s’appliquait avec suite à la corriger, avait-il pour Berthe un peu de cette préférence que sa femme avait eue pour Jean ? Peut-être l’inquiétait-elle plus que sa sœur, peut-être prévoyait-il pour l’une des luttes et des épreuves, qu’il ne redoutait pas pour Lucile. Quand il voyait Berthe dans ses phases, – dans ses lunes, disait-il gaiement, – de silence et de calme, il avait coutume de menacer du doigt en riant quiconque essayait de l’en tirer par des agaceries ou des supplications.
« Ne réveillez pas l’eau qui dort ! » répétait-il.
De cette locution familière, on avait fait un surnom qui était resté à Berthe. Lorsqu’en rentrant le maître de forges demandait ce que faisait sa fille cadette, il n’était pas rare d’entendre madame des Tournels ou Lucile répondre un jour : « L’Eau-qui-dort travaille, » et le lendemain : « L’Eau-qui-dort joue. »
Avec ce caractère variable et farouche, Berthe n’aurait pas inspiré beaucoup d’affection, si par intervalles elle n’eût éprouvé des mouvements impétueux d’une tendresse chaude qui se répandait sur tous ceux qui l’entouraient avec une grâce, une abondance, une vivacité qui la rendaient irrésistible : l’inquiète, la mobile, l’impérieuse, la violente Berthe avait disparu ; c’était une aimable fille dont le cœur se fondait, et qui trouvait pour les siens, comme pour les serviteurs de la famille, des paroles et des caresses d’une douceur et d’une onction que rien n’égalait. Elle pouvait changer avec le vent, le souvenir ne s’en effaçait pas, et si plus tard elle rudoyait sa gouvernante ou sa sœur, un domestique ou un ami, on lui pardonnait quand même. Berthe avait auprès d’elle une vieille bonne qui avait été sa nourrice, qui la gâtait à plaisir, et qu’elle tourmentait de son mieux. Quelquefois, à bout de patience, la pauvre créature se mettait à pleurer :
– Dieu du ciel ! disait-elle, faut-il que vous soyez méchante pour vous faire détester ainsi !
Alors Berthe la secouait par les épaules :
– Eh ! non ! s’écriait-elle, il faut au contraire que je sois bien bonne pour que tu ne puisses pas t’empêcher de m’aimer !
– Ça, c’est vrai, répondait l’excellente femme en s’essuyant les yeux.
Lorsqu’on interrogeait Berthe sur les motifs de ces révoltes si fréquentes succédant sans transition à des heures de soumission absolue, elle avouait naïvement qu’elle n’en connaissait pas l’origine, que c’était comme un feu qui était en elle, qu’elle en sentait les bouillonnements intérieurs, et qu’il fallait que l’explosion se fît. Elle n’en pouvait que retarder le moment, et encore à grand-peine.
Les maîtres de toute espèce ne manquèrent pas à Lucile et à Berthe : elles en profitèrent également, à cette différence près que celle-ci faisait en quelques semaines le travail de plusieurs mois ; l’une avait la patience et la continuité, l’autre l’élan et le feu ; à la fin de l’année, au point de vue du résultat, leurs études se valaient. Musique, langues, dessin, histoire, géographie, elles savaient un peu de tout et suffisamment pour bien comprendre qu’elles ne savaient rien, ce qui témoignait en faveur de leur intelligence et de leur bonne foi. Cette éducation brillante qui, depuis l’âge de huit ans, leur avait fait parcourir le cercle entier des connaissances qui sont du domaine des femmes, n’empêchait pas que les deux sœurs ne fussent pliées pendant de longues heures à des travaux d’aiguille où leur mère les dirigeait. Les amis de la maison, qui connaissaient la fortune de M. des Tournels, ne comprenaient pas bien l’importance qu’il attachait à ces occupations manuelles, auxquelles Lucile et Berthe ne devaient pas manquer de renoncer aussitôt qu’elles seraient mariées ; mais le père tenait bon, estimant qu’une fille qui sait ourler prestement une douzaine de mouchoirs peut exécuter une sonate aussi brillamment que celle qui s’oublie devant un miroir ou s’endort, un journal de modes à la main. En toutes choses, il semblait conduit par cette pensée, qu’un jour les deux héritières pouvaient être privées de tout. Elles faisaient leurs lits et taillaient leurs robes. Dès leur quinzième année, madame des Tournels, guidée par les mêmes principes, les mit tour à tour à la tête de la maison. Elles comptaient avec les fournisseurs, ordonnaient la dépense, réglaient le menu des repas, et les domestiques avaient ordre de s’adresser à elles seules pour tout ce qui regardait la direction et l’économie du ménage. Chacune d’elles l’administrait pendant trois mois. On remarquait que la dépense était plus considérable pendant l’administration de Berthe. On n’épargnait pas les observations à l’enfant prodigue, qui n’y prenait pas garde ; une fois néanmoins, impatientée, elle demanda à son père si elle avait dépassé le chiffre de leurs revenus.
– Non, certes ! répondit le maître de forges.
– Alors pourquoi tant économiser ? répliqua-t-elle.
Quand on connaissait les deux sœurs, on ne comprenait pas qu’elles fussent du même sang, qu’elles eussent reçu la même éducation. L’humeur égale et sereine de Lucile ne se démentait pas une minute en six mois ; telle on la retrouvait en automne après l’avoir vue au printemps, fraîche, souriante et gaie comme une matinée d’avril. Elle était prompte, diligente et complaisante ; sa voix, sa démarche aisée et rapide, son sourire, la bienveillance aimable de son accueil, quelque chose d’expansif, tout donnait l’idée d’une personne heureuse de vivre, et ce qu’on voyait d’elle ne démentait pas cette première impression. Elle était bonne à tous et à toute heure : elle avait cet art singulier de découvrir sans effort le bon côté de toutes choses et de s’accommoder des plus désagréables ; encore n’était-ce pas de l’art chez elle, c’était la nature qui parlait et qui agissait. Son père disait de Lucile qu’elle était fille à tirer du miel d’un rameau de ciguë. La seule chose qu’un observateur intéressé à l’étudier eût reproché à cet ensemble de qualités charmantes, c’était peut-être un peu de banalité, et par ce côté-là encore elle s’écartait pleinement de sa sœur. Il ne fallait pas faire grand fond sur l’amitié que Lucile témoignait aux personnes qu’elle recevait avec le plus d’effusion. La porte fermée, elle n’y pensait peut-être plus beaucoup : les gens partis, elle les oubliait. Ce n’est pas qu’elle ne fût pas tout à fait sincère dans l’expression de ses sentiments ; mais les impressions qui la dominaient étaient fugitives, et laissaient si peu de traces dans son cœur et son esprit, qu’il lui fallait un grand effort de mémoire pour qu’elle parvînt, après une absence d’un an ou deux, à se souvenir de ceux qu’elle avait aimés le plus. Tout glissait sur cette rieuse et belle fille, comme la pluie sur la fleur blanche et veloutée d’un lis. Un vieux chimiste qui allait en visite chez le maître de forges disait de Lucile, en langage scientifique, qu’elle était réfractaire au malheur. Le fait est qu’on ne l’avait jamais vue pleurer plus de cinq minutes ; au plus fort de ses chagrins d’enfant, elle se frottait tout à coup les yeux et partait en courant, laissant après elle le frais retentissement d’un éclat de rire plus vif et plus joyeux que le chant du pinson.
Le seul être pour lequel elle éprouvât une tendresse entière et constante était Berthe. Berthe pouvait la tourmenter, Lucile le trouvait bon. Il ne fallait même pas qu’on s’avisât de prendre sa défense ; Lucile alors se cabrait d’importance, renouvelant au profit de sa sœur, et sans le savoir, la fameuse scène de Martine et du voisin. Berthe, il est vrai, l’adorait, et, tout en ne lui épargnant ni les rebuffades ni les caprices, ne souffrait pas qu’une autre qu’elle la molestât ; mais, plus exclusive et concentrée en elle-même, quelquefois Berthe abandonnait sans motif apparent les jeux où Lucile s’égarait avec ses petites compagnes, et se retirait dans un coin sombre du jardin. Si Lucile, étonnée, tentait de l’y suivre au bout d’un quart d’heure et de l’interroger, Berthe la repoussait durement :
« Que t’importe de jouer avec moi, si tu peux t’amuser sans moi ? » disait-elle.
Bien que l’éducation des deux sœurs eût été de tous points pareille, dirigée par les mêmes professeurs, elles étaient loin de pouvoir lire les mêmes livres et d’en tirer les mêmes fruits. Certaines lectures, qui n’avaient produit sur l’esprit de Lucile qu’une impression fugitive de tristesse, évaporée un soir en quelques larmes, avaient laissé dans celui de Berthe des traces qu’on reconnaissait encore après de longs intervalles. C’était comme le soc de la charrue dans une terre forte : le sillon restait creux. Elle se passionnait pour les évènements de l’histoire aussi bien que pour les personnages de la fiction. Que de pleurs lui coûtèrent les infortunes et la mort romanesques d’Edgard de Ravenswood ! que de frémissements de colère et d’insomnie lui causèrent les malheurs augustes et le trépas épique de Marie-Antoinette ! Elle avait le cœur gros et le sang en feu. Rien ne glissait, tout pénétrait. Il fallut, après des nuits de fièvre, que madame des Tournels fît un choix sévère parmi les livres que Berthe fut autorisée à ouvrir. Lucile, étonnée de ces grands ressentiments, se moquait d’elle à tout propos :
« – Mais ne pleure donc plus et ne te fâche pas, disait-elle : ils sont morts !
– Oui, mais ils ont vécu ! » répondait Berthe.
Que rêvait-elle dans ces moments d’excitations ? quels trésors de tendresse, de courage, d’énergie, ne dépensait-elle pas au milieu de ce trouble et de cette angoisse inexprimables ? Elle les enfouissait en tremblant dans les replis les plus cachés de son cœur.
L’hôtel de la rue Miromesnil, qui était ouvert à beaucoup de monde dès les premiers temps qui suivirent l’arrivée de M. des Tournels à Paris, le fut bien davantage encore après que Lucile et Berthe eurent dépassé l’adolescence. M. des Tournels aimait à recevoir ; il avait un grand train de maison. Quelques personnes bien choisies dînaient fréquemment chez lui ; on y dansait trois ou quatre fois pendant l’hiver. Ses filles, dès qu’elles eurent seize ans, l’accompagnèrent une fois par semaine aux Italiens et à l’Opéra, quelquefois dans d’autres théâtres. Appelées par leur fortune à vivre dans le monde le plus brillant, il voulait qu’elles apprissent de bonne heure à le connaître, pour n’en n’être pas éblouies plus tard. Toutes les libertés compatibles avec les exigences des mœurs parisiennes, il les leur permit, afin, disait-il, de les plier tout doucement aux habitudes de la réflexion et aux enseignements de l’expérience. Par ce côté, leur éducation eut une physionomie anglaise qui donna au caractère des deux sœurs plus de relief et de contour ; mais tandis que Lucile apportait dans cette vie facile, bien que réglée, un entrain et une gaieté qui ne laissaient pas de doute sur le plaisir qu’elle éprouvait à en savourer les douceurs, on ne savait pas si Berthe s’y plaisait ou s’y soumettait. Il lui arrivait souvent de ne pas quitter la danse pendant toute une nuit, et souvent aussi de traverser un bal avec la pâleur d’Iphigénie sur le front. Aux heures où il y avait le plus de monde à l’hôtel ; et quand la conversation était le plus animée, il n’était pas rare de la surprendre au fond du jardin, assise sur un banc, les mains croisées sur les genoux et les yeux dans l’espace. La veille, personne n’avait causé avec plus d’abandon et de vivacité. Chose singulière ! cette jeune fille, dont le caractère était si souvent en lutte avec celui de M. des Tournels, pour qui elle était un sujet d’examen et une cause de trouble, était précisément celle qu’on chargeait des demandes épineuses et des négociations difficiles. Lorsqu’un subalterne avait une faute à se faire pardonner ou une permission à obtenir, quand Lucile elle-même était sous le coup d’une fantaisie qui ne lui semblait pas tout à fait raisonnable, on envoyait Berthe en ambassade auprès du maître de forges, et jamais Berthe n’hésitait. Si d’aventure M. des Tournels grondait un peu, Berthe insistait hardiment, et il cédait, tandis que Lucile se mourait de peur derrière la porte. Cette même personne, qui bravait en face un homme devant qui tout tremblait, devenait livide pour chanter une romance au piano devant dix imbéciles ; mais sur ce chapitre le maître de forges avait une volonté bien arrêtée : il fallait chanter, dût-on pleurer avant et s’évanouir après, et la raison était qu’il fallait faire simplement les choses simples. La timidité n’était pas un motif de s’abstenir ; excessive, elle avait un faux air de pruderie et de prétention dont il était bon de se corriger.
On était quelquefois surpris de la trace profonde qu’avaient laissée dans cet esprit libre et violent des évènements d’une importance médiocre en apparence, et sur lesquels de nombreuses années s’étaient accumulées lentement. Alors que Lucile, six semaines après, avait complètement oublié les choses qui l’avaient le plus charmée ou le plus attristée, on voyait Berthe tressaillir encore à de longues distances au souvenir de certains faits que sa mémoire implacable lui rappelait tout à coup ; la cicatrice faite, le ressentiment de la blessure était le même. Berthe donnait chaque année, le 17 octobre, un exemple frappant de cette malheureuse fidélité. On la voyait dès le matin inquiète, agitée ; rien ne la distrayait plus ; elle évitait toute conversation, fuyait tout travail ; certaines lueurs fauves que sa mère connaissait bien passaient dans ses yeux ; elle se retirait à l’écart, au fond du jardin, sous un vieil ormeau, à l’ombre duquel elle négligeait d’ouvrir le livre qu’elle emportait. Cet état durait jusqu’au soir : les paroles tombaient une à une de sa bouche ; le sourire était contraint, le son de sa voix sec et bref, le geste anguleux et dur. Irascible et intraitable, elle semblait couver des orages dans son silence. Un jour qu’il était question d’une soirée à passer au théâtre, elle secoua la tête. Madame des Tournels lui demanda si elle se sentait indisposée.
– Non, répondit Berthe ; mais je le serai certainement avant une heure si on veut me contraindre à sortir.
– Tu as donc la maladie et la santé à tes ordres ? répliqua sa mère gaiement.
Berthe prit sur la table une paire de ciseaux.
– Croyez-vous donc, dit-elle, qu’il soit très difficile de me déchirer le bras avec ce bout de fer ? On dira que c’est un accident, et je resterai.
Madame des Tournels effrayée lui arracha les ciseaux des mains.
– Es-tu folle ? reprit-elle.
Berthe posa froidement son ongle sur la page d’un journal en tête de laquelle on lisait la date du 17 octobre. Madame des Tournels tressaillit, et sans répondre appuya doucement la main sur l’épaule de Berthe ; ses yeux étaient devenus tout humides. Berthe émue s’agenouilla auprès d’elle ; la mère l’entoura de ses bras.
– Encore ? murmurait-elle à demi-voix.
– Toujours, malgré moi ! répondit Berthe tout bas.
Quelques mots sont nécessaires pour expliquer l’influence prolongée de cette date. Un jour, à l’âge de douze ans et à propos d’un travail que son père lui avait imposé, Berthe se montra si revêche, si acerbe, si cassante, que M. des Tournées, pris tout à coup d’un mouvement de colère irrésistible, leva la main et la frappa au visage. Berthe poussa un cri et tomba par terre inanimée. Son visage était vert. Quand elle se réveilla d’un long anéantissement et brisée par la violence de spasmes convulsifs, son premier regard rencontra son père debout au pied du lit, tout pâle et décomposé. Elle lui tendit les deux bras. M. des Tournels l’embrassa en pleurant, et sortit pour qu’on ne le vît pas éclater en sanglots. Berthe le suivit des yeux. Aussitôt que la porte se fut refermée :
« Ah ! dit-elle en se retournant vers sa mère, qui la soutenait sur l’oreiller, quel bonheur que j’aie eu tort ! Sans cela, jamais je ne lui aurais pardonné. »
Madame des Tournels ne vit pas plus de cinq ou six fois le retour de cette date terrible. Peu de jours avant d’expirer, elle avait fait approcher Lucile de son lit, et lui montrant Berthe debout contre la fenêtre :
– Prends garde à l’Eau-qui-dort, dit-elle ; il y a quelque chose en elle qui se dégagera,… je ne sais quoi ;… aime-la bien !
Cette recommandation, où l’accent de l’inquiétude se mêlait à la prière, fut la dernière parole qu’elle échangea avec Lucile. Elle ne pensa plus qu’à Berthe, que ses regards incertains suivaient partout. Que deviendrait-elle quand elle ne serait plus là ? Vers quelle destinée la pousserait ce caractère indéfinissable dont il était impossible de rien augurer ? Le mal extrême ne pourrait-il pas en sortir comme le bien ? Quel problème s’agitait dans cette âme fermée qui s’ignorait ? La pauvre mère se reprochait quelquefois cette constante préoccupation qui donnait tout à l’une au détriment de l’autre ; alors elle prenait la main de Lucile :
– Ne m’en veuille pas, disait-elle, tu ne me fais pas peur, toi !
Lucile, qui fondait en larmes, embrassait Berthe qui ne pleurait pas, mais qui étouffait. Un soir madame des Tournels, qui n’avait pas quitté sa fille cadette des yeux depuis plusieurs heures, laissa voir sur son visage une expression de joie dont le rayonnement l’illumina tout à coup. Elle fit de la main signe à Berthe de s’approcher :
– Écoute bien, dit-elle, je te recommande ton père ;… il va se trouver seul… Lucile l’aime de tout son cœur ;… mais l’heure présente est tout pour elle, et puis ta sœur est l’aînée, elle se mariera bientôt… Si tu fais comme elle plus tard, ne le quitte jamais :… Remplace-moi. – Elle tenait les deux mains de Berthe entre les siennes. – Me comprends-tu bien ? reprit-elle, ce sera difficile dans les commencements, mais si tu sens quelque fatigue, pense à moi, et petit à petit ton caractère se pliera à le rendre heureux ; me le promets-tu ?
Berthe baisa la main de madame des Tournels.
– Va, mon enfant, à présent je suis plus tranquille, reprit la mère.
La pauvre femme était plus tranquille en effet : elle venait d’imposer le frein du sacrifice à ce caractère indomptable ; ce don de seconde vue, qui illumine parfois l’esprit des mourants, lui avait fait comprendre que l’accomplissement et les fatigues d’un devoir étaient les seules barrières capables de maintenir Berthe dans la règle et la soumission. Il fallait qu’elle usât ses forces dans la poursuite d’un but, et lui montrer le plus difficile, en intéressant son cœur au résultat, pour qu’elle y trouvât l’ancre de salut.
Le lendemain madame des Tournels partagea ses bijoux également entre ses deux filles, et mourut sans bruit, simplement, comme elle avait vécu.
L’hôtel de la rue Miromesnil resta fermé pendant dix-huit mois. M. des Tournels y vécut profondément retiré, loin du monde, n’admettant entre ses filles et lui qu’un très petit nombre d’amis qui respectaient sa douleur. Elle était immense. Dès ce jour, il adopta un vêtement de deuil qu’il ne quitta plus. Aucun des objets qui avaient servi à madame des Tournels ne fut changé de place ; tout dans l’appartement où il continua de vivre demeura dans l’état où elle l’avait laissé. Il s’imprégnait de son souvenir, il respirait dans son air. Dès lors on vit combien avait été vif et profond cet éclair de divination qui avait entraîné la mourante à soumettre sa fille à la discipline du dévouement. Le chagrin sans bornes de M. des Tournels en fut adouci ; mais la plus grande somme de bien profita à Berthe elle-même. Dans la pratique quotidienne de cette tâche qu’elle avait acceptée, elle éprouva une sorte d’apaisement intérieur qui l’étonna d’abord. Ce n’est pas qu’elle n’eût très souvent encore des révoltes et comme des réveils terribles de cet esprit rebelle qui grondait et s’agitait au fond de son être ; mais elle en était plus maîtresse et le domptait avec des efforts moins vifs et moins douloureux. Elle avait promis de se consacrer à cette œuvre de salut, elle s’y acharnait et les plus dures aspérités de son caractère s’effaçaient lentement, une à une, sous le travail persévérant de sa volonté, comme les nœuds d’une planche de chêne sous le passage actif du rabot. Elle ne devinait pas encore ce doux mensonge de madame des Tournels, cette ruse pieuse qui lui montrait un père à consoler alors qu’il s’agissait d’une fille à sauver. Plus clairvoyante, Berthe eût été moins prompte à s’observer ; elle eût plus facilement lâché la bride à la fougue et à l’intempérance de ses instincts.
Cependant, si large que fût le changement qu’on remarquait en elle, il n’était pas tel encore que l’Eau-qui-dort eût mérité de perdre son surnom. Que d’heures passées sous l’ombre du vieil ormeau, seule avec elle-même et les agitations qu’elle ne voulait plus subir, et qui la tourmentaient par moments ! Elle combattait les emportements de son caractère, par le silence, et voulait le dominer par la concentration. Elle avait alors conscience de son indiscipline, et ne concevait pas bien qu’on en eût toléré si longtemps les violences. Ce qui était excusable à douze ou quinze ans, dans toute l’ardeur bouillante d’un sang qui coulait comme une eau vive, et dans lequel son père se reconnaissait tout entier, devenait impossible à dix-huit. Elle était résolue à se vaincre elle-même. Le bonheur d’un père ne lui avait-il pas été confié, et faillir à cette tâche n’était-ce pas le fait d’un cœur lâche et d’un esprit timide ? L’honneur, la tendresse filiale, le respect d’elle-même, tout lui faisait un devoir sacré de tenir sa promesse. À cette époque de sa vie, on la voyait errer au milieu des grandes pièces de l’hôtel et passer des salons déserts au jardin solitaire, fuyant sa sœur, silencieuse comme une ombre qui cherche les lieux où elle a vécu et souffert.
« Étrange fille ! » disait le père. « Pauvre âme ! » avait dit la mère.
Et l’Eau-qui-dort, perdue dans de longues méditations et de cruels efforts, demandait parfois à Lucile le secret de sa tranquillité.
« Que tu es heureuse ! disait-elle alors, tu descends le fleuve… Quelque chose me pousse toujours à le remonter ! »
Un jour, après une de ces crises qui devenaient de plus en plus rares, et dont Berthe sortait par un de ces mouvements soudains qu’elle ne prévoyait pas plus qu’elle n’y échappait, M. des Tournels, fasciné en quelque sorte par la chaleur et l’impétuosité franche de son élan, la prit dans ses bras, et, saisissant la tête de sa fille à deux mains :
– Ah ! si jamais quelqu’un t’aime, dit-il, ce quelqu’un t’aimera bien !
– Je l’espère, répondit Berthe.
Quelque temps avant la mort de madame des Tournels, bon nombre de personnes, grands-parents ou amis officieux, s’étaient présentés à l’hôtel de la rue Miromesnil dans des intentions faciles à deviner. Le maître de forges, qui ne voulait pas marier ses filles avant leur vingtième année, avait écarté toutes les demandes. Quand il eut rouvert ses salons, on y vit reparaître en foule toutes les mères qui avaient des fils à pourvoir et l’escadron volant des chercheurs de belles dots. L’heure était venue de faire un choix ; mais sans abdiquer, tant s’en faut, l’autorité d’un père, M. des Tournels voulut que ses filles eussent toute liberté d’apprécier les mérites des candidats qui leur venaient des quatre coins de Paris. Après les bals où il les avait conduites, volontiers, il mettait l’entretien sur le chapitre des jeunes gens qui avaient dansé avec Lucile après avoir dansé avec Berthe. On les passait au laminoir de la critique, la réflexion de l’une venait en aide à l’observation de l’autre, et, l’entretien fini, le plus souvent il ne restait plus rien des beaux messieurs qui aspiraient au mariage par le chemin de la valse et de la polka. On avait saisi les papillons par les ailes, et leurs riches couleurs avaient disparu.
Un nom cependant n’avait jamais été prononcé dans ces confidences familières, auxquelles Berthe ne se mêlait pas sans une certaine contrainte, et où elle apportait plus d’amertume et plus d’ironie que sa sœur. C’était celui de Francis d’Auberive, qu’un ami de province avait présenté à M. des Tournels, Francis était un jeune homme de Dijon qui avait quelques terres dans le voisinage des forges si longtemps exploitées par M. des Tournels, et qui habitait Paris les trois quarts de l’année. La connaissance faite, on avait chassé de compagnie dans les mêmes bois, et une certaine intimité avait été le résultat des relations continuées dans le laisser-aller de la campagne. Avec ses trente ans et quelque aisance, Francis se comportait alors comme un reître en pays conquis. Chaque nouvel an devait amener la réforme, mais les années s’écoulaient et la fortune s’en allait à la dérive. Ce qui lui en restait était placé dans une entreprise de charbonnage au fond de laquelle on ne voyait pas bien clair. On assurait en outre que le peu de terres qu’il possédait encore était grevé d’hypothèques nombreuses. Le meilleur de son avoir était alors représenté par une tante, qui l’aimait beaucoup et qui passait pour fort riche ; mais la bonne dame, qui vivait retirée au fond de sa petite ville, était fort sujette à des lubies. Tout son bien pouvait s’engloutir dans les fondations pieuses ou être partagé entre vingt collatéraux qui l’assiégeaient. Francis n’était pas un méchant garçon et ne manquait pas d’esprit ; néanmoins on aurait vainement battu la province avant de trouver un notaire qui l’eût accepté pour gendre. Ses bonnes qualités sautaient aux yeux de tout le monde ; par malheur, un ménage ne vit pas seulement de gaieté, de franchise, de courage et de facile humeur. À trente ans, Francis regrettait la vie décousue qu’il avait menée ; mais il continuait par habitude et désœuvrement. Il s’estimait trop vieux pour en changer. Personne ne savait comment il finirait.