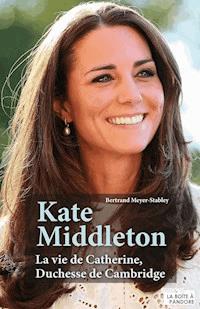Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: La Boîte à Pandore
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Du statut de petit actrice à celui de femme la plus importante d'Argentine.
Petite actrice à ses débuts, Eva Duarte va rapidement devenir la femme la plus importante d’Argentine, aux côtés de Juan Perón, idole de millions d’Argentins. À 33 ans, frappée par un cancer, elle disparaît en pleine gloire. Les ouvriers argentins renoncent à une journée de salaire pour lui élever un mausolée de bronze et de marbre. Soixante-cinq ans après sa mort, il est temps de cerner qui fut vraiment Eva Duarte Perón et quelles raisons l’ont poussée à tout faire pour réussir, en moins de dix ans, le prodige de se hisser à la tête d’un des pays les plus phallocrates de la terre. Son charisme et son rayonnement ont fait d’elle un être de légende et sa fin tragique l’a projetée dans la mythologie des héros fondateurs de «l’identité argentine ».
Pourtant, nombreuses sont les zones d’ombre de sa vie sur lesquelles ce livre, pour la première fois, lève le voile. Eva Perón, c’est l’histoire d’un mythe et d’une revanche. C’est l’histoire d’une petite fille illégitime d’émigrés espagnols, c’est la vie d’Eva Duarte. Peu de femmes ont été aussi frénétiquement adulées, aussi farouchement honnies.
A travers cet ouvrage, comprenez comment Eva Duarte a réussi l'exploit de se hisser à la tête d'un des pays les plus phallocrate de la terre.
EXTRAIT
Quant aux cités ouvrières, inaugurées en grande pompe sur le pourtour de la capitale, elles sont, selon eux, réservées non pas aux travailleurs, mais aux péronistes favoris qui ne sont pas forcément pauvres. Pis encore, à leurs yeux, les écoles et les hôpitaux une fois bâtis et inaugurés sont souvent sans ressource et doivent être parfois abandonnés. Ce qui n’est pas vrai ! Sous la pression constante d’Eva, sa fondation construit des « foyers-écoles » à Buenos Aires, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Salta, Comodoro Rivadavia, Corrientes, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, La Pampa, Entre Rios et Santiago del Estero. Dans le même temps, débute un vaste programme de construction d’écoles rurales à San Luis, Cordoba, La Pampa, Santa Fe, Chaco, Santiago del Estero et Entre Rios. L’ambition d’Eva est d’édifier des écoles-modèle qui, rompant avec les vieilles habitudes pédagogiques, montrent aux Argentins ce que peuvent être les écoles rurales. « Le sens profond de la fondation, dit-elle, c’est de réparer les injustices… Je crois que pour effacer dans l’âme des enfants, des vieillards et des humbles la trace d’un siècle d’humiliations imposées par une oligarchie froide et sordide, il faut leur donner de l’art, du marbre et du luxe ; c’est-à-dire, en quelque sorte, passer d’un extrême à l’autre, mais cette fois au bénéfice du peuple et des humbles… Il faut que les enfants de l’oligarchie, même s’ils vont dans les meilleurs collèges et les plus chers, ne soient pas mieux traités que les enfants de nos ouvriers dans les « foyers-écoles « de la fondation ». Les petites écoles construites par la fondation sont des modèles du genre : vastes, bien conçues, avec de grandes baies, des salles à manger pour les repas des enfants, des terrains de jeu, des arbres et des fleurs.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
© La Boîte à Pandore
Paris
http ://www.laboiteapandore.fr
La Boîte à Pandore est sur Facebook. Venez dialoguer avec nos auteurs, visionner leurs vidéos et partager vos impressions de lecture.
ISBN : 978-2-39009-292-6 – EAN : 9782390092926
Toute reproduction ou adaptation d’un extrait quelconque de ce livre par quelque procédé que ce soit, et notamment par photocopie ou microfilm, est interdite sans autorisation écrite de l’éditeur.
bertrand meyer-stabley
eva PerÓn
L’ Argentine adulée et décriée
« L’important, c’est l’image qu’on suscite chez les autres »
Jorge Luis Borges
PROLOGUE : Fin de règne
Buenos Aires, juillet 1952. D’Avellaneda à Belgrano, une ceinture de cheminées entoure la métropole et leurs fumées noires s’inscrivent dans le ciel comme de sombres présages. La capitale, comme toute l’Argentine, vit dans l’angoisse. Car, il n’y a plus aucun doute à avoir : Eva se meurt. Au fond de son palais doré, dans une chambre interdite, la toute-puissante souveraine d’une grande nation n’est plus qu’un corps diaphane qui se bat contre la Mort. Tout un peuple suit le combat singulier de celle qui, pour la première fois dans l’histoire d’un pays, entre dans la légende avec un diminutif.
Evita se meurt et personne ne sait avec certitude quel mal la ronge. Sa leucémie reste un sujet tabou. Jusqu’ici elle a pu sauver les apparences. Elle a démenti ceux qui annonçaient que son état avait empiré ; elle est apparue dans un suprême effort à un conseil des ministres ; elle est venue saluer à une fenêtre, avec une peau devenue cireuse et, sur le visage, ce sourire qui n’en est plus un. On peut tromper l’Argentine, on ne trompe pas la Mort. Dès le 9 juillet, personne n’en doute plus. Quand Buenos Aires retrouve son calme après avoir célébré le jour de sa fête nationale, quand ont résonné les dernières marches militaires, éclaté les derniers pétards qui disent que l’Argentine est indépendante depuis cent trente-six ans, le mensonge n’est plus possible : le général Perón, droit dans son uniforme de campagne, doit présider seul l’immense revue militaire de 100 000 réservistes. Pas d’Eva à ses côtés.
Le soir, c’est la première bombe : la radio d’État annonce : « La santé de l’épouse du Président n’est pas satisfaisante ». Dès lors, des milliers d’hommes et de femmes commencent à chercher dans leurs journaux la petite phrase laconique qui définit en deux ou trois mots, l’état de santé de la Première dame d’Argentine. C’est le commencement des inquiétudes, des commentaires, des prévisions. Le soir, la radio ne mentionne pas comme chaque jour les activités officielles du président, ce qui signifie qu’il a décommandé plusieurs rendez-vous pour rester au chevet de sa femme.
Alors, c’est le silence. Un silence que l’opinion remplit de questions, et d’abord : « Qui soigne Evita ? » Ses médecins sont aussi secrets que sa maladie. On devine bientôt qu’il y a le docteur Finochietto, qui l’opéra en novembre : il a remis toutes ses consultations. Il y a aussi le docteur Ivanissevitch, ancien ministre de l’Éducation nationale. Il opéra Eva, deux ans auparavant, de l’appendicite. Des médecins suisses arrivent clandestinement à Buenos Aires. Parmi eux, le professeur Hans Schinz, de Zürich.
Les grilles se ferment devant le jardin de la résidence d’Eva. C’est une immense villa au cœur d’un parc presque désert. On n’y entend que les faucilles des jardiniers qui, à gestes mesurés, coupent les branches de bois mort. Quelques intimes parviennent à entrer et parmi eux le ministre des Communications, Nicolini, et le secrétaire de l’Information, Scold. Ils ne disent mot. Personne ne dit rien sur la maladie d’Evita. C’est plus qu’une indiscrétion d’en parler : un véritable crime de lèse-majesté.
Le lendemain, un dimanche, des centaines de messes sont célébrées pour la santé de la malade. Toute la machinerie de la commisération officielle va se déclencher ; les diplomates eux-mêmes s’inquiètent. L’ambassadeur de France décide de supprimer les festivités. Toutes les délégations étrangères suivent le mouvement. La ville se tait, silencieuse, comme une rue le long d’un hôpital.
Bien qu’un communiqué dit : « État stationnaire », personne ne doute plus qu’il y ait une aggravation. Le Conseil des ministres qui se réunit tous les mercredis n’a pas lieu le 16 juillet. Depuis le 14 au matin, le général Perón n’a pas réapparu à son bureau de la Casa Rosada. Il est assis au chevet d’Eva. Cette fois le destin les a rapprochés, plus réellement qu’ils ne l’étaient sur toutes les photos officielles avec leur sourire de commande et leur bonheur conjugal déployé comme un étendard. Dans la chambre blanche où l’on entend le glissement des chaussures feutrées des infirmières, ils se retrouvent tels qu’au premier jour. Elle n’était alors qu’une jeune femme un peu aigrie d’avoir été refusée par la haute société de son pays et lui, un officier ambitieux. Quand la porte se referme sur eux, ils cessent d’être les héros légendaires dont se nourrit l’Argentine, le couple sacré de l’Amérique du Sud. « Perón comble, Evita dignifica » (Perón réalise, Evita idéalise), disent sur tous les murs des affiches de propagande. Elle est blonde et rose, lui est épanoui. Maintenant, son visage s’est émacié, elle est immobile, la tête sur l’oreiller. Lui, grave, sait qu’elle vit ses dernières semaines.
Mais les jours passent et aucun événement ne se produit. « Evita se meurt », répète tout un pays sans pouvoir ne rien faire d’autre qu’ériger des monuments en son honneur ou lui attribuer des décorations. Le 18 juillet pourtant un communiqué avoue : « La santé d’Eva Perón décline sensiblement ». La nouvelle parcourt la ville comme une traînée de poudre. Des groupes se forment qui stationnent devant sa résidence. On voit sortir des estafettes motocyclistes qui foncent vers des destinations inconnues. Cette fois, le trafic automobile est complètement interrompu. Le soir venu on apprend que la fin est proche. Affolement dans les journaux et à la radio. Mais c’est une fausse nouvelle. Eva a été placée sous une tente à oxygène. Elle a réagi. Elle a même pu dire quelques mots à son mari et à sa mère qui sont près d’elle depuis plusieurs jours.
La C.G.T. prépare dès le lendemain une messe grandiose qui doit se dérouler au pied de l’immense obélisque dominant l’avenue du 9-Juillet, au cœur de Buenos Aires. Le dimanche 20, dès l’aube, de nombreuses délégations arrivent par camions. Les infirmières de la Fondation Eva Perón, l’œuvre maîtresse de la malade, s’installent à droite et à gauche. Leurs uniformes font une tache bleue à travers la grisaille de la pluie. L’aumônier qui prend la parole fait l’éloge d’Eva Perón, « premier martyr de l’ère justicialiste ».
Le père Benitez, confesseur d’Eva, conclut par ces paroles de l’Évangile : « Tout ce que vous avez fait pour les pauvres et les nécessiteux, vous l’avez fait pour moi-même ». Mais même la mort n’arrête pas la vie d’un État. Le général Perón, les traits tirés, réapparaît à son bureau le lundi 21. Dans la ville aussi la vie continue, avec un bémol cependant : on ne joue plus certaines pièces légères. La Comédie-Française, en tournée à Buenos Aires, choisit de mettre à l’affiche La Reine Morte, comme un hommage ironique. Le mardi 22, une cérémonie intime se déroule dans la chambre d’Eva. Le général Perón remet à sa femme le grand collier de l’ordre du Libérateur Sand Martin. C’est un chef-d’œuvre de joaillerie. Il se compose de 763 brillants et de 3 821 éléments d’or et de platine. Le dernier trésor qu’Eva va ajouter à sa collection.
Dans le pays, on dresse partout des monuments en l’honneur d’Eva. Malgré la pluie, des femmes se pressent par centaines devant les grilles de son palais clos. Elles attendent passivement. Quelques voitures glissent silencieusement sur l’avenue proche. Sur les lampadaires, des panneaux demandent aux conducteurs de ne pas klaxonner.
Le vendredi 25 juillet, la mourante reçoit son confesseur et, devant le chagrin du prélat, murmure : « Il n’y a pas de quoi pleurer. Je suis immensément heureuse. Dieu m’a donné, à moi pauvre fille, tout ce qu’on peut donner dans ce monde ».
Le samedi 26 juillet au matin, elle réunit sa mère, son frère et ses sœurs autour de son lit et leur dit, telle la Traviata : « Aidez-moi à prier, si je passe cette semaine, alors je sais que je serai sauvée ». Mais secouant la tête, dans un ultime éclair de lucidité, elle laisse tomber : « Mais à quoi bon ? » « La flaca si va. » (« La maigrichonne s’en va. »)
À 17 heures, Eva Perón sombre dans le coma. Son cardiologue lui prend régulièrement le pouls. À 19 h 40, Eva rend son dernier soupir en présence de sa mère, son frère, ses sœurs et Perón. Le ministre de l’Information décide d’attendre que l’on ait préparé le corps avant d’annoncer la tragique nouvelle. Le 26 juillet 1952 à 20 h 52, les radios du pays annoncent la mort d’Eva.
La vie s’arrête en Argentine, et comme pour mieux marquer l’instant dramatique, on bloque les horloges du pays sur 20 h 25. Les cloches sonnent le glas. Un lourd rideau de pluie s’abat sur Buenos Aires. Tandis que la radio diffuse de la musique religieuse, Perón décide la suspension de toutes les activités officielles pendant quarante-huit heures et un deuil officiel de trente jours…
Partout, dans les restaurants, théâtres et boîtes à tango, tout s’interrompt. Dans les ranchos, des cierges sont allumés. Une partie des Argentins semble hébétée, d’autres pleurent nerveusement.
Mais qui pleurent-ils ? « La chef spirituelle de la nation, martyre du travail, protectrice des abandonnés, défenseur des prolétaires », comme la propagande péroniste la définit ? La jeune Argentine pauvre, la bâtisseuse, avide d’une société nouvelle, la combattante que seul le cancer a réussi à abattre ? Ou l’actrice ratée qui a trouvé son plus beau rôle en se forgeant un mythe dans un pays en quête d’identité ?
CHAPITRE 1 : Misère et revanche
Eva Maria Duarte naît le 7 mai 1919 à cinq heures du matin à Los Toldos, un petit pueblo de la province de Buenos Aires, situé à plus de deux cents kilomètres à l’ouest de la capitale. C’est une sage-femme indienne qui aide la mère à accoucher. Deux jours plus tard, Juana Ibarguren déclare la naissance de sa fille à la mairie devant deux témoins : José Lozano, un employé au mont-de-piété et le gaucho Juan Cabo.
Un siècle plus tôt, les Indiens Manqueles et Mapuches plantaient leurs tolderias (tentes) sur ces plaines vierges d’Argentine. Mais vers 1870, les crises agricoles que connaît l’Europe du Sud poussent vers l’immigration Espagnols, Italiens, Portugais et Français. De 1870 à 1914, l’Argentine accueille quatre millions d’immigrants qui se répandent à travers la grande prairie de la Pampa ou à Buenos Aires, faisant de la ville la plus grande capitale de l’Amérique du Sud.
Parmi eux, un charretier basque espagnol, Joaquin Ibarguren qui tombe amoureux de Petrona Nuñez, une marchande ambulante. Deux filles naissent de leur amour : Juana (la mère d’Eva) en 1894 et Liberata en 1895. La famille s’installe sur un terrain chaotique où se dressent les dernières constructions de Buenos Aires, des baraques de terre battue, des antres de tôle, à l’intérieur desquels pullulent des tribus qui hésitent entre ville et nature. Mais le travail est rare à Buenos Aires et la famille échoue finalement à Los Toldos, un de ces pueblos à l’aspect désolé.
Dans ces villages de la plaine argentine, la poussière est partout. Elle s’infiltre dans les petites maisons et brunit leur façade de plâtre rose ou jaune. Elle stagne dans l’air chaud avant de retomber lentement sur le sol et, au moment des orages, elle transforme la route en cloaque de boue quand les pluies déferlent à travers la pampa.
C’est dans ce décor rythmé par les pales métalliques de l’éolienne qui grincent au vent, par le bourdonnement permanent des mouches et par le passage des véhicules semblables à des catafalques que les riches prennent à la gare pour se faire conduire à leur estancia que grandit la mère d’Eva. Aujourd’hui, Los Toldos n’a guère changé. C’est la plus sinistre des bourgades de la Pampa, élevée sur l’emplacement d’un camp indien, à deux cent cinquante kilomètres à l’ouest de Buenos Aires. La ville donne une sensation de platitude, de total écrasement sous le ciel haut. De poussiéreuses maisons basses, en brique rouge ou blanche, avec une façade plate, un toit plat et de temps en temps un balcon. Le tronc des paraísos est blanchi à la chaux et la tête scrupuleusement écimée. Loin du centre, les avenues ignorent le goudron1.
Juana a 7 ans lorsque Juan Duarte, un politicien local, bien connu pour ses élections frauduleuses, mais joyeux drille, épouse à Chivilcoy Estela Grisolia, qui lui donne trois filles. En 1908, disposant de revenus, il afferme deux domaines à Los Toldos. Dans une des propriétés, « La Unión », Juana devient cuisinière à l’âge de 15 ans, en préparant le repas des gauchos. Que peut offrir à une adolescente un village comme Los Toldos ? Si elle possède une parcelle de terre, un mariage convenable ; avec un tant soit peu d’instruction, devenir institutrice ou employée des postes. Dépourvu de l’une et de l’autre, il ne lui reste qu’à se louer comme servante chez un riche propriétaire, pour garder un semblant de respectabilité.
Mais Juana Ibarguren est ambitieuse et plutôt avenante. À une époque où une fille restée vierge après 14 ans est une exception, elle devient, dès 1910, la maîtresse de son patron et la mère de ses enfants. Pour Juan Duarte, marié à Chivilcoy, ce double ménage ne se marque d’aucun sceau infamant ; c’est chose courante ! Seuls ses amis les plus rigoristes pourraient s’étonner et sa famille légitime s’indigner. Pour un homme, c’est la fidélité conjugale qui sort de l’ordinaire. Or, Juan Duarte est d’un naturel conformiste. Ses relations avec doña Juana, comme on l’appelle alors par courtoisie, vont durer plus de douze ans. Les voyages de Duarte entre Chivilcoy et Los Toldos donnent le jour à Blanca en 1910, à Elisa en 1913, à Juan Ramon en 1914, à Erminda en 1917 et enfin à Eva en 1919.
Étrangement, Juan Duarte semble conscient de ses responsabilités envers sa famille illégitime ; s’il ne vit pas avec elle, du moins lui rend-il souvent visite ; il ne désavoue pas sa paternité, car il permet à sa progéniture d’user librement de son nom et il choisit un de ses amis comme parrain d’Eva. Mais la pression de son épouse légitime finit par produire son effet. Peu après la naissance d’Eva Maria, il décide d’abandonner pour toujours sa concubine avec leurs cinq enfants.
Heureusement, Juana est courageuse. Elle loue une misérable cabane de torchis (le sol est en terre battue et elle a monté des cloisons pour délimiter les chambres et la cuisine). Elle a une vieille machine à coudre et accepte tous les travaux pour nourrir sa petite famille. Elle pédale sans relâche sur la Singer, du matin au soir, et les veines de ses jambes, ne résistant pas, éclatent, provoquant des ulcères.
Dans cette Argentine conservatrice et machiste, les enfants de Juana vivent dans la pauvreté. Leur statut de bâtards leur vaut brimades et humiliations. On refuse de les saluer, on affiche devant eux un sourire méprisant, on multiplie à souhait les vexations. Pour Juana, sa « tribu » doit faire face dignement à l’adversité. Un incident souligne d’ailleurs le cran de la petite Eva. Elle a 5 ans, lorsqu’elle se renverse par accident une poêle d’huile bouillante sur le visage. Une brûlure au second degré. Eva pleure à peine, courageuse devant la douleur. Et, sur les conseils d’une Indienne, on lui applique chaque jour un onguent d’herbes sauvages, ce qui va lui rendre la peau blanche, fine, presque diaphane.
Une brûlure bien plus intense l’attend le 8 janvier 1926, au cœur de l’été argentin : Juan Duarte meurt alors d’un accident de voiture. Son premier rôle, la petite Eva le joue le jour de l’enterrement de son père. À Chivilcoy, sa famille légitime, avec un manque de charité bien compréhensible, interdit à doña Juana de suivre le convoi avec ses enfants : en Argentine les funérailles prennent une importante signification familiale. La présence de doña Juana aurait rendu officielles ses relations avec le défunt, ce que la señora Duarte voulait éviter autant que doña Juana aurait aimé l’obtenir. Doña Juana ayant fait appel au parrain d’Eva (le frère d’Estela Grisolia), celui-ci obtient un compromis : les enfants de doña Juana seront du cortège funèbre, mais sans leur mère.
L’aînée, Blanca, a 16 ans, Elisa 13 ans, le seul garçon, Juancito, 12 ans, Erminda, 9 ans et la petite Eva, 6 ans. Elle est assez petite pour que son parrain la porte dans ses bras, mais assez grande déjà pour se vexer des airs hostiles de la famille de son papito, plus riche et mieux établie que la sienne. Même à l’âge de 6 ans, c’est un choc d’apprendre qu’on partage son papa avec une autre famille.
Entre enfants légitimes et enfants usurpateurs, entre les héritiers Duarte et les bâtards Ibarguren, les regards ne trompent pas. Chacun se dispute le droit d’effleurer d’un baiser la joue du gisant. Moment surréaliste, car les enfants de Juana sont tout endimanchés. Les petites filles, même la plus jeune, ont été pourvues en hâte de vêtements de deuil : robes noires, bas noirs, souliers noirs ; Juancito, lui, porte un brassard de crêpe à la manche. À ces formalités, le plus pauvre parent de la plus irrégulière des familles ne peut se soustraire. Eva apparaît alors comme une enfant tranquille, aux épais cheveux noirs. Portée dans les bras de son parrain, elle voit mieux que ses frères et sœurs le cercueil de son père par-dessus la tête des visiteurs de marque, et de ses demi-sœurs qu’elle considère avec l’implacable animosité de l’enfance.
La petite fille maigre et brune, au nez busqué et aux grands yeux noirs, connaît la première humiliation de sa vie. Elle comprend son statut de bâtarde, sans rang social. On l’a écartée, elle et ses frères et sœurs de la grande fête de l’enterrement du maître. La loi a repris ses droits, la légitimité catholique ne veut pas des enfants du péché. Un incident très bref passe inaperçu de l’assistance, mais laissera une trace indélébile dans la mémoire de la petite Eva. Pendant qu’on discutait pour savoir si sa famille veillera ou non le cadavre de son père, le prêtre chargé de l’office religieux l’a discrètement réconfortée, d’une légère caresse sur la joue. Eva n’oubliera jamais les affronts de cette journée ni le geste apaisant du prêtre. Peut-être l’origine de beaucoup de ses actes de femme adulte se trouve-t-elle dans ces événements de Chivilcoy ? Eva écrira plus tard : « D’aussi loin que je me souvienne, chaque injustice blesse mon âme comme si on y clouait quelque chose. Chaque âge m’a laissé le souvenir d’une injustice qui me bouleversa, me déchirant au plus profond de moi-même ».
Chivilcoy, c’est le bout du monde, le bout de la province de Buenos Aires, là où les chemins de terre deviennent impraticables, là où commence vraiment la Pampa argentine. Chivilcoy est un village planté là comme un décor pour metteur en scène avide de cinéma-vérité. Il y a là la taverne : « La Pulperia », où s’enivrent régulièrement les quelques grands fermiers du coin. Des fermiers qui ne sont pas les richissimes éleveurs de bétail de l’imagerie argentine. Des fermiers juste un peu plus riches, un peu plus puissants que les peones qui mènent leurs troupeaux. Comment ne pas sentir l’injustice et la misère dans ce décor où le premier « sans-chemise » qu’Eva connaît habite dans des huttes de briques séchées ?
Dès la fin de l’enterrement, silencieux et humiliés sur le triste chemin du retour, Juana et ses enfants comprennent qu’il leur faut dorénavant affronter de nouveaux problèmes : surpris par la mort, Juan Duarte leur a légué pour toute fortune le discrédit et l’opprobre. La famille de Juana doit déménager pour un logement encore plus étroit, sur un terrain en friche, bordé de buissons et de massifs de caroubiers. « Le problème de notre subsistance devint une lutte quotidienne, sous des formes différentes », dira Erminda. Une pauvreté extrême, sinon l’indigence absolue, s’installe dans ce foyer de femmes, entretenu au prix de durs efforts par les chiches revenus de Juana, grâce à son métier de couturière, et d’Elisa, employée à la poste de General Viamonte.
Le désastre financier provoqué par la mort de Juan Duarte retarde d’une année l’entrée d’Eva à l’école primaire. C’est une enfance cruelle et solitaire. Point de souvenirs de jeux ou de jouets partagés avec d’autres garçons et filles. Plus tard, lorsqu’elle l’évoquera, Eva se rappellera seulement des poules qui se pavanaient sur le sol de terre battue dans la cuisine, des chèvres et des chiens dans la cour, des troupeaux, et des pâturages infiniment verts et plats.
Pendant sa première année d’école primaire, en 1927, Eva Maria Duarte n’est pas plus ponctuelle que brillante élève. Absente quarante-huit jours sur cent quatre-vingt-quatre, elle ne laissera qu’un souvenir incertain dans la mémoire de son institutrice Nidia de la Torre de Dilagosto : « J’oublie le visage de cette élève, sans doute parce qu’elle n’a pas terminé ses études primaires au village. Elle était plutôt silencieuse et n’avait pas beaucoup de camarades. Je crois me rappeler que les mères demandaient à leurs enfants de les tenir à l’écart, ses sœurs et elle ». Eva obtient des notes tout juste suffisantes ; l’année suivante, elle doit redoubler, mais ses résultats deviennent excellents.
À 9 ans, Eva est une petite fille au corps svelte. D’allure mélancolique, elle grandit et devient une fillette aux longs cheveux blond foncé, maigre et étrangement pâle à côté des Argentins basanés. Elle ne ressemble guère à ses sœurs. Elle est douée d’une intelligence vive, intuitive et d’un caractère violent. Elle réagit souvent avec passion et s’emporte pour un rien. Le 6 février 1931, la famille déménage et part habiter Junin, car sa sœur Elisa y est mutée2. Juana et les siens s’installent dans une bâtisse vétuste de la rue Moisés Levenshon (rue Vasquez à cette époque). Elle rouvre son atelier de couture et y travaille tard dans la nuit, penchée sur sa machine à coudre « Singer ». Eva conservera à jamais cette image de sa mère.
Tout n’est pas sombre dans cette période. Bianca réussit son concours d’institutrice, Erminda termine ses études et Juan vend dans les rues l’encaustique « La Rosa » et le savon « Radical ». Eva, elle, manifeste sa vocation artistique. Elle joue dans la pièce Arriba estudiantes (En avant les étudiantes), interprétée par des élèves de son école. Ses yeux sont très beaux, mais elle a un regard triste qu’elle gardera pour le restant de sa vie.
Au milieu de l’année 1932, grâce aux apports de Juan et d’Elisa, la famille peut déménager pour un quartier plus cossu, au croisement des rues Alfonso Alsina et Lavalle, et plus tard au numéro 90 de la rue Winter. Luxe inusité : la nouvelle maison compte trois chambres à coucher et un salon-salle à manger. Juana en profite pour installer une petite pension et un restaurant. On accueille donc des commensaux ou on livre la nourriture à des clients extérieurs. D’après une voisine, Renata Coronado de Nuosi, « les Duarte étaient tellement pauvres qu’il leur fallait servir des repas pour pouvoir subsister ».
Leur maison ressemble à toutes les demeures citadines d’Argentine. Bâtie en forme de F, elle comporte sur la façade deux fenêtres à balcon et une étroite porte d’entrée qui donne directement sur le trottoir. La rangée de chambres derrière la sala est dépourvue de fenêtres. Le patio est limité par le mur d’une maison voisine et divisé au centre par une pièce plus vaste que les autres, destinée à servir de salle à manger et séparant la cuisine des pièces du devant. Dans le patio, on trouve quelques plantes vertes dans des caisses et, derrière la maison, un jardinet avec un citronnier et une éolienne métallique qui approvisionne la maison en eau. Junin, bâtie sur le même plan que toutes les villes des colonies espagnoles, se compose de ces pâtés de maisons de cent mètres carrés qui imposaient des formes biscornues à toutes les demeures argentines. Des maisons incommodes, car pour se rendre d’une pièce à l’autre, il faut traverser les chambres à coucher ou passer par le patio ; de plus, elles sont laides et ne permettent aucune intimité.
Eva fait les commissions, met la table… Elle est d’humeur changeante, tantôt gaie et vive, tantôt secrète et morose. À lire sans cesse des magazines de cinéma et des histoires à l’eau de rose, elle devient une romanesque, une exaltée. Mais quel destin l’attend donc ? Pour l’instant, c’est encore l’école. Elle apprend très vite, mais elle reste une élève passable qui ne fait pas d’étincelles. Comme le montrent les notes retrouvées par son institutrice : conduite, 10 ; lecture, 4 ; écriture, 6 ; grammaire, 3 ; arithmétique, 5 ; histoire, 4 ; géographie, 5 ; instruction civique, 5 ; géométrie et dessin, 5 ; physique et chimie, 5 ; botanique et agriculture, 5 ; zoologie et cheptel (étude indispensable à une fille de la pampa), 5 ; minéralogie et géologie, 5 ; anatomie, physiologie, hygiène, 5 ; travaux pratiques, 7 ; culture physique, 9 ; chant et musique, 10. Les seules activités où elle se distingue sont la gymnastique et les arts dits d’agrément. Ses études vont cahin-caha alors que Blanca, plantureuse madone blonde, est déjà maîtresse d’école suppléante et Elisa, gracile et morose, fonctionnaire des Postes. Vers 13 ans, Eva commence même à se lasser des études.
Des mariages rapprochés permettent à Juana d’avancer dans sa quête de la respectabilité bourgeoise. Blanca, la blonde, épouse Justo Lucas Alvarez Rodriguez, avocat et professeur au Collège National de Junin. Elle commande désormais à une nombreuse domesticité. Lorsque Mme Duarte est reçue chez sa fille, la cohorte servile s’incline devant elle au point de la faire pleurer de bonheur. Elisa, elle, convole avec le major Hermino Arrieta, chef du District militaire numéro 7. Ces deux unions constituent une ascension dans l’échelle sociale, mais ne leur ouvrent pas nécessairement les portes de la classe moyenne de la ville. Sur les Duarte continue à peser l’opprobre de leur origine bâtarde.
Sur les voies équivoques et solennelles du mariage, tel que le conçoit maman Duarte, Eva est bien la seule élève rétive. Elle ne cherche pas à provoquer l’attention des notables pour les conduire au mariage. Ni docile, ni bien élevée, ni douce, ni tendre, ni bien en chair comme ses autres sœurs, Eva désespère sa mère par son refus net et obstiné de comprendre qu’une fille est destinée au mariage.
C’est le métier d’actrice qui l’attire. Depuis toujours, elle fait preuve d’un goût prononcé pour le théâtre. Plus qu’une disposition, c’est une nature. Elle aime le masque, le costume. D’un simple chiffon, elle se fait un nouveau déguisement. Elle aime se travestir en vedette. Jouant de son âge et d’une prétendue ingénuité, elle se permet tous les excès. Elle descend l’escalier de la maison en montrant ses cuisses au rythme d’une musique imaginaire, elle se pare de jupons transparents et de chemisiers coquins, elle aguiche la faune masculine qui tourne autour de ses sœurs plus âgées, et ce, en toute impunité en raison de son âge. À 12 ans, on peut émoustiller, avec la plus grande impudeur du monde, on peut offrir au regard des hommes ce que les sœurs promettent avec des mines de vierges effarouchées. Ce n’est qu’un jeu. Car la provocation est l’une des premières armes d’Eva. Elle joue à imiter les stars d’Hollywood dont elle a tapissé les murs de la chambre qu’elle partage avec son jeune frère. Le soir, elle se campe devant les photos et annonce de sa voix rauque et animale : « Juan, je serai actrice… j’aurai le monde à mes pieds ». Tout au long de son existence, elle fera allusion à son goût du déguisement.
Jean Harlow, la blonde platinée d’Hollywood la fait rêver. Et comme toutes les jeunes filles de son âge, elle n’ignore aucun détail des biographies des célébrités d’Hollywood. S’il fallait analyser les ressorts psychologiques poussant Eva vers le théâtre, on citerait évidemment son désir d’échapper à la grisaille quotidienne en se plongeant dans un monde onirique. Le théâtre signifie l’évasion, elle peut s’y transformer en héroïne ou en princesse, oublier fugacement sa pauvreté, les limites de sa condition sociale. D’ordre matériel, la seconde motivation découlait de la première : elle pressentait que cette vie hérissée de soucis et d’humiliations n’a pas d’autre échappatoire que le théâtre. À lire les magazines, à écouter la radio, elle s’est familiarisée avec les milieux artistiques de Buenos Aires, les succès des actrices et des chanteurs en vogue. Il est improbable que la petite Eva Duarte ait fait alors de cette profession théâtrale le sédatif de ses angoisses métaphysiques ou de ses inquiétudes existentielles, encore qu’elle affirmât par la suite : « Dès mon plus jeune âge, j’ai toujours voulu réciter. C’était comme si je désirais dire quelque chose aux autres, quelque chose de grand que je ressentais au plus profond de moi-même »3.
La brièveté des études d’Eva, limitées aux années d’école primaire, est due soit à la situation financière de la famille, soit à sa santé plutôt fragile. Elle ne montre aucune aptitude particulière pour les études, mais elle aime les moindres fêtes de l’école et y prend une part active. Elle montre déjà une prédilection marquée pour les manifestations patriotiques des jours de fête nationale où les petites filles, habillées de tabliers blancs empesés, les cheveux ornés d’un gros papillon de ruban blanc, une rosette aux couleurs blanches et bleues épinglées sur la poitrine, défilent en chantant d’une voix aiguë et discordante des hymnes à la gloire de la patria. À cette époque, on inculque aux écoliers argentins un nationalisme narcissique et, sans doute pour contrebalancer leur éloignement du monde, on leur enseigne que leur nation occupe sur la terre une place aussi importante que le soleil au ciel. Ils chantent : « Et les peuples libres du monde répondent : «Salut à la grande nation argentine» ». Que peut offrir Junin à une ambitieuse comme Eva ?
À l’école, elle apprend ses leçons comme un perroquet, les répétant en chœur à la suite de l’institutrice. En ville, pas une bibliothèque ni une librairie, pas d’excursions ni de pique-niques ; d’ailleurs, la route poussiéreuse et droite où l’on voit souvent des carcasses de chevaux ou de vaches abandonnées aux vers et aux fourmis n’est guère engageante. Reste la gare : on peut attendre l’arrivée du train de Buenos Aires. Ou bien encore, les soirs d’été, elle peut se promener tout autour de la plaza avec ses amies, se tenant le bras par groupes de cinq ou six. Toutes les jeunes filles, même celles du milieu des Duarte qui ne sont pas soumises à une éducation stricte, doivent se conformer au rituel immuable de ces promenades vespérales. Un tel décor de conformisme, d’ennui et de manque de sophistication.
Julio Otero, qui connut Eva adolescente, prétend qu’elle « devinait tout naturellement ce que les gens éprouvaient ». Sans aucun doute, de telles qualités la préviennent contre l’avenir étriqué l’attendant à Junin : vertueuse, elle épousera quelque éleveur obèse ; affranchie, elle revivra le destin hasardeux de sa mère. « Je me marierai avec un prince ou un président », confie-t-elle un jour à Erminda. Elle confessera des années plus tard : « C’est pour cette raison que j’ai fui la maison. Ma mère m’aurait unie à quelqu’un du village, et je ne l’aurais jamais toléré ». Son moi était habité par un besoin indomptable de liberté : disposer d’elle-même sans maîtres ni sujétions d’aucune sorte. Un anticonformisme viscéral qui sera à l’origine de ses rébellions futures et scellera son destin. Ainsi qu’elle le disait, « j’ai toujours vécu libre ; comme les oiseaux, j’aime la forêt ; je n’ai pas même supporté cette sorte d’esclavage représenté par la vie chez mes parents ou dans le village natal ».
Pour bien comprendre le milieu d’Eva Duarte, il est sans doute essentiel de savoir qu’un abîme sépare la campagne environnante des habitants du pueblo, que ce soit un hameau comme Los Toldos ou un petit bourg comme Junin. La plupart de ces pueblos ressemblent à de petits îlots de taudis encastrés dans une des régions agricoles les plus riches du monde. L’opulence des champs dorés, les troupeaux de bovins primés, les magnifiques chevaux de trait, les vieilles estancias aux grandes baies vitrées abritées par leurs volets clos de la chaleur de l’été, nichées dans des bosquets de mimosas, d’eucalyptus et d’acacias vieux de plus d’une génération, tout cela appartient à l’aristocratie terrienne de l’Argentine ! Des énormes fortunes amassées par les grands propriétaires, les villages ne profitent en rien, car il ne se fait aucun échange entre l’estancia et le pueblo. Même les petites estancias forment des communautés indépendantes ; quant aux grandes, qui couvrent souvent plus de douze mille hectares, elles ont leurs églises, leurs écoles et leurs hôpitaux. Une seule famille peut posséder jusqu’à une demi-douzaine de grands domaines. Les propriétaires dépensent leur fortune à Paris, envoient leurs fils à Harrow. Ils reviennent parfois passer quelque temps dans leur hôtel somptueux à Buenos Aires ; on voit alors leurs enfants, gantés et empesés, jouer posément au Parc de Palerme sous le regard vigilant d’une nurse anglaise ou d’une gouvernante française. Comment ne pas rêver de la capitale, de Buenos Aires ?
Épouser un gros propriétaire de Junin et s’enterrer dans la triste ville de province ? Ou tourner le dos à la maison familiale, cette souricière à maris, et partir à l’aventure vers Buenos Aires ? Déjà très jolie, petite, mais bien faite, Eva apprend à se farder pour avoir l’air d’une jeune femme. Est-elle encore vierge à l’époque ? C’est incertain, mais elle en sait déjà long sur les hommes. Alors, Buenos Aires ? Une amie d’école, partie pour la capitale, est devenue vedette à la radio. En ville, l’argent ne manque pas ; les hommes sont riches, les femmes luxueusement habillées. Eva cherche à s’immiscer dans les bonnes grâces des comédiens de chaque tournée ; ou bien elle est dupe de leurs vantardises, de leurs prétendus succès dans la capitale, ou bien ils représentent pour elle le premier pas sur la route de la fortune. En tout cas, lorsqu’un jeune chanteur de tangos commence à la courtiser et lui promet, entre autres merveilles, un engagement à la radio, elle lui prête une oreille plus qu’attentive.
Eva dira : « Dans toutes les existences, il arrive un moment qui semble définitif. C’est le jour où l’on s’imagine être à jamais entré dans un chemin monotone, uniforme, sans détour, sans nouveaux paysages. On croit, dès lors, que, sa vie entière, on répètera les mêmes gestes quotidiens, et que l’on a, en quelque sorte, définitivement trouvé sa voie. C’est ce qui m’arriva à cette époque de ma vie. Je m’étais résignée à ma condition de victime. Plus encore : je m’étais résignée à une existence banale, monotone, qui me semblait stérile, mais inéluctable. Je n’avais aucun espoir d’y échapper. En outre, ma vie d’alors, comportait assez d’agitation dans sa monotonie pour m’absorber tout entière. Au fond de moi-même, cependant, je n’étais pas vraiment résignée. Et mon «grand jour» vint enfin ».
Tout se joue le 3 janvier 1935. De passage à Junin, un chanteur de tango, Agustin Magaldi, loge à la pension Duarte. Eva, fière de rencontrer une « vedette », lui récite un poème et lui avoue son désir de faire du théâtre. L’artiste lui griffonne son adresse. Convaincre sa mère et ses sœurs de la laisser « monter » à la capitale n’est pas chose facile. Son obstination est récompensée, sous réserve du chaPerónnage de son frère Juan. La « tribu » réunit l’argent du billet de chemin de fer et un modeste pécule de 100 pesos. La jeune fille pauvre de 15 ans, qui vient d’une province arriérée, se lance à la conquête de la capitale et d’un milieu artistique où chacun se moque des campagnards. Sa volonté et son courage vont lui faire ignorer les risques et les dangers de son rêve fou. Eva ne connaît rien du théâtre, mais, dans son imagination, elle se voit devenir une actrice. Elle a la tête pleine des images publiées dans les revues qu’elle feuillette. À son arrivée à la gare du Retiro, son frère Juan, qui termine son service militaire, l’attend sur le quai. À nous deux, Buenos Aires !
1. Dépourvue de plaque commémorative, rarement visitée (encore qu’une femme se rappelle y avoir vu un jour des gens de la télévision), la maison de brique sombre tombe en ruine à Los Toldos. Le vieux garagiste d’à côté (deux véhicules dans son garage), qui en est désormais le propriétaire, l’a convertie en entrepôt. Des herbes folles pendent du toit, dont la tôle ondulée s’effondre sur le patio.
2. C’est Pascal Lettieri, l’intendant radical de Los Toldos, qui est intervenu en faveur d’Elisa pour sa promotion à la poste de Junin.
3. Dans La raison de ma vie, Eva dit exactement : « Déjà, petite fille, j’avais le goût de la déclamation. J’avais en moi le besoin de dire quelque chose de grand, quelque chose que je sentais au plus profond de mon cœur et que je dédiais à tous les hommes ».
CHAPITRE 2 : Artiste
1935 marque à la fois la mort du plus célèbre chanteur de tangos de tous les temps, Carlos Gardel, et l’arrivée d’une Eva Duarte de 15 ans et demi, aux yeux grands comme ça, dans la capitale, au bras d’un séduisant interprète ambulant du folksong gaucho. À Buenos Aires, Agustin a promis de lui trouver un rôle au théâtre ou au cinéma. Mais il sait fort bien – et elle ne tarde pas à l’apprendre – que la beauté ne suffit pas. Pour percer, il faut avoir de l’expérience et du talent. Ne possédant ni l’un ni l’autre, elle est handicapée dès l’abord. Le rôle promis n’est qu’une illusion. Les amants se séparent bientôt. Ayant satisfait sa fantaisie, Magaldi remet sa guitare en bandoulière et part pour de nouvelles conquêtes en province.
Eva, elle, reste dans la capitale. Elle ne veut absolument pas retourner chez sa mère. Elle est toujours décidée à devenir actrice d’une manière ou d’une autre, sûre qu’elle est de se tirer d’affaire si les choses viennent à se gâter. Buenos Aires est écrasée de soleil, déchirée par les hurlements des trompes d’autos, les cris des vendeurs de journaux et des marchands ambulants. Un employé de la voirie municipale arrose mollement le pied des arbres et le gazon des plates-bandes de l’avenue. Des consommateurs, vêtus de tussor, chaussés de blanc, coiffés de chapeaux légers, sirotent des boissons fraîches à l’ombre des terrasses des grands cafés.
En 1935, Buenos Aires est une ville magnifique, un port tout entier tourné vers le commerce. Une ville à l’architecture délirante et grandiose qui cherche son identité face au vieux modèle européen. La misère et la richesse s’y côtoient, le tango pleure dans les cafés, les pauvres s’y bousculent à la recherche d’un rêve qui n’a pas la vigueur du rêve américain, mais lui ressemble. Ils arrivent de leurs villages misérables et espèrent survivre en ramassant les miettes que laissent échapper les riches.
Se sent-elle chez elle à Buenos Aires, elle qui écrira : « J’imaginais volontiers que les grandes villes étaient des endroits merveilleux où l’on ne rencontrait que richesse et joie de vivre sur son chemin. Tout ce que j’entendais dire autour de moi confirmait d’ailleurs cette croyance. On parlait couramment des grandes villes comme d’un paradis où tout était beau, extraordinaire, et il me semblait comprendre que les êtres humains y étaient mieux traités – plus dignement – que ceux de mon village » ?
Lorsqu’on débarque à Buenos Aires, on est pris instantanément d’un curieux sentiment. Ce n’est pas la sensation d’un dépaysement marqué, ni même celle d’un exotisme débordant. Mélange d’une architecture moderne et ancienne, population venant de tous les horizons, Buenos Aires est une ville cosmopolite. Une ville immense si on ajoute les banlieues regroupées autour d’elle et qui forment le « Gran Buenos Aires ». Pourtant, on ne s’y sent pas perdu. C’est que Buenos Aires est le reflet parfait de sa population, complexe, hétérogène. Une ville en pièces détachées, rapportées par les nombreuses vagues d’immigrants venus du Vieux Continent depuis la fin du 19e siècle. Un puzzle. C’est un peu Madrid quand on va autour du congrès ou de la plaza de Mayo, un peu Paris en allant vers le quartier chic de « La Recoleta », ou encore Barcelone ou Naples dans certaines rues de « La Boca ». Ici et là, de splendides édifices témoignent d’une Argentine prospère, alimentée alors par des capitaux étrangers, anglais surtout. C’est ce Buenos Aires riche et prospère, fréquenté par de nombreux étrangers fortunés, avec ses grands hôtels et ses casinos qui seront le théâtre du film Gilda.
Une ville où l’art et la culture s’épanouissent. Deux journaux, La Prensa et La Nación