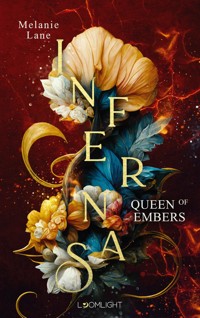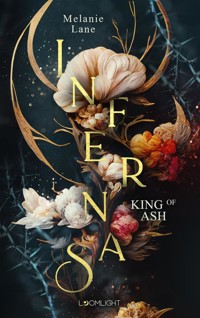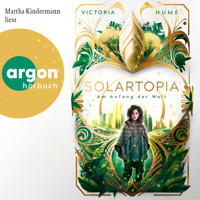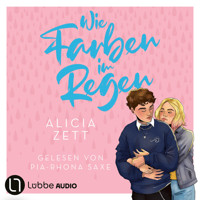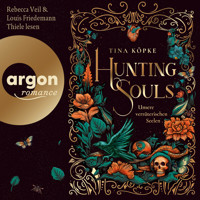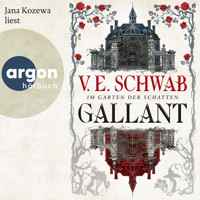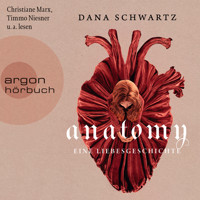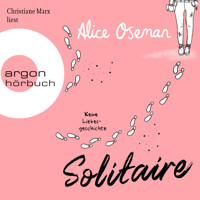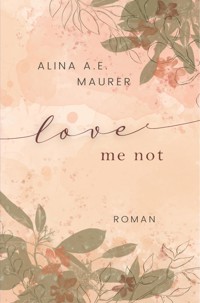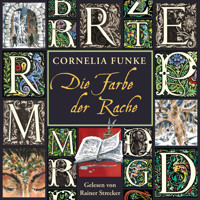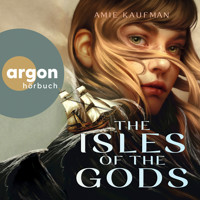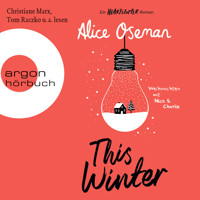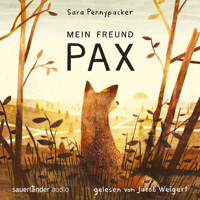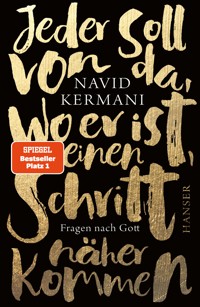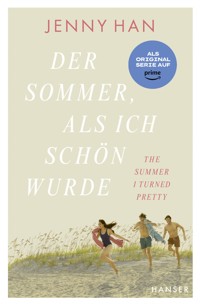Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: De Boeck (Pédagogie et Formation)
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Serie: Le point sur… Pédagogie
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2017
Comment les évaluations formative et certificative peuvent-elles se mettre au service des apprentissages des élèves et de leur reconnaissance sociale et institutionnelle ? Voici le bilan d'un ensemble de travaux majeurs.
L’évaluation est omniprésente dans le monde de l’éducation et de la formation. Il semble même que l’on tende, aujourd’hui, à vouloir toujours plus évaluer et tout évaluer : des apprentissages, des enseignements, des dispositifs, des programmes, des établissements, des systèmes éducatifs, des politiques, etc… L’évaluation n’a-t-elle pas aussi une fonction pédagogique, de soutien à l’apprentissage, à des fins d’amélioration de l’enseignement et plus généralement du système éducatif ? Mais de quelle(s) évaluation(s) parle-t-on ?
À PROPOS DE LA COLLECTION
LE POINT SUR... PÉDAGOGIE
Destinée aux étudiants en sciences de l'éducation, aux futurs enseignants et aux enseignants du terrain, de la maternelle au supérieur, cette nouvelle collection fait le point sur les recherches et les pratiques en pédagogie.
- Des synthèses précises et ancrées dans les recherches les plus récentes.
- Des thèmes classiques qui constituent des incontournables.
- Des problématiques communes aux pays de la francophonie...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 188
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
LE POINT SUR…
Cette collection s’adresse prioritairement aux étudiants de niveau Licence/Baccalauréat du premier cycle universitaire, BTS-DUT, Hautes Écoles et/ou ESPE, en leur procurant un aperçu condensé et un outil de révision des matières enseignées. Certains ouvrages sont également destinés au niveau Master, voire Doctorat.
Pédagogie - sous la direction de Sabine KAHN et Bernard REY
Comité scientifique : Les professeurs Anne Barrère (Université Paris 1 Sorbonne), Marc Bru (Université Toulouse 2), Professeure Anne-Marie Chartier (INRP), Michel Fabre (Université Nantes), Yves Lenoir (Université Sherbrooke), Lucie Mottier Lopez (Université Genève), Patrick Rayou (Université Paris 8), Laurent Talbot (Université Toulouse Le Mirail), Frédéric Tupin (Université Nantes), Isabelle Vinatier (Université Nantes).
BARRÈRE ANNE,École et Adolescence. Une approche sociologique
BERNARDIN JACQUES,Le rapport à l’école des élèves de milieux populaires
CAFFIEAUX c.,Faire la classe à l’école maternelle
CARETTE V., REY B.,Savoir enseigner dans le secondaire. Didactique générale
GUIGUE M.,Ethnographies de l’école. Une pluralité d’acteurs en interaction
KAHN S.,Pédagogie différenciée
MARGOLINAS c., WOZNIAK f.,Le nombre à l’école maternelle. Une approche didactique
MOTTIER LOPEZ L.,Évaluations formative et certificative des apprentissages. Enjeux pour l’enseignement
MOTTIER LOPEZ L.,La régulation des apprentissages en classe
ORANGE CH.,Enseigner les sciences. Problèmes, débats et savoirs scientifiques en classe
PHILIPPE J.,Fabriquer le savoir enseigné. Enjeux et problèmes
PRAIRAT E.,Quelle éthique pour les enseignants ?
REY B.,La notion de compétence en éducation et formation
TREMBLAY P.,Inclusion scolaire, Dispositifs et pratiques pédagogiques
VINATIER ISABELLE,Le travail de l’enseignant. Une approche par la didactique professionnelle
Pour toute information sur notre fonds et les nouveautés dans votre domaine de spécialisation, consultez notre site web : www.deboeck.com
© De Boeck Éducation s.a., 2015 Fond Jean Pâques, 4 – 1348 Louvain-la-Neuve
EAN 978-2-8041-9312-6
Cette version numérique de l’ouvrage a été réalisée par Nord Compo pour De Boeck Éducation. Nous vous remercions de respecter la propriété littéraire et artistique. Le « photoco-pillage » menace l’avenir du livre.
Sommaire
INTRODUCTION
CHAPITRE 1. ÉMERGENCEDUDOMAINEDEL’ÉVALUATIONDESAPPRENTISSAGESDESÉLÈVES
CHAPITRE 2. COMMENTPENSERL’ÉVALUATIONDESAPPRENTISSAGESDESÉLÈVES ? ENJEUXDESMODÉLISATIONS
CHAPITRE 3. QUELQUESPROBLÉMATIQUESACTUELLESDERECHERCHESURLESPRATIQUESD’ÉVALUATIONDESAPPRENTISSAGESENCLASSE
RÉFÉRENCESBIBLIOGRAPHIQUES
Introduction
Évaluer, c’est mesurer ! C’est juger ! C’est noter ! C’est sanctionner ! C’est interagir ! C’est co-construire du sens ! C’est accompagner ! C’est réguler ! … Toutes ces affirmations se trouvent dans la littérature. Mais l’évaluation, est-elle vraiment tout cela ? L’évaluation est omniprésente dans le monde de l’éducation et de la formation. Il semble même que l’on tende, aujourd’hui, à vouloir toujours plus évaluer et tout évaluer : des apprentissages, des enseignements, des dispositifs, des programmes, des établissements, des systèmes éducatifs, des politiques, etc… Des voix s’en inquiètent à juste titre : Faut-il avoir peur de l’évaluation ? s’interroge Hadji (2012). L’évaluation est une menace ! affirment Butera, Buchs et Darnon (2011). Pourtant, l’évaluation revendique une fonction pédagogique, de soutien à l’apprentissage, à des fins d’amélioration de l’enseignement et plus généralement du système éducatif. Alors, de quelle(s) évaluation(s) parle-t-on ?
Cet ouvrage n’a pas la prétention de présenter un panorama exhaustif de la question. Il cible le propos sur l’évaluation des apprentissages des élèves. En fonction de l’orientation des travaux que nous citerons, l’ouvrage mentionnera des savoirs, des connaissances, des compétences mais également des stratégies cognitives, des compétences sociales, etc. L’évaluation scolaire représente un de ces objets particulièrement sensibles en éducation, notamment en raison des différentes « missions » qui lui sont attribuées. Pour Abernot (2013), elles sont principalement de deux ordres : une mission de soutien à la formation des personnes et une mission de différenciation et de classement des individus. Ces missions sont souvent considérées comme inconciliables tant leurs buts semblent s’opposer. Elles génèrent des tensions, des paradoxes, des dilemmes parfois difficiles à assumer. Pourtant, les enseignants doivent faire co-exister ces différentes évaluations au sein de leur classe, dans leur rapport avec les élèves, les parents, les collègues, leur hiérarchie.
Historiquement, l’évaluation pédagogique s’est déclinée en deux fonctions principales : l’évaluation formative à des fins de soutien d’apprentissage, l’évaluation sommative à des fins de certification des acquis. Longtemps, et encore aujourd’hui, on a insisté pour que ces deux fonctions soient clairement distinctes l’une de l’autre en raison des buts différents qu’elles visent. Pour certains auteurs, leurs finalités s’opposent au point de ne pas pouvoir envisager des synergies entre elles. L’évaluation certificative reste définitivement marquée par des enjeux de hiérarchisation et de classement entre les élèves, totalement contraires à la visée de l’évaluation formative qui se met au service des progressions d’apprentissage de chacun. D’autres auteurs argumentent, au contraire, la nécessité de concevoir des complémentarités entre l’évaluation formative et l’évaluation certificative, mais sans les confondre pour autant. Pourquoi l’évaluation certificative ne pourrait-elle pas se mettre au service du jeu pédagogique avant de participer au jeu social ? Pourquoi l’évaluation formative ne pourrait-elle pas être aussi intégrée à des évaluations certificatives ? À titre métaphorique, les évaluations formative et certificative sont-elles condamnées à être la figure mythologique de Janus, c’est-à-dire deux visages opposés d’une même tête sans jamais pouvoir croiser leurs regards vers un même axe de convergence ? Sinon, quel pourrait être cet axe de convergence susceptible de les réunir ? Nous argumenterons, tout au long du livre, que cet axe peut être la visée de soutien au développement des trajectoires d’apprentissage des élèves et de leur reconnaissance sociale et institutionnelle.
Il existe un champ conceptuel et de recherche propre à l’évaluation des apprentissages dans les systèmes d’enseignement. Ce champ permet de se distancer du sens commun qui reste souvent attaché à l’évaluation, encore perçue par certains comme essentiellement une question d’outils, de méthodes ou de pratiques normatives. Nous nous inscrirons en faux contre cette représentation. Le but de cet ouvrage est de donner à voir une problématique évaluative ancrée dans un questionnement propre aux Sciences de l’éducation, en interaction avec d’autres champs théoriques de référence. Le livre a été rédigé dans la perspective de faire le bilan d’un ensemble de travaux majeurs à nos yeux. Une clarification est proposée à propos des fondements théoriques pour penser les pratiques d’évaluation en classe. Des aspects méthodologiques sont également développés. En effet, l’évaluation est aussi une question de praxis : comment évaluer ? C’est une question pleinement légitime quand on connaît l’impact de l’évaluation sur les parcours de formation des élèves.
Le choix des contenus qui organisent l’ouvrage fait écho, d’une part, aux questions qui nous sont les plus fréquemment posées en formation initiale à l’enseignement primaire et secondaire, ainsi que lors de nos interventions en formation continue. Il résulte, d’autre part, de notre connaissance des problématiques de recherche actuellement traitées à l’international, dans les communautés scientifiques francophones et anglophones (pour cette dernière, autour des travaux, qui portent sur l’axe classroom assessment). Nous avons choisi d’insérer ponctuellement des « encarts » qui citent des extraits de textes d’auteurs à des fins d’illustration ou d’approfondissement. Ils proposent des définitions de concepts, des démonstrations conceptuelles ou des exemples d’outils afin d’étayer notre propos. Le texte pourrait se lire sans les encarts. Ce n’est pas le cas des tableaux insérés dans le texte.
Le livre est constitué de trois chapitres. Le premier offre un regard sur la constitution du domaine de l’évaluation des apprentissages en Sciences de l’éducation tout au long du 20e siècle. Peu de travaux, à notre connaissance, retracent cette constitution. Connaître la façon dont ce domaine s’est défini, ainsi que les principaux questionnements et les problématiques qui l’ont traversé, permet de mieux comprendre les représentations qui restent attachées aux fonctions formative et certificative de l’évaluation en classe. Le chapitre suivant interroge les modèles développés pour conceptualiser l’évaluation des apprentissages, les relations avec les champs théoriques de référence, les positionnements épistémologiques qui permettent d’interroger le rapport des acteurs sociaux à l’évaluation, leurs valeurs, leurs croyances. L’essence de ce qui définit l’évaluation est explicitée. Des questions plus techniques, servant notamment à opérationnaliser l’évaluation en classe, sont abordées. Quant au dernier chapitre, il présente quelques axes actuels de recherche : les synergies possibles entre évaluations formative et certificative, les différentes formes d’évaluation en classe dont celles qui portent sur des compétences, l’implication des élèves dans les processus évaluatifs, les concertations entre professionnels. Des questionnements nouveaux sont exposés au regard de la perspective dite située de l’évaluation et de l’apprentissage des élèves. Une réflexion est proposée autour des cultures de l’évaluation telles qu’elles sont négociées au sein de chaque classe, mais également entre professionnels d’un même établissement scolaire ou entre plusieurs établissements par le moyen de pratiques de modération sociale.
D’une façon générale, cet ouvrage reste centré sur des questions qui interrogent les pratiques d’évaluation en classe et les enjeux d’apprentissage associés. Malgré leur intérêt, nous avons écarté les recherches qui étudient des relations entre l’évaluation scolaire et d’autres phénomènes éducatifs, sociaux, psychosociaux. Ce faisant, cet ouvrage assume un champ de recherche à part entière en Sciences de l’éducation sur les pratiques d’évaluation et de régulation des apprentissages des élèves dans les systèmes d’enseignement, ici, plus particulièrement la classe.
CHAPITRE 1
Émergence du domaine de l’évaluation des apprentissages des élèves
Sommaire
1. D’ABORD, DESPRATIQUESDECLASSEMENTETDENOTATION
2. LADOCIMOLOGIE, PREMIÈREPARTIEDU 20eSIÈCLE
3. L’ÉVALUATIONDEVIENT « PÉDAGOGIQUE » DÈSLESANNÉES 1970
4. UNESPÉCIALISATIONDESFONCTIONSDEL’ÉVALUATION, DEUXIÈMEPARTIEDU 20eSIÈCLE
5. ENCONTINU, UNÉLARGISSEMENTCONCEPTUELDEL’ÉVALUATIONFORMATIVEDANSLEMONDEFRANCOPHONE
6. MISEENCAUSEDELATHÉORIEDESOBJECTIFS, FINDU 20eSIÈCLE
Ce premier chapitre expose un aperçu de la constitution du domaine de l’évaluation des apprentissages des élèves en Science de l’éducation et de l’émergence d’une problématique évaluative. On ne parlait pas d’évaluation initialement, mais de pratiques de notation et de classement des élèves. C’est seulement courant du 20e siècle que la conception d’une évaluation pédagogique s’est développée. Après un bref rappel de ce point, le chapitre expose les principaux courants théoriques et de recherche qui ont participé à la constitution du domaine de l’évaluation des apprentissages : les travaux docimologiques, l’émergence de la distinction entre évaluation sommative et formative, la spécialisation des différentes fonctions de l’évaluation des apprentissages, l’élargissement conceptuel de l’évaluation formative à des fins de régulation des apprentissages et de l’enseignement. Le chapitre se clôt avec la mise en question de la théorie des objectifs et le renouveau apporté par les approches par compétences depuis les années 2000 dans le monde de l’école.
1. D’abord, des pratiques de classement et de notation
Peu de travaux scientifiques se sont attelés à faire « l’histoire de l’évaluation » comme l’a signalé Antoine Prost lors de son intervention aux Journées de l’évaluation à Paris en décembre 201417. Les quelques auteurs qui ont mené cette réflexion constatent que l’évaluation à l’école est d’abord appréhendée comme une question de notes et d’examens liées à des représentations fortement connotées : la note est associée à une « sentence » délivrée par un « jury ». Dans sa conférence, à partir d’exemples pris dans l’histoire en France, Prost rappelle qu’au 19e siècle les épreuves étaient orales et c’est le jury – tel un jury du tribunal ou des assises, compare le conférencier – qui décidait. Il n’utilisait pas de notes pour décider et, de l’avis même de Prost, « le passage de la sentence à la notation est extrêmement compliqué ».
Bugnard (2004) identifie deux mouvements principaux à l’origine de ce passage. Le premier est associé à un moyen disciplinaire : les notes et les examens remplacent les punitions et les châtiments corporels. Foucault (1975) compare l’examen à un dispositif de surveillance qui permet de qualifier, de classer et de punir. Les notes chiffrées « se sont peu à peu substituées aux châtiments corporels à l’issue d’une phase de transition centrée sur les motivations extrinsèques “douces” (punitions/récompenses ; honneurs/déshonneur) » (Bugnard, 2004, p. 94). La note récompense l’élève qui a bien travaillé ; elle punit le cancre.
Le deuxième mouvement est lié à un besoin social de différencier les élèves en fonction de leurs niveaux d’excellence. Maulini (1996) souligne que, dès le 16e siècle, les écoles des Jésuites ont proposé une éducation gratuite mais élitiste. L’éducation est rendue accessible autrement que par le seul critère de la naissance. Il s’agissait alors de « privilégier les plus méritants et d’éliminer les autres ». Placés en situation de concurrence perpétuelle (par le moyen de joutes oratoires, de récitations, de compositions, de concours, de prix, etc.), les élèves étaient répartis en des groupes hiérarchisés. Des plus méritants aux cancres, ces derniers étaient renvoyés. Les « thèmes », « versions » et autres « vers » que les élèves devaient produire faisaient l’objet d’une indication de rang (par ex. Xème sur Y élèves) qui, peu à peu, a été remplacée par une appréciation chiffrée, autrement dit une note. Des « billets », des prix, des tableaux récapitulatifs ponctuaient différentes périodes de formation (semaine, mois, trimestre, année) et contribuaient à redéfinir ou confirmer la catégorisation hiérarchisée des élèves. Si les pratiques variaient, comme l’observe Maulini, ces principes de notation chiffrée et de découpage temporel (note ponctuelle, appréciation globale après une période donnée) seront repris au 19e siècle par l’école républicaine. Malgré l’opposition de cette dernière à l’enseignement confessionnel des Jésuites, l’époque d’alors réclamait « un besoin de différenciation visible des personnes » (Bugnard, 2004, p. 95) qui s’est poursuivi jusque dans nos sociétés actuelles.
Ce bref aperçu historique souligne qu’on parle, dans ce cas-ci, de notes et d’examens. C’est seulement ensuite qu’on les associera à des moyens dits d’évaluation, parmi d’autres moyens, et au regard aussi d’autres buts que la sanction et le classement. Ce regard historique permet également de souligner que la notation scolaire, alors liée à des enjeux de discipline et de hiérarchisation des élèves, véhicule une représentation négative par rapport à des enjeux pédagogiques et éducatifs qui seront, dès la deuxième moitié du 20e siècle, revendiqués par l’évaluation des apprentissages. C’est certainement une des raisons qui a incité un ensemble d’auteurs à distinguer les notions de contrôle et d’évaluation en éducation et formation. Ainsi, Ardoino et Berger argumentent-ils dans leur texte de 1989 qu’évaluer n’est pas contrôler. Le besoin se fait sentir d’établir une différence conceptuelle entre ce que pourrait être une évaluation au service des apprentissages des élèves et de l’enseignement, et ces pratiques de notation et d’examens dont l’origine historique et les finalités s’apparentent à du contrôle normatif et social. Des avis plus nuancés sont aujourd’hui avancés par rapport à cette distinction entre évaluation et contrôle, souvent difficiles à dissocier complètement dans les pratiques.
2. La docimologie, première partie du 20e siècle
Dès la fin du 19e siècle, puis tout au long de la première partie du 20e siècle, des travaux scientifiques ont pris pour objets d’études les examens, leurs contenus, les méthodes de correction des épreuves et le comportement des examinateurs et examinés. Dans les années 1920, Piéron introduit le terme « docimologie », à partir de deux mots grecs, dokimé, épreuve, et logos, science. Il définit la docimologie comme étant « l’étude systématique des examens (modes de notation, variabilité interindividuelle et intra-individuelle des examinateurs, facteurs subjectifs, etc.) » (Parisot, 1988, cité par Bonniol & Vial, 1997, p. 57). Avec d’autres chercheurs, dont Laugier qui a publié avec des collaborateurs des études qui ont marqué le domaine entre les années 1927 et 1938, l’ambition est de créer une nouvelle « discipline », une « science des examens ». Elle est à l’origine de l’émergence du domaine scientifique qui, aujourd’hui, porte plus largement sur l’évaluation des apprentissages des élèves.
Il n’est pas inutile de rappeler quelques fondements de la docimologie. Dans la revue Histoire de l’éducation, Martin (2002) retrace les origines de cette science des examens associées à deux mouvements majeurs en France, la psychologie expérimentale qui « s’autonomise comme discipline scientifique à part entière sur le modèle des sciences expérimentales » et le développement de nouveaux courants pédagogiques « qui s’appuient en grande partie sur les applications éducatives de la psychologie » (pp. 2-3). De la docimologie, on a surtout retenu les différents facteurs d’influence (ou « effets ») qui font varier les jugements évaluatifs des examinateurs. Ils dénoncent la subjectivité des jugements évaluatifs qui mettent à mal la validité des examens. Des études fameuses ont marqué les esprits, donnant à voir d’importantes variations de notation entre plusieurs examinateurs, mais également pour un même correcteur à plusieurs mois d’intervalle. L’encart 1 résume les principaux effets dégagés par ces recherches. D’autres facteurs d’influence ont été mis en évidence depuis, dont « la constante macabre » (Antibi, 2003) qui désigne le phénomène consistant à attribuer toujours un certain pourcentage de mauvaises notes quelle que soit la qualité des réponses à l’examen.
Encart 1 : Les divergences de notations dépendent d’effets systématiques
« La docimologie repose sur les présupposés suivants : les copies d’élèves, à l’instar d’objets physiques sont mesurables et quantifiables ; les divergences de notation entre examinateurs résultent d’erreurs de mesure, elles sont donc réductibles ; il est donc possible d’améliorer la validité des examens et la fidélité des évaluations… La perspective docimologique a tenté de rendre compte des sources responsables de ces variations et d’expliquer les comportements des examinateurs. Quels sont les facteurs ou les situations responsables des écarts entre notateurs ?… Les notes attribuées dépendraient d’effets systématiques auxquels seraient sensibles tous les correcteurs » (Amigues & Zerbato-Poudou, 1996, pp. 135-136).
Principaux effets dégagés par les études docimologiques
Effet de fatigue ou d’ennui : cet effet peut engendrer laxisme ou sur-sévérité.
Effet de halo : le professeur, influencé par des caractéristiques de présentation de la copie (soin, écriture, orthographe) ou de l’élève, surestime ou sous-estime la note.
Effet d’assimilation : l’évaluation est influencée par les informations que le professeur possède de l’élève (statut scolaire de l’élève, origine socioéconomique, origine ethnique).
Effet de contamination : les notes/ points attribués successivement aux différents aspects d’un même travail s’influencent mutuellement.
Effet de tendance centrale : par crainte de sur-évaluer ou de sous-évaluer le travail d’un élève, le professeur groupe ses appréciations vers le centre de l’échelle.
Effet de l’ordre de correction et effet de contraste : l’évaluateur se laisse influencer par l’ordre des copies (les premières sont sur-évaluées) et par la qualité de la copie précédente. Un travail moyen paraîtra bon s’il suit un travail médiocre.
Effet de trop grande indulgence/ de trop grande sévérité : certains évaluateurs sont systématiquement trop indulgents ou trop sévères dans toutes leurs évaluations (personnalité des évaluateurs).
(Voir notamment les études citées par Amigues & Zerbato-Poudou, 1996)
L’analyse historique de Martin a pour intérêt de souligner les préoccupations sociales attachées aux travaux scientifiques des docimologues et des enjeux socio-éducatifs visés. L’auteur distingue trois grandes directions aux études docimologiques des années 1920-1940 : (1) une critique du caractère arbitraire de l’examen traditionnel. Par le recours aux méthodes statistiques, les chercheurs mettent en évidence des défauts structurels et les variations de correction intra et inter-examinateurs (voir encart 1) ; (2) l’étude des rendements scolaires qui visent à déterminer les caractéristiques psychophysiologiques des élèves examinés. Ici, le projet des chercheurs était de définir des groupes d’aptitudes en fonction des différents métiers (l’orientation professionnelle était une de leurs préoccupations), tout en croyant à « l’éducabilité ou la perfectibilité des aptitudes » ; (3) la fonction sociale de la sélection et la finalité de l’examen. Les chercheurs critiquent la confusion entre l’évaluation visant à contrôler les acquisitions liées à une formation donnée et l’évaluation dont la finalité est de déterminer les aptitudes des élèves par rapport à un programme de formation futur.18 Sur ce dernier point, comme le signale Martin (2002), le but des docimologues n’est pas de renoncer à l’orientation et à la sélection des individus, vues comme « indispensables à une organisation sociale rationnelle », mais ils plaident pour une évaluation de qualité, non arbitraire. Plus généralement, ces chercheurs revendiquent une fonction sociale à la science, c’est-à-dire assumant une « mission de réorganiser la société sur des bases à la fois plus justes et plus efficaces » (p. 5). La question éducative est alors centrale.
Après une phase de docimologie critique, comme le relève de Landsheere (1971), c’est-à-dire donnant à voir l’inconsistance et la faible fiabilité de la notation intra et inter-examinateurs, une deuxième phase constructive caractérise les travaux docimologiques dès la deuxième moitié du 20e siècle. Celle-ci vise à limiter la subjectivité des évaluateurs et à apporter des solutions face aux problèmes observés. Les docimologues proposent notamment d’expérimenter les questions d’examen au préalable, de répéter les mesures pour réduire les erreurs aléatoires, d’utiliser des banques d’items. On retiendra que la problématique des examens et de leur notation a d’abord été traitée dans une approche essentiellement de psychologie expérimentale. L’ouvrage de Noizet et Caverni (1978) en témoigne. Il est centré sur l’étude des processus de jugement des notateurs, la mise en évidence des facteurs qui les influencent, et la proposition de procédures visant à réduire les divergences de notation. Étudiée dans des orientations de psychologie sociale (e.g., Bressoux & Pansu, 2003 ; Butera, Buchs & Darnon, 2011), cette problématique est aujourd’hui traitée également dans des perspectives sociologiques d’orientation diverse (voir par exemple la synthèse de Merle, 2012).