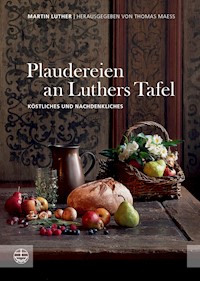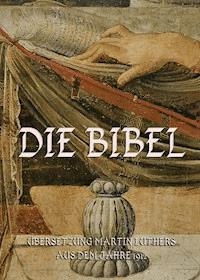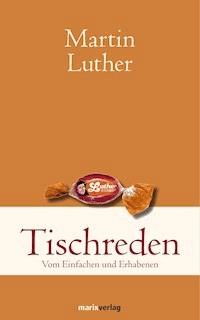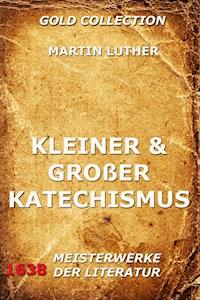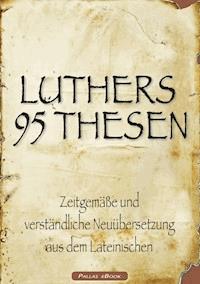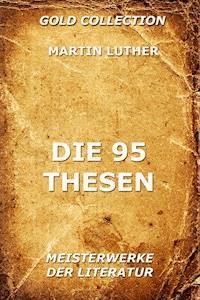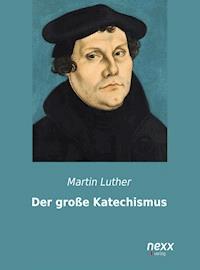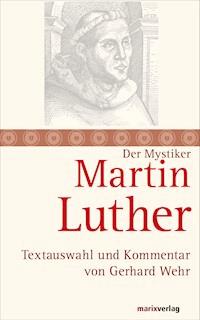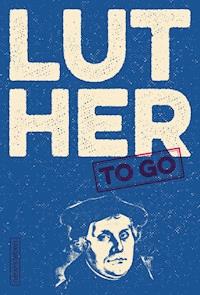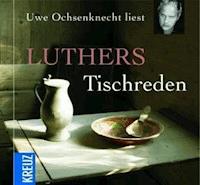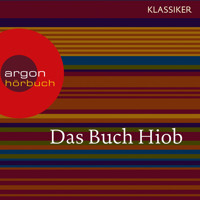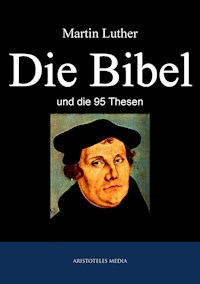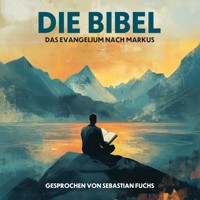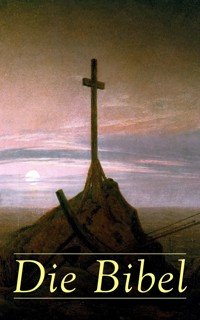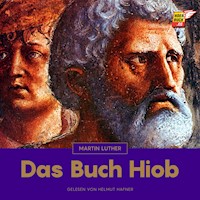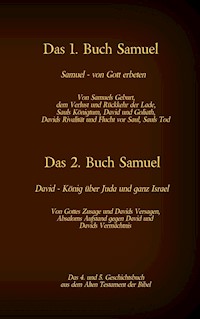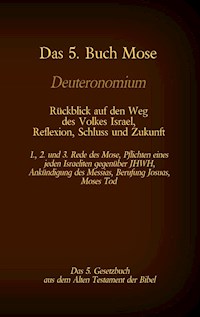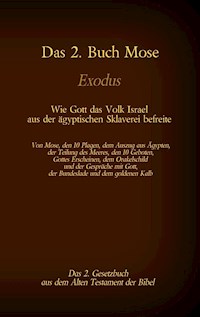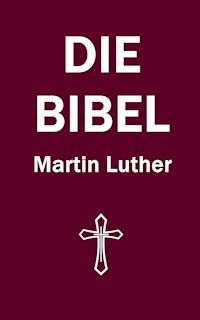Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Luther, qui a été un homme d'action, disait qu'il avait tant de choses à faire, qu'il devait consacrer au moins trois heures par jour à la prière, pour y parvenir... En 1517, l'année de l'affichage de ses 95 thèses, il y a tout juste cinq siècles, il fit paraître un traité d'une centaine de pages : Explication de l'Oraison Dominicale, qui fut l'un des premiers à être traduit en français, et qui eut un certain impact populaire. Trois siècles plus tard, un petit-fils d'Oberlin, le pasteur Louis Rauscher (1807-1840) le traduisit à nouveau de l'allemand en français. C'est son texte remanié par Frédéric de Rougemont (1808-1876), d'une étonnante fraîcheur, que nous présentons ici. En 1535, Luther installé à Wittemberg, à présent connu de toute l'Europe, reçut de son barbier, Peter Beskendorf, la singulière demande de lui apprendre à prier. Luther lui répondit par une lettre, naturellement beaucoup plus courte que le traité, mais où là encore il expose le sens du Notre Père, et montre le fruit qui peut en être retiré. Cette numérisation ThéoTeX donne en appendice la Simple Manière de prier, dédiée à mon ami, Maître Peter, le barbier. S'agissant des propres paroles de Jésus-Christ sur la prière, il est incontestable que le Notre Père restera jusqu'à la fin des temps le modèle par excellence de la prière chrétienne.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 158
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Table des matières
Préface
L’Oraison Dominicale
Invocation
Les sept demandes
Ton nom soit sanctifié
Ton règne vienne
Ta volonté soit faite
Notre pain quotidien
Pardonne-nous nos péchés
Ne nous induis pas en tentation.
Délivre-nous du mal
Dialogue entre l’âme et Dieu
Lettre à mon ami, maître Peter, le barbier
Préface
Luther avait à peine commencé de signaler publiquement les erreurs dans lesquelles était tombée la chrétienté, quand il publia son Explication de l’Oraison Dominicale, qui date de 1517. C’est un écrit populaire, un vrai traité religieux, destiné à faire connaître à toutes les classes de la société la vérité méconnue, à leur rappeler les éléments du vrai christianisme, à leur ouvrir les yeux sur leurs illusions et leurs péchés, et à éclairer leur entendement par la pure lumière de l’Évangile. La polémique contre les erreurs propres à Rome y occupe une très petite place ; celle contre les erreurs pratiques des chrétiens de tous les siècles et de toutes les communions, en occupe, au contraire, une très grande. En même temps, on ne peut assez admirer quelle profonde connaissance du cœur humain et quelles richesses d’expériences spirituelles ce petit livre suppose chez son auteur. C’est un cours pratique de religion, écrit par un homme dont le cœur est tout entier dévoué à son Sauveur, et l’esprit nourri du pain de vie. On y trouve exposé, avec une singulière originalité, la sainteté de Dieu, la corruption de l’homme, la lutte des deux royaumes, la nécessité de la repentance et de la conversion, le pardon des péchés, les devoirs des fidèles, leurs diverses tentations, les secours que Dieu leur donne. Ce n’est point un ouvrage systématique, ce n’est pas non plus un ouvrage complet ; nombre de points de détails ne sont qu’indiqués, tandis que d’autres sont développés au long. Mais rien d’essentiel n’y manque, et tout y est bien à sa place. Aussi cet écrit a-t-il survécu à la génération pour laquelle Luther l’avait composé ; et non seulement il témoigne avec éclat de la profonde piété de ce réformateur à l’entrée de sa carrière, mais il réveille encore de nos jours, en Allemagne, les consciences endormies, et, réimprimé par les sociétés actuelles de traités religieux, il se met de nouveau à « courir le pays, » comme au temps de son apparition 1.
Dès l’origine de notre société, M. Rauscher, alors pasteur à Saint-Dié, dans les Vosges, nous avait annoncé avoir en porte-feuille une traduction de cette Explication de l’Oraison Dominicale, à laquelle il n’avait pas encore mis la dernière main. Mais sa mort, si inattendue et si douloureuse pour tous ses amis, vint, après une année de ministère à Colmar, le surprendre brusquement au milieu de ses nombreux travaux. Nous lui devions la traduction des Cent Histoires et Anecdotes édifiantes ; nous lui devions surtout celle de la Vie de Vos, qu’on nous assure de toutes parts être lue avec un vif plaisir ; mais nous attendions encore l’Explication de Luther. Sa veuve et ses amis d’Alsace consentirent, sur notre demande, à nous confier ce manuscrit, et celui d’entre nous, M. FRÉDÉRIC DE ROUGEMONT, qui avait été en relations plus particulières avec feu M. Rauscher, et à qui il avait remis avec confiance la dernière révision de ses précédents manuscrits, se chargea de la correction de ce dernier, qu’il a faite avec tous les ménagements qu’exigeait une œuvre posthume.
M. Rauscher avait fait sa traduction, à ce que nous avons conclu de son travail, non sur une édition originale, mais sur une réimpression moderne, de laquelle on avait élagué quelques passages de polémique contre Rome, pour ne laisser subsister que ce qui allait à l’édification des protestants actuels ; et son but, en entreprenant cet ouvrage, doit avoir été moins de reproduire avec une fidélité historique les expressions même de Luther, que de faire de cette Explication un écrit d’une intelligence facile et d’une lecture aisée pour le public français, auquel il voulait la faire connaître. En un mot, il a désiré, si nous ne nous trompons, édifier ses frères avec Luther plutôt que de leur offrir Luther avec toutes ses originalités ou ses bizarreries, avec son style nerveux jusques à la rudesse, et parfois si prompt que l’enchaînement des idées en devient obscur. M. Frédéric de Rougemont a rétabli, non dans le texte, mais dans des notes, les passages de polémique, qu’il a la plupart abrégés ; et dans les endroits même où la traduction développait le texte au point de lui en faire un instant regretter la concision, il a trouvé la paraphrase si parfaitement conforme au génie de Luther, qu’il l’a partout scrupuleusement respectée. Ses corrections ont donc été peu nombreuses, et la plupart peu importantes.
Il y avait chez M. Rauscher une énergie de caractère, une vigueur de pensées, une force d’expressions qui devaient lui faire affectionner tout particulièrement le réformateur allemand, et qui nous font d’autant plus regretter son départ qu’elles sont plus rares dans notre siècle. Les accents de Luther résonnent parfois étrangement à nos oreilles, qui sont accoutumées à plus de douceur, de politesse et de ménagements; ils nous surprennent comme un violent orage surprend le vaisseau qui traverse des parages où ne soufflent d’ordinaire que des vents modérés. Peut-être plus d’un passage de cette Explication produira-t-il, chez tel ou tel lecteur, l’effet d’un reproche fait à l’improviste à qui le mérite ; on résiste, on s’irrite ; mais on ne peut arracher le dard de la plaie, et la blessure est une blessure salutaire.
Luther, en effet, a creusé si avant dans la corruption de son époque, et, d’autre part, les hommes de tous les temps se ressemblent tellement dans leur être moral, que les reproches qu’il adressait à son siècle papiste et pharisaïque sont encore vrais de notre époque saducéenne et rationaliste.
Nous l’avons dit, cette Explication est un traité populaire, ou, si l’on veut, une suite de méditations sur l’oraison dominicale. Comparez-la à l’exposition didactique que Calvin donne de cette même prière dans ses Institutions, liv. 3, ch. 20, et vous apprécierez, d’une part, l’opposition qu’il y a entre le génie analytique du réformateur français et le génie synthétique du réformateur allemand; d’autre part, leur grande conformité de doctrines à côté de quelques divergences de détails.
Ces divergences qui portent surtout sur l’efficacité du baptême et de la parole, sur l’explication de la quatrième demande et sur celle de la septième, s’expliquent par la date de l’écrit de Luther, qui n’avait pas encore entièrement secoué les erreurs de Rome, ou sont de trop peu d’importance pour mériter une discussion, ou enfin se rattachent aux caractères généraux du calvinisme et du luthéranisme. Nous rappellerons seulement que Luther cite, de temps en temps, les apocryphes avec les livres inspirés, sans nullement les assimiler à ces derniers.
Voici le premier écrit de Luther qui paraisse en langue française dans notre siècle. Serait-il le dernier, et n’encouragera-t-il pas quelques-uns de nos frères à tirer au jour quelque autre trésor des nombreux ouvrages du réformateur allemand? Ou si les différences de langage et du caractère national rendent de peu d’utilité pour nous les écrits de Luther, que l’Allemagne, qui en a publié récemment encore plusieurs éditions abrégées, à l’usage des chrétiens de toute condition, et qui y puise chaque jour une abondante nourriture, nous excite du moins par son exemple à rouvrir les écrits poudreux du grand réformateur français, qui sont fort rarement cités dans notre littérature religieuse, que, parmi nous, ne connaissent point les laïques, et qui, peut-être, sont plus lus au-delà du Rhin que dans nos églises !
SOCIÉTÉ POUR LA TRADUCTION D’OUVRAGES CHRÉTIENS ALLEMANDS.
1. Cet écrit est déjà connu de nos lecteurs, par les extraits qu’en a donnés Merle d’Aubigné dans son Histoire de la Réformation, tom. I, 3.10.
L’ORAISON DOMINICALE
Les disciples de notre Seigneur lui demandèrent un jour de leur enseigner à prier, et il leur répondit : « Quand vous priez, n’usez point de vaines redites, comme font les païens ; car ils s’imaginent être exaucés en parlant beaucoup. Ne leur ressemblez donc point ; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. Vous donc, priez ainsi :
Notre Père qui es aux cieux, Ton nom soit sanctifié ; Ton règne vienne ; Ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien. Et acquitte-nous nos dettes, comme nous acquittons aussi les dettes à nos débiteurs. Et ne nous induis point en tentation ; mais délivre-nous du mal. Amen. (Luc.11.1-4 ; Matth.6.7-13). »
Nous apprenons par ces paroles de Jésus-Christ 1o comment il faut que nous priions, et 2o ce que nous devons demander à Dieu; deux points qu’il est également essentiel de connaître.
De quelle manière faut-il qu’on prie ?
Faire peu de paroles, mais être pénétré profondément de ce que l’on dit, voilà la bonne méthode qui nous est recommandée par Jésus-Christ. Les prières qui se répandent le moins en paroles, sont les meilleures ; les prières verbeuses sont les plus mauvaises. Peu de mots, beaucoup d’âme, voilà la prière du chrétien. Abondance de discours et sécheresse de cœur, voilà celle du païen. C’est pourquoi Jésus-Christ dit : Quand vous priez, n’usez point de vaines redites, comme font les païens ; et à la femme samaritaine : Il faut que ceux qui adorent Dieu, l’adorent en esprit et en vérité, car le Père en demande de tels qui l’adorent (Jean.4.23-24).
La prière spirituelle est opposée, dans ce passage, à la prière corporelle ; la prière véritable, à celle qui n’est qu’apparente. Lorsqu’on se borne à murmurer des oraisons que la bouche profère sans qu’on les accompagne de ses pensées, c’est le corps qui prie et non pas l’âme, on adore Dieu en apparence, et non en vérité. La prière spirituelle et véritable, au contraire, est celle qui part du fond du cœur, élan, soupir, aspirations d’une âme qui cherche l’Éternel, et qui a soif du Dieu vivant. Celle-ci nous sanctifie et nous maintient dans une craintive humilité, tout en nous pénétrant d’une filiale confiance. L’autre rend hypocrite et donne lieu à une fausse et orgueilleuse sécurité.
Toutefois, il y a ici une distinction à établir, car on peut prier de trois manières différentes.
Et d’abord, par pure obéissance. C’est ainsi que les prêtres et les ecclésiastiques chantent et lisent les prières du culte public. Telles encore les prières que votre confesseur vous impose, ou celles que vous avez fait vœu de dire. Dans cette sorte de prières, ce qu’il y a à peu près de mieux, c’est l’obéissance, et elles doivent être mises au même rang que toute autre œuvre d’obéissance, pourvu qu’on les fasse avec simplicité, et non dans l’intention de gagner de l’argent, des honneurs, des éloges. Car telles sont les grâces ineffables attachées à la parole de Dieu, qu’encore qu’on ne la réciterait qu’avec la bouche et sans dévotion, elle ne laisserait d’être efficace et de faire mal au diable, à supposer toujours qu’on fût guidé en cela par un principe d’obéissance 2.
On peut prier, en second lieu, sans obéissance, soit à contre-cœur et avec répugnance, soit pour obtenir des richesses, des honneurs et des louanges humaines. Mieux vaudrait point de prières que de pareilles prières. Elles reçoivent sans doute ici-bas leur salaire en biens ou honneurs temporels. Mais ce sont précisément ses domestiques que Dieu paie, et non ses enfants.
Enfin, on peut prier par dévotion du cœur. Ici l’apparence se change en vérité, l’acte extérieur en un mouvement de l’esprit, ou, pour mieux dire, c’est la vérité cachée au fond de l’âme, qui rompt les digues du corps et qui fait éclater au dehors sa lumière. Or, il est impossible à celui qui prie avec ferveur et recueillement d’user de beaucoup de paroles. L’âme qui cherche à comprendre et à approfondir le sens des oraisons qu’elle récite, s’interrompt et s’arrête pour en méditer en elle-même les pensées et le contenu. Celui qui ne fait qu’entasser parole sur parole n’a pas le temps de réfléchir. C’est pourquoi les formulaires dont on se sert ne doivent être considérés que comme une impulsion, un choc donné à l’âme pour la faire entrer dans le cercle d’idées, de sentiments et de désirs qu’expriment les paroles de la prière. C’est ainsi que plusieurs psaumes portent en titre : « Louez l’Éternel, » c’est-à-dire que le peu de paroles qu’ils contiennent doivent exciter notre cœur à de pieuses pensées et à de saints désirs. D’autres psaumes sont coupés par le mot sélah (c’est-à-dire pause), qui ne doit être ni lu, ni chanté, mais qui se trouve placé là comme un banc de repos, qui nous invite à nous arrêter pour nous livrer à la contemplation des idées qui nous ont été présentées.
En quels termes nous devons prier, et ce qui doit être l’objet de nos prières.
Quant aux paroles dont nous devons nous servir lorsque nous invoquons Dieu, les voici : Notre Père, qui es aux cieux, etc. Car cette prière nous venant du Seigneur Jésus-Christ, nous ne pouvons douter qu’elle ne soit la prière la plus excellente, la plus sublime et la mieux appropriée à nos besoins. Si notre Seigneur en avait connu une meilleure, ce pieux et fidèle docteur n’aurait pas manqué de nous l’enseigner. Ce qui ne veut pas dire que toute autre oraison soit mauvaise, par là même qu’elle est conçue en des termes différents. Bien des saints personnages ont vécu avant la naissance du Seigneur, lesquels ne connaissaient pas ce formulaire. Mais ce que j’affirme, c’est qu’on doit tenir pour suspecte toute prière qui ne renfermerait pas le même sens et les mêmes pensées. Car les psaumes, par exemple, ne sont si propres à nous guider dans nos exercices de dévotions, que parce que l’Oraison dominicale s’y retrouve tout entière, quoique sans doute sous une forme moins précise et moins nette. Aussi ceux-là sont-ils dans l’erreur qui présument de comparer, ou de préférer même quelque prière que ce soit à celle du Seigneur 3, surtout lorsque c’est une prière qui a pour principal objet de demander la santé et une longue vie, des biens et des honneurs, ou encore la délivrance des maux temporels, toutes choses dans lesquelles l’homme cherche sa propre volonté et gloire, plutôt que la volonté et la gloire de Dieu.
L’Oraison dominicale se divise en deux parties. Il y a d’abord l’Invocation, ou introduction; ensuite viennent les sept demandes.
2. Nous trouvons dans ce paragraphe une des idées caractéristiques du luthéranisme, celle de la puissance mystérieuse que conserve la parole de Dieu dans les cas même où la foi est très petite et très faible. (F. R.)
3. Luther indique dans le texte les prières qu’il a en vue : les quinze prières de sainte Brigitte, les rosaires, les couronnes, etc. Saint Cyprien avait dit avant lui : « Peut-il y avoir une prière plus spirituelle que celle qui nous a été donnée par Celui-là même qui nous a donné le Saint Esprit ? et peut-on adresser au Père une prière qui lui soit plus agréable que celle qui est sortie de la propre bouche du Fils, qui est la vérité même? Ce n’est donc pas seulement une ignorance, mais une faute de prier autrement qu’il nous l’a enseigné, puisqu’il reproche aux juifs, Marc.7.8, de rejeter le commandement de Dieu pour établir leur tradition. » (Cyprien, de l’Oraison dominicale, au commencement). (F. R.)
Invocation
Notre Père, qui es aux cieux.
Pour bien prier, il faut savoir avant tout comment nommer et honorer Celui que l’on invoque, et comment l’aborder pour se le rendre propice et pour le disposer à écouter. Or, de tous les noms qui existent, il n’en est pas qui nous assure un meilleur accueil de la part de Dieu que celui de Père. Comme ce mot est doux et onctueux ! comme il est profond et comme il va au cœur! Seigneur, Dieu, juge, voilà des titres bien moins aimables et moins consolants. C’est la nature même qui a planté dans notre âme le nom de père, et qui l’a revêtu d’un si grand charme. Nul autre nom ne plaît autant à Dieu, et nul ne le dispose davantage à nous exaucer. En nous déclarant ses enfants, nous sommes sûrs d’émouvoir ses entrailles paternelles ; car, pour un père, ce qu’il y a de plus doux, c’est la voix de son enfant.
Nous ajoutons : qui es aux cieux, afin que ces paroles nous rappellent notre profonde misère, et nous excitent à prier Dieu avec ardeur qu’il daigne avoir pitié de nous. Car celui qui commence sa prière par ces mots : Notre Père, qui es aux cieux, et qui les prononce du fond de son cœur, confesse par là qu’il a, à la vérité, un père, mais que ce père est dans les cieux, tandis que pour lui il languit sur la terre, misérable et délaissé. De là doivent naître dans son âme de véhéments soupirs, comme ceux d’un enfant relégué loin du pays de son père, vivant parmi les étrangers dans la détresse et la misère. C’est comme s’il s’écriait : « Hélas ! mon Père, tu es dans le ciel ; et moi, ton pauvre enfant, je demeure sur la terre ; loin de toi je gémis dans la misère ; malheureux et proscrit, je passe ma vie au milieu des démons, des plus terribles ennemis, des plus redoutables dangers. »
Celui qui prie ainsi a le cœur bien placé vers Dieu, pour le fléchir et pour émouvoir sa miséricorde. Ces paroles sont d’une telle portée qu’elles ne sauraient sortir du sein de la nature humaine, à moins que l’Esprit de Christ n’y habite. Car, pour peu qu’on veuille y bien songer, on verra qu’il n’y a pas d’homme assez parfait pour dire en vérité : qu’il n’a pas de père ici-bas, qu’il ne possède rien sur la terre, qu’il y est entièrement étranger, que Dieu seul est son Père. Hélas ! telle est la perversité de notre nature, que nos yeux cherchent toujours ici quelque objet qui leur plaise, et que le Dieu du ciel ne suffit point à nos affections.
Ces paroles donc nous redressent et nous apprennent à ne mettre notre confiance qu’en Dieu, puisque lui seul nous peut introduire dans le ciel, selon qu’il est écrit : Personne n’est monté au ciel, sinon Celui qui est descendu du ciel, savoir le Fils de l’homme (Jean.3.13). Ce n’est que sur ses ailes que nous pouvons y arriver.
Aussi tout le monde doit-il faire cette prière, non seulement les savants, mais les simples ouvriers, et ceux-là même qui n’en peuvent mesurer toute la portée. Car je soutiens que la prière de ces derniers est souvent la meilleure ; c’est leur cœur qui parle plus encore que leur bouche.
[Dans l’édition originale sont ici quatre paragraphes dans lesquels Luther s’élève contre les prières des laïques et des prêtres, faites avec distraction et pour remplir sa tâche. « Ce n’est pas là prier, et Dieu dit à ces gens, par Esaïe.29.13) : « Ce peuple s’approche de moi des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » C’est