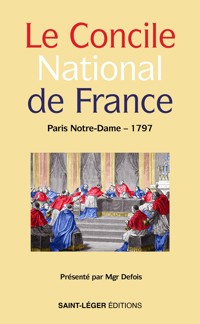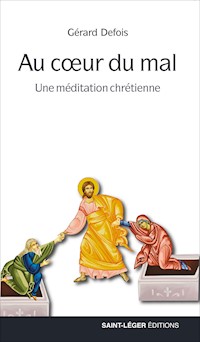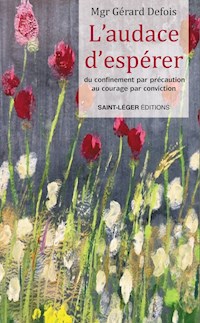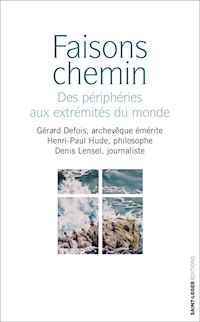
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Saint-Léger Editions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
L'évêque, le philosophe et le journaliste échangent leurs points de vue concernant l'unité des chrétiens face aux troubles sociétaux de l'époque contemporaine.
Notre mission est de poursuivre l’évangélisation des peuples jusqu’aux périphéries du monde. Nous, laïcs, prêtres et religieux, héritiers du concile œcuménique Vatican II cherchant l’unité des chrétiens, nous devons bien le comprendre et le mettre en œuvre dans la culture et la société d'aujourd'hui. Nous devrons aussi faire revivre le monde dans la paix, à l’heure où la guerre réapparaît aux portes de l’Europe, après la crise de civilisation révélée par la « crise sanitaire du Covid » : c’est le moment de changer nos modes de vie. Nous sentons la nécessité d’une « écologie intégrale » qui renouvelle la vie des familles et l’éducation des jeunes, car nous traversons un changement d’époque. En une série d’entretiens, un évêque sociologue et théologien à la longue expérience, un philosophe formé à l’étude de saint Thomas d’Aquin et de Bergson, et un journaliste informateur religieux et essayiste ont confronté leurs points de vue sur ces grands thèmes qui concernent l’avenir de l’Église et du monde.
À PROPOS DES AUTEURS
Mgr Gérard Defois, prêtre du diocèse d’Angers a été enseignant à l’Institut catholique de Paris, secrétaire général de la Conférence épiscopale de France (1973-1983), recteur de l’Université catholique de Lyon, archevêque de Sens-Auxerre, de Reims, où il reçut le pape Jean-Paul II, et de Lille. Émérite depuis 2008, il a été président des commissions Justice et Paix pour l’Europe (2009-2012).
Henri-Paul Hude est philosophe, auteur de plusieurs ouvrages dont Éthique des décideurs (Economica, 2013) et Ce monde qui nous rend fous (Mame, 2020). Ancien élève de l'ENS, docteur habilité, à été professeur à Rome (institut Jean Paul II, Université du Latran), directeur de "Stan", à Paris, puis du pôle d'éthique aux Écoles militaires de Saint-Cyr Coëtquidan. A fondé la société internationale d'éthique militaire en Europe et est membre du comité de rédaction de la revue Commentaire et a été membre du conseil scientifique de l'institut Montaigne.
Denis Lensel est journaliste et essayiste, auteur d’une dizaine d’ouvrages, spécialisé dans les questions religieuses, familiales et pédagogiques. Envoyé spécial en Europe de l’Est, en ex-URSS et à la conférence de l’ONU sur les droits des femmes à Pékin, il a suivi les voyages œcuméniques de Jean-Paul II dans les pays orthodoxes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 247
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Faisons chemin
des périphéries aux extrémités du monde
notre catalogue complet sur
saintlegerproductions
© Saint-Léger éditions, 2022.
Tous droits réservés.
Mgr Gérard Defois, archevêque émérite
Henri-Paul Hude, philosophe
Denis Lensel, journaliste
Faisons chemin
des périphéries aux extrémités du monde
1. L’itinéraire spirituel et pastoral de Mgr Gérard Defois
La vocation d’un engagement sacerdotal dans l’Église post-conciliaire et devant les nouveaux défis d’une société sécularisée, comme prêtre, évêque et enseignant.
2. La Politique : écrire l’Histoire entre guerre et paix ?
Comment garantir la liberté des peuples et préserver la paix à l’heure d’un retour de la guerre en Ukraine, après le siècle des génocides : un contexte de défis pour l’Europe, fait à la fois de menaces d’agression et d’échanges planétaires.
3. Devant la crise du Covid : crise sanitaire ou crise de civilisation ?
Une simple « crise sanitaire » ? ou bien le reflet d’une crise de civilisation ? Sera-t-on devenus meilleurs ou pires après cette crise ?
4. Les défis de l’Église :
a. Héritiers d’un testament spirituel méconnu
b. Un nouvel élan conciliaire vers les périphéries
Comment procéder à l’évangélisation du monde pour demain – Le rôle des laïcs–Comment appliquer aujourd’hui le Concile Vatican II, à l’heure de la Synodalité souhaitée par le Pape François
5. Quelle éthique pour une « Écologie intégrale » :
Le respect global de la vie de la conception à la mort naturelle, en passant par une morale du travail – La défense de la nature, création divine et cadre de vie des hommes.
6. Quel avenir pour la Famille :
Une solidarité naturelle toujours plébiscitée malgré ses difficultés, une nécessité humaine reconnue malgré la crise actuelle de l’engagement.
7. Quel Enseignement et quelle culture pour demain :
Quels objectifs pour former les jeunes ? Comment combler le vide de références et de valeurs transcendantes qui les guette, et comment leur donner une culture religieuse qui éclaire et alimente une intelligence croyante, apte à une recherche du sens de la vie.
Mgr Defois : un itinéraire spirituel et pastoral
« De mon temps, l’Église… »
C’est l‘expression qui me revient à l’esprit lorsque des catholiques de ma génération m’avouent leurs sentiments d’incompréhension devant les querelles de rites ou d’idées, voire d’habillement religieux qui surgissent ces temps-ci. Quand les médias érigent en scandale les protestations de « veufs de la chrétienté », ils l’imaginent accomplie hier dans les églises d’Alsace ou autour des calvaires bretons. Or le concordat d’Alsace à Strasbourg tout comme la statue de Jean-Paul II à Sainte Anne d’Auray est aujourd’hui remis en question par les instances administratives de notre République au nom de la neutralité de l’État. La laïcité est désormais envisagée comme la norme moderne justifiant l’exclusion de l’expression publique de toute religion. Au nom de quelle peur ?
Il me faut m’y résigner : né en terre d’Anjou en 1931 dans une famille rurale et catholique, toute ma formation a été traditionnelle. C’est dire qu’alors mon catéchisme ne consistait qu’en des réponses à apprendre par cœur, des prières à réciter quotidiennement et des promesses du baptême à honorer dès lors jusqu’à la « communion solennelle ». Ce n’est qu’à 22 ans, au séminaire, que j’ai appris le rôle central de la Résurrection du Christ dans la vie des baptisés comme le principe de la théologie catholique ; à 25 ans j’étais ordonné prêtre (en latin) pour le diocèse d’Angers et envoyé évangéliser les élèves des lycées publics de Cholet. En 1962, commençait un concile à Rome où, d’après les media de l’époque s’affrontaient les anciens et les modernes, sous le regard malicieux du bon Pape Jean XXIII.
Né dans la mémoire parentale de la guerre 14-18, formé par les Sulpiciens selon les directives antimodernistes du temps, envoyé en mission dans un territoire social de laïcité, ce monde de mes racines me prédisposait à tenir la rampe de la tradition pour accéder en 1950 à la pastorale missionnaire dont les catholiques français rêvaient comme d’une libération des attaches culturelles du Moyen Âge et de la « Contre-réforme » à l’encontre des protestants. Toutefois, selon les encycliques sociales récentes, une mission de résistance intellectuelle face au marxisme ou au libéralisme « saboteur du bien commun », gagnera les esprits. Car la France, où se cuit le pain de la chrétienté, selon la formule de Paul VI, ne saurait être en manque d’audace : il y avait les prêtres-ouvriers, les initiatives pédagogiques de la catéchèse, et surtout sous l’impulsion de Pie XI les mouvements d’action catholique. La France tenait les rênes de la mission face aux dérives de la tradition de l’Action Française et aux crispations de ceux qui craignaient une braderie de nos acquis et de nos sécurités. Mais aussi, en particulier nous savions que le Saint-Office d’alors était sur ses gardes face à des pasteurs gallicans de base séduits jusqu’au communisme par une adaptation moderne des pratiques et des théologies de notre Église de France. Mais nous voulions démentir Pie IX et son Syllabus de tentations modernes. Car il s’agissait d’adapter la tradition aux temps nouveaux pour parler un autre langage qui exprimerait la vie nouvelle de l’Église du Christ. Pour les incroyants d’aujourd’hui.
J’étais né entre deux guerres en 1931, et en 1956 je devenais prêtre entre deux conciles, car la prescription dogmatique du premier concile du Vatican, en recentrant l’Église sur le ministère de l’évêque de Rome – la théologie et l’exégèse biblique étaient surveillées par le Saint-Office du Saint-Siège – met à la source de l’évangélisation l’autorité de l’apôtre Pierre, lui attribuant ce service du contrôle général de la vérité de la foi des chrétiens. Sur ce point, les séminaires, les publications, les congrès d’exégètes étaient particulièrement observés afin de sauvegarder l’axe de la tradition apostolique comme référence obligée de toute expression publique ou privée de la foi. La conformité du langage était estimée comme une garantie de l’unité de la foi dans la vérité. Ce fut particulièrement ressenti en 1950 lors de la publication de l’encyclique Humani Generis de Pie XII. Elle précéda des sanctions sur des théologiens français, dominicains ou jésuites, dont le père de Lubac ou le père Congar qui se voyaient privés de leur mission universitaire d’enseignement.
Les hostilités mondiales avaient à leur origine l’Allemagne et les États européens construits sur des violences militaires, certes, mais aussi sur des systèmes idéologiques en concurrence violente : Bismarck et le Kulturkampf s’opposaient radicalement à la tradition populaire de l’espace géographique de l’Italie catholique où se trouvaient les États pontificaux. En particulier par une vision profondément antireligieuse de l’unité italienne sous un gouvernement marqué par la franc-maçonnerie de l’époque, un humanisme rationaliste. Ces mythes seront transformés en systèmes mussolinien ou nazi après la première guerre mondiale ; ils érigèrent en modèle politique une situation de désagrégation spirituelle et donnèrent lieu à de nouvelles formes de conquêtes politiques et sociales manifestant des ambitions de mainmise sur les nations européennes. De son côté, l’Église, sur le plan institutionnel, moral et politique, fut amenée à privilégier de nouvelles formes collectives d’expression, en particulier par les mouvements laïques d’apostolat implantés dans des classes sociales souvent antagonistes de la population, mais « bénis » par le Pape Pie XI.
De plus, nos concurrences européennes, après les épreuves du marxisme et de la violence nazie, se sont prolongées dans ce qui était alors appelé le Tiers-Monde. Les Papes ont compris assez tôt que les missions apostoliques et les missionnaires d’hier devaient dans ces régions en voie de développement laisser la place à des diocèses particuliers. Pour cela ils ont suscité un clergé autochtone qui, quoique formé selon les enseignements européens traditionnels, assurait une indépendance particularisée et donnait un visage propre à ces « églises » naissantes.
Nombreux alors furent les évêques d’Afrique ou d’Asie à découvrir l’Église universelle en venant au Concile de Vatican II. L’assemblée conciliaire elle-même était le reflet d’un monde où le marxisme et les persécutés du communisme, les européens meurtris et blessés de la guerre précédente, les nantis de la croissance selon l’économie libérale, accentuaient leurs différences et leurs difficultés de communication. Pour la plupart des évêques et des prêtres, ces trois années de travail et d’échanges conciliaires ont permis d’élaborer un langage commun, fondé sur les expériences intellectuelles de l’Europe la plupart du temps. Il en est ressorti des perspectives humanistes éclairées de la Bible et des œuvres des Pères de l’Église des premiers siècles de l’ère chrétienne, plus proches de l’expérience temporelle et d’une philosophie personnaliste que les formulations scolastiques abstraites de la tradition de nos séminaires européens d’alors nous avaient fait négliger au séminaire.
Je compris alors que si j’étais né entre deux guerres, j’avais été formé au séminaire d’Angers entre deux Conciles. Vatican I avait voulu solidifier le langage de la foi et de la théologie pour préserver les données essentielles de la Révélation par une tradition ferme face à l’anarchie des idéologies, à la fois culturelles et sociales, d’un dix-neuvième siècle post-révolutionnaire. Vatican II, selon les propos de Jean XXIII, espérait « infuser les énergies éternelles, vivifiantes et divines de l’Évangile dans les veines du monde moderne ; ce monde si fier de ses dernières conquêtes techniques et scientifiques, mais que certains ont voulu organiser en faisant abstraction de Dieu ». Paul VI reconnaîtra nos inquiétudes de jeunes prêtres d’alors, il en sera inquiet et le Concile l’avouera : « L’Église n’ignore pas quelle distance sépare le message qu’elle révèle et la faiblesse humaine de ceux auxquels l’Évangile est confié. » (Gaudium et Spes. n° 43.)
Bien qu’étant aumônier de jeunes dans un lycée d’Anjou, ayant contact avec divers mouvements sociaux particulièrement actifs, je me suis identifié à ce concile. Nous avions multiplié dans les années 60 des activités d’éducation ou de spiritualité particulièrement nombreuses, généralement approuvées par l’opinion publique des villes moyennes. Qui plus est, nous proposions des messages qui étaient perçus par les familles comme la réponse à leurs inquiétudes de parents, face aux incertitudes de la scolarisation massive voulue par tous pour ouvrir des carrières techniques dans une société en changement.
Les différents dossiers soumis aux quelque 3 000 évêques du monde entier furent travaillés longuement avec des experts, surtout théologiens, qui insufflèrent une régénération de la pensée théologique à partir de l’Écriture sainte et de la pratique pastorale. En termes d’intelligence de la foi ce fut pour tous les participants un rajeunissement par ce retour aux sources et une prise en compte de la pensée personnaliste du temps. Mais, comme l’a souvent rappelé Benoît XVI, ce qui a été communiqué au public par les journalistes fut souvent réduit aux joutes culturelles des anciens et des modernes en termes de nature politique et séculière ; le peuple de Dieu, y compris la majorité des prêtres, ne s’estimait pas directement concerné par les tensions entre le maintien du langage hérité de la scolastique et les formulations existentielles des « nouveaux » catéchismes ou des rites liturgiques, entre le maintien des rites d’hier et les expressions renouvelées de la même foi. Vatican II fut une découverte de la vitalité permanente d’une foi engagée, souvent espérée par les pasteurs et les spirituels, mais ignorée par la majorité des fidèles et des clercs qui en restaient aux traductions superficielles tant de la théologie que du sentiment religieux de l’opinion publique.
Personnellement, appelé par mon évêque à prendre en charge pour le diocèse la formation des catéchistes, j’ai suivi les enseignements de sciences humaines et de théologie du nouvel institut supérieur de pastorale catéchétique, avant d’en devenir l’un des chercheurs et des directeurs. Si l’émergence d’une théologie appuyée sur ces nouvelles rationalités a ouvert d’autres formulations de la tradition catholique, les médias et l’opinion publique en restaient aux controverses du passé et maintenaient le langage précédent devant l’insécurité culturelle qui perturbait les institutions catholiques et les communautés chrétiennes elles-mêmes.
Ce qui est notable alors, c’est que la tradition libérale a ébranlé nos institutions religieuses et culturelles, privilégiant le désir sur la règle, le ressenti sur le raisonnable, l’enthousiasme sur l’intelligence. C’est ainsi que les « événements » de mars à juin 1968 ont exprimé une émancipation des tutelles du passé et une anomie explosive qui remettait en cause toutes les formes hiérarchisées et instituées de notre culture européenne. La crise des langages et des repères qui s’en est ensuivie a été ainsi plus culturelle que sociale, plus morale qu’institutionnelle. Ceci devait provoquer une rupture généralisée des engagements et des alliances, sans que pour autant la sécurité traditionnelle des institutions et des traditions ne soit réinventée.
Bien sûr, la désagrégation des contraintes sociales ne pouvait se poursuivre dans un contexte où des parties importantes de nos populations perdaient des espoirs que les émancipations multiples ne pouvaient exaucer. Les étudiants et les jeunes des classes moyennes ont souvent été les acteurs d’un ordre social, moral et culturel cherchant à reconstruire pour assurer l’avenir. Les groupes politiques eux-mêmes n’ont pu comprendre le mouvement et répondre à des attentes fragiles, aussi les formations libérales ont repris le dessus et remis à plus tard les rêves d’une nouvelle société. La tradition est devenue la bouée de sauvetage de nos incertitudes, sauf pour ceux qui, tels les enfants des catégories dites « moyennes » de la population, n’avaient pas été initiés aux valeurs de ce passé.
Et l’on a vu les mouvements catholiques de jeunesse, les instituts religieux, les séminaires perdre leur nombreuse population d’hier et s’interroger sur la pertinence de leurs projets hérités des siècles précédents pour participer aux espoirs de réussite sociale des dernières années des « trente glorieuses ». Leurs parents accompagnaient de leurs vœux ces nouveaux projets dans leurs rapports à l’argent, à la technique, à la sexualité. À l’encontre, sur le plan religieux se développaient de multiples initiatives soit de communautés traditionnelles, soit de communautés nouvelles, toutes en marge des structures hiérarchiques de l’Église. Il s’agissait de faire des communautés, souvent autour d’un leader charismatique qui s’était établi comme le pivot solide d’une sorte de « famille spirituelle » forte de sa cohésion interne, affective et interpersonnelle et de sa mise à distance de l’institution ecclésiale par des différences accentuées. Nous savons les abus d’autorité, y compris en matière de sexualité, que cela a produit.
Les années 70-80 furent celles qui ont favorisé dans la mémoire des années 68 les plus radicales ruptures dans la conscience des Français. Si l’apparition d’un chômage massif de jeunes qui étaient déçus des résultats de leur formation, si les effets tragiques des conflits de la décolonisation fragilisaient nos convictions quant aux valeurs nationales et spirituelles, les relations dans le monde catholique se sont souvent éclatées au nom de l’esprit du Concile, interprété en marge des textes conciliaires réels qui étaient ignorés des protagonistes eux-mêmes. En fait, c’est l’insécurité d’un engagement total qui avait perdu son sens dans le service de la foi catholique, comme les valeurs de l’amour et de la fidélité dans la culture de consommation et de production matérielle qui a réduit les références morales, sociales et spirituelles, et qui a progressivement délité notre terroir traditionnel, entre autres, les familles. Ce qui a progressivement ébranlé tant la culture morale que la citoyenneté nationale et le socle chrétien de nos appartenances chrétiennes souvent d’origine rurale.
Cela nous l’avons vécu dans nos villages, nos associations communautaires et nos paroisses. Devenu alors membre du secrétariat de la conférence épiscopale j’ai été témoin des efforts des évêques français durant ces dix années pour comprendre ces changements, les interpréter selon la théologie pratiquée au Concile Vatican II. À Rome, après les malaises ressentis auprès de Paul VI déçu des mouvements divers créés par son enseignement en Humanae Vitae en août 1968 sur la contraception, puis ses interventions pour contenir les pratiques déviantes d’une part du clergé et les ruptures traditionalistes de Mgr Lefebvre, la venue de Jean Paul II a laissé espérer une reprise de l’espérance conciliaire comme ouverture réfléchie et modérée à l’intelligence de la modernité du temps présent. Certes, certains d’entre nous craignaient que ce pape polonais nous fasse « retourner en arrière », selon l’expression courante d’alors. Et il nous fallut plusieurs années et de nombreuses encycliques pour que soit reprise, en particulier par les Journées Mondiales de la Jeunesse, la dynamique d’évangélisation que nous avions considérée comme particulière à notre chrétienté française. Mais durant ce temps le nombre des prêtres s’est effondré, ainsi que les membres des communautés monastiques et apostoliques, fussent-elles dénommées « nouvelles ».
Analysant cette mutation, je pouvais en premier lieu y voir une baisse de la foi, comme certains l’ont dénoncé ces derniers temps. Mais une précision sociologique s’imposait, celle des transformations radicales que vivaient depuis 20 ans nos régions catholiques, en particulier la scolarisation des jeunes générations. Souvent les media et les intellectuels se référaient aux indicateurs préconisés par le chanoine Boulard en 1935 qui privilégiaient les formes de pratique dominicale de nos régions rurales de Bretagne ou d’Alsace. J’avais moi-même connu cette importance de la fréquentation des sacrements de l’Église catholique en Anjou et l’influence du milieu relationnel pour entourer les jeunes catholiques de plusieurs réseaux : groupes scolaires, groupes de loisirs comme les scouts ou les clubs sportifs ou les groupes eucharistiques des jeunes, surtout les mouvements divers d’action catholique, et ceci s’inscrivant plus ou moins dans la tradition des patronages du siècle dernier.
Mais le changement culturel fondant toute vérité sur la raison et sur les recherches scientifiques, y compris dans l’agriculture, a porté une grande partie de la population à privilégier les connaissances objectives et matérielles, et en conséquence à délaisser les vérités d’expression symbolique ou mystique. Au mieux à les prendre au sérieux à titre esthétique ou poétique. Ce fut pour la majorité des jeunes générations un désintérêt pragmatique pour la parole de l’Église et la réception des sacrements, y compris dans les milieux catholiques, le rejet de la « religion populaire » qui marquait traditionnellement notre « temps rural ».
Ainsi, devenant en 1984 recteur d’une Université catholique, je suis allé déjeuner avec un groupe d’élèves ingénieurs : ils revenaient de deux mois en Israël, ravis des plages et des bars de Tel-Aviv, mais aucun n’ayant aucunement eu l’idée d’aller à Jérusalem, d’autres revenant d’un séjour à Rome n’avaient eu aucune envie de visiter les lieux essentiels de la chrétienté. Ils n’avaient aucune prévention à l’égard de la foi catholique mais cette dimension religieuse et spirituelle du monde leur était étrangère, ils relevaient d’une culture dépourvue de sensibilité chrétienne. Et j’ai retrouvé la même indifférence religieuse chez nombre de parlementaires qui débattaient de la laïcité publiquement en mars-avril 2021. Ce qui révèle un manque de transmission familiale, notamment du fait d’une rupture de pratique dominicale et sacramentelle dans les familles catholiques depuis cinquante ans au moins.
Ce qui correspond aux années du grand développement économique de l’Europe : ce ne sont pas les changements du Concile qui sont en cause. Les débats et orientations de Rome ont été ignorés par les jeunes de mai 68, car leurs centres d’intérêt étaient essentiellement matérialistes et politiques. Les débats romains demeuraient déterminés par la suite de Vatican I et les questions importantes issues des philosophies athées de la culture de 1950, de l’existentialisme, du marxisme et de la pensée libérale. Mais les nouvelles ruptures morales ouvertes par la recherche scientifique en biologie, en communication et conquête de l’espace nous offraient des perspectives de puissance où l’homme devait atteindre la plénitude de ses rêves d’humanité.
Ne pas manquer la prise en compte de ces nouveaux espoirs de la richesse et de la puissance a conduit certains d’entre nous à négliger la piété traditionnelle, le langage des signes et des symboles sur lesquels reposait la tradition spirituelle des peuples d’Europe. L’humanisme d’une éthique spirituelle a été ressenti comme le support incontournable de l’expression actuelle de la foi chrétienne. Plutôt que de réinsérer les valeurs morales dans la continuité des pratiques de piété et de prière nous avons été portés à les contourner pour aborder un nouveau dialogue avec les puissances modernes de production et de communication, en attendant d’atteindre les appétits surexcités de consommation. Nous avons commis, nous dans notre pastorale, des erreurs dans la traduction contemporaine des « béatitudes » évangéliques. Mais il est néanmoins certain que les attentes universelles de réussite sociale et matérielle dans les années 1970 ont bouché la vue de l’essentiel : la relation est devenue possession, la temporalité immédiateté, le bonheur est réduit au désir individuel et à la subjectivité du ressenti. Nous en trouvons des traces dans les chants religieux produits en ces années de transformation des structures sociales et de quête générale de nouveaux langages.
En France pour le catholicisme, comme en Europe de l’Ouest souvent, nous avons été conduits à l’invention de « communautés charismatiques ». Souvent classiques dans leurs rites, mais confinées dans leurs différences. Chez les protestants, ce fut l’essor des évangélistes, plus généralement une pluralité de groupes d’émotions et de communication qui se sont multipliés en réseaux et en échanges interpersonnels. Chez les catholiques la ligne « lefevbriste » jouait sur les rapports de force à l’encontre de l’autorité par diverses formes de médiatisation contemporaine tandis que le courant moderniste s’évanouissait dans la libéralisation des mœurs et des allégeances. C’est dire combien l’évaluation de ce qui a été vécu à la fin du vingtième siècle alors que personnellement j’exerçais des responsabilités épiscopales, fut difficile, étant donné la multiplicité des données du temps et des interprétations de la tradition, mais néanmoins cela reste un devoir nécessaire pour interpréter l’avenir. Par ailleurs nous ne pouvons ignorer les vingt années de ministère papal de Jean-Paul II et l’éclairage de ses grandes encycliques, puis le contexte des changements politiques en France, l’évolution des pratiques et des repères en matière de sexualité qui va de la contraception en 1968 aux diverses formes de procréation pratiquées aujourd’hui dans le monde, en marquant la loi sur l’avortement. J’ai dû réfléchir avec la conférence des évêques sur ces risques graves d’intervention sur la vie, préparer des éléments de morale en matière de menace nucléaire et justifier des pédagogies d’enseignement religieux avec quelques cardinaux romains.
Le Pape Benoît XVI a subi les préjugés de ceux qui craignaient un « retour en arrière », qui dénonçaient une restauration des ambitions d’une chrétienté puissante par la « nouvelle évangélisation ». Son dévouement à la mission théologique que lui avait confiée le Pape Jean Paul II comme préfet du dicastère de « la Doctrine de la Foi » l’a conduit à réaffirmer les points d’attache de la conduite chrétienne sur la vie et sur la nature dont sont issus les repères moraux de l’existence chrétienne. Dans la vacuité éthique de notre politique internationale et la dérive des libertés contemporaines, le cardinal Ratzinger a su s’imposer à contre-courant des mythes modernes dominants. Néanmoins, en dépassant les habituels paradigmes médiatiques, nous percevons dans ses écrits le fil conducteur de sa vision du monde, il est essentiellement christologique. Mais en lisant ses écrits les moins connus nous remarquons que sa réflexion émerge d’une prise en compte de l’histoire de l’Église et des travaux de ses prédécesseurs. J’avoue avoir ainsi totalement renouvelé mon ecclésiologie, puis mon interprétation du message de Jean-Paul II sur la nouvelle évangélisation. Déjà en 1974, en préparant ma thèse de doctorat sur la « Révélation » selon Vatican II, j’avais repris quelques conférences du futur Pape, écrites et prononcées en 1980. Depuis j’ai découvert combien sa propre thèse écrite dans le sillage de Romano Guardini avait fait difficulté pour son jury très marqué par une anthropologie scolastique.
Tout ceci nous conduit à relever l’enjeu intellectuel de la réflexion chrétienne aujourd’hui. Nous souffrons d’un déficit philosophique radical dans une culture « auto-référentielle » dit le Pape François, c’est-à-dire répétitive et fermée sur elle-même. Une tradition qui ne réagit pas aux interrogations du temps demeure prisonnière du banal d’hier et du « même » d’aujourd’hui, elle est sans avenir, abandonnée à sa reproduction. Or le pasteur est affronté au quotidien fluctuant des choses et des hommes. C’est pourquoi Benoît XVI a écrit trois encycliques qui nous font relire dans notre temps les repères et les sources chrétiennes : l’espérance, la charité, et la foi enfin qu’il cosigna avec François, son successeur. En chacun de ces domaines nous faisons en Église avec le Pape une traversée des espaces culturels où s’entrecroisent les histoires et les civilisations, et nous prenons conscience de la fragilité des convictions des héritiers de la chrétienté que nous sommes. Depuis cinq siècles, par négligence, nous en avons bradé l’héritage, et notre inculture morale et spirituelle favorise tant les errances que les reniements.
Désormais en fin du voyage de ma vie pastorale, je note combien nos instances de formation d’enfants, de jeunes ou d’adultes sont faibles par rapport aux nouvelles formes de pouvoir sur la nature, sur la sexualité et même la mort. De la procréation manipulée artificiellement à la fin de vie traitée en termes techniques et économiques, nous sommes devant la responsabilité d’évaluer le prix de la vie humaine, pour les nôtres et leurs descendants. Rabelais pourrait nous redire combien « science sans conscience n’est que ruine de l’âme », cela devient une urgence mondiale pour assurer la survie de ce qui nous a fait naître. Là aussi la prospective anthropologique et spirituelle du cardinal Ratzinger devrait être appelée pour orienter nos responsabilités communes. Et là, il ne suffit pas de reprendre les enseignements d’hier, l’évangélisation nous demande une œuvre d’intelligence concrète. Et le devoir moral déborde les sentiments personnels, nous voyons par les épreuves que nous infligent les pandémies modernes que la responsabilité est de plus en plus universelle et intégrale, comme le répète constamment le pape François. Comment, malgré toute une vie consacrée à l’intelligence de l’homme, du temps donné au nom de la foi, ne pas être préoccupé de l’avenir de ce que nous avons fait naître ?
En 1968, je recevais d’Europe, d’Afrique, du Canada, d’Amérique latine, des prêtres et des catéchistes de bon niveau qui venaient à l’Institut catholique de Paris découvrir les pédagogies innovantes de la pastorale française. Et ceci dans la suite du concile Vatican II où tant de théologiens français s’étaient illustrés. Leurs compatriotes arrivaient, eux, comme ouvriers ou étudiants pour quelques années, en vue d’enrichir leur capital économique ou technique. Mais aujourd’hui ils s’installent en famille pour leur existence et veulent partager à demeure toutes nos richesses. Notre voisinage est de plus en plus universel et leur venue passe par des tragédies de « survie », en particulier pour des jeunes venus d’Afrique. La conséquence en est une pluralisation des composantes sociales, culturelles et religieuses du tissu de nos cités. Or ceci produit des concurrences multiples et des conflits de citoyenneté dans un système « national » ébranlé par des incertitudes d’identités, y compris à l’intérieur de chacun des habitants.
J’ai consacré beaucoup de temps à la rédaction d’un ouvrage : « La laïcité, une religion nationale ? » qui voit le jour dans un contexte où l’islam est mis en procès par diverses instances françaises. La question des migrations de populations pratiquant l’islam devient une épreuve culturelle et morale pour les traditions culturelles et sociales de la France. Et cela ne doit pas être sans effet sur les traditions religieuses et ethniques de notre pays. En retour, notre système politique veut élever des barrages législatifs inspirés des lois laïques du dix-neuvième siècle, s’interdisant ainsi de comprendre les enjeux d’un autre temps et d’une autre culture. Par là même le christianisme est lui-même contesté dans son identité spirituelle. Et nous voyons les enjeux d’un débat spirituel en profondeur évacués en raison d’un matérialisme sans avenir autre que les violences de la répression.
Nous évoquons souvent la situation de l’Église comme de l’Europe en termes de crise ou de défis. J’ose récuser ces concepts paresseux qui empêchent le courage de l’intelligence et sont l’étonnement naïf des bavards. Depuis Abraham, la promesse comme l’espérance sont devenues crise et rupture, le don de sa vie est devenu un défi à la mort par la foi, l’amour une promesse de l’universel. Nous allons dans ces pages tenter de débattre sur notre temps comme ensemencement de l’avenir de la foi et de l’espérance en cette humanité.
La politique : écrire l’histoire entre guerre et paix ?
Le destin de la France, de l’Europe et du monde
Denis Lensel : En 1917, l’année de sa mort, l’écrivain catholique visionnaire Léon Bloy avait intitulé les dernières pages de son Journal « Au seuil de l’Apocalypse ». On en était à la quatrième année de la Première guerre mondiale, cette « guerre civile européenne » qui tournait au suicide collectif… Outre ses guerres très meurtrières, le XXe siècle allait être une époque de génocides : après le massacre des Arméniens en 1915, le « Holodomor » de 1932-33 en Ukraine, la « Shoah » des nazis contre les Juifs, les massacres de la Chine maoïste, le génocide cambodgien de 1975, le Rwanda en 1994… En outre, une « culture de mort » s’est répandue à l’intérieur des pays « développés », avec la banalisation de l’avortement et l’introduction de l’euthanasie.
En outre, guerres et massacres ont repris au XXIe siècle, d’abord au Moyen-Orient, avec la guerre en Irak… Et voici qu’avec le conflit en Ukraine, la violence guerrière arrive aux portes de l’Europe… La vie humaine avait-elle jamais été aussi menacée à l’échelle internationale qu’aujourd’hui ?
Mgr Gérard Defois : Non sans quelque prétention, je dirai que la « culture de mort » a toujours sévi, mais qu’au cours de ce XXe siècle, elle a changé de nature. Hier il s’agissait de guerres de conquête de territoire ou de négligence habituelle en matière de sécurité dans le travail, les millions de morts lors des guerres royales de Louis XIV ou impériales de Napoléon, les terribles ethnocides en Vendée ou en Arménie revêtaient pour les belligérants la légitimité d’un drapeau ou d’une liberté à défendre. Aujourd’hui, si nos armées vont au feu pour assurer la sécurité et la paix dans le monde, la culture de mort