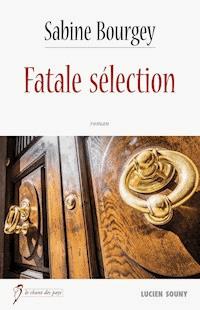
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions Lucien Souny
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Le chant des pays
- Sprache: Französisch
Le monde des antiquaires est en émoi : trois d'entre eux sont assassinés...
Les prétendants sont nombreux, mais la sélection sera draconienne… L’Exposition, un des plus grands salons d’antiquaires, se prépare, et tout le milieu est en effervescence en attendant l’attribution des stands. Les enjeux financiers sont colossaux, sans compter le prestige que confère la présence à cet évènement. Dans ce contexte particulièrement tendu commence alors une série de meurtres qui vise les grands noms de la profession. L’assassin n’a rien d’un psychopathe. Il tue proprement, sans intention de faire souffrir. Il fait preuve d’un pragmatisme sans faille et il possède une connaissance minutieuse du marché, de la littérature d’épouvante et des séries policières américaines. Il opère la plupart du temps dans des lieux emblématiques, usant d’une bonne dose d’audace et d’ingéniosité. Alors que l’enquête piétine, les professionnels, cédant à la panique, font appel, selon leurs penchants, à un coach, à un voyant ou à un garde du corps, pour déjouer le sort. Mais rien n’arrêtera le meurtrier…
Découvrez un roman riche en dialogues ciselés et en rebondissements loufoques qui analyse le cœur des hommes et leur carburant : ambition, amour, culpabilité...
EXTRAIT
Ils poussent la grille de l’impasse. Le tueur vient régulièrement y consulter une rhumatologue connue qui a soigné sa capsulite, il sait que le lieu est assez peu fréquenté. Ils commencent à marcher côte à côte dans l’allée pavée. Collignon trouve le cadre charmant. L’assassin qui sent sa cheville le tirailler en marchant sur les pavés inégaux se demande s’il a choisi le bon endroit. Mais au moins, il n’y a personne. — Regardez cette porte avec ses deux cobras dressés, c’est vraiment splendide! annonce-t-il avec enthousiasme, en indiquant à l’expert l’entrée d’un immeuble Art déco où deux serpents se font face.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Sabine Bourgey, experte en monnaies, est à la tête du cabinet fondé par son grand-père en 1895. Elle a été vice-présidente durant une dizaine d’années d’un grand syndicat professionnel du marché de l’art. Elle est l’auteure de nombreux articles et de livres sur la numismatique, sur les trésors mais aussi sur des sujets de société. Elle a également signé un polar, en 2012,
Le Trésor de la rue Mouffetard (Éditions Bourgey).
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 231
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Pierre-Alain repère aussitôt le logo noir et blanc sur l’enveloppe, au milieu du courrier. Il va enfin savoir quel stand lui a été attribué pour l’Exposition, il attend cette lettre depuis un bon moment.
Cher Monsieur,
Nous avons bien reçu votre courrier de candidature pour la prochaine Exposition ; nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à cette XXVIIIe édition. La commission Exposition est au regret de vous informer qu’après examen, votre candidature n’a pas été retenue.
En espérant pouvoir vous accueillir lors d’une édition future.
Veuillez agréer, cher Monsieur, mes sincères salutations.
Pierre Gaillard, président de la Compagnie des grands antiquaires.
Pierre-Alain est atterré, il relit la lettre et sent monter une bouffée de colère. Il est à deux doigts de balancer, de rage, un vase Gallé qu’il ne parvient pas à vendre, ce genre d’objet étant un peu passé de mode, mais il se souvient à temps que c’est un dépôt d’un confrère. La commission Exposition n’a pas retenu sa candidature ! Pas un mot d’explication et aucune motivation pour ce refus, comme l’administration !… après examen, votre candidature n’a pas été retenue, cela ne veut strictement rien dire ! Il est d’autant plus déçu qu’après deux tentatives infructueuses il était cette fois persuadé d’être accepté.
À cinquante-deux ans, Pierre-Alain Jurançon ne fait plus exactement partie de ceux que la presse du marché de l’art qualifie de jeunes antiquaires, même s’il ne paraît pas son âge. Un visage aux traits réguliers, de grands yeux bleus, il affectionne les cravates et les pochettes vives ainsi que les montres de marques. Quand il s’est aperçu qu’il commençait à perdre ses cheveux, il a pris le parti de se raser complètement la tête. Toujours très soigné, il fait preuve d’un narcissisme encore assez raisonnable. Il a débuté dans une petite boutique du boulevard de Courcelles, comme assistant d’une vieille antiquaire italienne, impécunieuse et fort distinguée, flanquée d’une particule et d’un titre incertains. La marquise Lavinia d’Asfeld lui a appris les bases de la pratique commerciale ; il n’avait à l’époque que quelques connaissances théoriques, glanées à l’Institut d’art et à l’École du Louvre.
Il se souvient encore de ce très charmant chargé de cours qui disait à ses élèves de première année : « Que ceux d’entre vous qui n’ont pas de père ou d’amant antiquaires sortent de la pièce ! Vous n’avez aucune chance de réussir dans ce milieu ! » Évidemment, personne n’était sorti, mais il lui faut bien reconnaître, trente ans plus tard, qu’il y avait du vrai dans cette remarque !
Sa compétence, sa grande gentillesse et l’enseignement de la vieille marquise lui avaient permis de se faire rapidement une place dans le domaine du mobilier et des objets des XVIIIe et XIXe siècles. Il est vrai qu’il avait été très aidé par le carnet d’adresses de ses parents, tous deux avocats à Lyon, et par les relations de quelques amants commissaires-priseurs et décorateurs. À la mort de Lavinia, il avait changé de rythme de vie en achetant une boutique rue du Bac, dans le 7e arrondissement, près du quai Voltaire, dans le fameux Carré Rive Gauche où se trouvaient de très nombreuses galeries.
Il ne s’était pas compliqué l’existence et avait juste suivi son goût qui était celui de son milieu d’origine : les meubles et les tableaux du XVIIIe siècle avec quelques objets du XIXe. Un homme profondément classique, parfaitement honnête et qui n’aimait pas les complications.
Depuis quelques années lui est venue l’envie de participer à l’Exposition, l’ultime consécration professionnelle pour un antiquaire. Il existe bien des salons d’antiquaires à Paris, celui d’Auteuil, le Pavillon des Arts décoratifs…, sans parler de quelques salons éphémères qui n’ont jamais rencontré leur public. En raison de son faste et de son rythme, l’Exposition reste, à ce jour, inimitable et inimitée.
Elle est la grande œuvre de la puissante Compagnie des grands antiquaires et – cas unique pour un salon – elle a lieu tous les deux ans. Parce qu’elle est censée réunir la crème des antiquaires français et européens et quelques galeries américaines, il y a beaucoup d’appelés et peu d’élus puisqu’une centaine de stands seulement sont disponibles. Claude Portinari, un confrère spécialisé dans les tableaux orientalistes, clame toujours que faire l’Exposition est l’équivalent pour les antiquaires de l’obtention du Label Rouge pour les poulets ! Il reste encore une année avant la prochaine édition et déjà la tension monte pour l’attribution des stands.
La vieille Lavinia lui avait maintes fois retracé l’histoire de l’Exposition, avec son charmant accent italien :
— Tu sais, mon chéri, c’est dans les années cinquante qu’est née l’idée d’une Foire des antiquaires de France, et quelque temps plus tard, sous l’impulsion du président de la Compagnie d’alors, un expert en faïence, à la moustache blanche très IIIe République, le projet s’est concrétisé. La toute première Exposition s’est tenue en 1956, à la Foire de Paris, porte de Versailles. J’y suis allée bien sûr ! Je me souviens qu’on pouvait voir des commodes XVIIIe, des livres rares, des monnaies anciennes, des tableaux qui côtoyaient des réfrigérateurs et des fours. C’était tellement amusant et pas snob !
— Ça devait être roulant ! Quand on pense à l’Exposition aujourd’hui ! avait rétorqué Pierre-Alain.
— C’est André Malraux, le ministre de la Culture, qui lui a ouvert les portes du Grand Palais, et la Foire des antiquaires est alors devenue « l’Exposition ». Elle se tenait tous les deux ans. Et en 1964, le Bal des débutantes a eu lieu dans l’Exposition. Jacques Chazot, le danseur mondain de l’époque, valsait avec des jeunes filles intimidées, sous l’œil attendri de leurs parents. Il était tellement drôle, cet homme ! Qu’est-ce que j’avais pu m’amuser cette année-là ! Et je n’étais déjà plus une débutante, chéri ! avait-elle ajouté coquettement.
— C’est à ce moment que l’Exposition est devenue un événement social important ?
— Très important même ! Parce qu’au fil des ans on a vu des actrices, des politiques, des couturiers, qui se sont mêlés aux clients riches et moins riches. Sans compter le dîner de charité donné au profit de la Fondation des Hôpitaux de Paris, de Bernadette Chirac, qui a achevé de donner un aspect mondain à la manifestation.
Pierre-Alain sait que l’organisation de cette foire d’antiquaires était rapidement devenue la principale activité de la Compagnie, le joyau de sa couronne et le théâtre de bien des intrigues. Après quelques années au Carrousel du Louvre, l’Exposition était revenue en 2006 aux fastes de son lieu précédent, « sous l’iconique verrière du Grand Palais », comme l’expliquaient alors les communiqués de presse.
Mais l’épineuse question qui ressurgissait régulièrement au conseil d’administration était de savoir s’il était opportun ou non d’annualiser cette manifestation. Il s’agissait alors de s’aligner sur la TEFAF de Maastricht, autre exposition prestigieuse qui était devenue sa grande concurrente. De nombreux journalistes n’hésitaient pas à dire désormais que cette dernière était beaucoup plus intéressante sur le plan commercial.
D’autres salons d’antiquaires, comme la célèbre BRAFA qui se tenait depuis plus de soixante ans fin janvier à Bruxelles, connaissaient également tous les ans un vif succès. Au fil du temps, plusieurs audits très documentés avaient été réalisés pour trouver une réponse à cette question. Il s’agissait « de se nourrir d’autres approches », pour reprendre la terminologie des communicants. Mais ces études n’avaient pas apporté de réponses significatives dans un sens ou dans l’autre. L’annualisation était un sujet qui revenait toujours, à date fixe, comme les articles sur les régimes au mois de mai ou ceux sur la retraite au mois de septembre, dans les magazines. C’était en quelque sorte le marronnier de la Compagnie. Les avis étaient partagés au conseil. Certains considéraient que l’Exposition était unique en son genre, que l’annualiser en ferait un salon parmi d’autres et qu’elle perdrait cette aura d’exception et de glamour. « Et comment va-t-on l’appeler ? L’Annale, peut-être ? » se demandaient toujours quelques esprits subtils. D’autres pensaient qu’il fallait s’aligner sur les autres foires.
Trois mois auparavant, en faisant son tour de salles à onze heures à l’hôtel des ventes de la rue Drouot, Pierre-Alain était tombé sur Pierre Gaillard, l’actuel président de la Compagnie.
Âgé de quarante-cinq ans, ce dernier est expert en archéologie. Doté d’un physique tout en rondeurs, il a des yeux gris perçants et une voix basse qui rendent intéressants la plupart de ses propos, ce qui l’a beaucoup aidé dans sa carrière. Il a une vraie passion pour l’art romain.
Celle-ci lui était venue après que ses parents, tous deux professeurs d’histoire, l’eurent emmené visiter Pompéi lorsqu’il n’était encore qu’un enfant de huit ans. Cette ville fantôme l’avait ébloui. Le goût de l’Antiquité ne l’avait plus quitté depuis et il avait eu la chance de faire de sa passion un métier. Encouragé par sa famille, il avait fait un doctorat d’histoire romaine et avait obtenu une bourse de l’École de Rome. Il avait vingt-six ans et passa des moments merveilleux dans cette ville, il tomba amoureux de plusieurs Italiennes et eut un coup de foudre pour le musée étrusque de la villa Giulia. À son retour en France, il avait choisi de s’orienter vers le marché de l’art, plutôt que vers l’enseignement ou la recherche, au grand dam de ses parents qui y virent une sorte de trahison.
Pierre-Alain lui avait expliqué qu’il souhaitait vivement exposer l’année prochaine. Gaillard avait approuvé et l’avait même invité à déjeuner au Café Drouot, un des deux restaurants qui se trouvent en face de l’hôtel Drouot. Tout en dégustant le pot-au-feu du jeudi, une des spécialités de la maison, les deux hommes avaient parlé métier. Pierre Gaillard avait évoqué avec une foule de détails les difficultés de sa présidence, les pressions diverses des membres pour obtenir ceci ou cela, sa famille recomposée, ses vacances dans la maison familiale en Savoie. Il lui avait même montré la photo d’une idole cycladique qui devait être l’objet phare de son stand à la prochaine Exposition.
— Regardez la modernité des formes de cette idole féminine, ces lignes épurées. On croirait presque une œuvre de Brancusi. Et dire que cette statue a vu le jour il y a près de cinq mille ans en plein cœur des civilisations égéennes !
Son enthousiasme était évident, mais Pierre-Alain ne tenait pas à passer le déjeuner à discuter de la statue antique. Il le ramena sur d’autres sujets comme la fréquentation moindre des galeries, les ventes publiques, la multiplication des salles de vente autour de Drouot, les changements de goût des clients et surtout son intention d’exposer à l’Exposition. Gaillard avait trouvé l’idée excellente et l’avait assuré de son soutien.
— Envoyez-moi votre candidature rapidement. On va vous trouver un stand ! lui avait-il dit avec chaleur en le quittant.
Pierre-Alain avait pris cela pour une acceptation en bonne et due forme. En tant que président de la Compagnie des grands antiquaires, Gaillard était évidemment membre de la fameuse commission Exposition qui a pour tâche de sélectionner les exposants. Elle est composée de membres du conseil d’administration et de quelques personnalités du marché de l’art.
Pierre-Alain a enfin cette année des meubles et des objets « de qualité Exposition » puisqu’il n’a pas hésité à s’endetter lourdement auprès de sa banque pour acheter un superbe pastel d’Odilon Redon à un client très au fait des prix. Celui-ci, ayant besoin d’argent rapidement, ne voulait pas passer par la vente publique. Il a également fait l’acquisition d’une spectaculaire console demi-lune, avec un dessus en marbre blanc supporté par une farandole de femmes drapées à l’antique en bois doré, qui date du début du XIXe siècle et dont il espère beaucoup.
À présent, la lettre de refus à la main, il se laisse tomber lourdement sur une chaise Charles X. Ne pas pouvoir faire l’Exposition est pour lui une vraie catastrophe. En optimiste invétéré, il a déjà parlé de sa participation future à cette manifestation à plusieurs de ses clients. Il a même demandé à Gérald de Menthon, décorateur en vogue, avec qui il a eu une petite liaison des années auparavant, de lui concevoir son stand. Celui-ci lui a déjà dessiné plusieurs projets. Il faut absolument qu’il expose ! Il décide d’appeler aussitôt Gaillard à sa galerie. Coup de chance, il est là et ne se défile pas !
— Tout le monde me téléphone au sujet de l’attribution des stands, mais je n’y peux rien. C’est la commission d’admission qui décide, et, avec les nouvelles règles de sécurité, nous avons eu moins de stands que prévu. Le Grand Palais nous a collé des obligations drastiques et nous avons dû réduire la surface réservée aux exposants. Comme nous avons eu plus de demandes qu’il y a deux ans, on est très embêtés.
— Oui, mais vous m’aviez dit… Vous savez, j’ai acheté un Odilon Redon exprès pour le mettre à l’Exposition ! Merde quoi !
— Je sais bien, mon pauvre vieux ! Je sais que je vous ai promis un stand, mais c’était avant cette foutue réunion. Je suis vraiment désolé, mais je n’y peux rien. Vous savez, je vous le répète, c’est la commission qui prend les décisions. Nous privilégions toujours les anciens exposants – enfin, ceux qui n’ont pas eu de problèmes, achève-t-il perfidement. Je n’ai pas mon mot à dire. Je ne suis que président, vous savez.
Pierre-Alain sent que son interlocuteur s’en fout allègrement et a un discours bien rodé. Gaillard poursuit :
— Tout ce que je peux vous proposer, c’est de vous mettre en tête de la liste 2.
— Qu’est-ce que c’est, la liste 2 ?
— C’est la liste d’attente. Si un stand se libère, on vous le propose. Je vais vous mettre en premier. Je suis vraiment navré, soyez-en sûr !
Pierre-Alain raccroche, furieux, et quitte sa galerie vers dix heures trente pour se rendre à pied rue Drouot, comme il le fait presque tous les jours. En arrivant au carrefour Richelieu-Drouot, il appelle sur son portable sa grande amie Caroline qui est membre du conseil depuis plusieurs années.
— Salut ! C’est moi. Tu es occupée ?
— J’ai un rendez-vous à onze heures au cabinet.
— Donc tu as le temps de prendre un café.
— O. K., je descends, mais vite !
L’hôtel Drouot – la salle, comme l’appellent les habitués – ouvre à onze heures tous les jours, sauf le dimanche, pour exposer les objets qui seront vendus l’après-midi ou le lendemain. Ces expositions drainent une foule de marchands, de clients, de curieux en tout genre. C’est encore assez amusant de se balader de salle en salle en cherchant quelques trouvailles à faire, bien qu’avec le développement d’Internet les vraies découvertes soient de plus en plus rares. Pour les professionnels, c’est aussi une façon facile de faire des relations publiques, car on rencontre une bonne partie de la galaxie antiquaires et commissaires-priseurs. Le tour de salle du matin permet même de récupérer quelques factures impayées et de faire du charme aux clients.
Pierre-Alain et Caroline ont leurs habitudes à La Cave Drouot, l’autre bistrot en face de Drouot, juste à côté de la mairie du 9e, car Pierre-Alain a décrété qu’on y a une meilleure vue sur les allées et venues de ceux qui entrent dans la salle et en sortent. Le Café Drouot n’a pas de vue directe, mais on peut y faire un loto, ce qui leur arrive de temps en temps. Le décor de La Cave a été refait quelques années auparavant, après qu’une conductrice un peu âgée ait défoncé les baies vitrées du restaurant en voulant faire une marche arrière. Elle n’avait pas l’habitude des voitures automatiques. Un client de Pierre-Alain qui prenait son café tranquillement à ce moment-là avait fait un vol plané et en parlait encore !
Derrière le bar circulaire, façon établissement branché, Luc, un titi parisien, longue tige pâlotte et grande gueule, s’occupe des habitués. Bien des affaires se concluent autour de ses tables.
Ce jour-là, Pierre-Alain s’installe et Caroline le rejoint cinq minutes plus tard. Ils se sont connus une dizaine d’années auparavant lors d’un trajet en train et ont tout de suite sympathisé. Caroline est petite, brune avec un joli sourire ; elle aime les couleurs vives, les bijoux et, en règle générale, tout ce qui brille. Elle est experte en monnaies, spécialité qui semble toujours austère, voire rébarbative, au tout-venant. Son cabinet est situé dans l’immeuble face à la salle.
Elle aime à raconter que, quand elle va dans des dîners, elle a souvent droit aux mêmes réactions.
— Vous travaillez ?
— Oui, je suis dans le marché de l’art.
— Ah ! quelle chance ! C’est passionnant ! Vous êtes dans quel domaine ?
— La numismatique.
— Ah ? (Le ton est tout de suite refroidi.) C’est les timbres !
— Mais non ! Ce sont les monnaies.
— Bien sûr ! C’est ce que je voulais dire ! Et vous en vivez ?
— Chichement, mais je n’ai pas de grands besoins !
Ce jour-là, elle est vêtue d’un tailleur noir, égayé par de nombreuses chaînes dorées et argentées. Elle pose sur la table son sac corail Versace et demande à Pierre-Alain :
— Alors ? Quoi de rigolo ?
— Oh ! rien de rigolo ! Figure-toi que je n’ai pas de stand pour l’Exposition, mais d’ailleurs tu es sûrement au courant puisque tu es au conseil !
— Je l’ignorais. Nous n’avons pas encore vu la liste des exposants, mais, comme c’est une mauvaise nouvelle, je préfère que tu l’apprennes par la voie officielle !
— Je suis vraiment furieux parce que Gaillard m’a laissé penser, quand j’ai déjeuné avec lui, que c’était pratiquement sûr et certain. C’est une vraie tuile. Tu as un stand, toi, bien sûr ?
— Oui, tu sais, l’Exposition, je la fais depuis dix-huit ans.
— Bon, ben, c’est bien ! Mais, pour en revenir à mon cas, ce crétin de Gaillard a dû promettre des stands à plein de gens…
— Il y a des chances ! Tu l’as eu depuis au téléphone ?
— Oui, tout à l’heure.
— Et qu’est-ce qu’il t’a dit ?
— Il m’a parlé des problèmes de sécurité, de la commission d’admission. En fait, il m’a dit n’importe quoi pour se débarrasser de moi, il s’en fout !
— L’histoire de la sécurité, c’est vrai !
— C’est quand même pas de pot ! Il m’a parlé de liste 2 ; je serai en tête en cas de désistement possible.
— Je serais toi, je n’y compterais pas trop. Les exposants ne se désistent pas, sauf s’ils sont en faillite ou s’ils claquent !
— Merci de m’encourager.
En rentrant chez lui pour déjeuner, Pierre-Alain raconte toute l’affaire à Étienne. Ils vivent ensemble depuis trente ans. C’est un couple solide et très fortuné avec, comme dans beaucoup de couples, des hauts et des bas.
Étienne Mallaval, plus vieux que Pierre-Alain de dix ans environ, est un des dermatologues les plus réputés de Paris. Il s’est mis quelques années auparavant à la médecine esthétique ; le Botox, l’acide hyaluronique et le laser lui permettent désormais de gagner extrêmement bien sa vie. Il fait de temps en temps des injections à Pierre-Alain, mais lui se contente de se faire blanchir les dents par un ex-amant dentiste qu’il pique en contrepartie avec un peu de Botox à la fin de la séance. Doté d’un physique passe-partout, son intelligence lui tient lieu de séduction.
Né à Issoire, il est resté provincial dans l’âme. Il aime les belles maisons, les bons vins, et rien ne lui plaît plus que de lancer dans la conversation le nom de ses clients connus. Il déteste, dans l’ordre, les écologistes, la diététique, les États-Unis, le rock, les féministes et l’art contemporain. Les deux hommes se sont installés depuis une dizaine d’années dans un grand appartement de la rue d’Assas qui donne sur le jardin du Luxembourg.
Étienne compatit et s’indigne ; il est franchement navré pour Pierre-Alain qui est évidemment, à ses yeux, un des plus grands antiquaires de Paris. En matière d’objets d’art, ils ont le même goût très classique, avec une prédilection pour les dessins et l’argenterie. Ils restent totalement réfractaires, l’un comme l’autre, à tout ce qui est art moderne. Ils sont de dignes représentants de ce que l’on appelle le « vieux goût ». Le bon docteur ne se montre pas plus encourageant que Caroline :
— En tête de liste 2 ? Tu es optimiste ! Tu sais bien que les promesses n’engagent que ceux à qui on les fait, tu connais l’expression ! À ta place, je n’y compterais pas trop. Pour une fois, ta grande copine a raison !
— Merci de m’encourager !
— Sois réaliste !
— Ce qui m’ennuie sur le plan fric, c’est le dessin d’Odilon Redon. J’étais sûr de le vendre à l’Exposition !
— Tu le vendras à la galerie.
— Sans doute, mais pas au même prix ! Je te dis que c’est une catastrophe. En plus, je l’ai payé trop cher, et tu sais que j’ai fait un emprunt.
— Qui décide de l’attribution des stands ?
— La commission de l’organisation de l’Exposition, qu’on appelle la « commission Expo », en fait. Le conseil a son mot à dire et je suppose que Gaillard aussi, surtout avec son caractère. En plus, j’en ai parlé à Gérald qui a commencé à faire des croquis pour le stand.
— Écoute, que tout cela ne te coupe pas l’appétit ! Gérald se fera une raison. Thanarani nous a fait des soles grillées et un crumble aux poires. En plus, on a reçu ce matin le panier de légumes de ce maraîcher dont je t’ai parlé, tu sais, celui qui me fournit les légumes de saison un peu rares. Il y a notamment des panais…
— Des panais ?
— C’est un légume racine appelé parfois carotte blanche…
— Fous-moi la paix avec tes panais, avec ta manie des légumes bizarres. Je vais te dire, je préfère une purée même en sachet ! D’ailleurs, je n’ai pas faim !
— Tu es odieux !
Claude Portinari, un des grands spécialistes français de tableaux orientalistes, ouvre la lettre à en-tête noir et blanc de la Compagnie, la lit et lâche un « putain de merde ! » tonitruant qui fait sursauter la jeune femme longiligne qui travaille depuis quinze jours dans sa galerie de la rue de Provence. Elle lui jette un regard inquiet, elle a encore du mal à s’habituer à ses coups de gueule et à son vocabulaire de charretier. Quand elle a eu son diplôme de l’École d’art et de communication, elle s’attendait à trouver un autre job que celui d’assistante dans cette boutique un peu vieillotte avec un antiquaire mal embouché. Mais lui, au moins, se montre assez pédagogue et paie très correctement ses collaborateurs. De temps en temps, il l’invite même à déjeuner sans essayer de la draguer. Elle compte se spécialiser dans le mobilier des années cinquante et espère s’installer un jour à son compte. Travailler avec Claude Portinari est un début qui en vaut un autre.
Soixante ans, grand, massif, un visage carré aux traits lourds, des cheveux poivre et sel très épais, une éternelle cigarette aux lèvres, toujours vêtu de vestes claires, il aime à cultiver une attitude un peu décalée qui est devenue son image de marque. Personne ne l’a jamais vu avec une cravate ; il affectionne les foulards genre aventurier des années quatre-vingt. Au moment de la guerre d’Irak en 1991, il a arpenté le quartier et la salle des ventes en treillis, lui qui a été réformé et qui supporte mal la vue du sang !
— Ces salopards ne veulent pas que je fasse l’Exposition. Écoutez-moi ça : Nous vous confirmons aujourd’hui que, par manque de place, nous ne serons malheureusement pas en mesure de vous proposer un stand. C’est encore un coup de ce fumier de Royer, j’en suis sûr. Je ne sais pas pourquoi, il me déteste ! Appelez-moi Gaillard et vous me le passez dans mon bureau.
— Tout de suite.
La conversation dure cinq minutes à peine. Portinari appelle par la suite plusieurs membres du conseil d’administration et reste environ une heure au téléphone. Quand il sort de son bureau, il est rouge et a l’air furieux. Il écrase sa cigarette dans le vide-poche qui traîne sur le bureau de sa collaboratrice et lui demande :
— C’est à quelle heure mon rendez-vous avec mon client italien ?
— À treize heures. J’ai réservé au Petit Riche, comme vous le souhaitiez.
— Il est temps que j’y aille.
Elle n’ose pas lui poser de questions précises, mais a néanmoins des réponses circonstanciées.
— J’ai eu ce crétin de Gaillard. Ça ne se passera pas comme ça ! De toute façon, l’Exposition, je la ferai. Ils ne me connaissent pas ! S’il le faut, je leur colle mon avocat dans les pattes !
Robert Guilhou fulmine, la lettre de la Compagnie à la main, dans sa galerie de la rue de la Grange-Batelière. Il est spécialisé dans les armes anciennes, dans les souvenirs historiques et dans les objets de la fin du XVIIIe siècle. Il fait autorité dans son domaine après avoir commencé sa carrière aux puces, car il a une incroyable connaissance de la période napoléonienne et une impressionnante bibliothèque.
— Évidemment, ils doivent penser que je ne suis pas assez bien pour eux ! Et pourtant j’ai fait leur foutu Salon « Art et collection » par pur esprit confraternel ! Moi, mes objets sont de meilleure qualité que ceux de Narishkine ou d’Haimery qui font l’Exposition depuis dix ans. À la dernière BRAFA, on a fait un tabac ! C’est tout de même moi qui ai exposé la paire de pots-pourris en bronze doré de Matthew Boulton ! Je vais aller leur foutre mon poing dans la gueule à ces messieurs de la commission Expo, ça va pas faire un pli !
— Calme-toi, Robert ! À quoi ça sert de te mettre en boule ? Tu vas encore me faire une migraine ! Tu sais comment ça se passe dès que tu t’énerves !
Christiane, sa femme, possède un robuste bon sens en accord avec son physique de blonde opulente. Elle est toujours couverte de bijoux, avec des décolletés avantageux qui ne se sont que peu restreints malgré ses cinquante-huit ans. Elle porte, dès dix heures du matin, des vestes de couleurs vives avec des strass aux poignets et un rang de diamants au cou. Ce style lui vaut encore de fervents admirateurs. Elle le connaît par cœur, son Robert, et, après trente-cinq ans de mariage, elle l’aime comme au premier jour.
— Tu ne te rends pas compte ! Je tablais sur l’Exposition pour me refaire une image.
L’antiquaire sort d’un procès pénible avec un client très connu qui a contesté l’authenticité d’un objet acheté cinq ans auparavant. Il vient de gagner en appel, mais reste très contrarié par cette affaire.
— Je me rends compte aussi bien que toi, mais tu dramatises toujours ! Pratiquement, qu’est-ce que tu vas faire ?
— Je ne sais pas encore, mais ils peuvent compter sur moi, je vais réfléchir à la question ! Je vais déjà appeler Gaillard, je vais même aller le voir directement dans son bouclard de la rue de Verneuil. Je te le dis, cocotte, l’Exposition, je vais la faire !
— Je ne sais pas pourquoi j’ai accepté d’être président, Vanessa. Portinari et Guilhou dans la même matinée, c’est trop ! gémit Pierre Gaillard auprès de sa collaboratrice.
Elle travaille avec lui depuis dix ans et elle a déjà entendu ce refrain à plusieurs reprises.
— Tous ceux à qui on a refusé un stand, et ils sont une bonne vingtaine, vont m’appeler. Dieu merci, c’est la commission Expo qui décide des attributions ! En plus, il y en a plein qui n’ont pas le niveau, mais ça je ne peux pas leur dire. Moi, j’essaie de faire plaisir à tout le monde, mais c’est pas évident. C’est décidé, c’est mon dernier mandat !
— Vous plaisantez ?
— Non ! J’y pense sérieusement.
* * *
Jacques Royer est un des grands noms de la tapisserie ancienne ; il possède depuis une trentaine d’années une vaste galerie rue de Beaune. L’assassin, qui passe régulièrement devant ses vitrines, a repéré que la secrétaire de l’antiquaire part généralement vers dix-huit heures, et que ce dernier reste souvent seul, parfois jusqu’à vingt heures. Un an auparavant, il lui a acheté une charmante tapisserie représentant une scène de chasse dont il ne se lasse pas. Il décide de tenter sa chance ce mercredi vers dix-neuf heures trente.
Il aime beaucoup ce coin du 7e arrondissement. En dehors d’une crue de la Seine, que les médias ne cessent de prévoir depuis des années et dont les conséquences seraient dramatiques, il ne trouve que des avantages à ce quartier. Il est cependant consterné de voir qu’il y a depuis quelques mois un SDF au coin de la rue de Beaune et du quai Voltaire. L’homme fait-il ses affaires ? Rien ne prouve que les gens soient plus généreux dans les quartiers chics que dans les quartiers populaires.





























