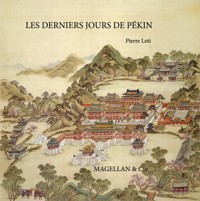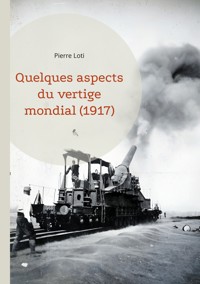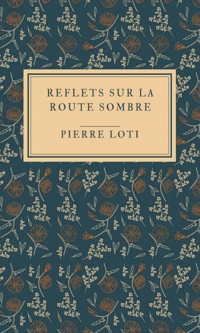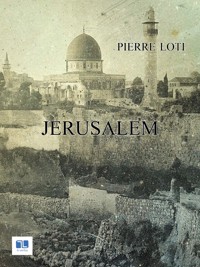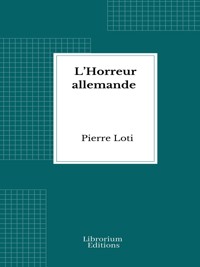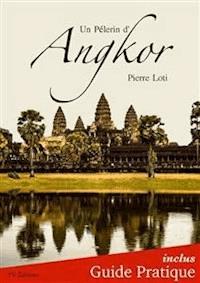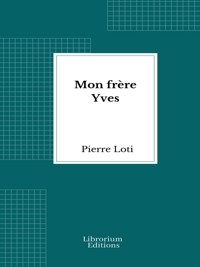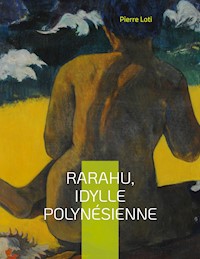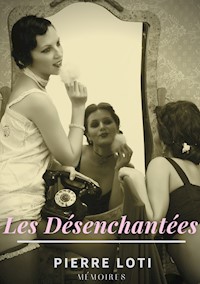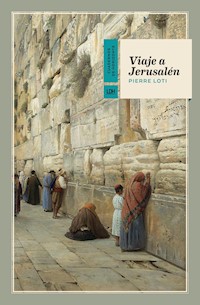Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Figures et choses qui passaient est un recueil de récits de voyage écrit par l'écrivain français Pierre Loti. Publié en 1893, ce livre nous emmène à la découverte de différents pays et cultures à travers les yeux de l'auteur.
Pierre Loti, de son vrai nom Louis Marie Julien Viaud, était un officier de marine et un écrivain reconnu pour ses récits de voyages exotiques. Dans Figures et choses qui passaient, il nous transporte en Orient, en Afrique du Nord, en Asie et en Océanie, nous faisant découvrir des paysages magnifiques, des coutumes étranges et des rencontres inoubliables.
À travers ses descriptions vivantes et ses observations perspicaces, Loti nous offre un regard unique sur des cultures lointaines et des peuples méconnus. Son style d'écriture poétique et évocateur nous plonge au cœur de ces contrées lointaines, nous permettant de ressentir la magie et l'exotisme de ces lieux.
Figures et choses qui passaient est un véritable voyage littéraire, une invitation à l'évasion et à la découverte de l'autre. Ce livre captivant nous transporte dans un monde lointain et mystérieux, nous offrant un regard fascinant sur des cultures et des paysages extraordinaires. Une lecture incontournable pour tous les amateurs de récits de voyage et d'aventures exotiques.
Extrait : ""Ce que je vais écrire est pour ceux qui, dans les cimetières, contemplant quelque fosse à peine fermée que les premiers bouquets blancs recouvrent encore, se sont sentis tenaillés jusqu'au fond et déchirés, au souvenir de petits yeux candides, éteints là sous la terre affreuse..."""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 217
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335003024
©Ligaran 2014
5 décembre 1894.
Ce que je vais écrire est pour ceux qui, dans les cimetières, contemplant quelque fosse à peine fermée que les premiers bouquets blancs recouvrent encore, se sont sentis tenaillés jusqu’au fond et déchirés, au souvenir de petits yeux candides, éteints là sous la terre affreuse…
Oh ! l’énigme déroutante et sombre, que la mort des petits enfants !… Pourquoi ceux-là, au lieu de nous, qui avons fini et qui, si volontiers, accepterions de partir ?… Ou plutôt, pourquoi étaient-ils venus, alors, puisqu’ils devaient s’en retourner si vite après avoir subi l’inique châtiment d’une agonie ?… Devant leurs tombes blanches, notre raison et notre cœur se débattent, en détresse révoltée, au milieu de ténèbres…
Le petit être délicieux, dont je voudrais prolonger un peu la mémoire en parlant de lui, était le fils unique de Sylvestre, – un domestique à nous qui est devenu, après dix années, presque quelqu’un de la famille.
Il n’avait vu que deux fois les étés de la terre. Ses cheveux de soie jaune, comme on en met aux poupées, se partageaient en drôles de petites mèches, rebelles aux coiffures. Son teint était comme celui des roses de Bengale, ses traits comme ceux des anges ; il avait une petite bouche toujours ouverte, au-dessus d’un menton un peu rentrant qui lui donnait une naïveté adorable. D’ailleurs, le plus joyeux des innocents bébés, tout au bonheur nouveau d’exister, de respirer, de se mouvoir ; plein de vie et de santé fraîche ; potelé, musclé comme les Amours païens.
Mais son charme surtout était dans ses yeux, de grands yeux bleus assez enfoncés sous l’arcade du front, des yeux de candeur, de confiance et aussi de continuel étonnement devant toutes les choses de ce monde…
À Paris, ce matin gris de décembre, dans une chambre d’hôtel quelconque, sans nouvelles depuis quatre jours, arrivant d’un voyage du Nord, j’ouvre au hasard une de mes lettres prises à la poste restante. – Et elle commence ainsi : « Hier au soir, à huit heures, cet amour de petit Roger mourait dans d’affreuses souffrances. Nous le pleurons tous, et Sylvestre fait une pitié profonde… »
… D’abord, je tourne sur place et je marche, vite, comme sous la poussée et l’exaspération d’une douleur physique… Ensuite, je reprends la lettre, pour continuer de savoir : c’est le croup, qui l’a emporté en quelques heures, au milieu de l’affolement de ceux qui le soignaient…
Je marche encore, détaillant sans savoir pourquoi les objets, les laideurs de cette chambre, repoussant du pied des choses qui m’entravent pour passer, – le temps de bien comprendre l’inexorable réalité de ce que je viens de lire, et puis, tout à coup, un nuage, je n’y vois plus – et je pleure…
L’idée ne m’était jamais venue que ce petit Roger pouvait mourir… Et puis, non, je ne croyais pas qu’il avait pris tant de place en moi, ce petit-là, je ne pouvais pas croire que je l’aimais tant !… Est-ce qu’on sait d’ailleurs pourquoi on aime tel petit être qui ne vous est rien, plutôt que tel autre qui vous touche de plus près : c’est quelque chose qui va des yeux dans les yeux, qui vient de la toute petite âme candide et neuve, pour pénétrer doucement jusqu’au fond de la vôtre, lassée et morne…
Dans ce même courrier, une dépêche, qui attendait aussi depuis deux jours à la poste restante : « Je suis dans la peine. Notre petit Roger mort. – SYLVESTRE. »
Maintenant je regarde les dates. Tout cela est déjà d’avant-hier ! Donc, on l’emportera au cimetière ce soir, et il est trop tard, je n’ai aucune possibilité d’arriver, aucun moyen humain de revoir la chère petite figure, même rigide et pâlie…
Roger Couëc, c’était le titre qu’il se donnait à lui-même quand on lui demandait : « Comment t’appelles-tu ? » (Couëc, une abréviation à lui du nom de son père, qui est un nom de Bretagne aux rudes consonances de granit.) Quand il prononçait ce Couëc, il était comique si gentiment, qu’on le lui faisait toujours redire – et, de retrouver aujourd’hui ce petit mot enfantin, de le réentendre en souvenir, me fait mal affreusement.
Ici, à Paris, où je devais m’arrêter, j’avais mille choses à faire, tant de rendez-vous arrangés ; des amis comptaient sur moi pour des dîners, des gens m’attendaient pour régler des questions importantes… Rien de tout cela n’existe plus ; sans seulement m’inquiéter de les avertir, je veux au plus vite m’en aller, rentrer chez moi, dans ma maison – où pourtant va manquer pour toujours cette petite fleur qui était Roger Couëc.
Mais je n’ai de train possible pour m’emmener que ce soir et, pendant tout un long jour désolé, il va falloir attendre dans cette chambre, ou bien errer dans les rues ; au milieu d’ambiances indifférentes ou hostiles, être sombre et seul, en révolte outrée et sans espoir contre la cruauté stupide de la mort, qui ferme de tels petits yeux, qui fauche de tels petits anges pour les coucher dans son charnier…
« Je suis dans la peine. Notre petit Roger mort. » Tandis que les heures suivent leur marche lente, je fais comme une revue de cette existence de deux étés – chaque instant qui vient, après la stupeur première, martelant en moi plus profondément la notion que c’est à tout jamais fini…
Oh ! sa petite voix dans la cour de notre maison, quand je passais devant le logis de ses parents et qu’il voulait me suivre : « Messieu ! messieu ! » (Pour lui, monsieur était mon nom.) Et ensuite son petit trottinement joyeux derrière moi, pour me rejoindre… Fini et glacé, tout cela !…
En souvenir, il me réapparaît surtout avec une certaine robe de molleton rose, qui fut son costume de tous les jours pendant cette fin de saison, et une cravate « La Vallière » blanche, brodée à chaque bout d’une fleur chinoise, qu’il portait généralement sens devant derrière, la rosette dans le dos, sous les petites mèches de ses cheveux jaunes… Mon Dieu, voici que cela me déchire le cœur à me faire pleurer encore, de penser à cette petite cravate tournée à rebours, retombant sur le dos de cette robe rose…
Il était très vif, ce petit Roger, et cependant il ne se mettait jamais dans de méchantes colères, comme tant d’autres enfants ; quand on le contrariait, en l’empêchant d’aller patauger dans l’eau ou en lui retirant des mains quelque objet qu’il aurait brisé, il jetait de grands cris et pleurait de grosses larmes ; mais c’était du désespoir seulement, avec un air de dire : « Est-il possible qu’on soit si injuste pour moi ? est-il possible qu’il m’arrive des malheurs pareils ? » Alors, il était si adorable qu’on lui cédait toujours. Et à présent, on donnerait des jours de la vie pour ne lui avoir jamais causé même ces très petits chagrins-là.
Parfois, quand il croyait avoir quelque chose de bien important à faire et qu’on voulait l’arrêter au passage, il vous regardait avec un sérieux impayable, en vous repoussant du bras sans rien dire, les sourcils froncés, et il continuait son chemin ; – les chats, à certaines heures, affectent de ces gravités drôles et charmantes, quand ils se rendent empressés quelque part, trop occupés pour répondre à votre appel.
Il avait des yeux, ce Roger, des yeux qui n’étaient pas de la terre, qui souriaient d’habitude avec une petite joie confiante, mais qui, par instants furtifs, regardaient trop profond. Bien que tout en lui respirât la vie, l’insouciant bonheur de croître et de rire, il avait des yeux, quand on y repense, qui semblaient interroger, implorer, s’inquiéter de quelque lendemain noir…
Et ce sont ceux-là qu’elle va choisir, la vieille Faucheuse implacable et imbécile, pour les jeter dans ses trous de cimetière !…
Le lendemain 6 décembre, après une nuit de voyage, j’arrive chez moi, au lever d’un sinistre jour d’hiver. Dans ma chambre, je trouve le pauvre Sylvestre allumant mon feu. Avec des sanglots qui tout de suite lui viennent, il me dit cette simple et enfantine phrase, résumant tout : « J’ai perdu mon petit Roger. » Et là, dans cette chambre glacée encore, éclairée par un commencement de jour et par une lampe qu’on a oublié d’éteindre, il me raconte la fin de ce petit enfant que je pleure autant que lui…
Si inattendue et si brusque, cette agression de la Mort ! Il a été étouffé en pleine vie, luttant, tordant ses petites mains dans la souffrance… « Jusqu’au dernier moment, dit Sylvestre, il me tendait les bras pour que je le prenne, il s’accrochait à moi, il voulait se soulever, il ne voulait pas mourir… »
En écoutant les déchirantes choses qu’il me dit, je me rappelle tout à coup une scène de l’été passé : un soir, on était venu m’avertir que le petit Roger s’étouffait, et j’étais accouru chez ses parents. Là, je l’avais trouvé assis sur les genoux de sa mère, encore tout rouge, tout tremblant, des larmes sur les joues, et il avait serré mon doigt dans sa petite main, puis m’avait regardé, les yeux froncés et implorants, avec un air de me dire : « Crois-tu, ce qui vient de m’arriver !… La peur que j’ai eue d’étouffer comme ça, si tu savais !… » Ce n’était rien de grave ; tout simplement, il s’était engoué, comme il arrive aux bébés quelquefois. Mais déjà, dans son regard, avait passé l’anxiété suprême, l’angoisse de se sentir si petit, si frêle encore devant l’inconnu des menaces sombres… Et, en me souvenant de cela, je me représente cruellement bien ce que devaient être la supplication et l’effroi de ce même regard, quand il tendait les bras à son père, « ne voulant pas mourir… »
L’habituelle et naïve confiance en notre protection, qui se lisait dans ses yeux, il semble que nous l’ayons trompée, en le laissant emporter ainsi par la vieille Faucheuse maudite. Son expression à certaines heures, revue si vivante dans ma mémoire, me fait un mal que les mots humains ne peuvent pas dire… Et je crois que l’humilité aussi de sa condition ajoute je ne sais quoi de plus à cette douleur que j’ai de l’avoir perdu : je le pleurerais certainement moins, s’il avait été un petit prince.
– Oh ! il n’a pas été oublié, continue Sylvestre. Tout le monde du quartier est venu, – et il a reçu tant de bouquets, tant de couronnes !…
D’ailleurs, la maison est en profond deuil de lui, la maison où ne s’entendra plus son petit rire, ni son pas menu, ni sa petite voix brusque et charmante.
Il est silencieux, notre déjeuner, ce matin de retour, et Sylvestre, qui reprend ses fonctions pour la première fois depuis les journées affreuses, a les yeux brûlés de larmes en nous servant.
C’est que, pendant tout ce dernier été, Roger venait souvent assister à nos repas, quand nous les prenions ici, dans la salle à manger intime. D’abord on l’entendait passer en trottinant dans la cour, au milieu des rangées de fleurs, très empressé d’arriver ; puis, il paraissait à la porte, souriant et rose, hésitant un peu cependant, avec des yeux qui demandaient la permission d’entrer, comme si déjà, dans sa petite tête, il prenait conscience de n’en n’avoir pas tout à fait le droit. Alors on disait : « Oui, entre, entre, Roger Couëc ! » Et il entrait, en faisant le soldat : « Une ! deux ! Une ! deux ! » Et tout le temps du déjeuner, bien que ce ne fût pas très correct, il tournait entre les jambes de son père, l’entravant beaucoup dans son service. Puis, à l’instant du dessert, auprès de mon fils Samuel – son aîné de trois ans, qui l’aimait comme sa plus belle poupée – il s’enhardissait jusqu’à avancer son petit bec confiant, pour recevoir une cerise ou une fraise.
Après déjeuner, je m’en vais, sous un ciel gris, au fond de la maison, dans une seconde cour en contrebas de la nôtre qui est celle des domestiques. Dans ce lieu ordinairement ensoleillé, où l’on descend par quelques marches, il m’était arrivé d’aller tant de fois, sous prétexte de voir à la serre, en réalité pour embrasser Roger Couëc, qui rôdait généralement par là, en robe rose et en cravate de soie chinoise.
Lui, sitôt qu’il m’apercevait, se dépêchait de venir, me prenait la main pour que je l’emmène avec moi, – et, même les jours où je ne voulais pas de sa compagnie, c’était irrésistible, sa petite voix me rappelant, son ardeur à me courir après : sur les marches, un peu hautes pour ses jambes, qui séparent les deux cours, il se mettait à quatre pattes, d’un air affairé, afin d’aller plus vite… Petit être éclos dans ma maison, comme, au printemps, il y naît des hirondelles, comme il y fleurit des roses sur les vieux murs, pour lui ces cours tapissées de branches vertes représentaient le monde ! Quel mystère que ses petites notions sur la vie, que ses petites pensées – retournées à présent au grand abîme noir !…
La première soirée, sur mon sinistre retour.
Chez moi, au-dessus de ma table à écrire, dans un cadre or et rose, – rose comme était la robe, – je viens de placer le portrait du petit Roger. C’est lui-même qui me l’avait donnée, cette photographie ; un jour, on la lui avait mise dans les mains en lui disant : « Va porter ça à Messieu. » Et il était venu, d’un air intimidé mais très fin, me présenter ce petit carton, tenu à deux mains avec une gaucherie exquise, comprenant bien que c’était sa propre image qu’il m’offrait là.
Maintenant Sylvestre arrive ; m’apportant, lavée et repassée de frais, la petite cravate « La Vallière », que je lui ai demandé de me donner. « Je l’avais achetée en Chine, dit-il, du temps que j’étais matelot. » Au cadre du portrait, j’attache cette cravate, nouée avec une branche de fleurs blanches.
L’image, pour un temps, fixera encore cette figure d’ange, qui fut si éphémère, si vite évanouie dans la grande Ténèbre. L’image fera durer quelques années de plus le je ne sais quoi inexprimable de ce regard d’enfant.
Un jour de passé encore.
Au matin gris, en traversant la cour du fond, j’ai vu la pauvre petite robe de molleton rose, qu’on avait lavée et qui séchait, suspendue sur une corde, les manches tombantes et ballantes. Elle va devenir une chose pliée soigneusement, qu’on gardera – jusqu’au jour où, dans des années plus lointaines, personne ne se rappellera quel enfant l’avait portée…
Puis, je suis entré chez Sylvestre et j’ai revu là, bien rangés et tristes sur une étagère, de modestes joujoux que je connaissais : son cheval de bois, sa grande chèvre, qu’il aimait tant, et son fusil pour faire le soldat…
Il avait aussi, je m’en souviens, un album d’oiseaux coloriés qu’il ne se lassait pas de voir ; en tournant les feuillets, il les désignait l’un après l’autre du bout de son doigt levé et prononçait leur nom, toujours avec sa brusquerie comique. L’autruche, qui sait pourquoi ? l’amusait le plus ; il trépignait de joie et prenait un air de triomphe pour l’annoncer : « Truche ! » dès qu’elle apparaissait.
Chaque infime et insignifiante chose qu’on se rappelle de lui à présent est pour faire souffrir.
Vers midi de ce même jour, un clair soleil perce les brumes du matin, resplendit bientôt au milieu du ciel vide. Avec Sylvestre en deuil, je chemine à travers le cimetière ; dans ces allées, on dirait un temps d’avril.
La voici, la place où il dort, notre petit Roger ; pas encore de tombe faite, mais l’impression d’un enfouissement d’hier. Cependant, la terre fraîchement remuée, la terre grasse, l’affreuse terre disparaît sous un lit de fleurs : tous les bouquets qui avaient suivi le léger cercueil et qui se fanent à peine.
Donc, c’est là-dessous que la petite figure s’est à jamais cachée, là-dessous que s’est figé le candide petit sourire…
Encore un jour, et c’est le premier dimanche depuis qu’il n’est plus là. Un de ces beaux dimanches d’hiver qui s’éclairent d’un soleil trompeur, qui simulent les temps d’avril, mais qui s’éteignent si vite dans des soirs froids – et qui sont peut-être les plus mélancoliques de toutes les journées.
C’est par de telles après-midi qu’on mettait à Roger Couëc sa belle robe, sa fourrure blanche, son beau chapeau, et que ses parents avaient la joie et l’orgueil de l’emmener à la promenade, où il était le plus rose et le plus joli de tous les bébés endimanchés de la ville.
Aujourd’hui, Sylvestre et sa femme, seuls ensemble, s’en sont allés au cimetière, lentement. Là sans doute, au pâle et trompeur soleil, ils se sont occupés à arranger les bouquets blancs encore frais, sur la petite fosse, sur l’horrible terre. Et maintenant le jour baisse avec des frissons désolés ; l’heure de rentrer vient, l’heure où l’on ramenait au logis l’amour de petit enfant, les joues rougies par le vent du dehors… Ce soir, ils rentreront seuls, les parents ; c’est leur premier dimanche sans leur petit Roger ; ils l’ont laissé là-bas, décoloré et froid sous la terre. Dans leur chambre, quand ils seront de retour, devant le feu qui s’allumera, la petite voix vive et le petit rire délicieux ne s’entendront pas. La robe et le beau chapeau des jours de fête, serrés dans l’armoire, sont devenus de pauvres reliques, que le temps va bientôt démoder et jaunir.
Et, à la longue, ils s’accoutumeront à ne plus le voir, leur petit Roger, de même que je me déshabituerai, moi, d’écouter s’il passe dans la cour ou d’attendre, à la porte de la salle à manger, ses petites apparitions soudaines…
Ce jour où il est retombé sur son berceau, inerte après avoir tant souffert, après avoir tant imploré du secours avec ses bras tendus ; oh ! ce jour-là, il était bien fauché à jamais et replongé au gouffre… Désagrégée et finie, cette combinaison d’atomes qui avait donné momentanément son petit sourire et l’expression de ses yeux. Au fond de nos mémoires, qui d’ailleurs se désagrégeront aussi, son image bientôt pâlira ; même dans ce minuscule recoin du monde où s’était limitée sa vie de deux ans, on oubliera bientôt qu’il a passé ; les choses, les existences, ici comme ailleurs, continueront leur marche. Et, dans le cours des innombrables destinées, dans la suite infinie des âges, sa disparition sera aussi négligeable et perdue que la mort d’une hirondelle ou que l’effeuillement d’une rose blanche sur nos murs… Mais pourtant, comment dire ma révolte amère, ma pitié infiniment tendre, au souvenir de la vaine supplication de ce petit regard qui s’épouvantait de sa fin ! Comment dire le mal que j’ai de lui, avec, en plus, cette presque puérile angoisse de songer que le cher petit mort ne le saura même pas !…
En ce temps-là, tous les mois étaient longs, très longs – et les années, presque infinies.
Les beaux mois de l’été et des vacances duraient délicieusement ; quant à ceux de l’arrière-automne et de l’hiver, empoisonnés par les devoirs, les pensums, les froids et les pluies, ils se traînaient, lamentables, avec de stagnantes lenteurs.
L’année dont je vais parler ici fut, je pense, la douzième que je vis sur la terre. Je la passai, hélas ! sous la férule du « Grand-Singe-Noir », professeur de belles-lettres, au collège où je débutais sans le moindre brio… Aussi m’a-t-elle laissé des impressions qui, aujourd’hui encore, me sont pénibles et déprimantes pour peu que j’y concentre mon souvenir.
Et je me rappelle, comme si c’était d’hier, la mélancolie profonde et désolée de ce jour d’octobre qui fut, cette année-là, le dernier des vacances et la veille de la cruelle « rentrée des classes ». J’étais revenu le matin même de passer un temps enchanteur, un temps de liberté et de soleil, chez des cousins du Midi, et j’avais la tête pleine encore des images de là-bas : les joyeuses vendanges parmi les pampres rougis ; les ascensions, sous des bois de chênes, vers de vieux châteaux fantastiques perchés sur des cimes ; les vagabondages imprévus, avec une bande de petits amis dont j’étais le chef indiscuté… Quel changement, mon Dieu ! Arriver ainsi dans ma maison – cependant si aimée – pour voir un été mourir et pour prendre demain une chaîne effroyable !…
Et ce jour-là précisément, sous un ciel tout à coup assombri, des frissons commençaient à passer, m’apportant ces tristesses de l’automne que, dans mon enfance, je ressentais avec une intensité si mystérieuse. De plus, le « Grand-Singe-Noir » (de son vrai nom M. Cracheux), qu’il faudrait affronter dans quelques heures, je le connaissais d’aspect, pour l’avoir maintes fois aperçu, en passant avec ma bonne devant la porte morose du collège ; depuis un an, je l’avais flairé, prévu, redouté, et mon dégoût très particulier pour sa personne aggravait encore mes terreurs de l’enfermement inévitable et prochain…
Cette dernière journée, je l’employai d’abord à mettre en ordre, dans mon musée d’enfant, les différents spécimens précieux que j’avais rapportés de mes courses méridionales : papillons extraordinaires, attrapés sur les foins de septembre ; fossiles étonnants, découverts dans les grottes et les vallées. Et puis, seul dans ma chambre, je m’installai sur mon bureau – où il faudrait, hélas ! recommencer à travailler demain – et j’entrepris une œuvre qui m’occupa jusqu’au crépuscule : confectionner un calendrier à ma façon, duquel je déchirerais tous les soirs une page ; préparer, pour les dix mois scolaires, dix petits paquets d’une trentaine de feuillets chacun, avec indication des dates et des jours, – les jeudis et les dimanches, écrits avec des honneurs spéciaux sur papier rose.
Dans la rue, tandis que j’arrangeais cela, des ramoneurs savoyards passaient sous le ciel brumeux, avec leur plaintif appel qui s’entend chez nous à l’automne, comme le glas des beaux jours : « A ramounâ la cheminâ, du haut en ba-às ! » Et leurs pauvres voix lugubres me mettaient dans le cœur des angoisses infinies.
Cependant ma besogne s’avançait ; j’en arrivais au mois d’avril et au bienheureux jour de Pâques. Sur papier rose, bien entendu, ce jour-là, et inscrit avec des soins tout à fait tendres dans une guirlande de fleurs ! Sur papier rose aussi, les dix jours suivants, qui seraient dix jours de vacances, une trêve délicieuse aux hostilités du « Grand-Singe »…
Quand ce fut terminé, j’ouvris l’armoire de mes jouets, pour clouer là, sur le devant d’une étagère, mes dix mois bien alignés, à commencer par ce sinistre octobre.
En clouant le mois d’avril, je regardais la petite liasse rose des vacances de Pâques, me disant avec un doute découragé : « Est-ce que vraiment il viendra jamais, ce temps qui est si loin de moi ? » Et, comme dans un rêve de chimérique avenir, je me voyais déchirant ces feuilles-là, sur la fin des journées plus longues et plus tièdes où le printemps serait dans l’air…
Le beau mois de mai eut son tour ensuite. Quand j’en arriverai là, me disais-je, l’heure de déchirer la feuille sera claire et charmante avec un ciel tout doré encore par les reflets du couchant, et j’entendrai dans la rue, sous des guirlandes accrochées aux fenêtres, les matelots, les jeunes filles, chanter et danser les vieilles rondes de mai…
Et juin, quel charme de fleurs, de cerises et de soleil !… Et juillet : l’approche enfin des grandes vacances, l’approche de l’enivrant départ pour chez les cousins du Midi !…
Mais, au fond de quels lointains inaccessibles, ces temps-là m’apparaissent !…
Le joug du « Grand-Singe-Noir » fut une chose vraiment terrible, dépassant mes prévisions les plus pessimistes. Quel hiver languissant et pitoyable, mon Dieu, avec des mains toujours tachées d’encre, des devoirs jamais finis et, par suite, une conscience jamais en repos !… Même les jeudis, même les dimanches, il nous accablait, ce vieillard sans entrailles !… Et, pour distraire un peu mes petits camarades de chaîne, je peignais, avec du noir épais, en tête de mes cahiers que l’on se faisait passer en classe, d’énormes singes dans des attitudes variées, pérorant sur des livres classiques – ou bien se grattant…
La race des « Grand-Singe-Noir », à notre époque tend à disparaître. Mais il en existe encore au fond des provinces, et je voudrais, en passant, ameuter contre eux les petits souffre-douleur qui sont derniers en thème, leur prêcher à tous la révolte contre le fatras qu’on leur impose pour les abêtir et les étioler !…
Cependant, Pâques s’approchait, cahin-caha, et bientôt s’en iraient au vent les derniers feuillets qui masquaient la désirée petite liasse rose.
Mais Pâques était de très bonne heure cette année, et le printemps se faisait prier pour nous venir. Une crainte me prenait déjà que les jours sur papier rose ne fussent que des jours de pluie et d’hiver…
Le dimanche des Rameaux passa, presque sans soleil. Puis, le vendredi saint, voilé de gris, très morne, avec les coups de canon tirés toutes les demi-heures, dans l’arsenal de la marine, en mémoire de la mort du Christ.
Et enfin, le samedi survint, sombre lui aussi, mais amenant la clôture des cours du Grand-Singe, l’heure adorable de la liberté !…
Elle allait finir, cette dernière classe. Rien qu’un quart d’heure encore !… Et je ne tenais plus sur mon banc.