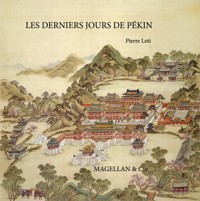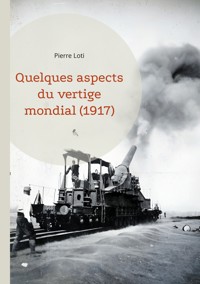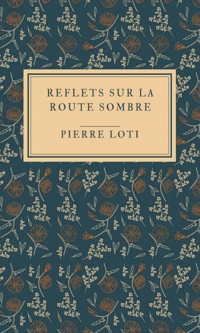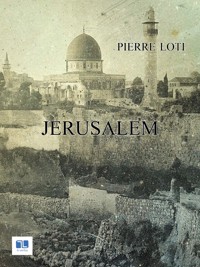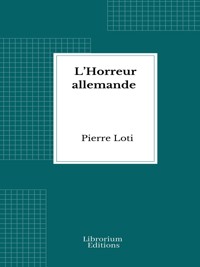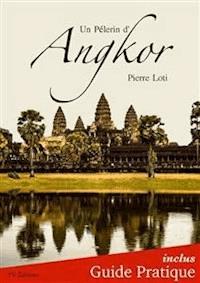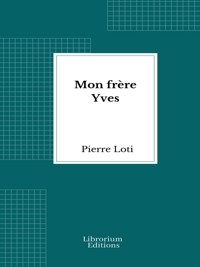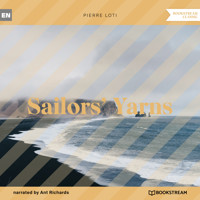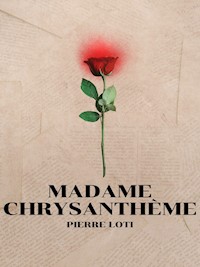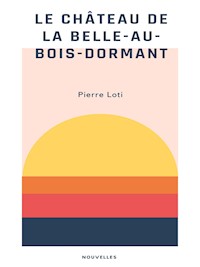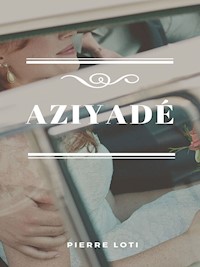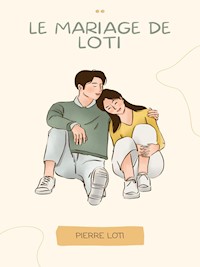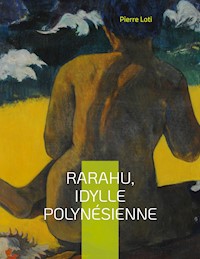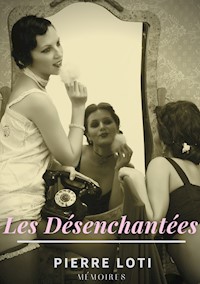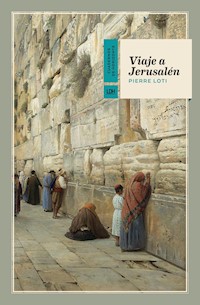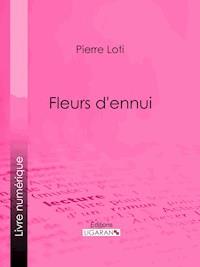
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Extrait : "PLUMKETT. – Mon cher Loti, on dit que les bêtes ont une âme : donc, vous et moi devons avoir quelque chose dans ce genre-là. Nos deux âmes, – puisqu'il est admis que nous en possédons chacun une, – ne sont pas sœurs, mais cousines germaines par l'ennui ; ce n'est pas d'hier, vous le savez, que nous avons découvert cette parenté."
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 366
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EAN : 9782335003048
©Ligaran 2015
PLUMKETT.– Mon cher Loti, on dit que les bêtes ont une âme : donc, vous et moi devons avoir quelque chose dans ce genre-là.
Nos deux âmes, – puisqu’il est admis que nous en possédons chacun une, – ne sont pas sœurs, mais cousines germaines par l’ennui ; ce n’est pas d’hier, vous le savez, que nous avons découvert cette parenté.
L’idée me vient d’organiser une petite réunion de famille, et de faire un petit bouquet de votre ennui et du mien : je vous enverrai des œillets d’Inde, et vous y répondrez par des pissenlits. – (Quant aux pensées, ce sont des fleurs que nous ne connaissons plus guère.) – Cela vous va-t-il ?
Moi, je me débiterai en aphorismes, instructifs pour la masse ; vous, vous ferez ce que vous pourrez : vous écrirez d’une manière quelconque des choses quelconques, n’importe quoi ; vous conterez vos rêves si vous voulez. Un sage de l’antiquité a émis cet axiome : « Il est bien difficile d’être plus bête que les autres. » Pénétrez-vous de cette vérité, et allez-y de confiance !
LOTI.– Je commence par un rêve :
J’étais tout en haut du clocher du Creizker ; Yves était assis près de moi, sur la tête d’une gargouille de granit. Les lointaines vagues du pays de Léon se déroulaient en bas sous nos pieds, dans le demi-jour plein de mystère qui éclaire les visions du sommeil.
C’était l’hiver et la lande bretonne était noire. – À l’horizon, on voyait la « mer brumeuse » et les rochers de Roscoff s’étageant comme dans les fonds peints par le Vinci.
Je disais à Yves : « Il me semble que le clocher du Creizker a tremblé. »
Yves répondait : « Mon bon frère, comment voulez-vous que cela soit ? » Et il regardait en souriant dans le vide.
J’avais le vertige, et je me serrais contre cette dentelle de granit qui nous soutenait dans l’air. Autour de nous il y avait de merveilleuses découpures de pierre, et des gargouilles à figure de gnome, auxquelles des lichens jaunes, – ceux qui dorent tous les vieux clochers de Bretagne, – faisaient des huppes et des barbiches de chèvre. Et la base du clocher se perdait, en fuyants indécis, en lignes confuses, dans l’obscurité de la terre.
Yves me paraissait plus grand que de coutume, ses épaules plus larges encore et plus athlétiques.
« Yves, disais-je, je t’assure que le Creizker a tremblé. »
… En effet, le vieux clocher des légendes bretonnes chancelait sur sa base, nous le sentions s’abîmer ; l’antique dentelle de granit se désagrégeait doucement, s’émiettait dans l’air, et les débris tombaient. C’étaient des chutes lentes et molles, comme des chutes d’objets n’ayant pas de poids, et nous tombions nous-mêmes, en cherchant à nous cramponner à des choses qui tombaient aussi.
… Maintenant nous errions par terre, au milieu de décombres qui continuaient de s’émietter et de disparaître. – En tombant, nous ne nous étions fait aucun mal, – mais nous éprouvions une angoisse, parce que le Creizker n’existait plus.
Nous songions au temps où nous naviguions, Yves et moi, sur la « mer brumeuse » : en passant au large, ballottés par les grandes houles d’ouest, mouillés par les embruns et la pluie, les jours sombres d’hiver, à la tombée froide et sinistre des crépuscules, – souvent dans les nuées grises nous apercevions de loin les deux clochers de l’église de Saint-Pol et le Creizker, posé près d’eux sur la falaise, les dominant de toute sa haute stature de granit. – Quand la nuit s’annonçait mauvaise, nous aimions à voir cet antique guetteur de mer, qui semblait veiller sur nous du haut de la falaise bretonne. À présent, c’était fini, et jamais nous ne le verrions plus.
Yves surtout ne pouvait se consoler de ce que son clocher fût tombé. – Moi, je lui disais : « On le rebâtira » ; mais j’avais conscience de l’irrémédiable de cet anéantissement : il était semé sur la terre en débris aussi nombreux que les galets des plages. – L’œuvre merveilleuse des siècles passés était détruite, et cela me paraissait un signe fatal des temps ; la fin de ce géant des clochers bretons me paraissait le commencement de la fin de toutes choses, – et je me résignais à voir tout finir, j’étais comme recueilli dans une attente apocalyptique du chaos.
Autour de nous il n’y avait déjà plus aucune trace de la vieille cité de Saint-Pol, ni de la maison où Yves est né. Nous étions au milieu de la lande sombre et déserte, parmi les genêts et les bruyères : la terre reprenait sa physionomie des époques primitives, avant de s’anéantir, et l’obscurité dernière s’épaississait autour de nous.
Alors Yves me dit, avec l’intonation d’une frayeur d’enfant : « Frère, regardez-moi, est-ce qu’il ne vous semble pas que je suis devenu plus grand que de coutume ?… » – Et je répondis : « Non », – pour ne pas lui faire peur ; mais je voyais bien qu’il était plus grand que nature, et maintenant il était vêtu comme un Celte, avec des peaux de loup jetées sur ses épaules. Autour de nous, il y avait des formes de larves qui s’agitaient dans l’obscurité toujours plus profonde, et je comprenais que déjà tous les deux nous étions morts…
… Puis le rêve se termina par des conceptions sinistres, confuses, qui s’éteignaient graduellement…
– Il n’existe plus de suites de mots qui puissent traduire ces choses mystérieuses.
PLUMKETT.– Mon cher Loti, je crois avoir trouvé l’explication de votre rêve : Vous étiez couché avec votre frère Yvon sur la table de quelque cabaret de basse Bretagne ; vous aviez bu du cidre et de l’eau-de-vie de grain ; vous étiez complètement gris, et vous aviez roulé sous la table. C’était là votre chute molle, dans laquelle fort heureusement vous ne vous êtes rien cassé : Yvon était peut-être tombé le premier et vous par-dessus. Le clocher du Creizker, ce devait être quelque grande bouteille vide que vous aurez fini par faire chavirer. Quant aux choses qui tombaient aussi, c’étaient des verres qui s’émiettaient sous vos pieds par terre, et les larves, c’étaient la cabaretière et les maritornes de l’établissement, occupées à réparer tout le désordre que vous aviez produit.
Il n’y a rien dans tout cela que de très naturel, seulement vous vous livrez, sur le commencement de la fin des choses, à des réflexions qui sont hors de propos. Songez donc, mon cher Loti, qu’il ne s’agit que de la fin d’une bouteille ; et encore cette bouteille que vous preniez pour un clocher n’était vide que parce que vous l’aviez bue ; or, il n’est pas raisonnable d’exiger que les flacons auxquels on boit ne se vident pas.
Au commencement de la vie, toutes les coupes sont pleines : buvez lentement, si vous voulez qu’il vous reste quelque chose sur le tard. Ne buvez pas trop les vins capiteux, car alors, vous ne sauriez plus sentir, les saveurs douces et saines…
LOTI.– Mon cher Plumkett, votre explication de mon rêve est idiote. Vous savez bien que je suis aux trois quarts musulman, et que je n’ai été gris qu’une fois dans ma vie : c’était à New-York, un soir où j’avais été convié à un banquet d’une société de tempérance. Les policemen m’avaient rapporté à mon bord.
PLUMKETT.– N’interrompez pas, Loti, pour dire des inepties, quand par hasard je dis des choses graves. C’est vrai, je suis tombé par malheur sur le seul défaut que vous n’ayez pas ; mais je parlais par images, comme ces orientaux que vous aimez. Il est d’autres ivresses plus dangereuses que celles du vin, et celles-là Loti, vous les connaissez…
Maintenant les coupes sont vides, les fleurs de la table sont fanées. Les convives ont disparu : les uns ont succombé à l’ivresse ; d’autres en ont eu peur, et se sont enfuis. Vous restez seul à une table chargée de débris : vous avez encore soif. Que ferez-vous ? Après un tel festin, en irez-vous chercher d’autres ? Non ; ils vous donneraient la nausée. Tout s’obscurcit autour de vous ; vous ne distinguez plus rien, et vous dites : « C’est le commencement de la fin. » – De quelle fin ? de la fin de toutes choses ? – Non ; ce n’est que votre festin à vous qui est fini.
Ainsi vous voyez que, même dans vos rêves, vos réflexions n’ont pas le sens commun.
LOTI.– Il n’est pas gai, Plumkett, ce premier œillet d’Inde que vous m’envoyez.
Et puis, comparer la vie à un banquet, comme c’est usé ! Vous auriez pu m’appeler aussi : infortuné convive, c’eût été encore très nouveau. C’est même une fleur fort commune que votre œillet, Plumkett, et vous l’aurez cueillie sans doute dans le jardinet de votre concierge, en passant.
Moi, j’ai longtemps cherché ce que je pourrais bien dire cette fois, pour que vous n’y preniez pas sujet de me faire une morale bête.
Je crois avoir trouvé la chose ; je vais vous conter une histoire d’un temps où, certes, je ne m’étais encore grisé avec rien du tout.
C’est une histoire de mai. J’étais tout petit, tout petit enfant ; ce n’était peut-être pas le premier printemps auquel j’assistais sur la terre, mais c’était peut-être le second, ou tout au plus le troisième…
On venait de me promener ; c’était le soir.
Quand je fus rentré dans ma maison, que vous connaissez, et que je me trouvai dans la cour, j’éprouvai une mélancolie vague, parce qu’il commençait à faire noir ; mélancolie très douce parce qu’il faisait admirablement beau : c’était une de ces longues soirées de printemps, au crépuscule tiède et limpide ; autour de moi, cela embaumait le jasmin et le chèvrefeuille.
J’étais habillé d’une petite robe rose que je vois encore ; c’est le seul costume d’enfant qui me soit resté dans la mémoire, celui que je portais ce soir-là. N’est-ce pas que c’est drôle, de se revoir en petite robe rose de bébé ?… Et puis au moins c’est bien honnête et bien innocent d’évoquer de pareils souvenirs.
Et quelle chose bizarre, se dire qu’à une époque encore peu éloignée, on assistait en nouveau venu aux choses de la terre, on ouvrait de grands yeux devant son premier printemps… Déjà on avait une intelligence capable de beaucoup comprendre, une petite tête capable de recevoir, dans le vague un peu, il est vrai, des impressions très compliquées ; et on n’avait encore rien vu ; on ne savait encore rien du tout, ni de l’évolution humaine commencée depuis cinquante siècles, ni du retour éternellement immuable des renouveaux de la nature… On regardait tout cela avec une sorte d’étonnement réfléchi, on y mêlait comme des resouvenirs troubles et pleins de mystères de choses antérieures… D’où venait-on ?… Y avait-il eu un avant, un en deçà ?… Plus tard, j’ai eu des instants dans ma vie où j’en ai été persuadé. Mais, alors, il y aurait un au-delà aussi, et il est bien ténébreux cet au-delà, et il me fait frémir.
Je suis très loin de la petite histoire que je vous contais, et je vais y revenir. Mais convenez que c’est singulier : quand on s’est promené par le monde, qu’on a tout vu dans le présent ; tout deviné dans les profondeurs du passé ; quand on a tout compris et tout ressassé… se dire qu’il y a trente ans à peine, on venait d’arriver, et qu’on s’étonnait de voir les soirées devenir longues et tièdes, les roses blanches fleurir sur les vieux murs, la fête du printemps commencer…
Vous connaissez, Plumkett, cette cour dont je veux parler, la cour de ma maison : une sorte d’avenue de verdure et de fleurs aboutissant à un fond très ombreux. – Dans ce fond, un fouillis de feuillage ; d’un côté de hauts murs tapissés de lierre, d’où pendent des vignes, des glycines, des roses, de grandes branches de toute espèce de plantes ; de l’autre côté, au midi, des murs très bas, enfouis sous des touffes, sous des bouillées de jasmins et de chèvrefeuilles. – Les jardins des voisins sont derrière, et au-dessus s’ouvre la grande échappée large et claire du ciel.
Ce soir dont je parle, cette échappée de ciel au midi et au couchant était d’un beau jaune limpide ; en haut, sur ma tête, c’était d’un bleu vert, très lumineux encore, et les branches pendantes se détachaient là-dessus en fines découpures noires. Je jetai un regard d’inquiétude vers quelque chose qui se dessinait très loin sur le ciel, au-dessus du mur, parmi des têtes d’arbres fruitiers. Cela occupait pourtant une bien petite place dans le lointain, ce quelque chose, mais c’était une silhouette extraordinaire : le pignon d’une vieille maison, avec une espèce de cheminée démolie, le tout ayant un profil d’animal, une ressemblance de loup. – Je l’ai vue pendant bien des années, cette forme de bête ; je ne la retrouvais que le soir, quand elle se découpait en chose obscure sur le fond doré du couchant, c’était les soirs d’été surtout, quand je rentrais de la promenade. Elle avait l’air triste, cette forme de bête, et sa tournure a été mêlée à toutes les mélancolies, à toutes les frayeurs de mes soirées d’enfant…
Plusieurs années plus tard, je me rappelle l’avoir encore cherchée dans ce coin de ciel, cette silhouette de loup, – un soir que je revenais au foyer après une longue campagne en Polynésie ; je l’aurais saluée à ce moment-là comme un vieux souvenir aimé d’autrefois ; mais elle n’y était plus : – en mon absence on avait démoli la vieille maison. – Par-dessus les folles branches des jasmins et des rosiers, je ne vis plus que des têtes de poiriers, et les bouquets de fleurs rouges d’un grand grenadier du jardin voisin.
Je vous fais mille excuses, Plumkett, de m’être encore lancé dans des digressions de cette longueur.
Je vous disais donc qu’un certain soir de mai, rentrant chez moi en petite robe rose, je m’étonnais beaucoup de voir combien, en quelques jours, tout était devenu vert et touffu. – C’était extraordinaire comme toutes ces masses de plantes qui retombaient des murs étaient maintenant épaisses et feuillues ; au-dessus de ma tête, cela faisait l’ombre plus dense, cela jetait une obscurité tiède, pleine d’odeurs douces. – Et ce grand berceau de jasmin de la Virginie, – je me rappelais très bien avoir vu, quelque temps avant, une lune d’hiver dessiner en petites lignes noires sur le sol tous les enlacements compliqués de ses branches. À présent, c’était un dôme compact tout vert et tout fleuri, sous lequel il faisait noir, et, à l’abri de cette voûte, il y avait des milliers de moucherons qui dansaient.
Moi, je me promenais là-dessous, les mains derrière le dos (ce qui est, vous savez, l’attitude des bébés quand ils ont des méditations profondes) et je cherchais à comprendre…
Et puis ces jours qui allongeaient, qui allongeaient, qui se traînaient en demi-obscurités limpides, et toutes ces fleurs qui poussaient partout, et cette augmentation de chaleur et de lumière, cette splendeur qui arrivait… Oui, tout cela m’apportait bien la notion confuse de quelque chose d’inconnu qui, allait commencer : l’été ! mon premier été !… je ne me rappelais pas celui d’avant, mais celui-là troublait ma petite tête et me charmait beaucoup.
Maintenant voici tout de bon où commence mon histoire :
Il y avait, ce jour-là, dans un coin de la cour, une caisse à fleurs pleine de sable. Toute la journée je m’étais amusé à remuer ce sable ; d’abord j’avais fait des petits pâtés avec une pelle ; et puis après j’avais aplani le tout et tracé une allée, le long de laquelle j’avais mis des petits vases et des brins de clématite recourbés en berceau.
Tout en me promenant à petits pas, dans mon attitude contemplative, je me rappelai ce jardin que j’avais construit dans le jour, et j’allai le regarder.
Ça sentait très bon, le soir, toute cette clématite. Les brins couvraient entièrement la caisse et retombaient autour ; toutes les fleurettes se voyaient encore, parce qu’elles étaient blanches, mais elles semblaient si légères dans cette demi-obscurité qu’on eût dit des plumes. Je vois encore tout cela.
J’avais très grande envie d’entrer dans ce jardin : on devait être tout à fait bien là, assis dans l’allée en miniature du milieu, et tapi sous cette clématite.
Mais c’était beaucoup trop petit, bien que ce fût un jardin ; je comprenais cela parfaitement : c’était trop petit pour me contenir…
Il était possible d’essayer pourtant… Après avoir réfléchi et fait appel à toutes mes connaissances sur les proportions des choses, je posai un pied sur le bord, et j’essayai de m’enlever pour monter.
Hélas ! la caisse chavira ; le sable, les petits vases, les fleurs, tout dégringola, – et moi aussi, – à la renverse, sur mon derrière, Plumkett. Je me fis du mal et je me mis à pousser des cris affreux.
Alors ma bonne m’emporta, en me faisant sauter pour me consoler, sauter en mesure sur un vieil air très gai du pays qui s’appelle la Pêche aux moules.
Plus tard, dans le courant de ma vie, chaque fois que j’ai fait des chutes cruelles pour avoir tenté des choses impossibles, si j’avais eu près de moi quelqu’un pour me prendre et me faire sauter la Pêche aux moules, j’aurais peut-être moins souffert…
PLUMKETT.– À quel état de sensiblerie mièvre, voisine du ramollissement, êtes-vous tombé, mon pauvre Loti ! – Vous auriez bien mieux fait de courir après votre cerceau comme une petite brute, que de commencer de si bonne heure à rêvasser de cette manière.
Mon Dieu, comme c’est ennuyeux et endormant, vos souvenirs d’enfance !
LOTI.– Attendez, Plumkett, je me rappelle encore ceci, qui se passait, je crois bien, dans la même soirée, – ou peut-être un an plus tard… Peut-être que je confonds ensemble deux printemps, mais peu importe !
Je voyais voler en l’air des espèces de choses noires, comme de grands papillons qui passaient très vite, sans faire de bruit, et je demandais à ma bonne :
– Dis, Zette, qu’est-ce qui vole comme ça ?
Ma bonne s’appelait Suzette. Elle était assise au bord d’une banquette de pierres moussues ; sous la retombée des chèvrefeuilles qui la mettaient dans l’ombre, je ne distinguais plus guère que le grand pointu blanc de sa coiffe de paysanne,
– Ça, c’est des souris-chaudes, répondit-elle. (Dans mon pays, c’est le nom des chauves-souris.)
– Et dis, qu’est-ce que c’est, des souris-chaudes ?
– Ah ! dame… (Elle était très calme, la vieille Suzette, et cherchait toujours fort tranquillement ses réponses.) Dame, des souris-chaudes, – c’est des souris qui ont des ailes. Quand vient le printemps, ça vole comme ça sur le soir, pour attraper les mouches et les hannetons qui n’ont pas voulu aller se coucher…
Des souris-chaudes ! cela me jetait dans des méditations profondes ; des souris qui volaient !… et puis d’abord, pourquoi étaient-elles chaudes, ces souris ? Elles me faisaient bien l’effet d’avoir une vague affinité avec le diable, personnage dont la physionomie probable me préoccupait beaucoup dans ce temps-là…
Un autre souvenir de chauves-souris me revient encore ; – laissez-moi écouler le stock de mes souvenirs de chauves-souris, Plumkett.
C’était plus tard ; j’avais bien dix ans. J’étais, un soir d’été, dans le jardin d’un domaine de campagne qui s’appelle la Limoise, et dont je vous reparlerai dans la suite. À lui tout seul, ce nom de Limoise a le pouvoir encore de réveiller pour moi un monde endormi d’images et d’impressions d’enfant : des bois de chênes, des bruyères, une campagne pierreuse ayant un bon air pastoral d’autrefois ; des moutons et des odeurs de serpolet… J’écrirais des volumes sur ce recoin de la terre, que je ne parviendrais pas à traduire par des mots le charme qu’il a exercé sur mon imagination d’enfant ; quelquefois, par instants fugitifs, je retrouve encore ce charme quand je reviens là ; – mais il s’obscurcit avec les changements et les années, et il s’effacera, en demeurant inexprimable…
Le grand jardin, très vieux comme la maison, était alors un peu abandonné ; il y avait des endroits dans ce pauvre vieux jardin qui retournaient positivement à l’état sauvage, et c’étaient les endroits que j’aimais le plus.
Les midis brûlants de juillet, j’allais souvent me percher à un certain point de prédilection sur le vieux mur ; je restais là tout seul, assis dans le lierre où l’on étouffait de chaleur ; au milieu de toute sorte de bourdonnements de mouches, j’écoutais les chansons des sauterelles ; je regardais les bruyères et les bois de chênes, accablés de soleil, les lointains de la campagne chaude et silencieuse. Et je chantais tout bas, tout bas, de petits hymnes que je composais à l’été et aux arbres ; je rêvais des forêts tropicales et des solitudes d’Afrique qui, de très bonne heure, ont hanté mon imagination d’enfant, et que j’avais deviné bien avant de les avoir vues… – Donc, un certain soir d’été, il y avait dans ce jardin une quantité inaccoutumée de chauves-souris qui volaient. C’était un soir chaud, lourd et calme ; du côté où s’était couché le soleil, on voyait encore, longtemps après, ces nuances d’un brun rouge qui sont particulières aux grandes chaleurs de l’été. On était très isolé dans cette campagne ; autour, il y avait des bois. Il nous arrivait, comme de très loin, un tintement de cloche ; un peu triste, un peu fêlé, ce pauvre son de cloche, mais il nous était familier et nous l’aurions reconnu entre mille. C’était l’Angélus qui sonnait là-bas, dans la vieille église du village d’Échillais…
Je courais dans ce jardin avec une jeune fille que j’aimais comme une grande sœur, et dont la mémoire, déjà lointaine, est mêlée pour moi à ce charme inexprimé des bois de la Limoise.
Elle était bien enfant, alors surtout.
– Veux-tu voir arriver toutes les chauves-souris autour de nous ? dit-elle. Je sais comment on fait pour les appeler.
Alors elle grimpa sur les branches basses d’un vieux poirier, et se mit à agiter son mouchoir en l’air.
En effet, elles arrivèrent toutes, effarées, pour voir ce que c’était que cette chose blanche qu’on leur faisait danser dans l’obscurité. Elles venaient même si près, que la peur nous prit de les voir nous tomber dessus, et nous nous sauvâmes en courant dans la maison…
Chauves-souris, pauvres bestioles, objet d’horreur pour tout le monde ; pour moi, bêtes des soirs d’été, ne volant que dans l’air chaud des beaux jours… Je leur pardonne leur laideur et je les admets, parce qu’elles ont déployé leur vol fantastique dans l’air pur de mes belles soirées d’autrefois, et que je les retrouve mêlées aux souvenirs des étés de mon enfance…
Plus tard, à Paris, j’habitais, au quartier Latin, une petite chambre d’étudiant, froide et grise, encombrée de livres classiques et de cahiers. Un tableau noir et de la craie, des choses laides et tristes.
J’avais dix-sept ans. Après un hiver d’études, longue saison d’ennui, de premières fatigues, de premiers écœurements, il arriva que le printemps fit son apparition, comme c’est la loi de nature.
Un soir de mai, le temps étant devenu tiède, j’étais resté accoudé à ma fenêtre haut perchée, – rêvant de m’en aller… J’avais là des perspectives mélancoliques de cheminées, de vieux toits noirs, le clocher de Saint-Étienne du Mont, le clocher de Sainte-Geneviève. Cette belle soirée me semblait étrange, tombant sur toutes ces choses maussades ; je m’étais figuré qu’à Paris le printemps ne reviendrait jamais.
Il était venu tout de même ; la soirée était douce et j’apercevais en bas, sur une fenêtre, de pauvres lilas fleuris.
La nuit tombait. Et tout à coup je vis deux chauves-souris qui décrivaient des courbes folles sous ma fenêtre… Avec quel plaisir je les saluai, ces deux pauvres vilaines bêtes ! C’était pour moi plus que les premières hirondelles, ces deux premières chauves-souris : vraies messagères de l’été, messagères des vacances, du départ et de la liberté.
Sans compter que j’espérais bien ne pas y revenir dans ce gîte noir… Et, en effet, je n’y revins pas : on me donna ma volée pour ailleurs, et je pris un grand vol qui me mena très loin ; on ne me revit plus au Quartier…
Vous savez, Plumkett, que, si je n’ai jamais été enfermé dans un lycée, je n’ai pas non plus beaucoup langui au quartier Latin. Je n’y ai guère passé qu’un an, juste assez pour en avoir une idée. Je traînais tout autant que les autres, mon Dieu, dans les divers établissements de la rive gauche ; mais j’y avais les allures inégales, – brusques ou timides, – effarées, d’un oiseau qu’on aurait pris déjà grand pour le mettre en cage ; j’y ai éprouvé bien des étonnements ; j’en ai emporté des souvenirs de choses fades, écœurantes, malsaines. Il y a des gens qui ont chanté cette vie-là ; moi, je n’ai jamais compris la poésie de la mansarde, ni de la grisette, ni de l’estaminet.
… Une dernière chauve-souris me repasse en tête, amenée par les autres, mais elle est grosse celle-ci, par exemple ; elle appartient à l’espèce énorme et affreuse des roussettes, qui habitent les régions toujours chaudes de la terre.
Je connaissais à la côte de Guinée un vieux forban qu’on appelait le père Barez (c’était beaucoup plus tard ceci ; j’avais environ vingt-trois ans, et déjà j’avais couru les cinq parties du monde).
C’était un vieil homme bizarre que le père Barez, fort connu dans les comptoirs de la côte : type d’une espèce aujourd’hui perdue, mulâtre de je ne sais où, ex-pirate et négrier ; revendant, quand il en avait assez, ses négresses avec les enfants qu’il leur avait faits, le tout en bloc, au plus offrant ; trafiquant de tout, et fourrant toujours dedans son monde.
Brave homme au demeurant, il disait avec un gros rire, en montrant ses dents blanches : « Mes amis, quand j’avalerai ma gaffe, je pourrai au moins dire que j’ai vécu ! » Et c’était vrai, il avait vécu, de la vie excentrique et tourmentée des anciens forbans ; il avait eu même son heure de fortune et de splendeur : on montrait encore, dans un coin du pays mandingue, les restes d’un palais fantastique qu’il s’était autrefois fait construire pour y donner d’étranges fêtes.
Sur ses derniers jours, s’étant fait ermite, il avait obtenu du gouvernement français le commandement de la rivière Ponga. Et il s’en tirait à merveille, grâce aux alliances qu’il s’était depuis longtemps ménagées avec les chefs noirs ; il était tout à fait l’homme de la situation.
Un jour, nous apprîmes que le père Barez était mort, et nous nous rendîmes au plus tôt dans la rivière Ponga, qui se trouvait, par suite de cet évènement, livrée aux factions et à l’anarchie.
Quand nous arrivâmes, la case du vieux pirate, à l’ombre de ses grands arbres exotiques, était verrouillée et barricadée ; personne n’y était entré depuis que le mort en était sorti, et on nous attendait pour le partage.
Il s’échappa de là-dedans, quand on ouvrit, une chaleur concentrée, un air irrespirable. Des objets extraordinaires étaient éparpillés partout en fouillis inquiétants, et il y avait, plaquée au mur, une roussette brune, qui dormait la tête en bas comme c’est l’habitude des chauves-souris. Elle s’éveilla effarée quand elle vit pénétrer la lumière, et, déployant ses membranes chauves, elle se mit à voler à tire-d’aile, en se heurtant partout comme une folle.
Un matelot breton, qui avait peur, l’abattit d’un coup de bâton, en disant : « C’est l’âme du vieux ! »
Moi, je fus tout de suite de l’avis de ce brave garçon, cela ne pouvait être en effet que l’âme du vieux : n’ayant pas su monter plus haut, elle était venue, sous forme de bête horrible, se coller au mur.
Je l’ai encore chez moi, cette roussette, – dans un cabinet qui est voué aux choses invraisemblables et aux souvenirs empaillés de mes promenades par le monde. – Elle est confite dans un bocal d’esprit-de-vin, la tête de côté, tirant la langue, et, comme elle n’est pas belle à voir, je l’ai légèrement dissimulée derrière un caïman. Il y a sur le flacon une étiquette, un peu jaunie par ses voyages en mer, mais où l’on peut lire : Âme du père Bavez.
De son vivant, le vieux négrier avait coutume de dire que le diable hériterait de son âme ; il se trompait, et c’est moi qui l’ai eue…
PLUMKETT.– C’est tout un. Mais, que voulez-vous ! il l’avait bien mérité, après tout, ce vieux, de finir entre vos mains.
On n’est jamais bien qu’ailleurs, mon cher Loti, vu qu’on s’ennuie partout. Donc, il n’est pas mauvais, de temps à autre, de s’en aller de partout où l’on est. Un certain nulle part fait d’inconscience universelle et d’anéantissement absolu, ce serait beau ! Qu’il existe ou non, ce néant, éternel sommeil sans rêves, plus doux que tous les rêves, je l’aime…
Que nous serions donc heureux si nous pouvions laisser dans quelque coin cette défroque de chair et d’os, destinée à faire de l’humus pour les générations futures. Songez qu’il nous faut la nourrir, la vêtir, la présenter convenablement dans le monde, et que, pour nous récompenser il n’est pas de sottises auxquelles elle ne nous entraîne.
Comme il doit être bon, le moment où notre âme s’envole comme un léger papillon aux ailes d’or, bien loin, bien loin de cette grossière chrysalide ! (Excusez, mon cher ami, cette image du papillon aux ailes d’or qui n’est peut-être pas bien neuve.)
Et si ce qui s’envole de la chrysalide, c’est rien, – cela n’en vaudra que mieux !
On pourrait essayer ce saut dans l’inconnu ; mais sera-ce un vol, une chute, ou encore rien ?… Et puis notre manque d’habitude de la chose (vu qu’elle n’arrive jamais qu’une fois) nous arrête toujours, et retarde sans cesse le plus beau jour de la vie, qui est celui de la mort.
En attendant donc que ce moment heureux vienne par la force destructive du temps ou des évènements, allons nous promener tous les deux. – Voulez-vous ?
Si chacun de nous laissait de lui-même avant de partir tout ce qui est bon à laisser, il ne resterait rien. Alors personne ne partirait ; il n’y aurait donc pas de promenade, et par suite pas de récit, pas d’œillet d’Inde. De simples pages blanches. Or, le public capable d’apprécier une semblable littérature n’existe guère dans nos pays, dont la civilisation est encore relativement en enfance. Je ne vois guère qu’en Orient, chez ces peuples millénaires arrivés au summum de la sagesse par les contemplations perpétuelles dans lesquelles ils laissent si heureusement tomber leurs vagues pensées, un public capable de trouver plus d’intérêt à des pages blanches qu’à toute autre chose, et encore faudrait-il le chercher surtout parmi les fakirs et les derviches.
Non, chez nous, il faut que ces pages soient couvertes de petits caractères noirs, alignés et ponctués. Donc, sacrifions au faux goût du jour comme tant d’autres l’ont fait avant nous : qu’il y ait un récit, deux voyageurs, et un quelque part où ils se promèneront.
Où irons-nous ? Voilà la question. Que ferons-nous ? Que dirons-nous ? Ne réfléchissons pas trop, car nous ne partirions pas. Ne songeons pas à ce que nous allons faire, car nous ne ferions rien ; à ce que nous allons dire, car il vaut toujours mieux se taire que parler. Rien vaut toujours mieux que quelque chose.
Vous croyez peut-être, ô Loti si naïf et si rusé, que je vais vous emmener dans ce que les clercs d’avoués appellent les « hautes sphères de l’idéal ».
Non, vraiment : l’idéal, c’est trop bête à la fin ! Et trop commun aussi, puisque tout le monde se mêle d’en avoir.
Donc, c’est sur terre que je vous emmène, et en Chine, pour nous reposer de votre Polynésie, et de vos pays musulmans, qui sont usés au possible…
Mais, attendez donc, il faut ménager la vraisemblance de ce récit de promenade en commun. Il est évident que nous n’avons pas pu combiner tranquillement ce voyage, comme deux bons compagnons qui se préparent à cheminer côte à côte en échangeant des impressions heureuses et humoristiques ; car, suivant nos habitudes, nous nous serions querellés avant le départ, et finalement nous ne serions pas partis.
– « Dieu qu’il est dur, ce départ ! Partiront-ils ou ne partiront-ils pas, ces deux voyageurs ? » se demande le lecteur avec inquiétude.
– « Oui, monsieur ; un peu de patience comme vous savez en avoir quand vous vous embarquez dans quelque omnibus de campagne qui a toujours de nouvelles commissions à prendre avant de se mettre en route. Un peu de patience, nous allons partir au lever de l’aurore, qui sera même une aurore boréale. Êtes-vous content ? »
– Voyons, arrangeons vite quelque chose de vraisemblable : nous nous sommes rencontrés par hasard dans un de ces endroits fréquentés et banals où tout le monde se retrouve, comme, par exemple, sur la glace de la baie du Pé-tchili, à une heure du matin, une nuit d’hiver.
J’étais, moi, vêtu d’un sayon en poil de chameau avec force peaux de bêtes par-dessus. Longs cheveux blancs postiches, tombant sur les épaules, longue barbe blanche postiche ; une besace sur l’épaule et cinq sous dans la main. – Vous, la taille serrée dans un élégant justaucorps de velours garni de fourrures, vous étiez drapé dans un grand manteau tout à fait romantique ; sur le front, un « signe fatal », et sur la tête une jolie barrette avec une aigrette rouge.
Nous avions eu l’idée de nous accoutrer ainsi, vous comprenez bien pourquoi : afin de ne pas nous reconnaître au cas où nous nous serions rencontrés promenant notre ennui sur quelque même point de cette planète, – qui a toujours été trop petite pour nous deux, puisque l’un n’a jamais pu aller nulle part sans y trouver l’autre.
De cette manière vous voyez que la conjonction a lieu par hasard, et le premier abord mutuel pourra être satisfaisant.
… La plaine de glace s’étend de tous côtés à perte de vue. La fantastique lumière de l’aurore boréale, promise au lecteur patient, embrase et colore superbement…
LOTI.– Laissez-moi faire cette aurore, Plumkett : cela m’amusera. J’en ai tant vu dans les mers du Nord, pendant mes nuits de quart, que je saurai bien en raconter une.
Vous disiez :
« La lumière boréale embrase et colore superbement… » cette nuit et ce désert. À travers le cristal étincelant des glaçons qui nous entourent, les reflets d’en haut se décomposent en tant d’arcs-en-ciel, que nous croyons marcher au milieu d’un monde fait tout entier de gemmes précieuses.
Au-dessus de nos têtes, les nuages qui planent sont d’un rouge sombre, d’une couleur intense de sang.
Et de grands rayons pâles traversent le ciel comme des queues de comètes ; il y en a des milliers et des milliers, qui divergent tous d’une sorte de centre mystérieux, perdu au fond de l’immensité noire : le pôle magnétique. Des faisceaux, des gerbes de rayons s’élancent et se déforment, reparaissent et puis s’éteignent. Cette étrange magnificence change et remue.
C’est la splendeur de cette force insaisissable, inconnue, qu’on a appelée magnétisme. Cette puissance occulte se donne ce soir une grande fête, par cette nuit d’hiver, là-bas dans les régions hyperborées. Elle rayonne, elle éblouit, elle inquiète, elle jette son épouvante de chose inexpliquée, incompréhensible, spectrale.
Une sorte de tremblement continu agite toute cette lumière. On croit l’entendre bruire et crépiter ; – on écoute, – rien… Ce n’est qu’une grande fantasmagorie silencieuse. Ce feu est froid et mort ; dans ce ciel et sur cette mer gelée, c’est le silence absolu.
PLUMKETT.– C’est bien cela. Ce milieu grandiose agissant sur nos nerfs, nous voici, Loti et moi, dégagés de toute entrave banale, ce qui facilite encore le bon accueil que nous nous faisons l’un à l’autre.
Le premier, je vous interpelle : « Je suis Ahasvérus, dit le Juif errant, ayant vingt-cinq centimes dans ma poche, et le tour du monde à faire jusqu’au Jugement dernier, sans autres ressources pécuniaires, depuis mille huit cent quarante-neuf ans. Et toi, jeune homme, qui as dû entendre raconter ma piteuse légende, qui es-tu ? »
Vous répondez : « Je suis Childe-Harold. J’ai bu à toutes les coupes ; je me suis enivré de tous les nectars et j’ai aussi senti l’âcreté de tous les fiels. J’ai respiré tous les parfums et tous les miasmes pestilentiels, quoique jeune encore. Je porte au front un signe fatal que tu peux y voir, vieillard ; tiens, là, entre les deux yeux. Et, repu de tout, blasé sur tout, je cherche autre chose que tout.
Ahasvérus : « Tes discours ne me semblent pas clairs, jeune homme, mais c’est égal : tu me plais ! Vas-tu au nord ou au midi ? »
Childe-Harold : « Je vais où le vent chasse la feuille détachée de son rameau.
Ahasvérus : « Eh bien, justement, moi aussi, je vais là. Viens avec moi, et mon âge mûr pourra tempérer les ardeurs de tes passions, qui me semblent un peu déréglées ; mon expérience, dix-neuf fois séculaire, guidera ta jeunesse… »
Et nous voilà donc, cheminant côte à côte sur la glace, moi en Juif errant et vous en héros byronien.
LOTI.– Ahasvérus et Childe-Harold sont démodés, mon pauvre Plumkett, et votre petite histoire est d’un rococo complet.
PLUMKETT.– Nous échangeons des propos fort intéressants. Je vous parle de mes mille huit cent quarante-neuf années de voyages ; dans mes récits, je vous montre un ailleurs perpétuel, et je vous tiens ainsi sous le charme de ma conversation.
Vous, croyant me raconter du nouveau, vous me confiez des idylles dont les héroïnes, appartenant à toutes les races humaines connues, ont les mœurs les plus étranges. Et, dans vos discours, les mots parfums exotiques, charme oriental, calme tiède, chaleur énervante, sables brûlants, immensité plate ou platitude immense, et autres propos semblables reviennent très souvent ; – le tout accompagné de beaucoup de désespérance et d’amertume…
Cependant, de la ligne droite de l’horizon, nous voyons devant nous surgir de petits points noirs…
LOTI.– Permettez, Plumkett, il faut aussi songer à éteindre notre aurore boréale, car la nuit s’avance, je suppose, et le jour va bientôt paraître.
Les nuages, qui d’abord ressemblaient à du sang vu par transparence, ont peu à peu changé de couleur. Les uns sont devenus d’un rouge sombre, les autres, d’un rose triste et mourant.
Les grands yeux pâles s’en vont à la débandade dans le ciel immense ; on dirait qu’ils ont perdu leur centre ; on dirait qu’on les en a détachés en les tranchant : du côté du pôle, leurs sections sont nettes comme des sections faites à coups de ciseaux.
Seulement ils se tiennent encore entre eux, les rayons pâles, juxtaposés en longues séries mouvantes et tremblantes. Cela semble des bandes d’une gaze lumineuse plissée à petits plis.
Des souffles mystérieux, qu’on ne sent pas sur terre, des souffles magnétiques, agitent doucement ces étoffes de feu blême ; elles s’enroulent en spirales légères, ou se déploient comme des banderoles impalpables, en s’éteignant toujours.
De dernières rougeurs, presque livides, paraissent encore çà et là sur les nuages.
De derniers lambeaux de cette gaze lumineuse traînent au hasard dans l’espace, en tremblant toujours. Ils deviennent de plus en plus diaphanes. Ils sont si vagues, qu’on a peine à les suivre. Ils sont si ténus, que l’œil les perd. Ils ne sont plus rien. La lumière polaire est éteinte. L’aurore boréale vient de mourir.
La nuit noire et glacée nous enveloppe et nous n’y voyons plus, au milieu de ce chaos déchiqueté qui est une mer figée.
PLUMKETT.– Pardon ; nos yeux sont habitués à l’obscurité, mon cher Loti, et nous pouvons encore parfaitement nous diriger. D’ailleurs voici la première clarté indécise du jour d’hiver qui se lève. Devant nous, comme je vous le disais, nous voyons surgir sur la ligne d’horizon des petits points noirs, qui deviennent des masses, qui, insensiblement, montent, montent, à mesure que nous nous en rapprochons, et s’élèvent enfin rapidement au-dessus de la surface polie et réfléchissante du golfe gelé. Une ligne brunâtre vient ensuite réunir tous ces petits îlots épars qui prennent à nos yeux des aspects formidablement guerriers : c’est la côte du Pé-tchili, c’est l’entrée du Pé-ho ou rivière du Nord, ce sont les forts de Ta-hou, c’est la Chine !
Nous nous engageons au milieu de divers ouvrages en terre, et découvrons l’embouchure étroite et tortueuse du fleuve. Ici la glace est opaque et d’un jaune terreux : ce n’est plus de l’eau, c’est de la vase gelée.
Lentement le jour se lève.
Sur chaque berge se dresse une formidable citadelle, flanquée d’énormes bastions à l’européenne, avec des embrasures qui laissent paraître des canons Armstrong.
Sur chacune de ces citadelles flotte un long pavillon jaune, sorte de banderole dentelée sur laquelle on voit un dragon vert cherchant à prendre avec les dents une grosse boule, blanche qui représente la lune. C’est le pavillon du Tien-tze ou Fils du Ciel, souverain de ce Tchoung-koué ou empire du Milieu, au sein duquel nous pénétrons.
Des hommes se montrent aux remparts. Ils sont vêtus de larges casaques noires bordées de galons rouges ; ils ont sur le ventre une boule rouge et portent dans le dos les deux caractères Tang-ping qui signifient soldat (nous reconnaissons à ces signes leur position sociale).
Ils sont coiffés de petits turbans noirs autour desquels s’enroule leur chevelure tressée en queue.
Nous examinons ces faces patibulaires de bandits. Elles ont des expressions cruelles et niaises, féroces et riantes ; nez courts, épatés et busqués, petits yeux obliques, bouches largement fendues, mentons renfoncés.
Tous gesticulent, se démènent et crient à la vue des deux étrangers voyageurs qui arrivent. Et s’ils pouvaient se douter de ce qui se passe dans leur tête ! Leur cervelle de Chinois éclaterait !
Une plaine marécageuse qui n’en finit plus, plaquée çà et là d’étendues luisantes, qui sont des flaques d’eau gelée.
Un grand village, amas de petites cabanes en terre dont la couleur se confond avec celle du sol. Puis un autre village, toujours de la même couleur terreuse, puis un autre, et un autre encore. Et des gens couverts de peaux de bêtes comme des Esquimaux, avec de longues queues toujours et des yeux de travers, qui grouillent, qui vont et viennent comme des fourmis, qui s’arrêtent sur les berges, qui s’attroupent, écarquillent leurs petits yeux sournois, et, en nous voyant crient à tue-tête : Koué-tsé ! Koué-tsé ! (Fils de diables !)
Sur la place, un grand va-et-vient de charrettes, de traîneaux, d’hommes montés sur des ânes, de piétons, tous ronds comme des boules, sous leurs amas de peaux de bêtes.
Sur les berges, là où il n’y a pas de maisons, d’interminables alignements de jonques halées à sec, peintes en couleurs éclatantes, avec des proues représentant des gueules de monstres.
Puis encore des villages en terre, encore des jonques, encore des fourmis humaines, encore des traîneaux sur la glace, encore de grands forts bastionnés avec des bannières et des banderoles jaunes ; encore des Tang-ping, avec leurs boules rouges sur leur ventre noir. Et du monde s’égosillant, hurlant : Koué-tsé ! Koué-tsé ! Koué-tsé !
– « Nous allons louer ce char qui passe, dit Ahasvérus-Plumkett, et nous serons, dans trois jours, arrivés à Péking. Si vous saviez, Childe-Harold, tout le monde de pensées qui s’éveille en moi, à simplement considérer cette charrette à deux mules que nous allons prendre. Songez, mon cher ami, que, six cents ans avant notre ère, le sage Koung-Fou-Tsé voyageait comme nous, dans une charrette exactement pareille à celle-ci, à travers cet immense empire, qui alors ressemblait fort à ce qu’il est aujourd’hui. Les charrettes chinoises, ô Childe-Harold, n’ont pas évolué d’après la loi de Darwin ; leur espèce est restée stationnaire. »
Childe-Harold-Loti : « Mais, je ne me trompe pas !… Ces discours emphatiques et détraqués, cette parade de science moderne mal digérée !… Ce n’est pas Ahasvérus, c’est – Plumkett ! »
Le faux Ahasvérus arrache sa perruque, sa barbe et son nez postiches. Loti efface son signe fatal,