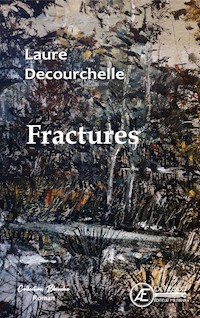
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ex Aequo
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Quatre histoires de garçons et de filles adolescents qui cherchent le chemin vers la sérénité.
L’adolescence… Le plus bel âge de la vie, celui de tous les possibles… ? Pour certains, comme cette reine du bal ou Madeleine et sa sœur au lendemain de la mort violente de leur mère, l’adolescence n’est rien d’autre qu’une antichambre cynique à la vie d’adulte. Pour d’autres, comme Ben et Eddie enfermés dans leur cité ou Esther à qui on avait pourtant formellement interdit de s’écarter du sentier dans le bois, tout n’est pas forcément joué…même si le chemin vers une vie plus sereine peut sembler lointain. Mais pour tous ou presque, la jeunesse est synonyme de passion charnelle, tantôt immorale, tantôt pure, toujours magnifique parce que vécue sans barrières.
Quatre histoires de garçons et de filles qui racontent les amitiés exaltées ou les tourments de la chair, le temps d’un été, d’une année scolaire…
Plongez-vous dans ce roman passionnant qui vous fera revivre d'une certaine façon votre jeunesse.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 291
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Laure Decourchelle
FRACTURES
Nouvelles
ISBN : 979-10-388-0161-5
Collection : Blanche
ISSN : 2416-4259
Dépôt Légal : juin 2021
©couverture Ex Æquo
© 2021Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction intégrale ou partielle, réservés pour tous pays
Toute modification interdite
Je souhaiterai dire un grand, grand merci à Sarah et Martial, mes premiers fans, merci, les amis !
1
Dans la vie, il existe deux catégories de personnes : celles qui considèrent leurs années collège comme une période difficile de leur existence — si ce n’est la pire — et les autres. Pour ma part et aujourd’hui encore, je n’ai pas décidé dans quelle catégorie je devais me situer. Ce que je sais, c’est que même à des milliers de kilomètres, je rêve toujours du Gérard{1} — encore que pas souvent, même si je trouve que la fréquence a augmenté ces deux dernières années — et dans la grande majorité des cas, ce n’est pas à propos de ce qui s’est passé à la galerie d’art, ni même ce mercredi au club photo. Non, je rêve d’elle, nous sommes assises l’une à côté de l’autre sur le muret qui court devant la vie scolaire, le ciel bas de février posé au-dessus de nous comme un couvercle, elle parle, vite comme à l’accoutumée, je ne l’écoute pas, mais je la dévore des yeux. Les autres rêves sont de mauvais rêves, des docu-fictions où Alexis et elle sont ensemble et font des choses, ou bien c’est le jour de l’exposition, mais en pire… Et puis il y a ce cauchemar où je nous revois toutes les deux dans la cour du collège, le temps est au beau fixe, car nous approchons des grandes vacances d’été, elle se tient debout devant moi, les pieds bien campés au sol comme un boxeur, ses yeux d’ordinaire placides lancent des éclairs, et cette fois-ci lorsqu’elle parle, je l’écoute et ce qu’elle dit me fait peur. Non, c’est faux… en fait, je suis terrorisée, terrorisée et dévastée. Ces fois-là, lorsque je me réveille, la mâchoire douloureuse d’avoir trop serré des dents dans mon sommeil, je suis soulagée que tout ça soit derrière moi… Mais parfois aussi, tandis qu’encore engluée dans la toile du passé je reste assise dans mon immense lit depuis lequel je peux voir Central Park et derrière, l’Hudson River, loin, loin du Gérard et de cette vie que trouvais étriquée et misérable, le soulagement laisse place à une infinie nostalgie de cette période où je ne m’étais jamais sentie plus vivante que durant ces jours et ces nuits où me branlant rageusement, je pensais à elle.
2
Le Gérard Yvon à Vendôme était un assez gros collège : pas loin de six cents élèves, une architecture de béton amer, des fenêtres qui quadrillaient tout l’édifice comme les yeux d’un insecte et une cour qui ressemblait à un parking de boîte de nuit. J’étais une élève populaire : brillante, discrète, mais bonne camarade, des pommettes hautes et de grands yeux bruns, des cheveux dorés comme les blés mûrs, une jolie silhouette… Un visage de poupée, quoiqu’un nez un peu long… Un canon et une chouette fille. Par ailleurs, j’ai toujours eu le sens de l’élégance et heureusement, car mon petit côté BCBG je ne risquais pas de le tenir de mes parents : ma mère, mi-femme au foyer, mi-meuble avait autant de style qu’une choucroute en boîte et mon père était chaudronnier. Rien à voir avec les parents de mes « amies » : médecins, notaires, entrepreneurs… Tous notables à Vendôme… Tous au Lion’s Club… Tous des connards condescendants… Je les détestais, mais je méprisais encore plus les miens. Petite déjà, je rêvais en lisant le petit Lord Fauntleroy, Anastasia… tous les bouquins de Roal Dahl qui parlaient de ces gosses qui finissaient par vivre autre chose que ce que leur présageait leur début merdique dans la vie. Avec le temps, en ne voyant venir ni serviteur Hindou comme dans Little Princess ni couple de chirurgiens en quête de leur bébé échangé à la maternité, j’ai fini par accepter de devoir travailler cent fois plus dur que le monde entier. Putain de pauvres.
Il faisait chaud et terriblement beau cette rentrée scolaire 1994, ce qui donnait le sentiment que ce début de nouvelle année qui augurait de nous voir enfermés dans des classes pendant les dix prochains mois n’était qu’une énorme farce… On sortait les fournitures de la liste, on ouvrait nos classeurs et on copiait nos nouveaux emplois du temps, mais sans conviction parce que dehors, l’été se prolongeait et nos fringues n’étaient pas les nouvelles achetées exprès pour la rentrée à l’Intermarché, mais celles qu’on portait deux jours avant sur la plage ou aux camps de vacances. Même moi qui prenais l’école et plus encore cette année de brevet au sérieux, je n’étais pas dedans. J’avais encore la tête du côté d’Avignon, au camp de vacances des CMA avec lesquels j’avais passé trois semaines et je me rappelais de tous les garçons et les filles de ce camp sur lequel j’avais régné comme une petite reine des bois. En classe, je tripotais sans cesse le bracelet brésilien que Marc, un moniteur, m’avait offert lors d’une veillée comme si c’était une alliance. Je repensais à l’effet que je lui avais fait à lui, mais aussi à tous les gars du camp, particulièrement lorsque l’on partait se baigner au lac et que j’exhibais ce haut de bikini qui cachait tant bien que mal une poitrine somme toute assez banale pour une strip-teaseuse, moins pour une jeune fille de quinze ans aux épaules frêles… Je me souvenais des regards que je provoquais chez les autres : douloureux, éperdus, haineux… À moi seule, j’étais un véritable manège à émotions. Je ne m’étais jamais sentie plus exaltée que cet été-là lorsque j’avais fait pleurer cet idiot en lui disant que je préférais sortir avec un garçon de mon âge ou lorsque j’avais convaincu cette fille de se faire toucher par des gars en échange d’un peu de fric, la persuadant que les garçons donneraient n’importe quoi, ne serait-ce que pour voir ses seins, que c’était parce qu’elle était plus sensuelle et plus mature que les autres filles et qu’il vaudrait mieux que cela reste entre nous parce qu’elles ne comprendraient pas et pourraient être jalouses… Quelle conne ! Avec l’argent, j’ai acheté une bouteille de Malibu Coco et des bonbecs qu’on s’est partagés toutes les deux la veille du départ en parlant de tout et surtout de rien… C’est marrant comme les choses ne tournent jamais comme vous les imaginiez : j’avais très sérieusement envisagé de perdre mon pucelage durant ce camp, les détails étaient flous, mais je comptais ramener dans mon sac à dos, entre les sachets de lavande et d’herbes de Provence, le souvenir de ce moment particulier où je découvrais enfin que ce bout de chair entre mes cuisses avait plus de sensibilité qu’un morceau de liège. Je me masturbais depuis l’âge de douze ans avec pour seul résultat des irritations et une grande perplexité ; je pétrissais ma poitrine en faisant des cercles de salive sur les mamelons, mais j’avais plus l’impression de malmener des sacs de viande que de m’exciter. À cette époque j’essayais un paquet de trucs copiés sur les films X, mais je ne ressentais rien. Je faisais tout ça parce que mes copines étaient de vraies chaudières : à treize ans elles se masturbaient avec les vibromasseurs de leur mère, à quinze, elles étaient envoyées en pension pour s’être fait prendre à tailler des pipes à leurs cousins. Elles n’étaient pas nymphomanes ni rien. C’est juste qu’elles s’amusaient. Elles buvaient, fumaient et trouvaient ça drôle de se branler avec un concombre et de la crème Nivéa. Elles étaient scandaleuses et hautaines, libérées et vibrantes, fascinantes et sensuelles. Moi, je n’étais que hautaine. Je voulais être comme elles, depuis toujours, mais quoi que je fasse, quel que soit le jean que je portais, la coupe au carré que j’arborais, la manière affectée avec laquelle je crapotais les Winston, je n’étais pas des leurs. Au moindre choc, le faux vernis BCBG craquelait et apparaissait la fille du meuble en bois massif et du chaudronnier, celle qui faisait ses devoirs sur un coin de la nappe cirée de la cuisine parce qu’elle n’avait pas de chambre à elle, celle qui s’était acheté une croix en argent fin pour faire croire que Jésus aussi était dans le camp des pauvres (ce qui était faux bien sûr, Jésus ne trinquait qu’avec les riches), celle qui n’invitait jamais personne chez elle parce qu’elle aurait préféré se pendre plutôt que montrer ses parents, Valoche et J-P, fans inconditionnels d’Alain Barrière et de l’emplacement A103 du camping « Les roches mousseuses » dans le Lubéron… Autant visiter Thoiry. Des caricatures se rencontrant ne pouvaient donner qu’une rencontre caricaturale… Je voulais être cool et flamboyante, mais je ne me voyais pas pour autant jouer à touche pipi avec un demeuré de la ville : une fellation faite par une jeune fille en robe blanche dans un château de la Loire, ça avait toujours plus de classe qu’une branlette à Michael à l’arrêt de bus. Sauf que pour une fille comme moi, il n’y avait que des Michael et des arrêts de bus, et dans ces petites villes mesquines, étriquées, les réputations se font, mais se défont rarement : il y a des codes, des règles à respecter, une salope bourgeoise sera une Lady Chatterley, une salope pauvre sera toujours une putain de salope. On ne jouait pas avec le même jeu entre les mains. Aussi, quand mes parents m’annoncèrent que je partais en camp de vacances pendant trois semaines, j’y ai vu une occasion de mettre en pratique ce que Canal + et Play-boy m’avaient appris, loin de Vendôme et du Gérard, d’avoir un wagon d’avance sur ces garces et de faire enfin partie du cercle. Je pensais que ramener dans mes bagages un 69 ou un plan à deux à raconter serait toujours plus flamboyant qu’un pompier à Jean-Eudes au mariage de la cousine Eugénie… Là-bas, j’ai aussitôt jeté mon dévolu sur le moniteur des louveteaux. Il était mignon et jouait de la guitare, mais surtout il était moniteur. Est-ce qu’il me plaisait ? Non. Et j’ai aussi très vite compris que je n’aimais pas vraiment ça, je faisais les choses d’une manière mécanique : ouvrir la bouche, mais pas trop, glisser la langue délicatement et faire tourner, peu importe le sens, caresser les cheveux, les cuisses, j’étais un robot. Un soir lassée de ne rien ressentir, j’ai sorti sa bite et j’ai craché dans ma paume en la faisant glisser de haut en bas ; je me souviens du durcissement palpitant dans mon poing et son regard vitreux, ses lèvres entr’ouvertes dans une grimace grotesque, le gars mignon et sensible qui ourlait des yeux en jouant de la guitare à la veillée était devenu une marionnette pitoyable. Quand il a joui, les spasmes secouèrent sa poitrine comme s’il s’électrocutait. Je l’ai trouvé pathétique et je me souviens avoir pensé que même ces giclées paresseuses l’étaient. Alors, j’ai décidé de ne pas le laisser me dépuceler. Le lendemain, je le larguai et décidai de partir à la recherche de celui qui ferait tilter mon clitoris comme l’extra balle. Je ne l’ai pas trouvé et je ne ramenais rien dans mon sac à dos cet été-là, rien d’avouable en tout cas. Mais à la fin de ces trois semaines, j’eus deux convictions : la première, que je ne serais jamais une femme-buffet condamnée à traîner la pantoufle dans un pavillon minable, la deuxième que je n’étais pas loin d’être frigide. Dans les deux cas, ça m’allait. Je n’aime pas le sexe, pas seulement cette façon qu’il a de ravaler les gens à ce qu’ils sont de plus méprisables, mais aussi les corps, les chairs flasques qui s’entrechoquent dans des bruits de flac-flac, ça pendouille, ça suinte, ça s’enflamme, ça pend de la langue, on dirait un abattoir. Le sexe vous perturbe, vous fait perdre le contrôle… Je n’aime pas l’être qu’il révèle en nous. Les animaux pratiquent la reproduction mus par l’instinct de survie de leur espèce, nous on se met à quatre pattes en écartant les fesses avec nos mains en suppliant l’autre de nous faire mal….
Finalement, une seule de ces deux convictions se trouva être vraisemblable.
3
Cette rentrée-là, notre petit cercle de pimbêches avait rétréci comme peau de chagrin, les jumelles de la Pharmacie Serre et Marie-Louise passeraient leur année de brevet dans un établissement plus conforme avec les valeurs de leur famille, façon bourgeoise de dire qu’ils allaient devoir brider ces petites crétines, mais qu’ils préféraient confier ce travail à des experts : les religieuses de St Benoît, collège où j’avais toujours rêvé d’aller, car loin, c’était plus facile de s’inventer une autre vie. On s’était dit au revoir assez froidement et je réalisais que le dernier échange sincèrement amical qu’il y avait eu entre Marie-Louise et moi remontait à la cinquième, lorsque que l’on s’écrivait des mots dans nos cahiers de textes avec des stylos parfumés et ces récréations que l’on passait à parler de ce tour d’Australie à vélo que l’on ferait ensemble et cette grande maison avec piscine que l’on partagerait et ce job qu’on aurait aussi ensemble, un restaurant pourquoi pas, où je cuisinerais et elle ferait la décoration de la salle et l’accueil des clients grâce à son niveau d’anglais « amazing »… Et puis l’été suivant, ce petit monde chouette et réconfortant s’était écroulé : de nouvelles amies plus sophistiquées étaient apparues à la villa de Biarritz et au centre équestre et on m’avait fait comprendre que je ne faisais pas le poids avec mes deux mois passés entre le centre aéré de la ville et le camping « Les Mousses Rocheuses », que je n’avais jamais fait le poids finalement. Malgré tout, cette année-là, j’ai continué à traîner avec elles — enfin, c’est plutôt elles qui me traînaient — parce que je les admirais depuis toujours et que je voulais leur ressembler et puis parce que j’avais une haute opinion de moi-même, alors j’ai essayé de ne pas montrer que je les suivais comme un petit toutou, mais c’était dur parce qu’elles me tournaient de plus en plus le dos. Dans ce nouveau cénacle, je n’avais pas ma place, je n’avais aucun voyage exotique et fun à raconter — sauf si le Lubéron était devenu la nouvelle destination à la mode —, aucune fête cool durant laquelle j’avais bu du mauvais vin en ricanant devant un film porno gay, aucun parent qui m’avait punie à rester dans ma chambre de 30 m² comme une princesse scandaleuse… Rien, parce que j’étais une putain de pauvre et tandis que les autres me donnaient l’impression de faire des pas de géant dans la vie, moi, je stagnais, entre Alain Barrière et la vieille guitoune bleue, emplacement 103. Mais j’étais jolie, belle même et maligne comme un singe et je traînais derrière moi comme une queue de comète des fans, mâles et femelles, qui faisaient du bien à l’ego de ce merveilleux petit groupe où, une belle fille c’était mieux dedans que dehors, raison pour laquelle on me tolérait du bout des lèvres, mais déjà je savais qu’à la rentrée d’après il y aurait des coupes franches, le groupe n’existerait plus ou en tout cas plus avec moi.
En réalité, l’annonce de leur départ ne me fit ni chaud ni froid, au contraire : le camp m’avait redonné du poil de la bête et j’avais déjà dans l’idée de faire dissidence, pourquoi pas avoir ma cour à moi… J’avais aussi envie d’être seule, de m’entendre penser pour une fois. En fait, je ne savais pas trop ce que je voulais.
4
Les quinze premiers jours de septembre furent un calvaire : je tournais en rond comme un lion en cage, j’enrageais d’être là, de retour dans cette ville minable, entourée de gens médiocres ; je bouillais d’être la reine d’un royaume aussi naze. Je voulais un diadème plus prestigieux que la fille la plus jolie ou la plus douée en maths du bahut et en même temps je voulais être la reine de personne. Je ressassais le souvenir du camp comme une actrice sur la touche sa gloire passée. Et un jour, je la vis plantée, les bras ballants au milieu de la cour en train de cuire sous le soleil comme une laitue déshydratée. Gogolita… c’est le premier mot qui m’est venu à l’esprit. Des cheveux mi-longs, couleur queue de bœuf, fins et gras s’étalaient en boucles sur ses épaules massives et voûtées, un nez long et disgracieux, des petits yeux rapprochés et une peau épaisse couleur manouche… Le plus laid était le bas de son visage : sa bouche, béguë, aux lèvres décolorées et petites, et son menton en galoche… Une vraie mocheté de conte de fées. Elle portait un débardeur pastel à fines bretelles et un bas de jogging rose. Au niveau des fesses, une serviette hygiénique tendait le tissu. C’était une SES, comprenez Sous Espèce Siphonnée qui, dans la hiérarchie des débiles, se plaçait un milliard de crans au-dessous des CPPN — Crétins Presque Normaux —. Le SES était la lie du collège, on y trouvait de tout : du trisomique, du futur violeur et même du nain. Si les CPPN portaient l’ambition d’aller un de ces jours grossir les bancs d’un lycée professionnel, les SES, eux, finissaient soit en taule soit dans un HP. Au Gérard, ils étaient une dizaine pour trois ou quatre profs qui avaient l’air aussi bizarres que leurs élèves : ils avaient tous des têtes d’activistes du Larzac et les rares fois où on les voyait traîner du côté de la salle des profs, on aurait cru des loups lâchés dans la bergerie. Les SES étaient à part, on ne les croisait jamais dans les couloirs, car leurs salles se trouvaient dans un bâtiment annexe à côté des salles de technologie et du réfectoire ; leurs cases peintes au sol pour les rangs étaient aussi à l’écart, juste sous les fenêtres de la CPE et ils mangeaient et sortaient plus tôt que nous. On ne les voyait qu’à la récréation du midi et là on les évitait comme la peste parce qu’ils avaient une réputation de cinglés et même les plus moustachus des 3èmes ne venaient pas leur chercher des noises. Je me rappelle en 6ème d’un gars qui m’avait demandé devant tout le monde si je suçais pour un BN, ça l’avait bien fait rire avec ses copains et moi j’avais rougi, car même si je ne savais pas de quoi il parlait, je savais que c’était dégueulasse… Il m’avait terrifié jusqu’à la fin de l’année. En 3ème, les SES ne me faisaient plus peur, plus personne ne me faisait peur et question bites, j’en connaissais certainement plus que ces connards. Gogolita avait, comme la plupart des élèves de sa classe, les stigmates de la crétinerie congénitale, mais elle avait quelque chose en plus, ou plutôt en moins, elle avait un regard doux et égaré comme celui d’une biche prise dans les feux d’une bagnole. J’ai eu le coup de foudre.
En octobre, j’allais mieux. J’avais été élue déléguée de ma classe, je m’étais portée volontaire pour être référente du tutorat des 4èmes-3èmes ; j’avais fait une demande argumentée auprès du proviseur pour monter un club photo : les CMA m’avaient appris quelques bricoles sur le développement des pellicules et le tirage de l’argentique et je savais que du matériel prenait l’humidité dans les placards. J’étais hyperactive, mais ça ne m’empêchait pas de penser à Gogolita… Tout le temps… Je ne lui avais jamais parlé évidemment, mais je la matais, dans la cour, dans les rangs… J’avais appris qui était son frère, Arnaud (on suivait le même cours d’anglais renforcé) et on avait un peu discuté : sa famille avait débarqué à Azé — un patelin perdu au milieu des vaches à dix kilomètres de Vendôme — durant l’été, le père avait intégré l’usine où le mien travaillait et la mère avait un boulot de cantinière à l’hôpital. Il y avait aussi un petit frère, en primaire, qui d’après ce que j’avais vu à la sortie du collège, n’avait pas l’air très frais non plus. Arnaud allait la voir à chaque récré, il avait l’air protecteur et attentif, il la faisait rire. En décembre, il y eut le bal du collège durant lequel je fus élue « Reine du Gérard ». Je brillais de mille feux ! Pour la première fois de ma vie, j’étais heureuse — pas satisfaite, pas contente, pas repue —, heureuse, détendue… Même avec mes parents, ça allait mieux, je tolérais leur conversation inepte sur fond de Top 50 ou leur silence béat sur fond de Patrick Sabatier… Tolérer n’est pas le mot… En réalité, j’étais absente, un « ghost »… Avant, je claquais les portes et j’avais des moues hautaines apprises à l’école des petites garces BCBG, mais à cette époque j’étais murée dans mes fantasmes qui étaient un mélange de diadème, de bonnes notes et d’elle. Elle était mon secret, noir et chaud que j’enfouissais dans les tréfonds de mon âme, à côté de celui que j’avais ramené cet été-là avec le savon à la lavande et la boîte d’herbes de Provence et que je ne révélai à personne — Grand Dieu non — ce souvenir du camp où, cachée derrière le mur des sanitaires avec des pièces de dix balles plein les poches de mon short, je regardais cette fille se trémousser et pousser des petits gémissements sous les mains du gars à qui c’était le tour, et ses seins lourds aux larges aréoles brunes tressauter comme les muscles des canassons sous les piqûres des mouches et que la nuit allongée dans mon lit, lorsque ces images me revenaient, c’était moi le garçon et alors une chaleur irradiait mon bas-ventre et pesait dans mon vagin comme un bouchon à demi-enfoncé. J’avais ramené ça dans mon sac à dos…
5
Un samedi de janvier, peu avant la fin des vacances, je rentrais à la maison et ce fut comme lorsqu’à cinq ans, j’avais découvert sous le sapin le Kiki géant que je voulais le plus au monde : elle était là, assise dans le canapé de mon salon et caressait Jill, le Yorkshire de la maison, — ou plutôt celui de ma mère —. On aurait dit un tableau de Goya. Elle a levé ses yeux de velours vers moi et m’a souri. Elle a murmuré un truc comme « Il est mignon », mais je n’ai pas bien compris, car on aurait dit une camée sans dents. Je me suis assise à côté d’elle et Jill, qui n’avait jamais pu me sacquer, se mit à grogner sourdement. Pour l’apaiser, Gogolita se mit à la caresser plus fort sur la tête, faisant ressortir dangereusement ses globes oculaires. Je ne l’avais jamais vue de si près : sa peau était grumeleuse avec des pores dilatés, elle portait la coiffure la plus improbable de l’histoire de la coiffure — une demi-queue haute avec un serre-tête en plastique rose — ses larges cuisses étaient enserrées dans un fuseau violet qui jurait avec un pull jacquard noir et blanc ; elle sentait la transpiration, un mélange de soupe aux poireaux et de boudin noir… Elle était laide, mais son regard doux éclipsait presque tout le reste. À cet instant, j’ai basculé : le secret noir des CMA a pris les couleurs moirées et violentes d’un désir que je ne contrôlais pas. Je lui ai souri et probablement mon sourire ne reflétait-il pas le désir carnassier que je lui portais ou peut-être était-elle tout simplement trop débile pour le remarquer, toujours est-il que ce jour-là, je la mis dans ma poche. Et je me dis souvent que si Jill avait su communiquer avec elle, elle lui aurait dit de faire gaffe… Les chiens sont parfois moins cons que leur maître et dans son cas, ce n’était pas excessivement dur…
Pour la petite histoire, mon père avait fini par se lier d’amitié avec le père Verdier, au point qu’un soir il invitât toute sa petite famille à dîner. Je ne sais pas trop ce qui les avait rapprochés… Probablement, l’amour des meubles massifs et des boissons anisées. La mère était une petite chose qui puait le cendrier froid, le père un connard avec l’œil égrillard constamment posé sur ton cul ou tes seins, le petit frère n’avait rien de remarquable excepté une belle « gueule en biais » comme on dit par ici et Arnaud, pour une raison inconnue, était absent. Le dîner fut horrible, mélange de conversation de comptoir PMU, caricatures de Bidochons et de pensées constamment tournées vers elle. Je touchais le fond du seau à merde et pourtant rien ne me décidait à taper du pied et à remonter à la surface et à la fin du repas, je décidai que je l’aurais… mais je ne savais pas qu’elle m’aurait aussi.
6
En mars, le club photo entre midi et deux battait son plein à la grande fierté de Mr Delmas, le proviseur, qui nous avait commandé une exposition pour la fin de l’année. J’étais une bonne pédagogue, mais pas une très bonne photographe. Mais j’adorais ça. Avant l’avènement des appareils numériques, les Réflex étaient de vrais Kinder surprise et les surprises étaient quelquefois vraiment bonnes. Je faisais principalement des paysages du Loir et des portraits et aussi un truc que j’avais découvert par hasard : j’impressionnais deux fois la pellicule, ce qui donnait lieu à des images hybrides parfois géniales : joueurs d’échecs et cheval, bâtiment en construction et bras de rivière, petite sœur et chat crevé… Lorsque l’image se révélait dans le produit, j’avais l’impression de voir de la magie à l’œuvre. Le thème de l’expo était « La différence au collège, une richesse à cultiver », ce qui m’avait valu d’être portée aux nues par la salle des profs tout entière ; je voulais faire des portraits : des SES, des gros, des petits, des beaux, des binoclards, des becs-de-lièvre, des Noirs, des Arabes, le prof de biologie en fauteuil roulant, la fille de cuisine rouquine et autres handicapés de la normalité… Du coup à la récré, je m’autorisai à aller parler à Gogolita, ce qui un an auparavant aurait été impensable, mais comme désormais je faisais dans l’entraide et la solidarité, on voyait ça comme une mission humanitaire. J’étais devenue la Mère Térésa du Gérard Yvon.
Elle parlait beaucoup, un vrai moulin à paroles, mais je ne comprenais rien la plupart du temps, car elle butait sur les mots et aussi parce qu’elle était con comme une pelle, mais cela n’avait aucune espèce d’importance puisque je ne l’écoutais pas, je la regardais. Parfois, elle me faisait des câlins maladroits et brusques et son corps était comme un bloc de chair compact sous ses pulls informes ; elle me faisait penser à un poupon en plastique. Un poupon pour adulte… Un jour, je lui demandai de poser pour moi… hors exposition. Avec le recul, je me demande si je n’avais pas choisi le thème dans l’unique but de l’attraper avec mon objectif… et de l’attraper tout court. On faisait ça au collège, dans le studio derrière le labo qu’on avait monté avec des draps blancs et des lampes de bureau. Elle aimait que je la prenne en photo, surtout parce que je la maquillais : elle se trouvait belle. Je ne la contredisais pas, au contraire, et séance après séance, je lui disais qu’elle était jolie, qu’elle avait des yeux époustouflants et que les garçons de sa classe devaient se battre pour sortir avec elle, ce à quoi elle bougonnait qu’ils étaient tous moches et bêtes et qu’ils préféraient de toute façon Sonia Letourneux parce qu’elle avait de gros seins… Je lui rétorquais l’air de rien qu’elle avait un très joli corps, mais peut-être devait-elle le mettre davantage en valeur, avec des t-shirts qui souligneraient un peu plus sa poitrine par exemple et que si elle voulait, je pourrais lui en donner qui ne m’allaient plus. Je ramenais alors des t-shirts que j’avais évidemment achetés, mais elle était tellement con qu’elle ne remarquait pas la différence de nos tailles, des débardeurs et des hauts moulants qui faisaient ressortir ses seins en poires et je lui rappelai qu’elle ne pouvait les porter qu’ici, au club, pour les photos, parce que sa mère ne serait peut-être pas d’accord qu’elle porte ce genre de vêtements, lui expliquant que parfois les mères préféraient continuer d’habiller leurs filles avec des fringues de gamines parce qu’elles n’acceptaient pas qu’elles soient devenues des femmes même lorsqu’elles avaient seize ans et qu’elles portaient des soutifs. Je lui répétais sans cesse qu’elle avait de la chance d’avoir un tel physique et qu’elle devait en faire des jalouses… Elle a fini par le croire… Devant mon objectif, elle prenait la pose et faisait la moue. Elle était ridicule et d’aucuns l’auraient trouvée sinon charmante, du moins émouvante, moi je la trouvais pathétique, vulnérable et… excitante. Est-ce que une seule fois j’ai voulu faire marche arrière ? Non. Durant cette période, je me suis demandé si mes salopes de copines m’auraient comprise, peut-être Marie-Louise… Après tout, on l’avait mise dans le privé pour avoir — entre autres — sucé ses cousins (dont un de douze ans). Le seul risque à St Benoit était qu’elle prenne goût à la badine… Croyez-le si vous le voulez, mais cette fille (de chirurgien), qui à l’époque avait pour seule ambition l’argent et regarder la manière dont le monde tournait autour d’elle, cette fille est aujourd’hui directrice de centre de loisirs dans une petite commune des Pyrénées et aux dernières nouvelles, elle se réjouissait de son projet de ferme pédagogique et de son potager bio intégrés au centre… Sauf que le naturel revient toujours au triple galop et tu peux bien te coller un autocollant WWF au cul si tu veux et défiler une pancarte à la main, tes cheveux passés au henné au vent pour délivrer les poules de leur cage, garce tu as été, garce tu resteras et je n’ai aucune peine à imaginer la manière dont elle règne aujourd’hui sur une équipe de jeunes animateurs payés au lance-pierres… C’est comme ça : on fait avec ce qu’on est.
7
En principe, le collège n’accueillait aucune activité les mercredis après-midi, mais il était ouvert toutes les deux semaines pour les élèves collés. J’avais demandé à Delmas la permission d’aller au studio un mercredi de « non-collés » prétextant des photos à tirer d’urgence en vue de l’exposition et il avait refusé, car ces mercredis-là, seule l’administration était ouverte et elle ne pouvait pas avoir la responsabilité de surveiller une élève. Les mercredis de collés, en plus de l’administration il y avait Mme Simoès la gardienne, Mme Cornu la CPE, et des pions. Ce mercredi-là, la surveillante était Machine qu’on surnommait Bamboula à cause de ses lèvres épaisses. Je suis allée me présenter à la mère Cornu en lui disant que j’en avais pour deux ou trois heures et que je n’oublierais pas de passer déposer les clefs chez Mme Simoès en partant. Gogolita m’attendait, cachée dans les toilettes comme je lui avais demandé. La vieille Simoès l’avait peut-être vue ou pas, vu qu’elle ne voyait rien à deux mètres sans ses carreaux qu’elle ne portait jamais sauf au bout d’un cordon sur sa poitrine pour ne pas dépareiller avec son magnifique visage ; mais d’elle, je m’en foutais, c’était des autres qu’il importait qu’elle se cache… À ses parents, elle avait pipoté un après-midi chez moi, ce qui n’était pas absolument faux puisque je comptais la ramener à la maison vers 16 heures, une heure environ avant que ma mère ne se pointe avec ma sœur qui rentrait de son cours de danse. Il existait, bien sûr, le risque du coup fil inopiné, mais j’y croyais peu… J’avais à peu près tout prévu et quand j’y repense, je me demande encore pourquoi j’avais choisi de faire ça au collège…
Personne ne nous avait vus monter les étages et nous faufiler dans le studio. J’avais dit à Gogolita qu’elle n’avait pas le droit d’être là et qu’on devait être discrètes dans les couloirs, du coup elle prenait ça comme un jeu et pouffait exagérément dans ses mains en plissant des yeux comme un Chinois de BD. Dans les escaliers, je sentais mon cœur s’affoler et mes mains moites glisser sur la rampe. Aujourd’hui encore, je me souviens de tout ou à peu près de cet après-midi-là, de nos semelles couinant dans le silence assourdissant des couloirs déserts, l’odeur du détergent à base de savon de Marseille… Nous ne rencontrâmes personne, à croire que Dieu la crapule lui-même voulait que ça arrive. Arrivée à la porte du club, je me rappelle avoir contemplé le dessin du grain de la peinture pendant un moment au point d’avoir tatoué les circonvolutions des gouttes dans mon esprit et encore maintenant il suffit que je ferme les yeux pour les voir, et je me disais devant cette porte grise que peut-être, Sébastien ou Emmanuelle avaient décidé de venir ce mercredi, que Delmas avait accepté puisqu’il était prévu que j’y sois… en fait, je crois qu’une part en moi, peut-être minuscule, avait envie qu’ils soient là. J’ai glissé la clef dans la serrure qui ne trouva aucune résistance.





























