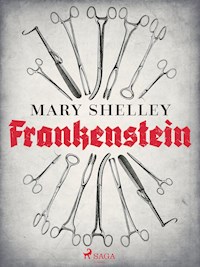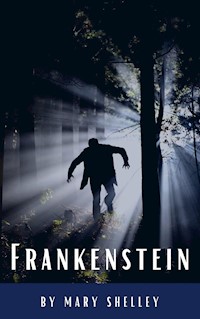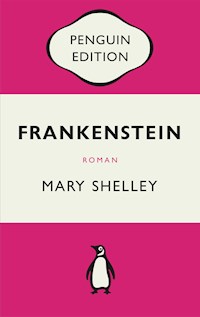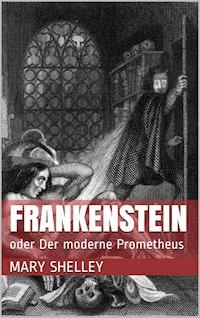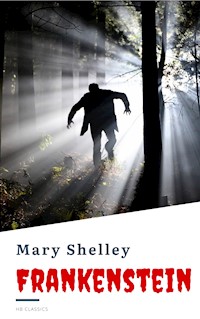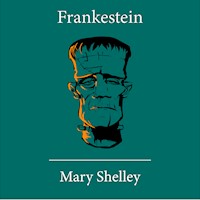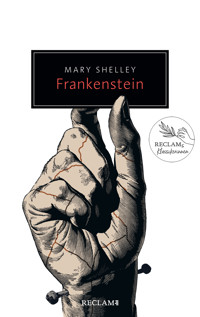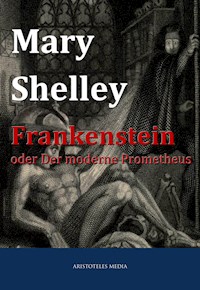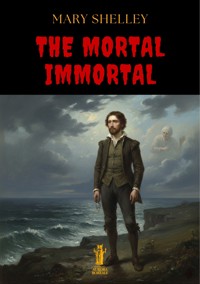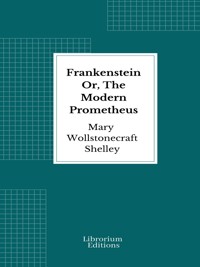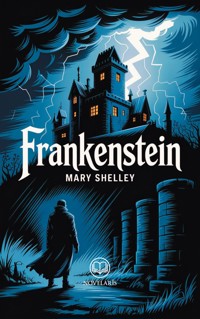
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: SK Digital Classics
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Le jeune Victor Frankenstein, brillant étudiant en sciences naturelles, découvre le secret de la vie et crée un être artificiel dans son laboratoire. Mais sa créature, abandonnée par son créateur, se transforme en une force vengeresse qui poursuit Frankenstein à travers l'Europe, des glaciers suisses aux étendues glacées de l'Arctique. Entre le créateur et sa création s'engage un duel mortel où se mêlent fascination scientifique, terreur gothique et questions philosophiques profondes. Mary Shelley inventa à dix-huit ans l'un des mythes les plus puissants de la littérature mondiale. Frankenstein fusionne magistralement science-fiction, roman d'horreur et méditation sur la nature humaine. Cette œuvre visionnaire, née d'un défi lancé entre amis lors d'un célèbre été littéraire en 1816, explore avec une modernité saisissante les dangers de l'ambition scientifique et les responsabilités du créateur envers sa créature.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 384
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Mary Shelley
Frankenstein
Édition française intégrale
Copyright © 2025 Novelaris
Tous droits réservés. Aucune partie de cet e-book ne peut être reproduite, distribuée ou transmise, sous quelque forme ou par quelque moyen que ce soit, sans l’autorisation écrite préalable de l’éditeur.
ISBN: 9783689312510
Table des matières
Lettre 1
Lettre 2
Lettre 3
Lettre 4
Chapitre 1
Chapitre 2
Chapitre 3
Chapitre 4
Chapitre 5
Chapitre 6
Chapitre 7
Chapitre 8
Chapitre 9
Chapitre 10
Chapitre 11
Chapitre 12
Chapitre 13
Chapitre 14
Chapitre 15
Chapitre 16
Chapitre 17
Chapitre 18
Chapitre 19
Chapitre 20
Chapitre 21
Chapitre 22
Chapitre 23
Chapitre 24
Cover
Table of Contents
Text
Lettre 1
À Mme Saville, Angleterre.
Saint-Pétersbourg, le 11 décembre 17—.
Vous serez heureuse d’apprendre qu’aucun désastre n’a accompagné le début d’une entreprise que vous considériez avec tant de mauvais présages. Je suis arrivé ici hier, et ma première tâche est de rassurer ma chère sœur sur mon bien-être et ma confiance grandissante dans la réussite de mon entreprise.
Je suis déjà loin au nord de Londres, et tandis que je marche dans les rues de Saint-Pétersbourg, je sens une brise froide du nord caresser mes joues, ce qui me revigore et me remplit de joie. Comprenez-vous ce sentiment ? Cette brise, qui vient des régions vers lesquelles je me dirige, me donne un avant-goût de ces climats glacials. Inspiré par ce vent prometteur, mes rêveries deviennent plus ferventes et plus vives. J’essaie en vain de me persuader que le pôle est le siège du gel et de la désolation ; il se présente toujours à mon imagination comme une région de beauté et de délices. Là-bas, Margaret, le soleil est toujours visible, son large disque effleurant l’horizon et diffusant une splendeur perpétuelle. Là-bas — car avec votre permission, ma sœur, je vais faire confiance aux navigateurs qui m’ont précédé — là-bas, la neige et le gel sont bannis ; et, naviguant sur une mer calme, nous pourrions être transportés vers une terre surpassant en merveilles et en beauté toutes les régions découvertes jusqu’à présent sur le globe habitable. Ses productions et ses caractéristiques peuvent être sans précédent, tout comme le sont sans aucun doute les phénomènes des corps célestes dans ces solitudes inconnues. Que ne peut-on espérer dans un pays de lumière éternelle ? J’y découvrirai peut-être la puissance merveilleuse qui attire l’aiguille et qui peut réguler mille observations célestes qui n’ont besoin que de ce voyage pour rendre leurs excentricités apparentes cohérentes à jamais. Je satisferai ma curiosité ardente en voyant une partie du monde jamais visitée auparavant, et je foulerai peut-être une terre jamais foulée par le pied de l’homme. Telles sont mes motivations, et elles suffisent à vaincre toute crainte du danger ou de la mort et à me pousser à entreprendre ce voyage laborieux avec la joie qu’éprouve un enfant lorsqu’il embarque dans un petit bateau, avec ses camarades de vacances, pour une expédition de découverte sur le fleuve de sa région natale. Mais même si toutes ces conjectures s’avéraient fausses, vous ne pouvez contester le bénéfice inestimable que j’apporterai à toute l’humanité, jusqu’à la dernière génération, en découvrant un passage près du pôle vers ces pays, dont l’accès nécessite actuellement tant de mois, ou en perçant le secret de l’aimant, ce qui, si cela est possible, ne peut être réalisé que par une entreprise telle que la mienne.
Ces réflexions ont dissipé l’agitation avec laquelle j’ai commencé ma lettre, et je sens mon cœur brûler d’un enthousiasme qui m’élève vers le ciel, car rien ne contribue autant à tranquilliser l’esprit qu’un objectif constant, un point sur lequel l’âme peut fixer son regard intellectuel. Cette expédition a été le rêve préféré de ma jeunesse. J’ai lu avec ardeur les récits des différents voyages qui ont été effectués dans l’espoir d’atteindre l’océan Pacifique Nord à travers les mers qui entourent le pôle. Vous vous souvenez peut-être que l’histoire de tous les voyages d’ , effectués à des fins de découverte, constituait l’ensemble de la bibliothèque de notre bon oncle Thomas. Mon éducation a été négligée, mais j’aimais passionnément la lecture. Ces volumes étaient mon étude jour et nuit, et ma familiarité avec eux augmentait le regret que j’avais ressenti, enfant, en apprenant que l’injonction de mon père sur son lit de mort avait interdit à mon oncle de me permettre de me lancer dans une vie de marin.
Ces visions s’estompèrent lorsque je lus pour la première fois ces poètes dont les effusions enchantèrent mon âme et l’élevèrent vers le ciel. Je suis moi-même devenu poète et j’ai vécu pendant un an dans un paradis de mon propre cru ; j’imaginais que je pourrais moi aussi obtenir une place dans le temple où les noms d’Homère et de Shakespeare sont consacrés. Vous connaissez bien mon échec et le poids de la déception que j’ai endurée. Mais c’est à ce moment-là que j’ai hérité de la fortune de mon cousin, et mes pensées se sont tournées vers leur orientation initiale.
Six ans se sont écoulés depuis que j’ai décidé de me lancer dans mon entreprise actuelle. Je me souviens encore de l’heure à laquelle je me suis consacré à cette grande entreprise. J’ai commencé par endurcir mon corps à la souffrance. J’ai accompagné les baleiniers dans plusieurs expéditions en mer du Nord ; j’ai volontairement enduré le froid, la famine, la soif et le manque de sommeil ; j’ai souvent travaillé plus dur que les marins ordinaires pendant la journée et consacré mes nuits à l’étude des mathématiques, de la théorie de la médecine et des branches de la science physique dont un aventurier naval pourrait tirer le plus grand avantage pratique. À deux reprises, je me suis engagé comme second sur un baleinier du Groenland, et j’ai fait mes preuves de manière admirable. Je dois avouer que j’ai ressenti une certaine fierté lorsque mon capitaine m’a offert le deuxième rang sur le navire et m’a supplié de rester avec la plus grande sincérité, tant il considérait mes services comme précieux.
Et maintenant, chère Margaret, ne mérite-je pas d’accomplir quelque chose de grand ? J’aurais pu passer ma vie dans le confort et le luxe, mais j’ai préféré la gloire à toutes les tentations que la richesse plaçait sur mon chemin. Oh, si seulement une voix encourageante pouvait me répondre par l’affirmative ! Mon courage et ma détermination sont fermes, mais mes espoirs fluctuent et mon moral est souvent bas. Je m’apprête à entreprendre un long et difficile voyage, dont les imprévus exigeront toute ma force d’âme : je devrai non seulement remonter le moral des autres, mais parfois aussi soutenir le mien, lorsque le leur faiblira.
C’est la période la plus favorable pour voyager en Russie. Ils volent rapidement sur la neige dans leurs traîneaux ; le mouvement est agréable et, à mon avis, bien plus agréable que celui d’une diligence anglaise. Le froid n’est pas excessif si vous êtes emmitouflé dans des fourrures, une tenue que j’ai déjà adoptée, car il y a une grande différence entre marcher sur le pont et rester assis immobile pendant des heures, sans aucun exercice pour empêcher le sang de geler dans vos veines. Je n’ai aucune envie de perdre la vie sur la route postale entre Saint-Pétersbourg et Arkhangelsk.
Je partirai pour cette dernière ville dans deux ou trois semaines ; j’ai l’intention d’y louer un navire, ce qui peut facilement se faire en payant l’assurance pour le propriétaire, et d’engager autant de marins que je le jugerai nécessaire parmi ceux qui sont habitués à la chasse à la baleine. Je n’ai pas l’intention de prendre la mer avant le mois de juin, et quand reviendrai-je ? Ah, chère sœur, comment puis-je répondre à cette question ? Si je réussis, de nombreux mois, voire des années, s’écouleront avant que nous puissions nous revoir. Si j’échoue, vous me reverrez bientôt, ou jamais.
Adieu, ma chère et excellente Margaret. Que le ciel te comble de bénédictions et me sauve, afin que je puisse te témoigner encore et encore ma gratitude pour tout ton amour et ta gentillesse.
Ton frère qui t’aime,
R. Walton
Lettre 2
À Mme Saville, Angleterre.
Archangel, le 28 mars 17—.
Le temps passe si lentement ici, entouré comme je le suis par le gel et la neige ! Pourtant, un deuxième pas a été franchi dans mon entreprise. J’ai loué un navire et je m’occupe actuellement de recruter mes marins ; ceux que j’ai déjà engagés semblent être des hommes sur lesquels je peux compter et qui possèdent assurément un courage intrépide.
Mais j’ai un besoin que je n’ai jamais pu satisfaire, et l’absence de son objet me semble aujourd’hui un mal très grave : je n’ai pas d’ami, Margaret. Lorsque je serai animé par l’enthousiasme du succès, personne ne partagera ma joie ; si je suis assailli par la déception, personne ne s’efforcera de me soutenir dans mon découragement. Je coucherai mes pensées sur le papier, certes, mais c’est un piètre moyen pour communiquer ses sentiments. Je désire la compagnie d’un homme qui pourrait sympathiser avec moi, dont les yeux répondraient aux miens. Vous me trouverez peut-être romantique, ma chère sœur, mais je ressens amèrement le manque d’un ami. Je n’ai personne près de moi, doux mais courageux, doté d’un esprit cultivé et ouvert, dont les goûts sont les mêmes que les miens, pour approuver ou modifier mes projets. Comment un tel ami pourrait-il réparer les défauts de votre pauvre frère ! Je suis trop ardent dans l’exécution et trop impatient face aux difficultés. Mais ce qui est encore pire pour moi, c’est que je suis autodidacte : pendant les quatorze premières années de ma vie, j’ai couru à l’état sauvage dans la campagne et je n’ai lu que les livres de voyages de notre oncle Thomas. À cet âge, j’ai fait la connaissance des poètes célèbres de notre pays, mais ce n’est que lorsque j’ai cessé d’être en mesure de tirer le meilleur parti d’une telle conviction que j’ai compris la nécessité d’apprendre d’autres langues que celle de mon pays natal. Aujourd’hui, j’ai vingt-huit ans et je suis en réalité plus illettré que beaucoup d’écoliers de quinze ans. Il est vrai que j’ai plus réfléchi et que mes rêveries sont plus longues et plus magnifiques, mais elles manquent (comme disent les peintres) de constance ; et j’ai grand besoin d’un ami qui ait assez de bon sens pour ne pas me mépriser comme un romantique, et assez d’affection pour moi pour s’efforcer de réguler mon esprit.
Mais bon, ce sont là des plaintes inutiles ; je ne trouverai certainement pas d’ami sur le vaste océan, ni même ici à Arkhangelsk, parmi les marchands et les marins. Pourtant, certains sentiments, étrangers à la médiocrité de la nature humaine, battent même dans ces poitrines rugueuses. Mon lieutenant, par exemple, est un homme d’un courage et d’une entreprise merveilleux ; il est follement avide de gloire, ou plutôt, pour employer une expression plus caractéristique, d’avancement dans sa profession. Il est anglais et, malgré les préjugés nationaux et professionnels, qu’aucune culture n’a adoucis, il conserve certaines des plus nobles qualités de l’humanité. Je l’ai connu à bord d’un baleinier ; apprenant qu’il était sans emploi dans cette ville, je l’ai facilement engagé pour m’aider dans mon entreprise.
Le capitaine est une personne d’excellente disposition et se distingue à bord par sa gentillesse et la douceur de sa discipline. Cette circonstance, ajoutée à son intégrité bien connue et à son courage intrépide, m’a donné très envie de l’engager. Une jeunesse passée dans la solitude, mes meilleures années passées sous votre douce et féminine tutelle, ont tellement raffiné les fondements de mon caractère que je ne peux surmonter une intense aversion pour la brutalité habituelle exercée à bord des navires : Je n’ai jamais cru cela nécessaire, et quand j’ai entendu parler d’un marin également réputé pour sa gentillesse et le respect et l’obéissance que lui témoignait son équipage, je me suis senti particulièrement chanceux de pouvoir m’assurer ses services. J’ai entendu parler de lui pour la première fois de manière assez romantique, par une dame qui lui doit le bonheur de sa vie. Voici, en bref, son histoire. Il y a quelques années, il aimait une jeune Russe de fortune modeste, et après avoir amassé une somme considérable grâce à des primes, le père de la jeune fille consentit à cette union. Il vit sa maîtresse une fois avant la cérémonie prévue, mais elle était en larmes et, se jetant à ses pieds, elle le supplia de l’épargner, avouant en même temps qu’elle en aimait un autre, mais que celui-ci était pauvre et que son père ne consentirait jamais à cette union. Mon généreux ami rassura la suppliante et, après avoir appris le nom de son amant, abandonna instantanément sa quête. Il avait déjà acheté une ferme avec son argent, où il avait prévu de passer le reste de sa vie, mais il la céda entièrement à son rival, ainsi que le reste de ses gains, pour acheter du bétail, puis il sollicita lui-même le père de la jeune femme afin qu’il consente à son mariage avec son amant. Mais le vieillard refusa catégoriquement, se considérant lié par l’honneur à mon ami qui, voyant le père inflexible, quitta son pays et n’y revint que lorsqu’il apprit que son ancienne maîtresse s’était mariée selon ses désirs. « Quel homme noble ! » s’exclamerez-vous. Il l’est, mais il est totalement inculte : il est aussi taciturne qu’un Turc, et une sorte d’insouciance ignorante l’accompagne, ce qui, tout en rendant sa conduite d’autant plus étonnante, diminue l’intérêt et la sympathie qu’il susciterait autrement.
Pour autant, ne croyez pas que, parce que je me plains un peu ou parce que j’imagine une consolation pour mes efforts que je ne connaîtrai peut-être jamais, je vacille dans mes résolutions. Celles-ci sont aussi immuables que le destin, et mon voyage n’est retardé que par le temps, qui doit permettre mon embarquement. L’hiver a été terriblement rigoureux, mais le printemps s’annonce bien, et il est considéré comme remarquablement précoce, de sorte que je pourrai peut-être partir plus tôt que prévu. Je ne ferai rien de précipité : vous me connaissez suffisamment pour avoir confiance en ma prudence et ma prévenance chaque fois que la sécurité d’autrui est confiée à mes soins.
Je ne peux vous décrire mes sensations à l’approche de mon entreprise. Il m’est impossible de vous communiquer l’idée de la sensation tremblante, mi-agréable, mi-effrayante, avec laquelle je me prépare à partir. Je pars pour des régions inexplorées, pour « le pays de la brume et de la neige », mais je ne tuerai aucun albatros ; ne vous inquiétez donc pas pour ma sécurité et ne craignez pas que je revienne vers vous aussi usé et malheureux que le « vieux marin ». Vous sourirez de mon allusion, mais je vais vous révéler un secret. J’ai souvent attribué mon attachement, mon enthousiasme passionné pour les dangereux mystères de l’océan à cette œuvre du plus imaginatif des poètes modernes. Il y a quelque chose qui agit dans mon âme que je ne comprends pas. Je suis pratiquement industrieux, minutieux, un ouvrier qui exécute son travail avec persévérance et diligence, mais en plus de cela, il y a un amour pour le merveilleux, une croyance dans le merveilleux, qui s’entremêlent dans tous mes projets et me poussent à sortir des sentiers battus, jusqu’à la mer sauvage et les régions inexplorées que je m’apprête à explorer.
Mais revenons à des considérations plus chères. Vous reverrai-je, après avoir traversé d’immenses mers et être revenu par le cap le plus au sud de l’Afrique ou de l’Amérique ? Je n’ose espérer un tel succès, mais je ne peux supporter de voir le revers de la médaille. Continuez pour l’instant à m’écrire à chaque occasion : je recevrai peut-être vos lettres à des moments où j’en aurai le plus besoin pour soutenir mon moral. Je t’aime très tendrement. Souviens-toi de moi avec affection, si jamais tu n’as plus jamais de mes nouvelles.
Votre frère qui vous aime,
Robert Walton
Lettre 3
À Mme Saville, Angleterre.
7 juillet 17—.
Ma chère sœur,
Je t’écris quelques lignes à la hâte pour te dire que je suis sain et sauf et que mon voyage avance bien. Cette lettre arrivera en Angleterre par un navire marchand qui fait actuellement route vers son port d’attache depuis Arkhangelsk ; plus chanceux que moi, qui ne reverrai peut-être pas ma terre natale avant de nombreuses années. Je suis toutefois de bonne humeur : mes hommes sont courageux et semblent déterminés, et les plaques de glace flottantes qui ne cessent de nous dépasser, signe des dangers de la région vers laquelle nous nous dirigeons, ne semblent pas les décourager. Nous avons déjà atteint une latitude très élevée, mais c’est le plein été et, bien qu’il ne fasse pas aussi chaud qu’en Angleterre, les vents du sud, qui nous poussent rapidement vers ces côtes que je désire tant atteindre, apportent une chaleur revigorante à laquelle je ne m’attendais pas.
Jusqu’à présent, aucun incident digne d’être mentionné dans une lettre ne nous est arrivé. Un ou deux vents violents et une voie d’eau sont des accidents que les navigateurs expérimentés ne prennent même pas la peine de noter, et je serai bien content si rien de pire ne nous arrive pendant notre voyage.
Adieu, ma chère Margaret. Sois assurée que, pour mon propre bien comme pour le tien, je ne m’exposerai pas imprudemment au danger. Je resterai calme, persévérant et prudent.
Mais le succès couronnera mes efforts. Pourquoi pas ? Jusqu’ici, j’ai tracé une route sûre sur des mers inexplorées, les étoiles elles-mêmes étant les témoins et les témoins de mon triomphe. Pourquoi ne pas continuer à avancer sur cet élément sauvage mais obéissant ? Qu’est-ce qui peut arrêter le cœur déterminé et la volonté résolue de l’homme ?
Mon cœur gonflé d’émotion se déverse ainsi involontairement. Mais je dois terminer. Que le ciel bénisse ma sœur bien-aimée !
R.W.
Lettre 4
À Mme Saville, Angleterre.
5 août 17—.
Un accident si étrange nous est arrivé que je ne peux m’empêcher de le consigner, même s’il est très probable que vous me verrez avant que ces papiers ne vous parviennent.
Lundi dernier (31 juillet), nous avons été presque encerclés par la glace, qui a entouré le navire de tous côtés, ne lui laissant pratiquement plus d’espace pour flotter. Notre situation était quelque peu dangereuse, d’autant plus que nous étions entourés d’un brouillard très épais. Nous avons donc décidé de rester sur place, dans l’espoir que l’atmosphère et le temps changent.
Vers deux heures, le brouillard s’est dissipé et nous avons aperçu, s’étendant dans toutes les directions, de vastes plaines de glace irrégulières qui semblaient infinies. Certains de mes compagnons ont gémi, et mon esprit a commencé à s’inquiéter, quand un spectacle étrange a soudainement attiré notre attention et détourné notre sollicitude de notre propre situation. Nous avons aperçu un chariot bas, fixé sur un traîneau et tiré par des chiens, qui passait vers le nord, à une distance d’un demi-mille ; un être qui avait la forme d’un homme, mais apparemment de stature gigantesque, était assis dans le traîneau et guidait les chiens. Nous avons observé la progression rapide du voyageur avec nos télescopes jusqu’à ce qu’il disparaisse parmi les irrégularités lointaines de la glace.
Cette apparition suscita notre émerveillement sans réserve. Nous étions, selon nous, à plusieurs centaines de kilomètres de toute terre, mais cette apparition semblait indiquer qu’elle n’était en réalité pas aussi éloignée que nous l’avions supposé. Enfermés par la glace, il nous était toutefois impossible de suivre sa trace, que nous avions observée avec la plus grande attention.
Environ deux heures après cet événement, nous avons entendu la mer de fond, et avant la nuit, la glace s’est brisée et a libéré notre navire. Nous sommes toutefois restés à l’arrêt jusqu’au matin, craignant de rencontrer dans l’obscurité ces grandes masses flottantes qui dérivent après la rupture de la glace. J’ai profité de ce temps pour me reposer quelques heures.
Le matin, cependant, dès qu’il fit jour, je montai sur le pont et trouvai tous les marins occupés d’un côté du navire, apparemment en train de parler à quelqu’un dans la mer. Il s’agissait en fait d’un traîneau, semblable à celui que nous avions vu auparavant, qui avait dérivé vers nous pendant la nuit sur un gros fragment de glace. Il ne restait qu’un seul chien vivant, mais il y avait un être humain à l’intérieur que les marins persuadaient de monter à bord du navire. Contrairement à l’autre voyageur, il ne semblait pas être un habitant sauvage d’une île inconnue, mais un Européen. Lorsque je suis apparu sur le pont, le capitaine m’a dit : « Voici notre capitaine, et il ne vous laissera pas périr en pleine mer. »
En m’apercevant, l’étranger s’adressa à moi en anglais, bien qu’avec un accent étranger. « Avant de monter à bord de votre navire, dit-il, auriez-vous l’amabilité de m’indiquer votre destination ? »
Vous pouvez imaginer mon étonnement en entendant une telle question de la part d’un homme au bord de la destruction et pour qui, selon moi, mon navire aurait dû être une ressource qu’il n’aurait pas échangée contre les richesses les plus précieuses que la terre puisse offrir. Je répondis toutefois que nous étions en voyage d’exploration vers le pôle Nord.
En entendant cela, il sembla satisfait et accepta de monter à bord. Mon Dieu, Margaret, si vous aviez vu cet homme qui capitulait ainsi pour sauver sa vie, votre surprise aurait été sans limite. Ses membres étaient presque gelés et son corps terriblement amaigri par la fatigue et la souffrance. Je n’avais jamais vu un homme dans un état aussi pitoyable. Nous avons essayé de le porter dans la cabine, mais dès qu’il a quitté l’air frais, il s’est évanoui. Nous l’avons donc ramené sur le pont et l’avons ranimé en le frottant avec du brandy et en le forçant à en avaler une petite quantité. Dès qu’il a montré des signes de vie, nous l’avons enveloppé dans des couvertures et l’avons placé près de la cheminée du poêle de la cuisine. Peu à peu, il s’est rétabli et a mangé un peu de soupe, ce qui l’a merveilleusement revigoré.
Deux jours s’écoulèrent ainsi avant qu’il ne puisse parler, et je craignais souvent que ses souffrances ne l’aient privé de raison. Lorsqu’il eut quelque peu recouvré ses forces, je le transférai dans ma cabine et m’occupai de lui autant que mon devoir me le permettait. Je n’ai jamais vu de créature plus intéressante : ses yeux ont généralement une expression sauvage, voire folle, mais il y a des moments où, si quelqu’un lui fait une marque de gentillesse ou lui rend le moindre service, son visage s’illumine, pour ainsi dire, d’un rayon de bienveillance et de douceur que je n’ai jamais vu égaler. Mais il est généralement mélancolique et désespéré, et parfois il grince des dents, comme s’il était impatient du poids des malheurs qui l’oppressent.
Lorsque mon invité eut un peu repris ses esprits, j’eus beaucoup de mal à éloigner les hommes qui voulaient lui poser mille questions ; mais je ne voulais pas qu’il soit tourmenté par leur curiosité oiseuse, dans un état physique et mental dont le rétablissement dépendait manifestement d’un repos complet. Une fois cependant, le lieutenant lui demanda pourquoi il était venu si loin sur la glace dans un véhicule aussi étrange.
Son visage prit instantanément une expression des plus sombres, et il répondit : « Pour chercher quelqu’un qui m’a fui. »
« Et l’homme que vous poursuiviez voyageait-il de la même manière ?
— Oui.
— Alors je pense que nous l’avons vu, car la veille du jour où nous vous avons recueilli, nous avons vu des chiens tirer un traîneau, avec un homme à l’intérieur, sur la glace.
Cela éveilla l’attention de l’étranger, qui posa une multitude de questions sur l’itinéraire emprunté par celui qu’il appelait le démon. Peu après, alors qu’il était seul avec moi, il me dit : « J’ai sans doute éveillé votre curiosité, ainsi que celle de ces braves gens, mais vous êtes trop prévenant pour me poser des questions.
— Certainement ; il serait en effet très impertinent et inhumain de ma part de vous importuner avec ma curiosité.
« Et pourtant, vous m’avez sauvé d’une situation étrange et périlleuse ; vous m’avez bienveillamment rendu la vie. »
Peu après, il me demanda si je pensais que la rupture de la banquise avait détruit l’autre traîneau. Je répondis que je ne pouvais pas répondre avec certitude, car la banquise ne s’était rompue que vers minuit, et le voyageur avait peut-être atteint un endroit sûr avant cette heure, mais je ne pouvais pas en juger.
À partir de ce moment, un nouvel élan de vie anima le corps défaillant de l’étranger. Il manifesta le plus grand empressement à monter sur le pont pour guetter le traîneau qui était apparu auparavant ; mais je l’ai persuadé de rester dans la cabine, car il est beaucoup trop faible pour supporter la rudesse de l’atmosphère. Je lui ai promis que quelqu’un guetterait pour lui et l’avertirait immédiatement si un nouvel objet apparaissait à l’horizon.
Tel est mon journal de ce qui concerne cet étrange événement jusqu’à ce jour. L’étranger a progressivement retrouvé la santé, mais il est très silencieux et semble mal à l’aise lorsque quelqu’un d’autre que moi entre dans sa cabine. Pourtant, ses manières sont si conciliantes et si douces que les marins s’intéressent tous à lui, bien qu’ils aient très peu communiqué avec lui. Pour ma part, je commence à l’aimer comme un frère, et son chagrin constant et profond me remplit de sympathie et de compassion. Il devait être un être noble dans ses jours meilleurs, car même aujourd’hui, dans son état de naufragé, il est si attachant et aimable.
J’ai dit dans une de mes lettres, ma chère Margaret, que je ne trouverais aucun ami sur le vaste océan ; pourtant, j’ai trouvé un homme qui, avant que son esprit ne soit brisé par la misère, j’aurais été heureux d’avoir comme frère de cœur.
Je continuerai à tenir mon journal sur l’étranger à intervalles réguliers, si j’ai de nouveaux incidents à consigner.
13 août 17—.
Mon affection pour mon invité grandit chaque jour. Il suscite en moi à la fois une admiration et une pitié extraordinaires. Comment puis-je voir une créature aussi noble détruite par la misère sans ressentir une douleur poignante ? Il est si doux, mais si sage ; son esprit est si cultivé, et lorsqu’il parle, bien que ses mots soient choisis avec le plus grand soin, ils coulent avec rapidité et une éloquence sans pareille.
Il s’est maintenant bien remis de sa maladie et passe son temps sur le pont, apparemment à guetter le traîneau qui précède le sien. Pourtant, bien que malheureux, il n’est pas tellement absorbé par sa propre misère qu’il ne s’intéresse pas profondément aux projets des autres. Il m’a souvent parlé des miens, que je lui ai communiqués sans détours. Il a écouté attentivement tous mes arguments en faveur de ma réussite éventuelle et tous les détails des mesures que j’avais prises pour y parvenir. Je me suis laissé facilement convaincre par la sympathie qu’il manifestait d’utiliser le langage de mon cœur, d’exprimer l’ardeur brûlante de mon âme et de dire, avec toute la ferveur qui m’animait, à quel point je serais heureux de sacrifier ma fortune, mon existence, tous mes espoirs, pour faire avancer mon entreprise. La vie ou la mort d’un homme n’étaient qu’un petit prix à payer pour acquérir les connaissances que je recherchais, pour obtenir et transmettre la domination sur les ennemis élémentaires de notre race. Tandis que je parlais, une sombre tristesse envahit le visage de mon auditeur. Au début, je perçus qu’il essayait de réprimer son émotion ; il plaça ses mains devant ses yeux, et ma voix trembla et me manqua lorsque je vis des larmes couler rapidement entre ses doigts ; un gémissement s’échappa de sa poitrine haletante. Je m’interrompis ; enfin, il parla d’une voix brisée : « Malheureux ! Partages-tu ma folie ? As-tu toi aussi bu de cette potion enivrante ? Écoute-moi ; laisse-moi te raconter mon histoire, et tu rejetteras la coupe de tes lèvres ! »
Vous pouvez imaginer que ces paroles excitèrent fortement ma curiosité ; mais le paroxysme de chagrin qui s’était emparé de l’étranger eut raison de ses forces affaiblies, et il fallut de nombreuses heures de repos et de conversation tranquille pour lui rendre son calme.
Ayant maîtrisé la violence de ses sentiments, il semblait se mépriser lui-même pour avoir été l’esclave de la passion ; et, réprimant la sombre tyrannie du désespoir, il m’amena à nouveau à parler de moi-même. Il me demanda l’histoire de mes premières années. Le récit fut vite raconté, mais il suscita diverses réflexions. Je parlai de mon désir de trouver un ami, de ma soif d’une sympathie plus intime avec un esprit semblable que je n’avais jamais connue, et j’exprimai ma conviction qu’un homme qui ne jouissait pas de ce bonheur pouvait se vanter de peu de bonheur.
« Je suis d’accord avec vous, répondit l’inconnu ; nous sommes des créatures inachevées, à moitié formées, si quelqu’un de plus sage, de meilleur, de plus cher que nous-mêmes — tel devrait être un ami — ne nous aide pas à perfectionner notre nature faible et imparfaite. J’ai eu autrefois un ami, le plus noble des êtres humains, et j’ai donc le droit de juger de l’amitié. Vous avez de l’espoir, le monde devant vous, et vous n’avez aucune raison de désespérer. Mais moi, j’ai tout perdu et je ne peux pas recommencer ma vie. »
En prononçant ces mots, son visage exprima une douleur calme et sereine qui me toucha au cœur. Mais il se tut et se retira dans sa cabine.
Même brisé dans son âme, personne ne peut ressentir plus profondément que lui les beautés de la nature. Le ciel étoilé, la mer et tous les spectacles offerts par ces régions merveilleuses semblent encore avoir le pouvoir d’élever son âme au-dessus de la terre. Un tel homme a une double existence : il peut souffrir de la misère et être accablé par les déceptions, mais lorsqu’il se retire en lui-même, il devient comme un esprit céleste entouré d’une auréole, dans le cercle de laquelle aucun chagrin ni aucune folie ne s’aventurent.
Sourirez-vous de l’enthousiasme que j’exprime à l’égard de ce divin vagabond ? Vous ne le feriez pas si vous le voyiez. Vous avez été formé et raffiné par les livres et le retrait du monde, et vous êtes donc quelque peu exigeant ; mais cela ne fait que vous rendre plus apte à apprécier les mérites extraordinaires de cet homme merveilleux. J’ai parfois essayé de découvrir quelle qualité il possède qui l’élève si infiniment au-dessus de toutes les personnes que j’ai connues. Je crois que c’est un discernement intuitif, un pouvoir de jugement rapide mais infaillible, une pénétration des causes des choses, inégalée en clarté et en précision ; ajoutez à cela une facilité d’expression et une voix dont les intonations variées sont une musique qui subjugue l’âme.
19 août 17—.
Hier, l’étranger m’a dit : « Vous pouvez facilement percevoir, capitaine Walton, que j’ai subi des malheurs immenses et sans pareil. J’avais décidé à un moment donné que le souvenir de ces maux mourrait avec moi, mais vous m’avez convaincu de changer d’avis. Vous recherchez la connaissance et la sagesse, comme je l’ai fait autrefois, et j’espère ardemment que la satisfaction de vos désirs ne sera pas un serpent qui vous piquera, comme cela a été le cas pour moi. Je ne sais pas si le récit de mes malheurs vous sera utile ; cependant, quand je pense que vous suivez la même voie, vous exposant aux mêmes dangers qui ont fait de moi ce que je suis, j’imagine que vous pourrez tirer de mon histoire une morale appropriée, qui pourra vous guider si vous réussissez dans votre entreprise et vous consoler en cas d’échec. Préparez-vous à entendre des récits qui sont généralement considérés comme merveilleux. Si nous étions dans un cadre plus familier, je craindrais peut-être votre incrédulité, voire votre dérision ; mais beaucoup de choses qui provoqueraient le rire de ceux qui ne connaissent pas les pouvoirs infiniment variés de la nature semblent possibles dans ces régions sauvages et mystérieuses ; et je ne doute pas que mon récit, dans son ensemble, apporte la preuve interne de la véracité des événements qui le composent.
Vous pouvez facilement imaginer que j’étais très satisfait de cette proposition, mais je ne pouvais supporter qu’il renouvelle son chagrin en me racontant ses malheurs. J’étais très impatient d’entendre le récit promis, en partie par curiosité et en partie par un fort désir d’améliorer son sort si j’en avais le pouvoir. J’ai exprimé ces sentiments dans ma réponse.
« Je vous remercie, répondit-il, de votre sympathie, mais elle est inutile ; mon destin est presque accompli. Je n’attends plus qu’un seul événement, puis je reposerai en paix. Je comprends votre sentiment, continua-t-il, voyant que je souhaitais l’interrompre, mais vous vous trompez, mon ami, si vous me permettez de vous appeler ainsi ; rien ne peut changer mon destin ; écoutez mon histoire, et vous comprendrez à quel point il est irrévocablement déterminé. »
Il m’a ensuite dit qu’il commencerait son récit le lendemain, lorsque je serais libre. Cette promesse m’a inspiré les remerciements les plus chaleureux. J’ai décidé que chaque soir, lorsque je ne serai pas occupé par mes obligations, je noterai, aussi fidèlement que possible, ses propres mots, ce qu’il m’aura raconté pendant la journée. Si je suis occupé, je prendrai au moins des notes. Ce manuscrit vous procurera sans aucun doute le plus grand plaisir ; mais pour moi, qui le connais et qui l’entends de sa propre bouche, avec quel intérêt et quelle sympathie je le lirai un jour ! Même maintenant, alors que je commence ma tâche, sa voix pleine résonne dans mes oreilles ; ses yeux brillants me regardent avec toute leur douceur mélancolique ; je vois sa main fine se lever avec animation, tandis que les traits de son visage sont illuminés par son âme. Son histoire doit être étrange et poignante, la tempête qui a frappé le vaillant navire en pleine mer et l’a fait naufrager doit avoir été effroyable… ainsi !
Chapitre 1
Je suis genevois de naissance et ma famille est l’une des plus distinguées de cette république. Mes ancêtres ont été pendant de nombreuses années conseillers et syndics, et mon père a occupé plusieurs fonctions publiques avec honneur et réputation. Il était respecté de tous ceux qui le connaissaient pour son intégrité et son attention infatigable aux affaires publiques. Il a passé sa jeunesse occupé en permanence par les affaires de son pays ; diverses circonstances l’ont empêché de se marier tôt, et ce n’est qu’à la fin de sa vie qu’il est devenu mari et père de famille.
Comme les circonstances de son mariage illustrent son caractère, je ne peux m’empêcher de les raconter. L’un de ses amis les plus intimes était un marchand qui, après avoir connu la prospérité, était tombé dans la pauvreté à la suite de nombreux revers de fortune. Cet homme, qui s’appelait Beaufort, était d’un caractère fier et inflexible et ne supportait pas de vivre dans la pauvreté et l’oubli dans le même pays où il s’était autrefois distingué par son rang et sa magnificence. Après avoir payé ses dettes de la manière la plus honorable, il se retira donc avec sa fille dans la ville de Lucerne, où il vécut dans l’anonymat et la misère. Mon père aimait Beaufort d’une amitié sincère et était profondément attristé par son retrait dans ces circonstances malheureuses. Il déplorait amèrement la fausse fierté qui avait conduit son ami à un comportement si peu digne de l’affection qui les unissait. Il ne tarda pas à se mettre à sa recherche, dans l’espoir de le persuader de recommencer sa vie grâce à son crédit et à son aide.
Beaufort avait pris des mesures efficaces pour se cacher, et il fallut dix mois à mon père pour découvrir où il se trouvait. Ravi de cette découverte, il se précipita vers la maison, située dans une rue modeste près de la Reuss. Mais lorsqu’il y entra, seuls la misère et le désespoir l’accueillirent. Beaufort n’avait sauvé qu’une très petite somme d’argent du naufrage de sa fortune, mais cela lui suffisait pour subvenir à ses besoins pendant quelques mois, et entre-temps, il espérait trouver un emploi respectable dans une maison de commerce. Il passa donc cette période dans l’inaction ; son chagrin ne fit que s’intensifier et s’envenimer lorsqu’il eut le loisir de réfléchir, et finit par s’emparer de son esprit à tel point qu’au bout de trois mois, il se retrouva alité, incapable de faire le moindre effort.
Sa fille s’occupait de lui avec la plus grande tendresse, mais elle voyait avec désespoir que leurs maigres ressources diminuaient rapidement et qu’il n’y avait aucune autre perspective de soutien. Mais Caroline Beaufort avait un esprit hors du commun, et son courage se renforça pour l’aider à surmonter l’adversité. Elle trouva un travail simple ; elle tressait de la paille et, par divers moyens, parvint à gagner un maigre salaire à peine suffisant pour subsister.
Plusieurs mois passèrent ainsi. L’état de son père empira ; elle consacrait tout son temps à s’occuper de lui ; ses moyens de subsistance diminuèrent ; et au bout de dix mois, son père mourut dans ses bras, la laissant orpheline et mendiante. Ce dernier coup la terrassait, et elle était agenouillée près du cercueil de Beaufort, pleurant amèrement, lorsque mon père entra dans la chambre. Il vint comme un esprit protecteur à la pauvre fille, qui se confia à ses soins ; et après l’enterrement de son ami, il la conduisit à Genève et la plaça sous la protection d’un parent. Deux ans après cet événement, Caroline devint sa femme.
Il y avait une différence d’âge considérable entre mes parents, mais cette circonstance semblait les unir encore plus étroitement dans des liens d’affection dévouée. Il y avait dans l’esprit droit de mon père un sens de la justice qui rendait nécessaire qu’il approuve hautement pour aimer fortement. Peut-être avait-il souffert, au cours des années précédentes, de l’indignité tardivement découverte d’un être cher, et était-il donc disposé à accorder une plus grande valeur à la valeur éprouvée. Son attachement à ma mère était empreint de gratitude et d’adoration, très différent de l’affection aveugle de la vieillesse, car il était inspiré par le respect de ses vertus et le désir de la récompenser, dans une certaine mesure, pour les souffrances qu’elle avait endurées, mais qui donnaient à son comportement envers elle une grâce inexprimable. Tout était fait pour satisfaire ses souhaits et sa commodité. Il s’efforçait de la protéger, comme un jardinier protège une plante exotique, de tous les vents violents et de l’entourer de tout ce qui pouvait susciter des émotions agréables dans son esprit doux et bienveillant. Sa santé, et même la tranquillité de son esprit jusqu’alors constant, avaient été ébranlées par ce qu’elle avait vécu. Au cours des deux années qui s’étaient écoulées avant leur mariage, mon père avait progressivement renoncé à toutes ses fonctions publiques ; et immédiatement après leur union, ils avaient recherché le climat agréable de l’Italie et le changement de décor et d’intérêt qu’offrait un voyage à travers ce pays merveilleux, afin de restaurer la santé fragile de ma mère.
De l’Italie, ils visitèrent l’Allemagne et la France. Moi, leur aîné, je suis né à Naples et, dès mon plus jeune âge, je les accompagnai dans leurs pérégrinations. Je restai pendant plusieurs années leur unique enfant. Bien qu’ils fussent très attachés l’un à l’autre, ils semblaient puiser dans une mine inépuisable d’affection pour me combler de leur amour. Les tendres caresses de ma mère et le sourire bienveillant de mon père lorsqu’il me regardait sont mes premiers souvenirs. J’étais leur jouet et leur idole, et quelque chose de mieux encore : leur enfant, la créature innocente et sans défense que le ciel leur avait donnée, qu’ils devaient élever dans le bien et dont le destin futur était entre leurs mains, pour le diriger vers le bonheur ou le malheur, selon qu’ils remplissaient ou non leurs devoirs à mon égard. Avec cette profonde conscience de ce qu’ils devaient à l’être auquel ils avaient donné la vie, ajoutée à l’esprit actif de tendresse qui animait les deux, on peut imaginer que, tandis que chaque heure de ma vie d’enfant m’apportait une leçon de patience, de charité et de maîtrise de soi, j’étais guidé par un cordon de soie qui me faisait tout sembler une succession de plaisirs.
Pendant longtemps, je fus leur seule préoccupation. Ma mère avait beaucoup désiré avoir une fille, mais je restai leur unique enfant. Quand j’eus environ cinq ans, lors d’une excursion au-delà des frontières de l’Italie, ils passèrent une semaine sur les rives du lac de Côme. Leur bienveillance les poussait souvent à entrer dans les chaumières des pauvres. Pour ma mère, c’était plus qu’un devoir, c’était une nécessité, une passion – se souvenant de ce qu’elle avait souffert et de la façon dont elle avait été soulagée – d’agir à son tour comme un ange gardien pour les affligés. Au cours d’une de leurs promenades, une pauvre chaumière nichée dans les replis d’une vallée attira leur attention par son aspect singulièrement désolant, tandis que le nombre d’enfants à moitié vêtus qui s’y étaient rassemblés témoignait d’une misère des plus extrêmes. Un jour, alors que mon père était parti seul à Milan, ma mère, accompagnée de moi, rendit visite à cette demeure. Elle y trouva un paysan et sa femme, travailleurs acharnés, courbés par les soucis et le labeur, distribuant un maigre repas à cinq enfants affamés. Parmi eux, il y en avait un qui attira l’attention de ma mère bien plus que les autres. Il semblait être d’une autre race. Les quatre autres étaient des petits vagabonds aux yeux sombres et robustes ; cet enfant était maigre et très blond. Ses cheveux étaient d’un blond éclatant et, malgré la pauvreté de ses vêtements, semblaient former une couronne de distinction sur sa tête. Son front était clair et large, ses yeux bleus sans nuage, et ses lèvres et les traits de son visage exprimaient une telle sensibilité et une telle douceur que personne ne pouvait la regarder sans la considérer comme une espèce à part, un être envoyé par le ciel, portant une empreinte céleste dans tous ses traits.
La paysanne, voyant que ma mère fixait cette charmante jeune fille avec émerveillement et admiration, lui raconta avec empressement son histoire. Elle n’était pas sa fille, mais la fille d’un noble milanais. Sa mère était allemande et était morte en lui donnant naissance. Le bébé avait été confié à ces braves gens pour qu’ils l’élèvent : ils étaient alors plus aisés. Ils n’étaient pas mariés depuis longtemps et leur aîné venait de naître. Le père de leur protégée était l’un de ces Italiens nourris du souvenir de la gloire antique de l’Italie, l’un de ces schiavi ognor frementi qui se sont battus pour obtenir la liberté de leur pays. Il fut victime de la faiblesse de celui-ci. On ne savait pas s’il était mort ou s’il croupissait encore dans les cachots autrichiens. Ses biens avaient été confisqués ; son enfant était devenue orpheline et mendiante. Elle continua à vivre avec ses parents adoptifs et s’épanouit dans leur humble demeure, plus belle qu’une rose de jardin parmi les ronces aux feuilles sombres.
Lorsque mon père revint de Milan, il trouva dans le hall de notre villa une enfant plus belle qu’un chérubin, qui jouait avec moi, une créature dont le regard semblait rayonner et dont la silhouette et les mouvements étaient plus légers que ceux d’une chamois des collines. Cette apparition fut bientôt expliquée. Avec sa permission, ma mère persuada ses gardiens rustiques de lui confier la garde de l’enfant. Ils étaient très attachés à la douce orpheline. Sa présence leur semblait être une bénédiction, mais il aurait été injuste de la maintenir dans la pauvreté et le dénuement alors que la Providence lui offrait une protection si puissante. Ils consultèrent le prêtre du village, et il en résulta qu’Elizabeth Lavenza devint la pensionnaire de la maison de mes parents, ma sœur plus que tout autre chose, la belle et adorée compagne de toutes mes occupations et de tous mes plaisirs.
Tout le monde aimait Elizabeth. L’attachement passionné et presque révérencieux que tous lui portaient devint, alors que je le partageais, ma fierté et ma joie. La veille du jour où elle fut amenée chez moi, ma mère m’avait dit en plaisantant : « J’ai un joli cadeau pour mon Victor, il l’aura demain. » Et quand, le lendemain, elle m’a présenté Elizabeth comme le cadeau promis, j’ai, avec un sérieux enfantin, interprété ses paroles littéralement et considéré Elizabeth comme mienne, mienne pour la protéger, l’aimer et la chérir. Toutes les louanges qui lui étaient adressées, je les recevais comme si elles s’adressaient à un bien qui m’appartenait. Nous nous appelions familièrement « cousin ». Aucun mot, aucune expression ne pouvait décrire le genre de relation qui nous unissait — elle était plus qu’une sœur pour moi, car jusqu’à sa mort, elle ne serait qu’à moi.