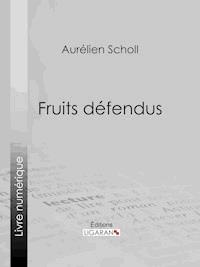
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Französisch
Extrait : "C'est une chose connue que, vers la fin du souper, quand les hommes sont ivres, ils se plaisent à causer de l'immortalité de l'âme. La discussion est souvent fort vive ; l'un verse des larmes en parlant de sa mère ; l'autre, cœur endurci, se plaît et s'exalte dans le blasphème. Les jeunes filles d'amour, étoiles des cabinets particuliers, mangeuses de pommes, d'écrevisses et d'amandes vertes, s'occupent peu de l'autre monde."
À PROPOS DES ÉDITIONS LIGARAN :
Les éditions LIGARAN proposent des versions numériques de grands classiques de la littérature ainsi que des livres rares, dans les domaines suivants :
• Fiction : roman, poésie, théâtre, jeunesse, policier, libertin.
• Non fiction : histoire, essais, biographies, pratiques.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 339
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
C’est une chose connue que, vers la fin du souper, quand les hommes sont ivres, ils se plaisent à causer de l’immortalité de l’âme. La discussion est souvent fort vive ; l’un verse des larmes en parlant de sa mère ; l’autre, cœur endurci, se plaît et s’exalte dans le blasphème.
Les jeunes filles d’amour, étoiles des cabinets particuliers, mangeuses de pommes, d’écrevisses et d’amandes vertes, s’occupent peu de l’autre monde. Elles pensent avec raison que l’avenir est à Dieu et aiment à évoquer le passé. Pour chacune d’elles, l’histoire de sa chute est le gros évènement. Aussi n’y a-t-il guère de souper au champagne sans que ces demoiselles racontent comment elles sont tombées.
L’une s’est jetée à l’eau par amour ; on l’a repêchée, et prenant son parti de la vie, elle s’est lancée dans les aventures.
L’autre a été mariée ; au bout de six mois, son mari est devenu fou ; elle l’a remplacé par tout le monde.
Les débuts sont rarement dramatiques ; le tempérament, la curiosité, la misère sont les grands recruteurs des bataillons de Vénus.
L’autre nuit, au premier étage d’un grand restaurant du bois de Boulogne, dans un petit salon qui ouvre sur la terrasse, une demi-douzaine de Parisiens en rupture de Trouville faisaient la fête avec des capitonneuses.
La petite Eliane, qui supporte mal les vins d’Espagne, promenait un regard vague sur l’assistance et se contentait de repousser son amant, chaque fois que celui-ci faisait mine de vouloir l’embrasser.
– Et toi, lui demanda une grande fille de l’Hippodrome, qui pose pour la vertu (dans les ateliers), une nous as jamais dit comment tu as laissé tes parents pour « faire la noce. »
– Moi ? fit Eliane, je suis devenue votre camarade parce que je ne comprenais pas, dans ma jeunesse, qu’une femme pût avoir un amant…
Il y eut une hilarité générale.
– Comme je vous le dis, continua Eliane. Mon père était percepteur dans une petite ville. Nous avions une jolie maison avec un jardin, des allées de rosiers et un petit bouquet d’arbres dans le fond.
Je vivais là avec ma mère. La proximité de Paris nous privait de la société de M. le percepteur, qui préférait le boulevard à sa résidence. Quand on laisse une place vide, il se trouve toujours quelqu’un qui la prend. Un voisin, un certain M. d’Albessard, qui posait pour l’homme du monde parce qu’il lisait les journaux de mode, était devenu le commensal habituel de la maison. J’avais surpris entre lui et ma mère quelques familiarités qui m’avaient choquée. Cet homme me portait sur les nerfs ; sa présence m’était odieuse, ses politesses m’irritaient. J’avais beaucoup de tendresse pour mon père, bien que je ne le visse que rarement, et je ne comprenais pas que M. d’Albessard se tînt d’une certaine façon qui ne pouvait convenir qu’au maître de la maison. Il y a de ces haines instinctives. Les enfants prennent en horreur tout homme qui fait l’empressé jusqu’à la galanterie auprès de leur mère. Or, j’allais avoir dix-sept ans et je commençais à comprendre.
Un soir, il y avait quelques personnes chez nous. Un thé de petite ville. Mon père, par hasard, était à la maison. La société vaguait dans le jardin ; c’était à la fin de juin. Ma mère avait pris le bras de M. d’Albessard et tous deux s’étaient éloignés. Je suivais dans l’ombre et j’écoutais leur conversation.
Quand tout le monde fut rentré au salon et que je vis arriver à son tour M. d’Albessard, je m’élançai au-devant de lui ; ce fut comme un mouvement de folie :
– Allez-vous-en, misérable ! lui criai-je. Je vous chasse…
Les assistants se regardèrent comme pour se dire : La petite sait tout.
D’Albessard balbutiait, ne sachant quelle contenance tenir.
– Mais allez-vous-en donc ! repris-je ; attendez-vous que je vous crache au visage ?
Là-dessus, je m’évanouis. On me transporta dans ma chambre. La tête cachée dans mon oreiller, je sanglotais et je tâchais d’étouffer mes cris. J’étais en proie à une violente crise nerveuse.
Ma mère, fort inquiète, m’avait suivie et me prodiguait ses soins.
Tandis que mes dents serraient le bord du verre plein d’eau fraîche qu’elle m’avait tendu, ma mère disait :
– Qu’as-tu, mon enfant ? Tu as besoin de repos sans doute ? Tout le monde est parti, je vais rester avec toi.
Elle était assise au pied de mon lit.
Après une demi-heure de silence, elle sembla faire, pour parler, un violent effort sur elle-même.
– Que t’a donc fait M. d’Albessard ? demanda-t-elle avec un léger tremblement dans la voix.
Je ne répondis pas.
– Eliane, reprit ma mère, je veux savoir le motif de ta haine.
Que lui dire ? L’accuser en face, lui jeter la raison de mon emportement, de mon dégoût, cela me parut impie.
– Eh bien ! lui dis-je, M. d’Albessard m’a dit qu’il m’aimait…
– Toi ? fit ma mère avec épouvante.
– Je l’ai cru, continuai-je.
Ma mère tremblait.
– Et alors ? fit-elle, les dents serrées.
– Un soir, il m’a prise par les mains…
Je n’eus pas la peine de continuer. Ma mère, après s’être levée, frémissante, était tombée de tout son long sur le tapis. Deux jours après, elle était morte.
Mon père obtint son changement. On l’envoya dans une jolie ville de l’Ouest, un port de mer. Il était de toutes les fêtes ; il jouait gros jeu au cercle de la Marine et menait grand train. Il eut sa voiture. Je ne comprenais pas que ses appointements pussent lui suffire. Il tint cependant trois ou quatre ans.
Un soir, il me dit :
– Fais vite tes malles. Emporte tout ce que tu pourras. Nous partons ce soir.
– Et où allons-nous ?
– Cela ne te regarde pas.
Nous étions prêts à partir quand deux gendarmes conduits par le commissaire central, vinrent arrêter mon père.
Oh ! l’horrible moment que celui-là.
Pauvre cher père ! qu’allait-on faire de lui ?
Je connaissais la faiblesse de son caractère ; il avait cédé à la frivolité, au désir de paraître, de briller. Il n’était pas coupable pour moi.
Je le serrai sur mon cœur. Il m’embrassait de toutes ses forces, il pleurait. – On l’entraîna, et je rentrai seule à la maison. Seule, à vingt ans ! Seule, avec un remords ! Seule, avec une tache !
Une fois l’instruction terminée, je pus le voir. C’est triste et sombre, une prison ! La voûte y a des retentissements de beffroi…
J’avais tendu la permission au gardien, et, à travers une grille, j’aperçus mon père, pâle et maigri.
Après quelques instants, il me dit à voix basse :
– Si tu pouvais me sauver, le ferais-tu ?
– Oh ! vous n’en doutez pas !
– Eh bien ! approche. Le faux sera écarté. Je me servais d’une griffe… Je n’en avais pas le droit, mais enfin je puis me tirer de cette accusation. Restent l’abus de confiance et le détournement. Or, l’instruction a fourni la preuve absolue que mon ancien caissier, qui est mort, était coupable lui-même de détournements importants. Je pourrais donc tout mettre sur son compte, s’il m’était possible de justifier des dépenses que j’ai faites.
– Et bien ?
Mon père me parla plus bas encore.
Je pâlis d’abord, puis le sang me monta au visage – et je m’enfuis.
Le grand jour arriva, le jour des assises. Je fus appelée comme témoin, et là, devant tous, le visage sans voile, je déclarai que l’argent dépensé était le fruit de mon inconduite… que je m’étais vendue !…
Je trouvai le doute chez les juges, l’indignation autour de moi.
Je répétai, j’insistai, m’accusant hautement, avec impudence.
L’avocat profita de ce qu’il appelait « ma douloureuse confession ».
Il plaida longuement. Mon père, dit-il, avait laissé à sa fille les soins de l’intérieur, il puisait sans compter…
Mon père échappa au bagne. Il en fut quitte pour cinq ans de prison. Il sort dans quinze mois, et, d’ici-là, je voudrais compléter dix mille francs de rente pour aller vivre au loin, dans un pays où l’on se cache, où l’on ne connaît pas les noms des condamnés de France. Voilà l’histoire que vous m’avez demandée. Il y a des gens qui m’appellent fille de joie… Je suis une fille de douleur !
Tous les drames n’aboutissent pas à la Gazette des Tribunaux, et il y aurait beaucoup à gagner pour un observateur sérieux qui renoncerait à connaître ce qui éclate et devient public, pour savoir ce qui s’étouffe et reste secret.
Que de vols restent impunis ! Que de chantages odieux n’ont pour témoins que l’exploiteur et sa victime ! Que d’assassins inconnus et de cadavres sans étiquette !
Il était six heures du soir quand une femme voilée et vêtue de deuil entra dans le cabinet de Me Dubrassard, avoué, rue des Petits-Champs.
Me Dubrassard se leva et salua sa cliente en lui offrant un fauteuil. Celle-ci rejeta son voile et se laissa tomber, plutôt qu’elle ne s’assit, sur le siège qui lui était offert.
– Madame la comtesse de Prémédis ! dit l’avoué avec étonnement.
– Oui, monsieur, moi, murmura la comtesse en portant son mouchoir à ses yeux.
– Qu’arrive-t-il donc ? reprit l’avoué. Vous semblez sous le coup d’une impression terrible…
– Ah ! monsieur ! que faire ? que devenir ? Sauvez-moi !
– Calmez-vous, madame, je vous en prie. Vous savez que vous pouvez compter sur mon dévouement le plus absolu…
– Eh bien ! monsieur, voici ce qui m’arrive… je suis bigame !
– Vous ? s’écria l’avoué avec stupéfaction.
– Écoutez-moi, et vous verrez s’il y a quelque chose à faire. Vous m’avez connue heureuse, riche, recherchée, et voilà que tout s’écroule…
La comtesse respira longuement, comme si elle eût été près d’étouffer, et commença son récit. – Je suis fille d’un officier supérieur, le colonel Vallière. Mon père était veuf quand il prit sa retraite, et, pour des raisons d’économie, il se fixa à L…, petite ville de l’Ouest que les chemins de fer n’ont pas encore affamée. C’est là que mon éducation s’est faite, c’est là que j’ai grandi. La sœur de M. de Prémédis, Caroline, mariée depuis au baron de Laroque d’Estay, était ma camarade de pension, ma meilleure amie. Depuis l’âge de douze ans, M. de Prémédis, Louis, comme nous l’appelions familièrement, était le compagnon de nos jeux. Nous grandîmes à côté l’un de de l’autre. Un jour, il me dit tout bas qu’il m’aimait… Il fut convenu que je serais sa femme. Mais, quand il eut vingt-deux ans et qu’il parla de ses idées de mariage, le comte et la comtesse de Prémédis poussèrent les hauts cris. Ils traitèrent mon père d’intrigant, et il lui fallut fermer sa porte à mon bien-aimé.
Cédant à la volonté de ses parents, Louis partit pour la Guadeloupe, où M. de Prémédis avait conservé des propriétés.
Six mois, un an se passèrent. J’étais sollicitée de divers côtés ; puis, un certain sentiment de fierté vis-à-vis de ceux qui m’avaient dédaignée me poussait à prendre un mari. J’acceptai donc le nom d’un lieutenant de vaisseau, M. Desgrigny. Bon garçon, mais facile à l’entraînement, joueur, léger jusqu’à la folie, M. Desgrigny eut bien vite dissipé les quelques milliers de francs qui constituaient ma dot lime demanda pardon en pleurant, déclara dramatiquement à mon père qu’il allait se faire tuer ; après quoi, il partit pour le Sénégal.
Quelques mois plus tard, un chirurgien renvoyé de la marine, le docteur Barthez, qui avait été l’un des témoins de M. Desgrigny lors de son mariage, se présenta chez nous. Il nous raconta qu’il ramenait d’Afrique mon mari dévoré par les fièvres. Il avait cru devoir débarquer à Santander, pour conduire le malade à je ne sais quelles eaux des Pyrénées.
Enfin, mon mari était mort à Figuieras, petit village de la frontière, et enterré à Palalda, sur le sol français, aux confins des Pyrénées-Orientales, le 16 février 1873. Le docteur Barthez remit à mon père un extrait mortuaire en langue espagnole, où il n’y avait de clair qu’un cachet de la capitainerie générale de Catalogne. Tout le reste, écrit à la main était absolument illisible.
La comtesse passa de nouveau sur ses yeux mouillés de larmes la fine batiste qu’elle tenait à la main, et continua rapidement et presque à voix basse :
M. et Mme de Prémédis moururent à quelques jours de distance. Louis revint des Antilles, accourut chez mon père, me serra dans ses bras… et je devins sa femme.
Alors commença pour moi le bonheur le plus vrai, le plus complet qu’une femme puisse envier. Oh ! je puis mourir, j’ai eu ma part. Mais… mourir, ce n’est rien à côté de ce qui me menace…
Mme de Prémédis eut un mouvement d’épouvante et d’horreur.
– Vous avez su, continua-t-elle, la mort de M. de Prémédis…
– Oui, madame, une chute de cheval… dont les journaux ont donné le récit.
– Je suis restée veuve à trente ans pour la deuxième fois et, quoi qu’il arrive, pour la dernière fois. Louis m’a laissé deux enfants ; l’aîné a huit ans, le deuxième en a trois… Eh bien ! monsieur, ces enfants sont menacés dans leur nom, dans leur fortune… Ce Barthez, ce misérable s’est présenté chez moi, ayant, disait-il, à me faire une communication de la plus haute importance. Et il m’a appris que M. Desgrigny n’était pas mort quand a eu lieu mon mariage avec M. de Prémédis. Nous avions mal lu le papier qu’il avait remis à mon père, et la croix qui est plantée sur la tombe de M. Desgrigny, à Palalda, porte : décédé le 13 février 1874, c’est-à-dire deux mois après mon second mariage. Donc, ce mariage est nul…
– Mais, interrompit l’avoué, qui aurait intérêt à poursuivre cette affaire ?
– Oh ! M. de Prémédis avait des parents éloignés, qu’il ne connaissait même pas. Mais, s’ils sont mis en possession des papiers qui prouvent que j’étais bigame…
– Alors, M. Barthez veut vous les vendre ?
– Eh ? monsieur, je lui ai offert la moitié, les deux tiers de la fortune de mes enfants. Ce n’est pas cela qu’il veut. Il a osé me dire qu’il m’aimait… et, pour se taire, il exige que je l’épouse ?
– Voyons, voyons, dit l’avoué, ne nous montons pas la tête. Demandez quinze jours de répit. M. Barthez ne manquera pas de penser qu’une imprudente précipitation pourrait entraîner la ruine de ses projets.
– Que comptez-vous faire ? demanda Mme de Prémédis.
– Je vous le dirai à mon retour.
– Où allez-vous donc ?
– À Palalda.
Mme de Prémédis passa quatorze jours dans des transes mortelles, priant, pleurant, pressant ses enfants dans ses bras.
Elle reçut enfin une lettre de Me Dubrassard et, suivant ses instructions, elle écrivit à M. Barthez pour l’informer qu’elle l’attendrait le lendemain chez elle.
Le docteur fut introduit chez Mme de Prémédis, qui lui présenta Me Dubrassard.
– Je suis, dit celui-ci, l’avoué de Mme la comtesse, et je crois devoir vous déclarer, monsieur, que je n’ajoute aucune foi à vos allégations.
– Le registre de l’état civil de Niguieras peut en fournir une première preuve, répondit hautement Barthez.
– Malheureusement non, continua l’avoué. Vous n’ignorez point que, lors de la dernière insurrection, la maison de l’alcade a été pillée et incendiée par une bande carliste. Il ne reste plus aucune trace de la constatation du décès de M. Desgrigny. Un seul témoin en a le souvenir, le sieur Thomas Sanguino, aubergiste, chez lequel a demeuré Desgrigny. Ce Thomas Sanguino affirme que le voyageur français est décédé au commencement de l’année 1873.
– Il a sans doute été payé pour cela, fit Barthez.
– Restent, continua froidement l’avoué, l’entrée du corps à Palalda et l’inscription gravée sur la croix. Eh bien ! le sieur Jean Etchegoyen, sacristain et bedeau à Palalda, raconte qu’il y a quelques mois un étranger demanda à être introduit dans le cimetière accroché au flanc de la montagne. Il donna la pièce au gardien et, à la croix de bois placée sur le tertre qui recouvre les restes de Desgrigny, il en substitua une autre fabriquée plus récemment à Céret et peinte par un certain Pierre Soubalos, dont la boutique se trouve au pied de la vieille tour.
– C’est un roman que vous racontez là, monsieur l’avoué ! s’écria Barthez.
– Peut-être, monsieur, mais vous devez savoir que la mode est aux romans naturalistes. Aussi ai-je eu soin de convoquer les personnages, pour que personne ne puisse mettre en doute leur authenticité.
Me Dubrassard se leva et ouvrit la porte de communication avec la pièce voisine.
– Entrez, messieurs, dit-il.
Et il ajouta :
– J’ai l’honneur de vous présenter M. Thomas Sanguino, hôtelier à Figuieras ; M. Jean Etchegoyen, bedeau à Palalda, et M. Soubalos, peintre-décorateur à Céret.
Barthez s’était levé, pâle et l’écume aux lèvres.
– Reconnaissez-vous cet homme ? demanda l’avoué.
– Oui, oui, répondirent les nouveaux entrés, c’est bien lui.
– Maintenant, continua Me Dubrassard, il y a dans une autre pièce un personnage que les Français désignent sous le nom de commissaire de police…
Barthez eut un geste d’angoisse.
– Mais, fit toujours Dubrassard, ma cliente ne tient pas à vous punir au prix d’un scandale et vous autorise à sortir.
Barthez se précipita vers la porte.
– À la condition que vous ne reveniez pas, poursuivit l’impitoyable avoué.
– Je pars pour l’Amérique, répondit solennellement Barthez.
– Et vous avez raison, conclut Dubrassard, puisque c’est un des pays où l’on pend !
Mme de Prémédis serrait les mains de son avoué, embrassait ses enfants avec une joie folle.
– Messieurs, dit Dubrassard aux témoins qu’il avait amenés, vous allez recevoir une indemnité de déplacement qui vous est bien due. Vous pourrez dire, en revenant chez vous, que vous avez fait une bonne action. Quand voulez-vous repartir ?
– Ce soir, répondirent-ils tous les trois.
– Comment ! vous avez assez vu Paris ?
– Oh ! vous savez, monsieur l’avoué, on a ses habitudes !
– Paris ne vous a pas semblé beau ?
– Si… si… mais, ça ne vaut pas Perpignan !
CLOPORTIGNY – petite ville du département de… arrosée par la Boueuse, 4 629 habitants. Citadelle, tribunal de 1reinstance. Château en ruines. Huile, nougats, tanneries, chanvres. Société d’Agriculture. A soutenu un siège en 1314.
À quelques variantes près, l’indication précédente peut s’appliquer à des milliers de localités en France. L’une a un vieux château, l’autre un volcan éteint ; celle-ci une source minérale qu’elle voudrait bien mettre en bouteilles, celle-là des carrières de plâtre qu’elle espère mettre en actions. C’est la véritable province, comme l’entendent les romanciers.
Marseille, Lyon, Bordeaux, Nantes et plusieurs autres villes constamment en rapport avec Paris, dotées de théâtres et de concerts, ont cessé d’être « province » depuis que les chemins de fer y versent chaque jour une population flottante, qui traîne après elle le bruit, le mouvement, et égalise les niveaux entre la place de la Concorde et les allées de Tourny, entre les Champs-Élysées et le cours Belzunce.
C’est dans la petite ville, la toute petite, qu’on trouve encore des préjugés inattendus et d’épaisses naïvetés. Les idées y arrivent péniblement, tronquées en route par le conducteur de la diligence ou par un étudiant qui passe naturellement pour un mauvais sujet.
Il n’est personne qui, pour une raison ou pour une autre, ne soit allé passer quelques jours dans une petite ville.
J’en ai vu plusieurs, pour ma part, une entre autres, une surtout dont le souvenir m’inspire encore une hilarité mêlée de terreur. J’y retrouvai un ami du temps passé, du temps où nous avions dix-huit ans à nous deux. Il était alors blond et pétulant, gentil comme une petite fille.
Quand je le revis, c’était un mossieu pétri de suffisance, lourd, commun, bête, ignare. Il tenait les bras éloignés du corps, comme s’il avait craint de se mettre de la peinture aux mains en frôlant son pantalon ; il posait son chapeau sur le derrière du crâne et il marchait en se dandinant. Des favoris énormes exagéraient l’ampleur paysannesque de sa grosse figure. Il riait fort en se tordant. Ses oreilles rouges et démesurées se déployaient comme si sa tête allait prendre son vol.
Eh bien ! je vous le jure en conscience, dans ce pays-là il était beau.
C’est à cet être qu’échut l’honneur de me promener.
Il me montra l’église, le port ; il me fit voir l’étalage du marchand de nouveautés, m’indiqua le pâtissier et me présenta à un bourgeois qui avait UN tableau.
M. le maire nous donna à dîner. Soupe aux choux, poulet sauté, poulet à la sauce blanche, canard de basse-cour à la broche, fromage du pays et des fruits à discrétion.
On causa de la fortune de Mlle Machin. M. le maire nous fit entendre, en clignant de l’œil, que M. Bourchot était un vieux malin et qu’il avait de quoi ; il ajouta que M. Michelard était un homme conséquent, et M. Dutourtois un homme bien capable.
Mon ami me poussa du coude dans la Grand-Rue, en me désignant d’un air malin une jeune femme qui passait les yeux baissés.
– C’est, me dit-il, la femme de l’ancien médecin d’ici. On ne la reçoit nulle part. Elle a une mauvaise vie.
Et il m’apprit que, mariée fort jeune à un homme dont l’âge ne pouvait faire oublier la laideur, elle avait eu un sentiment pour un damoiseau du voisinage.
Elle avait lutté contre son cœur et lui avait écrit : « Je ne serai jamais à vous, parce que je veux dormir en paix dans notre petit cimetière, à côté de ma mère, qui a toujours été vertueuse. Je ne serai jamais à vous, et cependant je vous aime… »
En effet, elle résista. Mais le lâche montra sa lettre qui fit le tour de la ville. Et cette épouse martyre, cette héroïne, fut persiflée et honnie par ce bétail humain pour qui le sacrifice est chose fermée.
Les dames de la ville se croyaient vertueuses parce qu’elles n’avaient jamais aimé, – pas même leurs maris.
Pauvre femme ! toujours seule, pâlie et dévorée par une souffrance sans confident, je la vois encore, le front penché et les paupières fermées – comme les volets d’une maison dans laquelle il y a un mort.
Elle expiait son renoncement sublime et personne, sur son passage, ne lui faisait l’aumône d’un salut.
Les brutes qui la coudoyaient se regardaient d’un air goguenard.
Quelques instants après, nous rencontrâmes, mon ami et moi, un homme jeune encore, qui cheminait mélancoliquement et dont la physionomie me frappa.
– Quel est ce monsieur ? demandai-je.
Mon compagnon fit une moue dédaigneuse.
– Ça, c’est le journaliste.
Le journaliste… malheureux ! il était seul de son espèce dans toute la ville. Personne qui pût lui donner une idée en échange des siennes ! Comment et à la suite de quelles infortunes était-il venu s’échouer dans ce trou ?
Quand l’homme de lettres s’est vainement épuisé en efforts pour arracher à l’indifférence du public quelque lambeau de célébrité, il arrive souvent qu’il se condamne à un exil volontaire et va, pendant quelques années, rédiger le canard politique d’une petite ville.
Il y avait autrefois à Paris une pépinière de journalistes qui s’appelait le bureau de l’esprit public.
C’est de là que sont partis, pendant une période de trente années, tous les journalistes ministériels des départements. Quelques-uns ont fait leur chemin. Les uns ont été nommés préfets, d’autres sous-préfets ; quelques-uns ont siégé à la Chambre des députés…
Le lendemain, j’avais fait connaissance avec le journaliste, et voici ce qu’il me raconta : Mon premier journal a été l’indépendant de M… Il faut vous dire que l’Indépendant justifiait assez peu son titre, puisqu’il était vendu à la préfecture.
À mon arrivée dans la ville, j’allai rendre visite aux autorités qui me reçurent avec une gravité que je tâchai d’imiter de mon mieux.
J’annonçai dans mon premier-M… que le journal allait entrer dans une nouvelle voie. J’augmentai le format, je promis des caractères neufs, et une multitude d’améliorations successives. Le journal, qui avait été rempli maladroitement jusqu’alors d’articles d’emprunt, prit bientôt une certaine tournure, et après trois mois, il fut constaté que le nombre des abonnements avait augmenté de vingt-sept.
J’eus recours aux affiches ; je multipliai le nombre des échanges, afin qu’on vît dans les départements voisins. « Nous lisons dans l’Indépendant, etc. » Je tâchai de convaincre les commerçants de l’utilité des annonces : tout cela amenait bien quelque chose ; mais si peu de chose !… J’imaginai alors d’intéresser le public par des faits locaux. Je criais tous les jours :
« La ville est mal éclairée. Les rues sont mal pavées. Les trottoirs sont insuffisants, le marché est trop petit, etc. »
Le préfet me fit demander et me déclara que la ville, endettée, ne pouvait faire mieux et qu’il fallait mettre un terme à des plaintes qui blessaient la municipalité.
Cette mine précieuse une fois épuisée, à quels faits locaux pouvais-je me livrer.
Il ne se passait rien dans la ville.
À peine si, de loin en loin, un paysan des environs jetait sa femme dans un puits ! J’offris cent francs par mois à un mauvais drôle de M… pour y commettre quelques bris de clôture, et s’il était possible quelques tentatives d’incendie. Il accepta, et cela me réussit d’abord. Je donnais à ces petits évènements une couleur qui en faisait autant de drames.
« La rue Saint-Dizier a été le théâtre d’une tentative épouvantable… »
Ou bien :
« Tout le quartier de la Rive est plongée dans la consternation… »
Les habitants n’osaient plus sortir de chez eux passé huit heures, mais l’Indépendant était rempli d’intérêt.
On finit par s’apercevoir que je racontais quelquefois les évènements avant qu’ils ne fussent arrivés.
L’autorité s’en émut, et je crus prudent de laisser la ville, qui retomba aussitôt dans la torpeur.
Je fondai alors le Franc-Parleur de B…, journal qui paraissait de temps en temps. Mais j’avais beau me multiplier, la population restait fidèle à l’Écho départemental, journal rédigé par un vicaire de la cathédrale et une vieille maîtresse de pension.
Je voulus alors frapper un grand coup. Un pâtre des environs ayant disparu mystérieusement, je racontai en quel endroit précis et de quelle manière il avait été dévoré par trois loups.
On remarqua dans la ville que le Franc-Parleur était mieux renseigné que l’Écho.
Mais l’Écho me demanda le lendemain, comment, en admettant que le pâtre eût été dévoré par les loups, je pouvais savoir qu’il y en avait justement trois ; j’affirmai d’une façon péremptoire qu’il y avait trois loups et qu’ils s’étaient enfuis à l’approche d’un gendarme.
On commençait à me croire, quand le cadavre du pâtre fut trouvé dans la rivière. Encore une ville qui devenait impossible !
Je pris alors la rédaction du Courrier de R… Un amateur de la ville, membre correspondant de l’Académie de Cauterets, m’offrit une somme de mille francs pour publier en feuilleton un roman russe intitulé :
L’OURS
ou
L’ORIGINE D’UN GRAND PEUPLE
C’était vraiment mauvais : il y eut un tolle général dans le pays. Les abonnés me firent des menaces de mort ; les boutiquiers sortaient sur mon passage.
– Eh ! me criaient-ils avec cette familiarité des gens du Midi, est-ce que vous vous f… du monde ?
Je dus interrompre cette publication pendant quelques jours. Après trois semaines, je risquai un feuilleton. On me donna un charivari.
Toutefois, je n’en eus pas le démenti ; l’Ours fut publiée en entier, un feuilleton par mois ! Cela dura deux ans et demi. Chaque fois qu’un feuilleton de l’Ours paraissait, je me condamnais à rester deux ou trois jours sans sortir, et je ne me risquais dans les rues que quand l’irritation était calmée.
Aujourd’hui j’ai pris mon parti des tristesses bouffonnes de cette existence. Je veux mourir ici, rédacteur du Mémorial. La femme du médecin et moi, nous sommes les deux êtres les plus malheureux de la ville – tous les deux incompris !
Qui ne se rappelle la Messe de l’athée, cette page qui a l’air d’un béquet dans l’œuvre de Balzac ? Le docteur Bianchon surprend son ancien maître Desplein assistant en cachette à la messe. Or, Desplein était un apôtre du matérialisme le plus absolu. – Pour lui, dit Balzac, l’atmosphère terrestre était un sac générateur ; il voyait la terre comme un œuf dans sa coque. Il ne croyait ni en l’animal antérieur, ni en l’esprit postérieur à l’homme. Desplein n’était pas dans le doute : il affirmait. Cette opinion ne devait pas être autrement chez un homme habitué depuis son jeune âge à disséquer l’être par excellence, avant, pendant et après la vie, à le fouiller dans tous ses appareils sans y trouver l’âme unique, si nécessaire aux théories religieuses.
– Me direz-vous, mon cher, dit Bianchon à Desplein, la raison de votre capucinade ?
Et Desplein raconte à son élève l’histoire de sa jeunesse. Pauvre jusqu’au dénouement, sans famille, sans ressources, sans espoir, il s’est rencontré avec un Auvergnat, un porteur d’eau nommé Bourgeat. L’homme du peuple, simple, naïf, sans instruction, comprend que l’autre avait une mission. Il sacrifie ses économies pour lui fournir l’argent nécessaire à ses examens ; il lui prête de l’argent pour acheter des livres ; il le nourrit, le sert, devient à la fois pour lui un père et un domestique. Il meurt enfin sans avoir eu la joie de contempler son ouvrage achevé ; il meurt avant que Desplein fût devenu l’illustre chirurgien, le savant admiré de sa génération.
Or, cet Auvergnat avait la foi du charbonnier ; il aimait la sainte Vierge, le petit Jésus, les saints. Il était convaincu qu’il y avait quelque part, dans le ciel, un palais des Tuileries où vivait la famille divine avec les anges pour cent-gardes et saint Pierre pour concierge.
Bourgeat avait timidement parlé de messes pour le repos des morts. Et, comme la seule chose que Desplein pût lui offrir était la satisfaction de ses pieux désirs, le célèbre professeur faisait dire à Saint-Sulpice quatre messes par an. Il y assistait, disant avec la bonne foi du douteur : « Mon Dieu, s’il est une sphère où tu mettes après leur mort ceux qui ont été parfaits, pense à Bourgeat ! »
Bianchon, qui soigna Desplein dans sa dernière maladie, n’ose pas affirmer que l’illustre chirurgien soit mort athée.
J’ai relu dernièrement cette histoire en sortant de chez l’un des hommes les plus instruits de notre époque, un philosophe, un professeur, qui a été l’ami de Littré et de Claude Bernard.
Comme il m’avait laissé seul quelques instants dans une pièce attenante à son cabinet de travail, je feuilletais les épreuves d’un de ses premiers ouvrages, dont l’éditeur prépare une nouvelle édition.
Le chapitre V est intitulé : « La nature de l’âme. Doctrine de l’émanation et de l’absorption. »
X…, rentrant, me surprit au milieu de ma lecture.
– Vous connaissez, me dit-il, avec un sourire qui présageait une confidence, vous connaissez la plupart de mes ouvrages !
– Je les connais tous, répondis-je.
– Eh bien, continua-t-il en s’asseyant, la nature humaine est si faible, si accessible aux faits extérieurs, qu’une impression forte reçue dans le premier âge peut s’imposer à l’homme jusqu’à la fin de sa vie sans que l’étude et le raisonnement triomphent jamais même d’une absurdité. Notre élévation intellectuelle et morale ne nous soustrait point aux opérations naturelles de notre organisme, pas plus que notre perfectionnement matériel ne nous soustrait à la maladie et à l’infirmité. Sauvages ou civilisés, nous portons avec nous un mécanisme qui nous montre le souvenir ou l’image de ce que nous avons éprouvé d’important dans notre vie. Ce mécanisme ne respecte personne. Les plus orgueilleux sont contraints de subir les avertissements qu’il leur donne. Ce mécanisme, puisant sa force dans ce qui nous paraîtrait la source la plus invraisemblable, nous conduit insensiblement à une croyance, au moyen de fantômes dès longtemps évanouis !
Ce professeur de matérialisme, cet athée célèbre, cet auteur mis à l’index, excommunié, frappa de la main sur la table qui se trouvait auprès de lui.
– Regardez-moi bien, me dit-il, je ne suis pas fou. Vous avez lu mon ouvrage sur l’indestructibilité de la matière et de la force ?
– Oui.
– Vous connaissez mon étude du système d’Averroës ?
– Oui.
– Eh bien ! mon cher ami, le soir, quand je suis seul, assis ou couché ; quand la lumière est éteinte, quand j’ai perdu le souvenir de ma bibliothèque… il me prend une soif inexplicable de mystérieux et il me semble que je sens un Dieu !
– Comment expliquez-vous cette contradiction de vos œuvres avec votre croyance intime ?
– Ce n’est pas une croyance, c’est une superstition, un rêve, une folie, une vision qui, précisément, se rattache à ce mécanisme dont je vous parlais tout à l’heure…
X… passa la main sur son front et reprit :
– Mon père, vous le savez, était percepteur dans une petite ville du centre.
La maison où je suis né avait un grand jardin où je passais une partie de mes journées à jouer avec mes sœurs. Quand Mathilde, l’aînée, fut mise en pension, je restai avec la petite Berthe, de deux ans moins âgée que moi. Notre dialogue commençait à sept heures du matin pour ne s’arrêter qu’à huit heures du soir, quand la voix de notre mère se faisait entendre pour dire : Allons, mes enfants, il est temps de se coucher !
Alors, j’embrassais Berthe sur les deux joues, puis elle m’embrassait à son tour. Ne pouvant me résigner à la quitter, je disais : Encore ! et je recommençais. Puis elle reprenait : À moi, maintenant ! Il fallait nous arracher des bras l’un de l’autre.
Cette petite sœur était tout pour moi. Il me semblait que je ne vivais que par elle. Le matin, on nous habillait séparément, elle dans la chambre qu’elle partageait avec notre aînée, moi dans un cabinet où je couchais à côté de la chambre de notre mère.
Et comme les portes restaient ouvertes, je criais : Berthe, es-tu prête ?
– Tout à l’heure, répondait-elle. On me passe mon jupon. Et toi ?
– Moi, je n’ai plus que ma veste à mettre.
– Il fait très beau, ce matin.
– Dépêche-toi, nous irons dans la charmille.
On faisait le panier de Mathilde. Un morceau de viande froide et quelques fruits pour son déjeuner. Puis nous allions l’accompagner jusqu’à la porte et la bonne la conduisait à sa pension.
Alors seulement commençait notre journée. Berthe et moi, nous faisions un bouquet pour maman ; nous allions cueillir des fraises ou des groseilles, des raisins ou des pêches, suivant les ordres reçus.
Une fois ce devoir accompli, les jeux commençaient. Les voisins nous faisaient de nombreux cadeaux à l’époque du jour de l’an ; aussi, avions-nous toute sorte d’amusements ; cordes à sauter, raquettes et volants, toupies, bilboquet, ballons de toutes les dimensions et même une boite à couleurs pour les jours de pluie.
Nous savions diviser et varier nos plaisirs, tantôt assis sur un banc de bois peint en vert qu’ombrageait un épais feuillage. Là, les poupées de Berthe s’exprimaient, par sa bouche, comme des personnes naturelles, auxquelles répondaient avec à-propos mon polichinelle, mon pantin ou mes soldats de bois, moustachus comme des Brésiliens et raides comme la discipline.
Un jour, Berthe tomba malade. Elle avait une méningite. À peine me laissait-on entrer dans sa chambre une fois par jour l’embrasser. Elle était brûlante et appuyait péniblement ses lèvres sur ma joue ; après quoi, elle se tournait avec un petit soupir.
Je sortais le cœur gros et les yeux mouillés de larmes.
– Quand sera-t-elle guérie ? demandais-je.
– Bientôt, mon ami, bientôt.
Oh ! que les journées, alors, me parurent longues ! Je les passais presque entièrement assis sur une marche de la porte d’entrée, ne sachant que faire ni que devenir.
Puis, on m’interdit même l’entrée de la chambre… et, un jour, je vis « maman » se jeter en sanglotant dans les bras de mon père. Celui-ci la serrait sur son cœur ; il semblait respirer péniblement, sa poitrine avait des soubresauts et de grosses larmes coulaient sur son visage.
– Que se passait-il donc ? J’entendis une des servantes dire à la voisine : « Mlle Berthe est morte… »
Morte ? qu’est-ce que c’est que cela d’être morte ? pensais-je.
Je demandai à ma pauvre mère :
– Berthe reviendra, n’est-ce pas ?
Et ma mère ne me répondit point.
Le soir, après avoir longuement réfléchi, je résolus de revoir ma petite sœur. Ce projet m’avait absorbé toute la journée et j’avais fait mon plan. Je pensais qu’à l’heure du dîner des domestiques je pourrais me glisser jusque dans la chambre mortuaire.
Il devait être six heures du soir quand, sur la pointe des pieds, j’arrivai devant la porte. J’ouvris tout doucement. C’était à la fin du mois d’août ; le soleil avait tourné la maison, mais il faisait encore jour. On avait laissé la fenêtre ouverte ; pas un nuage au ciel, un bleu pâle, profond, l’image de l’infini.
Mes yeux allèrent droit au lit. Berthe était là, immobile, blanche comme le marbre. C’était bien encore le visage bien-aimé ; mais qu’il me parut changé ! La nuit était tombée sur ces yeux naguère si pleins de vie et d’éclat. Les mains étaient jointes, comme pétrifiées. Un petit christ d’ivoire sur une croix d’ébène avait été placé sur la poitrine… Alors, je me penchai sur le cadavre et j’appuyai en pleurant mes lèvres sur le front glacé de ma petite Berthe…
Je ne sais quelle intuition m’avait élargi le cœur et le cerveau. Je comprenais…
Tout à coup… oh ! j’en suis sûr !… quand, dans l’égarement de ma douleur, je posais comme un fou mes lèvres sur ses lèvres, il me sembla voir s’élancer une petite flèche de feu, bleu et or, mais d’une telle ténuité qu’on eût dit un brin de fil tissé d’un feu follet…
Mon cœur d’enfant se souleva, comme porté par une vague, pour s’élancer à la poursuite éternelle de cette flèche. Mais la flèche disparut dans le ciel et je la suivis longtemps des yeux par la fenêtre ouverte…
Le professeur me regarda d’un air presque anxieux.
– Il y a de cela quarante-neuf ans, dit-il. Eh bien ! quand j’ai fini mes travaux, quand je me sens loin du monde, quand ma solitude est complète, absolue, je revois la petite flèche d’or qui s’envolait des lèvres de la morte… Et il me prend une soif d’au-delà… un besoin de me cramponner à une corde qui tomberait du ciel… Je regarde en haut par la fenêtre, dans le creux… et bêtement, malgré moi, tandis que je me ris au nez et que j’ai honte de ma faiblesse, j’éprouve une fascination… je vois les tombeaux s’ouvrir… et furieux contre moi-même, je déchire mes livres et mes manuscrits !
En passant une nuit dans un phare, on assiste à un spectacle des plus intéressants. Des milliers de papillons et d’insectes de tous genres, de toutes dimensions et de toutes couleurs accourent des quatre points cardinaux à cette lumière vivace qui s’élève au-dessus de la mer. Tous les oiseaux voyageurs, cygnes noirs, albatros, spatules, canards sauvages, et aussi mouettes et goélands se précipitent, éblouis, fascinés, éperdus, sur ce soleil de nuit et se brisent le bec la tête ou l’aile contre les vitres épaisses de la lanterne.
Le matin, les gardiens peuvent ramasser au pied de la tour des oiseaux étranges, quelquefois inconnus dans la contrée.





























