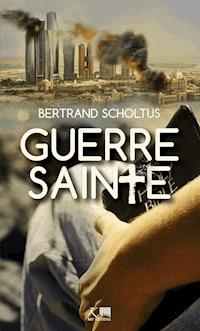
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ker
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Nous vivons une période déstabilisante et complexe qui met à l’épreuve la capacité de résistance de nos sociétés. Ne nous y trompons pas, le terrorisme chrétien est là pour durer. - Hassan Moulaji, expert en terrorisme pour Dubaï TV
À quoi ressemblerait aujourd’hui notre monde si les Ottomans avaient vaincu à Vienne en 1529 et conquis l’Europe ?
Un monde dans lequel la civilisation islamique est dominante, où l’Europe est divisée en États corrompus aux mains de tyrans, un monde dans lequel la république de Castille et l’émirat de Grenade se disputent encore la péninsule ibérique, où des immigrés européens survivent dans les quartiers ghettos des métropoles du Moyen-Orient. Un monde où des chrétiens radicalisés ont basculé dans le terrorisme…
Esteban est un jeune Castillan enrôlé dans une milice qui harcèle les patrouilles grenadaises musulmanes afin de faire progresser la Reconquista. Peu à peu, il perd ses illusions et découvre d’autres chemins. Plus durs, plus extrêmes.
Paul est un immigré francilien de deuxième génération. Installé à Dubaï, il assiste, révolté et incrédule, à la radicalisation de son fils aîné. Quand celui-ci disparaît, Paul est prêt à tout pour le sauver.
Leurs destins vont s’entremêler dans un puzzle haletant où, peut-être, la soif de liberté répondra à une terrifiante spirale de destruction.
Une épopée dystopique palpitante où il devient difficile de distinguer les saints des démons…
EXTRAIT
La foule qui se presse sur la place est déjà dense. Les jours précédant les fêtes attirent toujours la clientèle en masse. Mais alors qu’Hatida arrive en vue de la poste, le soleil s’échappe soudain de l’horizon et l’embrase. Dans un espace de temps suspendu, la place se transforme en magma ocre, rouge, jaune. La peau de Hatida gonfle et éclate. La gravitation devient folle. Le trottoir se disperse en dalles sautillantes au-dessus de sa tête. L’horizon fait la culbute. L’espace d’un infernal battement de paupières, la place danse une folle farandole puis se fige. Le blanc recouvre alors le monde en une exhalaison rauque. Mille et un débris retombent et rebondissent, une pluie cristalline sur l’asphalte écartelée. La place Sadaqa s’est brutalement transformée en cratère. Le silence qui suit l’explosion est surnaturel, aérien. Une dernière pensée à peine cohérente traverse l’esprit de Hatida.
Paul ? Rejoins-moi, Paul !
À PROPOS DE L'AUTEUR
Né en 1966,
Bertrand Scholtus a d’abord laissé les chiffres le séduire. Intrigué par l’explication du monde que lui semblaient offrir les sciences, passionné par les mystères de la physique quantique, il entame des études de physique à l’ULB. Diplôme en poche, mais rapidement déçu par quelques expériences dans l’enseignement, il dérive lentement vers le monde réel et plus particulièrement l’économie, plus par raison que par goût. Aujourd’hui, il effectue des estimations et des prévisions budgétaires des régimes de sécurité sociale au Bureau fédéral du Plan mais il lui arrive toujours de lire de temps à autre un ouvrage de vulgarisation scientifique.
Grand dévoreur de romans depuis toujours, il a pris goût à l’écriture durant l’adolescence, via l’écriture de scénarios de jeux de rôle dans un premier temps, de nouvelles ensuite. Ce plaisir le suit de loin en loin durant sa vie adulte. La maturité arrivant, l’idée d’écrire un roman qui le titillait depuis longtemps finit par quitter le champ du fantasme, maladroitement d’abord, avec plus de méthode par la suite. C’est ainsi qu’arrive au monde
Guerre Sainte, son premier roman, publié en 2017 chez Ker. Il espère qu’il y en aura bien d'autres par la suite !
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 647
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
à mon pèreà ma mèrequi m’ont donné le goût de lirequi m’ont donné l’envie d’écrire.
pour Anne.
Avant-propos
En l’an 950 de l’Hégire (1529 du calendrier chrétien), le sultan ottoman Soliman le Magnifique s’empara de Vienne puis, profitant de la débâcle des armées ennemies, conquit toute l’Europe Centrale. L’Espagne, la France et l’Angleterre n’eurent d’autre choix pour éviter l’invasion turque que de mettre genou en terre. À peine sorties des âges sombres, ces nations y retournèrent. À ce jour, elles ne se sont pas relevées, semblant condamnées à un déclin irrémédiable. Après ce fait d’armes, l’empire ottoman, désormais sans rival, s’apaisa. Au fil des siècles, il se pacifia, connut une révolution philosophique et démocratique, puis une révolution industrielle et scientifique. De nos jours, le Sultan Mehmet XI, souverain constitutionnel et démocratique, trône à la tête du plus grand pôle mondial de développement technologique, d’un havre de paix et de liberté sans pareil, d’une puissance commerciale et militaire inégalable. Avec ses multiples alliés arabes, perses, pachtounes et indonésiens, l’empire tente de réguler le monde en favorisant la liberté de pensée, de religion, de commerce et d’expression. Sa démocratie et les droits généreux qu’il accorde et garantit à ses citoyens en font une force culturelle et politique invincible. Le mode de vie ottoman est copié jusque dans les villes déliquescentes de l’Europe, dans les jeunes et violentes métropoles africaines, dans les cités-dortoirs de l’Asie.
Tout n’est pas rose pour autant…
Prologue
Bagdad, de nos jours
Allahu akbar… Allahu akbar… Allahu akbar… Allahu akbar… Intemporelle et immuable, la voix lancinante du muezzin se déverse des haut-parleurs perchés sur les toits et les coupoles du quartier. Ashadu an lâ ilâha ill Allah… Ashadu an lâ ilâha ill Allah… Pourtant, l’adhan de la prière du matin, perçant à travers les bruits de la circulation automobile, ne rencontre qu’indifférence au sein de la foule de citadins affairés. Ashadu anna Muhammad ar-rasûlu-l-lah… Ashadu anna Muhammad ar-rasûlu-l-lah… Ici comme ailleurs dans le monde musulman, la pratique religieuse a décliné et il n’y a plus que dans les quartiers populaires, où se sont repliés les derniers imams, que l’on observe encore les prières quotidiennes. Hayya ‘ala-s-salat… Hayya ‘ala-s-salat… Ailleurs, seule demeure la tradition qui justifie qu’à cinq reprises dans la journée, l’appel à la prière résonne, inondant de mots sacrés les artères engorgées de la cité.
Le soleil vient de se lever. Les boutiques de luxe qui encadrent la grande avenue n’ont pas encore ouvert leurs portes aux arabesques sable et argent. Pourtant, les Bagdadis se hâtent de rejoindre les bureaux du centre-ville. Les affaires n’attendent pas ! Hatida progresse d’un pas assuré, zigzaguant entre les piétons qui encombrent le trottoir. Pour la troisième fois depuis son lever, elle énumère le programme chargé de sa journée. En priorité, trouver des cadeaux pour ses neveux. Demain a lieu la célébration de l’Aïd-el-Kebir. Pas question de débarquer dans la belle-famille sans offrandes pour les derniers nés. Ce sera, comme à l’habitude, un casse-tête de choisir des cadeaux pour ces enfants qui ont déjà tout. Elle en frémit d’avance. D’autant qu’elle ne peut compter sur sa peu commode belle-sœur pour émettre la moindre suggestion. La coutume sera respectée : deviner la déception poliment dissimulée sur le visage de ses neveux lorsqu’ils découvriront ses présents sera le hors-d’œuvre de la cérémonie familiale. Elle y jouera sans joie le rôle de la femme mûre sans enfants, plongée dans les affres des familles nombreuses et heureuses qui composent l’essentiel de son entourage.
*
Alors qu’elle bifurque dans la sharia Sultan Suleyman, la plus luxueuse de Bagdad, Hatida se mire dans les vitrines. Sa tenue est soignée, ni trop stricte, ni trop relâchée. Une abaya cintrée couleur crème, achetée trois fois rien. Un foulard safran, élégamment plié, à mille lieues de ces chiffons noirs informes dans lesquels s’enroulent les bigotes. Un habillement qui convient à la cadre commerciale respectable qu’elle est devenue. Hatida s’attribue quelques bons points. Elle porte encore beau, malgré la quarantaine débutante. Ses courbes sont toujours harmonieuses, son visage évite le flasque, ses traits la lassitude. Seule sa coiffure laisse à désirer. Un rendez-vous chez son coiffeur s’impose. Parviendrait-elle à l’intercaler dans l’après-midi ? Satisfaite et souriante, elle reprend sa marche.
Avoir pensé à son âge lui remet en mémoire la découverte de la veille. En fouillant dans ses archives, elle a mis à jour une photographie chiffonnée, prise le jour de ses vingt ans. La photo rassemble ses amis les plus proches de l’époque, posant devant la salle des fêtes de l’université de Bagdad. Aïcha, sa sœur aînée. Puis Aziz, beau jeune homme, devenu depuis le mari de celle-ci. Et enfin Paul, son petit ami de l’époque. Il lui a fallu un certain effort de mémoire pour retrouver son nom complet. Paul Lemonnier. Un bel Européen fougueux, exigeant et ambitieux. L’aventure ne dura pas, mais elle brûla d’une belle flamme. Ils surent rester amis quand elle décida de reprendre sa liberté. Jusqu’à ce que les études de Paul prennent fin à leur tour. Il repartit pour Dubaï, rejoindre sa famille. Aziz et Aïcha, également diplômés, lui emboîtèrent le pas pour d’autres raisons. Ce fut une période déprimante pour Hatida, abandonnée par ses aînés. Elle resta à Bagdad. Les liens se distancèrent. Le peu de contact qu’elle garda avec sa sœur lui apprit qu’Aziz réussissait brillamment dans les affaires. Mais de Paul, elle n’eut plus de nouvelles. Qu’es-tu devenu, Paul, toi qui rêvais de changer le monde ? Aurais-je été plus heureuse si j’avais fait l’effort de rester à tes côtés ? Serais-je devenue moi aussi une mère de famille comblée ? Qui aurait dit que vingt ans après t’avoir perdu, je me baladerais avec une photo de toi dans mon sac, pensant aux beaux jours d’un été passé ?
Attendant que le feu passe au vert, Hatida contemple la devanture d’une librairie. Et si elle achetait un livre pour ses neveux ? Pourquoi pas cette version remise au goût du jour d’Aladin, dont les médias ont abondamment parlé ? Son regard est attiré par les Unes des quotidiens : le scandale des écoutes téléphoniques illégales ordonnées par le grand vizir Selim Ozal chez l’un, les attaques à la bombe qui ont récemment ensanglanté Le Caire chez l’autre, les mises en garde sinistres du kahya bey Émir Gül, l’austère vizir des Affaires intérieures, prédisant de nouveaux attentats terroristes dans les mois à venir. Quelle horreur ! Quelle déprime ! Refroidie, elle se remet en route, empruntant la courbe élégante de la sharia Suleyman alors que le soleil, surmontant enfin la ligne des dômes et des terrasses, colorie les rues de la médina de tons pastel. Que le monde va mal ! Comme tous, Hatida est révoltée par la vague d’attentats qui frappe l’Orient depuis la destruction de la Sultan Ahmet Camii, la Grande Mosquée Bleue d’Istanbul. Difficile de rester objectif quand des fondamentalistes chrétiens fous furieux massacrent des centaines d’innocents à Istanbul, Damas, Le Caire ou Alger. Comment ne pas adhérer au sentiment d’union sacrée qui a suivi l’annonce par le Grand Vizir Ozal du Jihad contre le terrorisme ? Était-ce ce monde dont tu rêvais, Paul ? Toi qui aimais tant la fraternité. Étrange comme cet homme qui n’a partagé sa vie que quelques mois il y a vingt ans lui revient soudain en mémoire de manière insistante par la grâce d’une photographie. Serait-ce un signe ? De quoi ? Que son mariage bat de l’aile ? Que l’homme qui partage sa vie ne lui inspire plus rien ? Une idée folle germe. Et si elle envoyait la photo à Aïcha, à charge pour elle de la communiquer à Paul ? Elle n’est pas certaine que sa sœur ait gardé des contacts, mais qu’a-t-elle à perdre ? Inch’ Allah ! Hatida se décide d’un coup de tête et bifurque en direction de la poste. Elle rédigera rapidement quelques mots sur une carte à destination de sa sœur aînée. Elle en profitera pour lui adresser ses vœux à l’occasion de l’Aïd-el-Kebir.
La poste la plus proche se trouve dans le centre commercial Hansar. Hatida traverse la place Sadaqa alors que les magasins qui la cerclent sortent de leur torpeur et soulèvent leurs grilles dans un concert de cliquetis métalliques. La foule qui se presse sur la place est déjà dense. Les jours précédant les fêtes attirent toujours la clientèle en masse. Mais alors qu’Hatida arrive en vue de la poste, le soleil s’échappe soudain de l’horizon et l’embrase. Dans un espace de temps suspendu, la place se transforme en magma ocre, rouge, jaune. La peau de Hatida gonfle et éclate. La gravitation devient folle. Le trottoir se disperse en dalles sautillantes au-dessus de sa tête. L’horizon fait la culbute. L’espace d’un infernal battement de paupières, la place danse une folle farandole puis se fige. Le blanc recouvre alors le monde en une exhalaison rauque. Mille et un débris retombent et rebondissent, une pluie cristalline sur l’asphalte écartelée. La place Sadaqa s’est brutalement transformée en cratère. Le silence qui suit l’explosion est surnaturel, aérien. Une dernière pensée à peine cohérente traverse l’esprit de Hatida. Paul ? Rejoins-moi, Paul ! La quiétude ouatée dure une longue seconde. Hatida ne se sent pas très bien. Elle ne ressent aucune douleur. Mais elle a l’impression étrange, déplaisante, de se vider. Elle ne parvient plus à se redresser. Son bras n’est pas là où il devrait être. Le bitume lui râpe la joue. La tête lui tourne un peu. Elle a froid. Puis les bruits reviennent et Hatida s’en va. La cervelle s’écoule de son crâne éclaté. Son sang nappe le bitume d’un joli rouge vif. Des gens crient, pleurent, hurlent. D’autres n’ont plus assez de force pour tenter autre chose qu’un râle discret. La photo de Paul, en partie carbonisée, arrachée par le souffle, s’envole en une douce sarabande dans la brise matinale. Une fumée épaisse obscurcit le ciel. C’est fini.
1
Osons le dire : les vacances à Dubaï ont remplacé le pèlerinage à La Mecque dans l’inconscient collectif du monde musulman.
Cheikh Bati ben Hushur Al Bakoum, émir de Dubaï
Dubaï, le lendemain
Depuis son pupitre en acajou lustré du funduq Al-Andalus, Paul Lemonnier examine tout et tous d’un regard d’aigle. Attentif au moindre détail, il veille à ce que les clients n’attendent pas indûment un bagagiste ou un voiturier, guette le moindre signe d’énervement, la plus petite prémisse d’irritation. Quand le hall se vide, il continue de scruter l’espace. Il repère le coussin trop enfoncé, la plante en pot insuffisamment arrosée, le tapis bosselé, la tache d’oxydation sur le cuivre d’un narguilé. C’est son métier, son sacerdoce. Sous ses ordres, une troupe d’employés, pantalon bouffant opalin, gilet émeraude et fez rubis, s’active jour et nuit afin que le premier contact des estivants avec le funduq Al-Andalus soit un modèle de perfection. Pour l’heure, la source de son déplaisir se situe dans la télévision de l’entrée, allumée en permanence. Celle-ci diffuse en boucle les nouvelles du triple attentat qui a frappé Bagdad la veille. Le visage grave du Sultan Mehmet vient de s’afficher. Le discours se veut ferme : « Devant cette violence, je sais que vous vous posez la question : le sacrifice en vaut-il la peine ? Pourquoi ne pas nous replier sur nos terres et abandonner la planète à son sort ? Moi, Mehmet XI, je vous dis : ne doutez pas. Nous sommes en guerre. Nous combattons des hommes mauvais, animés d’une haine aveugle envers la liberté, équipés d’armes meurtrières, qui sont capables des pires atrocités. Mais nous défendrons notre liberté. Il y aura encore des moments difficiles qui mettront notre détermination à l’épreuve, mais le combat continue et je vous promets que nous resterons sur le terrain partout où cela est nécessaire, jusqu’à ce que la Sainte Croix soit vaincue ». La journaliste vedette Imad Abdullah embraie, rappelant que les attentats ont été revendiqués par une branche jusqu’ici inconnue de la Sainte Croix de l’abbé Antonio et que le bilan, très lourd, n’a pas encore été établi avec certitude. Elle cède ensuite la parole à l’expert en terrorisme attitré de la chaîne qui, l’air pincé et désolé, pose ses conclusions : « Nous le savons depuis les attentats d’Istanbul, et ceux de Damas, Le Caire, Alger et aujourd’hui Bagdad nous le rappellent : nous vivons une période déstabilisante qui met à l’épreuve la capacité de résistance de nos sociétés. Ne nous y trompons pas. Le terrorisme chrétien est là pour durer. » C’en est assez pour Paul qui, d’un geste de la main, ordonne à un de ses assistants de changer de chaîne.
Pendant que le subordonné s’échine à dénicher un canal ne diffusant pas de nouvelles tragiques, Paul Lemonnier voit son attention attirée par un tumulte. Les épaisses tentures de velours de l’entrée s’agitent, des cris résonnent. Une émeute déboule soudain dans l’écrin ambré du hall de réception. Un homme gesticulant s’avance tout en déversant ses imprécations sur un employé encombré de valises. Deux femmes stridentes et une tripotée d’enfants agités suivent en remorque. L’employé n’en mène pas large. Paul se redresse, ajuste son gilet. Face à un client mécontent, il est le dernier recours. Ses subordonnés le savent et comptent sur lui. Au premier regard, il a reconnu dans le client récriminant un Iranien. Deux épouses et six enfants. Paul se permet un haussement de sourcil. Il n’y a plus guère que dans la Jomhuri Eslami que l’on pratique encore la polygamie. Légataire déconfit d’un passé glorieux, l’Iran regarde les autres pays musulmans de haut. À l’image de leur Jomhuri Eslami, les Iraniens souffrent d’un complexe de supériorité. Cela en fait des vacanciers délicats à gérer. Mais Paul est un expert. Voilà dix ans qu’il est le mudîr du service de réception du funduq Al-Andalus. Autant dire qu’il a plus de pratique diplomatique que l’ensemble du corps des ambassadeurs de la Sublime Porte.
L’homme est de mauvaise humeur. À ses récriminations, Paul comprend qu’il s’est retrouvé coincé sur le tarmac de l’aéroport en raison d’une alerte à la bombe et que, pour ne rien arranger, une partie de ses bagages s’est égarée en chemin. Ses vacances, bien méritées, commencent mal. Alors que la troupe arrive au milieu du hall, une des valises rescapées s’ouvre et se répand en éventail sur les tapis. L’Iranien hurle aussitôt des imprécations en farsi à l’encontre du jeune porteur qui n’y comprend rien. Femmes et enfants, soudain cois, rebroussent chemin pour se tapir derrière les tentures veloutées. Paul Lemonnier, qui observe la scène depuis le début, sort de derrière le comptoir de l’accueil. Il tire d’un geste sec sur son gilet brodé vert et or et rajuste son fez écarlate. Le pas est volontaire, la mâchoire serrée en un sourire étudié.
Alors qu’il ne se trouve plus qu’à quelques mètres du lieu de l’incident, il attire l’attention de l’homme par un pas plus appuyé. Quand celui-ci se détourne du porteur, Paul capte son regard en esquissant une ébauche de salutation accompagnée d’une formule de politesse élaborée, prononcée dans un farsi sans défaut. L’Iranien le regarde, déconcerté. Il recule d’un pas, perd le fil, bafouille. D’un geste étudié, prenant soin d’éviter tout contact physique, Paul le fait pivoter. Dans son dos, le porteur s’empresse de ramasser les sous-vêtements. Sans lui laisser le temps de se reprendre, Paul explique au client à quel point Téhéran est une ville fascinante, empreinte d’une culture plusieurs fois millénaire. Que de civilisations ont éclos sur ces terres ! Les Parthes ! Les Sassanides ! Les Safavides ! L’Iranien esquisse un sourire. Paul baisse les yeux. L’affaire est déjà réglée. Le reste n’est que de la routine : un peu de pommade, un surclassement gratuit, le repas du soir offert par la maison. Un quart d’heure plus tard, le client apaisé s’installe dans une suite avec sa famille nombreuse. Après avoir été saluer l’Iranien et s’être assuré qu’il ne manquait de rien, Paul regagne son pupitre. Ses employés le suivent du regard, respectueux. Tirant d’un geste nerveux sur son gilet, il se permet un discret sourire avant d’apostropher son meilleur employé qui astique une table basse non loin.
— Jean-Robert, vous prenez ma place. Je dois aller discuter avec sidi Djaout.
Ahmed Djaout est le grand mudîr du funduq Al-Andalus. Les investisseurs libanais à qui appartient l’hôtel lui laissent l’entière responsabilité du bon fonctionnement de l’établissement. Soulevant la tenture ocre qui occulte l’entrée du bureau, Paul découvre le directeur assis à même le tapis, le dos calé par de plantureux coussins. Jambes croisées sous lui, il consulte le front plissé une liasse de feuillets. D’une main distraite, il tient l’embout d’une pipe à eau. L’air s’embaume des effluves d’un tabac de qualité.
— Assalamu alaykum, Ahmed. Tu es fort occupé ?
Ahmed Djaout lève la tête.
— Salaam, Paul, répond-il d’une voix lasse. Je suis toujours occupé. Actuellement, je termine les choses urgentes d’avant-hier.
Il soupire, dépose la liasse sur une table basse puis se frotte les paupières et le front.
— Mais pour mon ami Paul, j’ai toujours dix minutes, reprend-il. D’ailleurs, une pause ne me fera pas de mal. Ces bilans comptables finiront par me tuer. Entre ! Installe-toi. Veux-tu un thé ? J’ai reçu de la menthe de la plantation d’Adh Dhaïd. C’est la meilleure de toute la péninsule arabique, tu sais ? Production traditionnelle garantie sans engrais chimiques.
Paul accepte de bon cœur. Il s’installe, tasse quelques coussins pendant qu’Ahmed déploie sa longue et maigre carcasse pour se diriger vers le samovar.
— Je viens te prévenir d’un surclassement que j’ai autorisé ce matin…
— Inch’ Allah ! Et tu as sûrement bien fait, le coupe Ahmed en lui tendant une tasse en porcelaine. Depuis combien de temps travailles-tu au funduq ? Dix ans ? Quinze ans ? Tu ne m’as jamais déçu. Laissons cela ! Dis-moi plutôt : à quelle heure, ce soir ? J’ai tellement de soucis, j’ai déjà oublié.
— Vingt heures serait parfait.
— Bien. Lydia et moi serons là, répond Ahmed en s’asseyant dans un grand soupir.
S’emparant de l’embout du narguilé, il tète goulûment quelques bouffées, avant de poursuivre.
— Ah, Paul ! Laisse-moi te le dire ! C’est un grand honneur pour moi de rencontrer Cheikh Suleyman. Choukran, mille fois, choukran.
— Ce n’est rien, Ahmed. Aziz est un ami de vingt ans. Nous nous sommes connus à l’université, lui, sa femme Aïcha et moi. Nous avons fait nos études ensemble et avons été diplômés le même jour.
— Mais il fréquente l’émir Al Bakoum ! Il reçoit chez lui des vizirs ! C’est un notable, un cheikh ! Mieux, c’est un bâtisseur !
— Il a su rester simple. C’est quelqu’un de facile à approcher, tu verras.
— Choukran, choukran, répète Ahmed en se trémoussant de bonheur. Je te le revaudrai. Je te le dis, mon ami, je te le revaudrai.
Paul sourit. Il boit une lampée de thé avant de poursuivre, secouant la tête.
— La vérité, c’est que tu ne me dois rien. N’est-ce pas toi qui m’as donné du travail ? Qui m’a confié cette place au funduq ? Une poste de responsable, contre l’avis de tes patrons ?
— C’est de l’histoire ancienne, ça ! Et puis, tu étais au chômage. C’est le moins que je pouvais faire pour mon beau-frère, non ? C’était déjà un scandale que tu ne puisses pas trouver de poste correspondant à tes qualifications.
— Tu t’es battu pour que j’obtienne ce poste au funduq, Ahmed. Les Libanais ne voulaient pas d’un Européen, je le sais. Je t’en serai éternellement reconnaissant.
— Allons, allons…
Ahmed dépose sa tasse et s’empare des mains de son ami, qu’il secoue doucement.
— Paul, je n’ai fait que ce que je devais faire, par amitié, par justice. Laissons cela. Dis-moi, comment vont les enfants ? Il y a longtemps que tu ne m’as pas parlé d’eux.
Le sourire s’efface. Paul secoue les épaules.
— Oh, tu sais ce que l’on dit, hein ? Petits enfants, petits soucis, grands enfants… Je n’ai pas de problèmes avec Yossef, mon cadet. Mais Iskander, mon aîné, bah ! Il devient… Je ne sais pas… L’an passé, il traînait avec des voyous, de la graine de trafiquants, je me faisais beaucoup de soucis. À présent, il s’est assagi.
— C’est bien, c’est très bien.
— Oui, oui, c’est bien mais… bon, il a une nouvelle lubie. Il est devenu croyant, chrétien je veux dire, évidemment.
— Allons, Paul. Tu en parles comme si c’était une catastrophe.
— C’est que c’est… tellement à l’opposé de l’éducation que je lui ai donnée, enfin, que j’ai cru lui donner…
— Allons, allons, mon ami. Ce n’est pas un crime d’être chrétien.
— Non, mais dans le monde dans lequel nous vivons, ce n’est pas un atout non plus.
Paul se lève et salue son ami d’un signe de tête.
— Je dois te laisser. Aujourd’hui, c’est moi qui récupère les enfants à la madrassa. Sophie est occupée, tu sais, la préparation du repas… Elle est si perfectionniste. Nous nous verrons ce soir. Salaam, Ahmed.
— Salaam, mon ami. À ce soir.
À peine est-il de retour au pupitre de l’entrée qu’un de ses employés lui tend le téléphone. Il s’agit de son épouse. Inquiet, Paul prend la communication immédiatement, sans prendre la peine de s’isoler. La voix familière qui lui répond tremble d’émotion.
— Paul ? Tu ne réponds pas à ton portable !
— Jamais au boulot, Sophie, tu le sais. Que veux-tu ?
— Tu as entendu les nouvelles ? L’attentat ? À Bagdad ?
— Eh bien oui. On ne parle que de ça. C’est insupportable…
— Aïcha Suleyman vient de m’appeler. Sa sœur est parmi les victimes…
— Sa sœur ? Mais laquelle ?
— Hatida, celle qui habite Bagdad.
— Hatida ! Mon Dieu…
— Ils ne viendront pas ce soir, évidemment.
— Évidemment…
Paul raccroche. Des images vieilles de vingt ans le submergent. L’université de Bagdad, un été. Hatida, la douce Hatida. Une aventure de quelques mois. Quelques scènes se pressent hors de sa mémoire, comme si elles dataient d’hier. Hatida qui danse dans le soleil. Hatida qui rit aux éclats sur les marches de l’université. Souvenir de jeunesse, de légèreté. Nostalgie de cette insouciance révolue. Quel triste destin, ma belle Hatida. Qui aurait pu le prédire à l’époque où nous nous serrions dans les bras l’un de l’autre ? Qui aurait pu…
— Sidi ? Est-ce que ça va ?
Un employé obligeant vient de surprendre Paul perdu dans ses pensées. À ses côtés, une famille de vacanciers attend yeux ronds, désireuse de régler la note avant de rentrer chez elle. Paul se reprend. Pas le temps de s’appesantir davantage. Juste noter qu’il faudra prévenir Ahmed de l’annulation du repas de ce soir. La vie continue, Hatida. Inch’ Allah !
2
Dubaï, deux mois plus tard
La MadrassaFiransiyy, le Lycée Français, est un établissement vieux de deux siècles installé dans un quartier de la ville à l’écart des grands centres touristiques. Œuvre sociale financée par quelques riches ecclésiastiques et hommes d’affaires européens, le Lycée est fréquenté par de jeunes Européens aisés. Les cours se donnent parfois en français, parfois en anglais, de plus en plus souvent en arabe. Naviguant dans les embouteillages, Paul se remémore à quel point il s’était opposé à inscrire ses enfants dans cet établissement. Un paradoxe puisque son défunt père y a enseigné et que lui-même y a effectué toute sa scolarité. Mais Paul estime que ses enfants auraient eu tout à gagner à étudier dans une madrassa de l’enseignement public et à fréquenter des enfants arabes. Après tout, Iskander et Yossef vivront probablement toute leur vie en Orient. Ce sont des Dubaïotes, nés en terre arabe comme leur père. Qu’ont-ils encore de commun avec les Européens ? Hélas, leur mère avait insisté, résolument, invoquant son désir qu’un lien soit forgé entre ses enfants et la culture de leurs ancêtres. Aucun des arguments de Paul ne l’avait détournée de son but. Après bien des discussions, il avait rendu les armes. Il regrette sa capitulation. L’enseignement n’est pas en cause, mais la dérive récente d’Iskander vers la religion n’aurait pu arriver dans un enseignement public… Ou peut-être que si… Après tout, les madrassa publiques des quartiers ghettos européens ne sont pas renommées pour leur mixité ni pour leur qualité.
Alors qu’il pénètre dans le hall d’entrée sécurisé sous le regard placide d’un vigile, Paul aperçoit Monsieur Gabriel, le directeur de la madrassa. Celui-ci achève de sermonner un jeune garçon avant de le remballer en roulant des yeux féroces. Avisant Paul, il change d’expression du tout au tout, écartant les bras en signe de bienvenue.
— Lemonnier effendi, salaam, comment allez-vous ?
Vêtu d’une élégante djellaba couleur perle, Monsieur Gabriel accueille Paul à grand renfort d’embrassades avant de l’emmener faire le tour de la cour de récréation bras dessus bras dessous. Après l’avoir salué en arabe, il poursuit dans un français impeccable en lui tapotant l’avant-bras.
— Comment va madame, Monsieur Lemonnier ? Bien ? Laissez-moi vous le dire, je suis très content du comportement de vos enfants. Ce sont de bons éléments. Yossef, le cadet, est un peu espiègle mais c’est de son âge, n’est-ce pas. Il apprend bien, même s’il n’est pas très doué pour les mathématiques ni pour l’arabe. On n’en fera pas un savant, ce ne sera pas le prochain Averroès, mais il se débrouille. Et l’aîné ? Bien, très bien. Il s’est calmé. Il s’est intégré dans un groupe de jeunes gens désireux de réussir. Il n’a plus ces mauvaises fréquentations qui l’entraînaient à faire des bêtises. Il est très doué, vous pouvez être fier de lui.
De fait, Paul aperçoit Iskander discutant avec une poignée de condisciples à l’écart de l’agitation des plus jeunes. Le groupe semble sérieux et posé. Paul est sur le point d’exprimer ses craintes sur son fils aîné et ses nouvelles fréquentations quand Iskander l’aperçoit. Le jeune homme salue calmement ses amis et vient le rejoindre. Après avoir récupéré Yossef et salué Monsieur Gabriel de mille et un salamalecs, ils rejoignent la voiture puis replongent dans le trafic insensé de la fin de journée. Le visage collé à la vitre, les enfants contemplent d’un œil éteint le fade spectacle des rues de banlieue.
— Bonne journée, les enfants ? Tout s’est bien passé ? Vous avez bien travaillé ? demande Paul en arabe. Il évite au maximum d’utiliser le français en dehors de l’appartement familial. Des grognements indistincts lui répondent depuis la banquette arrière.
— Qu’avez-vous appris d’intéressant aujourd’hui ?
Dans son rétroviseur, Paul voit son fils aîné détacher lentement son front de la vitre.
— On a parlé des attentats de Bagdad en classe de religion chrétienne, répond-il en français.
Bagdad ! L’horreur absolue, une sauvagerie sans nom ! Jamais les bombes des terroristes n’ont fait autant de victimes. Et quelles victimes ! Des étudiants, des enfants, des femmes, des vieillards… et Hatida.
— … nous a demandé d’essayer de nous mettre dans la tête des terroristes…
Perdu dans ses pensées, Paul entend à peine la réponse avant que celle-ci revienne le frapper à la nuque.
— Qu’as-tu dit ? demande-t-il, repassant sans s’en rendre compte au français.
Soupir de l’adolescent qui reprend, excédé, détachant les syllabes de manière exagérée.
— J’ai dit que le père Luc nous a demandé d’essayer de nous mettre dans la tête des gens qui ont commis les attaques. Pour essayer de comprendre leurs motivations.
— Leurs motivations ? Qui est-ce père Luc ?
Nouveau soupir.
— Je viens de te le dire : le professeur de religion chrétienne.
— Et pourquoi vous demande-t-il de comprendre les motivations des terroristes ?
Iskander hausse les épaules, écarte les mains, exaspéré de devoir expliquer l’évidence.
— Parce que c’est perturbant, non ? Comment la foi en Jésus-Christ peut-elle pousser des hommes à agir de cette manière ? Comment ces gens ont-ils accumulé tant de haine dans leur cœur pour trouver la force de se tuer de cette manière ? Il voulait que l’on réfléchisse à ça.
— Pourquoi ? Mais parce que ces hommes sont des monstres ! Il n’y a rien d’autre à comprendre !
— C’est ce que disent le Sultan et pas mal d’Orientaux, en effet. Le père Luc trouve que ce discours, tu sais, les terroristes sont une incarnation du Mal, blablabla, est simpliste. En tant que chrétiens, on doit se sentir interpellé par ces actes. On doit se poser la question : pourquoi certains d’entre nous ont-ils versé dans le terrorisme ?
Entendre son fils revendiquer sans cesse son appartenance à la communauté chrétienne agace Paul.
— Je ne vois pas l’intérêt de se poser ce genre de questions, répond-il d’une voix acerbe.
Dans le rétroviseur, il aperçoit Iskander qui se tend, agressé par le ton, mais décidé à ne pas lâcher.
— Le père Luc pense qu’on ne peut excuser les terroristes, mais que ceux-ci n’agissent pas par méchanceté comme le dit le Sultan. Il faut comprendre les raisons de leurs actes, ce que la propagande officielle évite soigneusement de faire.
— La propagande officielle ? Mais qu’est-ce que tu racontes ? Qu’est-ce que c’est que ces salades ? Et les télévisions, et les journaux, et les magazines, et la liberté de l’information ? Tout ça, c’est de la propagande ?
— Oui. Évidemment.
— Allons ! Iskander ! Paul secoue les épaules, tapote sur le volant, agite l’air de sa main. La presse arabe n’est-elle pas la plus libre du monde ?
— C’est une illusion. Elle semble libre pour des yeux arabes, mais en vérité, elle ne l’est pas. Elle est le reflet de la société musulmane qui refuse aux chrétiens le droit de croire en Jésus.
— Ah oui, c’est vrai, ah ! J’avais oublié. Tu crois en Jésus.
— Jésus fait plus partie de ma culture que Mahomet, c’est sûr.
— Tais-toi ! Tu ne sais pas de quoi tu parles. Ta culture ! Ta culture ? Ta culture, elle est ici !
Vexé, Iskander se mure dans le silence. Indifférent, Yossef regarde par la fenêtre. Évitant de justesse un motard qui déboîte, le rembarrant à grands coups de klaxon, Paul bifurque dans la shariaMohamed et se concentre sur la circulation.
La famille Lemonnier habite dans un appartement en lisière de la zone touristique. Dans ce quartier paisible, les demeures s’inspirent de l’architecture arabe classique. Coupoles, moucharabieh, portes en bois sculpté abondent. Les rues sont aérées par des rangées de palmiers et les nombreux ronds-points s’ornent en leur centre de figuiers sycomores et de magnolias. Dans l’escalier menant à l’appartement, la discussion reprend et c’est une tornade qui pénètre dans la pièce, faisant sursauter Sophie qui se détendait dans un hamac accroché entre deux murs. Alors qu’elle se redresse, Yossef passe en trombe devant elle, visiblement agacé, et file se réfugier dans sa chambre.
— Ces chrétiens radicaux sont des monstres, des assassins, lance Paul en posant son fez sur la table tout en pointant un doigt sévère vers son fils. J’espère que si ton père Luc te demande encore d’y réfléchir, tu sauras quoi lui répondre !
— Tu n’essaies même pas de comprendre, lui répond Iskander d’une voix tendue, le visage fermé.
— Il n’y a rien à comprendre. Ces gens ont tué des enfants, réplique Paul avant de s’asseoir sur un pouf pour retirer ses babouches.
— Les avions turcs tuent des enfants chaque jour en Ukraine.
— Les Ottomans mènent une guerre contre les terroristes. Ils ne tuent pas des civils volontairement, à l’inverse des chrétiens radicaux.
— La belle affaire ! Pour ce que ça change pour les Ukrainiens. Ceux qui ne croient pas en Jésus ne peuvent voir le monde tel qu’il est vraiment.
— Ceux qui… Ben voyons ! Comme c’est facile. Écoute-moi bien, Iskander ! Je veux, tu m’entends bien, je veux, j’exige que tu restes à bonne distance de tous ceux qui tiennent des discours intégristes, qui critiquent la société orientale, qui font preuve d’intolérance.
— Je… je n’ai jamais rencontré de telles personnes. À cause des médias, les gens ont une vision déformée des chrétiens et…
— Tais-toi ! Je sais que de telles personnes existent, qu’elles recrutent des jeunes gens et les endoctrinent.
— Ah oui ? Qu’en sais-tu vraiment ? Tu fréquentes les églises ?
— Il suffit ! Je ne veux plus que l’on discute de cela aujourd’hui, conclut Sophie. Iskander, va dans ta chambre. Je ne veux pas que tu répondes sur ce ton à ton père ! Et retire tes babouches !
*
Le calme est revenu. Paul s’est effondré, tête renversée, dans le divan, les paumes pressant ses paupières. Sophie s’assied à ses côtés, lui tapote la cuisse.
— Ça lui passera, va.
— Peut-être. Peut-être pas.
— Ce n’est pas votre première dispute. Ce ne sera pas la dernière. Tu as acheté le tabac ?
Paul se redresse. Il l’embrasse, rasséréné par le ton optimiste.
— J’ai acheté le tabac et pas n’importe lequel : du dosib dokha, un mélange de tabac iranien et de pulpe de pommes. Pas donné mais Aziz l’adore. Et pour le pousse-café, je nous ai pris quelques dizaines de grammes de haschich d’Afghanistan. Selon le vendeur, le charas de l’Hindu Kush, affiné dix ans dans de véritables peaux de chèvre, est le meilleur du monde.
— Ne compte pas sur moi pour y toucher ! Je n’ai pas envie de me donner en spectacle. Et tu serais bien avisé de ne pas en fumer non plus. Tu n’as pas l’habitude d’Aziz.
— Ne t’inquiète pas. Je me contenterai de thé… J’espère qu’il sera remis du drame.
— Et Aïcha ? C’était sa sœur à elle, tout de même !
— Évidemment. Lui et Aïcha. C’est très gentil de leur part d’avoir proposé de faire ce repas si peu de temps après…
Sophie lui prend la main, le couvant d’un regard tendre.
— Ne t’inquiète pas, tout va bien se passer.
— Inch’ Allah !
3
L’intégration ne va pas si bien que ça : le quart des Européens sont au chômage et les deux tiers des échecs scolaires, c’est l’échec d’enfants d’immigrés.
Abu Abdallah Abd Al-Malik, Kahya Bey de Dubaï,vizir responsable de la sécurité intérieure
Le soir
— Khayyam, Khayyam ! Depuis ce film, il n’y en a plus que pour Khayyam !
— Magnifique, ce film, non ?
— Comme s’il n’y avait pas d’autres poètes perses de valeur ! Attar ? Inconnu ! Afiz ? Oublié ! Nezami ? Disparu ! Et les modernes, hein ? On n’en parle jamais des modernes ! Nima Yushij, Ahmad Shamlou…
— Délicieux, Sophie !
— Choukran, Aïcha, c’est tout simple à faire, en vérité !
— La, choukran alawajib ! Tu dis ça mais moi, je sais que la cuisine française, il faut être française pour savoir la faire. Je le disais encore à ce cher Maurice l’autre jour…
— Ou les Turcs !
— Allons ! Les Turcs sont des ignares à côté des Perses !
— Paul, toi qui viens de là-bas, tu devrais aller boire un café crème à Al Café de Paris. C’est ce jeune architecte dont tout le monde parle, Maurice, qui a assuré la décoration intérieure. C’est magnifique. Si exotique, si dépaysant, si… européen dans le bon sens du terme…
— … bref, je le disais à Abdel Zhitany l’autre jour : tu programmes des émissions culturelles. Bien, très bien ! Mais profites-en pour éduquer les gens ! Où va-t-on si même les émissions culturelles versent dans la facilité, dans le convenu ?
— Et qu’est-ce qu’il a répondu ?
— Oh ! Tu connais Abdel…
— Je n’ai pas cette chance.
— Inch’ Allah ! Il a beau être l’un des trois directeurs de Dubaï TV, il va te dire qu’il a moins de pouvoir que le dernier des téléspectateurs. Il m’a répondu culture de masse, concurrence, annonceurs, refus de l’élitisme, blablabla. Je lui ai dit : Abdel, je te le dis comme je le pense, ta télé, c’est de la merde. D’ailleurs, moi, je ne regarde plus que les chaînes satellitaires indiennes ou iraniennes. Ha !
Aziz Suleyman, figure ronde, crâne chauve luisant de sueur, se renverse, tassant les coussins jusqu’au bord de l’éclatement. Avec sa large silhouette serrée dans un kami clair sans fioritures, il fait plus penser à un Beyrouthin combinard qu’au directeur influent, vénéré et tout-puissant de Suleyman, Adoum & Melki, première entreprise de construction de l’émirat. À ses côtés, son épouse Aïcha cultive son personnage de grande bourgeoise. Le verbe haut, le compliment facile, elle passe sans peine d’un éloge des couturiers afghans – talentueux mais si misogynes – à l’état d’avancement de sa biographie de Hoda Chaarawi, mère du féminisme arabe – la première à avoir osé brûler son voile en public. En la contemplant, Paul ne peut s’empêcher de songer avec nostalgie à l’étudiante vive et ironique qu’il a connue sur les bancs de l’université de Bagdad. La perle scintillante s’est transformée en un épais coussin brodé. L’image de Hatida lui revient alors. Hatida la cadette, élancée, souriante. Il y a pensé à quelques reprises depuis la nouvelle de sa mort. Mais trop d’années ont passé. L’éloignement. Le manque de contact. Bizarre qu’une personne qui lui fut si proche à un moment de sa vie ait pu s’estomper à ce point. Paul se reprend. La sinistrose n’a pas sa place ce soir.
Face à lui, Ahmed et Lydia, engoncés dans leurs plus beaux habits, ont fini par se détendre. Assis sur les poufs autour de la table basse encombrée de plats, les trois couples s’apprécient, manifestement heureux de partager cette soirée et la salle à manger des Lemonnier résonne de leurs rires. Paul commence à s’apaiser. Habituée à deviner les humeurs de son mari, Sophie profite d’un moment d’isolement dans la cuisine pour le lui faire remarquer.
— Toujours inquiet ? chuchote-t-elle à son oreille.
— Tu sais à quel point la préparation de ce repas m’a stressé, répond Paul à mi-voix.
— Et je ne comprends toujours pas pourquoi.
— Sophie, il s’agit de mon patron et d’un des hommes les plus influents de Dubaï !
— Paul ! Ce sont nos amis ! Tu ne peux pas en parler comme ça ! Tu connais Aziz et Aïcha depuis quoi ? Vingt ans ? Et Ahmed et Lydia depuis plus longtemps encore. Ce sont nos amis, Paul. Pas ton patron. Pas l’homme influent. Nos amis. Détends-toi ! Ils ont l’air de s’amuser, non ?
— Inch’ Allah !
*
— Et cette crise de l’immobilier qu’on ne cesse de nous annoncer, Aziz effendi ? Existe-t-elle ou n’est-ce qu’un fantasme de journaliste ?
Ahmed a lancé le sujet au dessert. De la cuisine, Paul expédie la préparation du kawa et, plateau de biscuits au miel à la main, revient s’asseoir avec un naturel forcé qui n’échappe pas à Sophie.
— J’ai quatre chantiers en cours en ville et dans les environs immédiats, mais au-delà, mon carnet de commandes à Dubaï est vide, si l’on excepte le Sphinx de Gizeh…
— Le fameux projet pharaonique de l’émir !
— En effet, mais celui-là n’est pas certain. Il y a de fortes oppositions au niveau des vizirats.
— C’est donc vrai ? reprend Ahmed.
— Tout le monde savait que nous ne pourrions maintenir indéfiniment le rythme de construction que Dubaï a connu ces dix dernières années. Je suis même étonné que cela ait duré aussi longtemps. Ne le répétez à personne, mais je pense que l’émir a un peu perdu le sens des réalités.
— Vous savez, intervient Aïcha, l’émir est un drôle de type, à la limite de la schizophrénie. Quand nous avons été reçus au palais à l’occasion de l’Aïd-el-Fitr, il a été extrêmement gentil avec tout le monde. Bon, il est un peu lassant quand il parle de ses faucons de chasse et de ses chameaux de course, mais sinon, il est charmant. Mais en affaires, c’est un autre homme, une brute parfois odieuse !
— Et pas d’inquiétudes pour l’avenir de Suleyman, Adoum & Melki ? reprend Ahmed, redoutant que la conversation ne se perde en digressions oiseuses.
— Oh ! Ce n’est pas nous qui allons souffrir de la crise. Nous sommes à un niveau supérieur. À l’échelle du monde, le marché de l’immobilier obéit à la loi des vases communicants. Quand ça se vide quelque part, ça se remplit ailleurs. Il ne faut pas aller très loin : Abu Dhabi jalouse Dubaï. L’émir de là-bas veut faire construire des funduqs encore plus prestigieux. Il y a le sultanat d’Oman qui est aussi très actif. Nous avons également un projet en Irlande.
— En Irlande ?
— Le pays est calme, comparé au reste de l’Europe.
— Il n’y avait pas une espèce de guerre de religion entre sectes chrétiennes ?
— C’est de l’histoire ancienne. Ils ont fait la paix il y a quatre ans et sont à présent désireux d’attirer les investisseurs orientaux. Nous allons construire une station de vacances non loin de Dublin. Il y a un vrai potentiel touristique.
— Sans compter que les artisans celtes produisent des choses merveilleuses et très modernes, intervient de nouveau Aïcha. Toutes ces courbes entrelacées, ces volutes, ces arabesques… Ils ont inventé l’abstraction avant tout le monde, ces gens-là ! L’art celte sera la prochaine sensation en matière de décoration, croyez-moi.
— Le plus gros problème, reprend Aziz, c’est la criminalité locale, mais comme la station sera autosuffisante, les touristes n’auront pas à mettre le nez dehors sauf pour des excursions organisées et nous avons déjà un contrat avec une société de vigiles ici et une milice là-bas pour assurer la sécurité.
— Une milice ? N’est-ce pas dangereux ?
— Ce sont des vétérans des guerres religieuses qui se sont reconvertis. Ils sont compétents et parfaitement fiables. D’ailleurs, les vigiles seront à l’intérieur et les miliciens à l’extérieur. Ce sera totalement sécurisé.
— Parle-nous un peu de ces nouveaux funduqs que tu construis à Dubaï, dit Paul, soucieux de relancer le sujet.
— Qu’y a-t-il à en dire que la presse n’ait déjà révélé ? Il y a l’Algesiras, un funduq de milieu de gamme, assez similaire à Al-Andalus. Rien de remarquable, si ce n’est que les commanditaires sont une famille indienne de Goa ayant fait fortune dans le textile. Ensuite, le Sultan Murad, un cinq-étoiles sur le front de mer couplé avec un casino, commandé par des Libanais.
*
Après le kawa, les trois couples s’installent dans le coin salon. Chacun s’assied confortablement sur les tapis, le dos calé dans les coussins. Paul allume le narguilé et ouvre le coffret contenant des pipes en porcelaine. Il dispose sur la table des pots de tabac et de haschich. Aziz et Paul se bourrent chacun une pipe de dosib dokha pendant qu’Aïcha et Ahmed tombent d’accord pour se partager le narguilé au haschich.
— Délicieux, ce tabac, affirme Aziz, la mine gourmande, après avoir aspiré plusieurs bouffées.
— Choukran, Aziz. Il vient de la boutique près du funduq.
— Très bonne boutique, en effet.
— Et vos enfants ? demande Aïcha en portant l’embout du narguilé à la bouche. Vous nous les cachez ? Ça fait une éternité que je ne les ai plus vus !
— Ils sont de sortie ! répond Sophie. Yossef dort chez une amie et Iskander est au cinéma avec ses copains.
— Vous avez de la chance. Aziz et moi n’avons jamais eu le temps d’en faire. Je suis sûre qu’un jour, ça nous manquera.
— Nous avons mon neveu, Ali, intervient Aziz. C’est comme si c’était notre enfant. Il n’a plus que nous au monde.
— Le pauvre Ali. Quelle tragédie ! Perdre ses parents de cette manière ! Comment va-t-il, ce petit ? demande Sophie.
— Eh bien, il y a longtemps que tu ne l’as plus vu, répond Aziz. Ce petit a vingt ans à présent. Il débute à Dubaï TV. On l’a vu ce midi aux infos. Avec cette nouvelle alerte à la bombe à l’aéroport.
— Cette alerte à la bombe m’a retournée. J’ai pensé à Hatida, la pauvre.
— Évidemment. Ça a dû être un choc terrible, de perdre sa sœur dans ces circonstances aussi tragiques, répond Ahmed.
— À la vérité, nous avions très peu de contacts. Elle avait fait sa vie à Bagdad, moi à Dubaï. Nous nous parlions peu. Son mari est un type insupportable. Mais Paul, n’étais-tu pas proche d’elle à une époque ?
— À l’université, en effet, nous étions proches. Mais j’ai perdu contact avec elle une fois que je suis revenu à Dubaï. Je n’ai plus jamais eu de ses nouvelles.
Un silence songeur s’installe fugacement jusqu’à ce qu’Aïcha s’exclame, dans un soupir enfumé tout en tendant l’embout du narguilé à Ahmed.
— On ne peut pas comprendre les motivations des gens qui font ça !
— Qui font quoi ? demande Sophie, interloquée.
— Qui se font sauter comme ça ! C’est le Mal, Shaytan, le diable ! réplique Aïcha. Moi, je ne crois pas en Dieu, mais je crois au diable !
— Nous n’avons pas besoin de Shaytan, Aïcha. La noirceur de l’âme humaine est insondable, corrige Paul tout en se demandant quelle épingle a soudainement piqué l’épais coussin brodé.
— Paul a raison, intervient Ahmed après avoir expiré un nuage odorant. Ce ne sont pas des démons surgis de l’enfer qui se font sauter dans nos villes. Ce sont des jeunes Européens, nés et éduqués chez nous !
— Mais pourquoi ? Pourquoi ? Sont-ils si mal chez nous ? demande Aïcha.
Enveloppé de fumée, Ahmed reprend, agitant l’embout du narguilé en direction de son interlocutrice.
— Je crois que ces jeunes gens détestent l’Orient comme un alcoolique déteste l’alcool.
Aziz pouffe puis, la fumée lui sortant du nez et de la bouche, tousse, la face rubiconde, manquant de s’étrangler tandis qu’Ahmed continue sans désemparer.
— Je crois que chez les jeunes chrétiens, l’Orient est perçu comme d’autant plus détestable qu’ils le trouvent séduisant. Pour eux, tout vient de Dieu. Épouser le mode de vie oriental, c’est se détourner de Dieu puisque c’est repousser le type de société qu’il a inspiré. Et à l’inverse, refuser l’Orient, c’est prouver sa croyance en Dieu.
— Je n’ai jamais entendu les chrétiens parler de leur religion de cette manière. Je veux dire : prétendre que leur religion est la meilleure, la plus parfaite, dit Sophie.
— Mais ils le disent ! Ouvertement en Europe, discrètement chez nous.
Aziz a toujours apprécié une bonne discussion. Profitant qu’Ahmed fait une pause dans son discours pour fumer le narguilé, il répond.
— Il y a des agités, c’est certain, mais la capacité de nuisance de ces quelques illuminés est assez faible. Ahmed a raison sur un point : leur projet de société est nul. Le problème, c’est qu’on n’entend que les radicaux, les excités. Il faut que les modérés, les Européens, les chrétiens d’Orient, disent aux Arabes, aux musulmans : regardez-nous, nous ne sommes pas différents de vous. Paul et toi, Sophie, qui représentez si bien l’élite européenne de cette ville, vous devriez témoigner, écrire un livre peut-être.
— Je ne suis pas un chrétien d’Orient, répond Paul, désemparé par le tour inattendu qu’a pris la discussion.
— Mon mari, intervient Sophie avec une lueur ironique dans le regard, a tourné définitivement le dos à l’Europe. Les gens dont tu parles ne sont plus ses compatriotes. Tu l’insultes en lui rappelant ses origines étrangères.
— Je ne suis pas d’origine étrangère ! Je suis né ici, à Dubaï ! J’ai vécu toute ma vie en Orient et suis citoyen des Émirats Arabes Unis comme l’étaient mes parents. Sophie n’a de cesse de me reprocher ma position. Elle trouve que je trahis mes ancêtres gaulois ! Mais n’ai-je pas raison ?
— Tu dois rester fidèle à tes racines, Paul. Ta culture est aussi riche que la nôtre. C’est elle que tu dois valoriser, dit Aïcha.
— Mais ma culture est ici ! Ma…
— Il faut cesser de prétendre que la culture européenne vaut bien la nôtre, le coupe brusquement Ahmed. Le relativisme fait le lit du fanatisme. La culture européenne n’a plus rien produit de valable depuis quatre siècles. Il faut oser le dire.
— Depuis que les Turcs ont pris Vienne et mis à bas les royaumes chrétiens les uns après les autres, réplique Aziz dans un panache de fumée.
— Sans doute mais qu’est-ce que ça change ?
— Ça change que ce sont les Ottomans qui ont détruit la culture européenne.
— Les Turcs n’ont fait que donner un coup de pied dans l’arbre. La pomme était blette. Que Paul mette sa culture en valeur, je suis d’accord, mais de là à dire qu’elle est aussi riche que la nôtre…
— Ma culture est ici, répète Paul sans que personne ne relève.
— Ahmed a toujours été un prosélyte discret mais borné, intervient soudain son épouse Lydia d’une voix dure. Le haschich fait qu’il se dévoile un peu plus que d’habitude, mais il ne faut pas hésiter à lui dire qu’il a tort. Moi, je suis chrétienne, je n’ai pas peur de le dire. Je crois en Jésus-Christ et ma religion vaut bien la sienne.
— Ma femme et moi nous disputons parfois à ce sujet, confie Ahmed, souriant pour désamorcer la tension. Quand je l’ai connue, elle se proclamait agnostique, mais depuis quelques années, elle a redécouvert la foi de ses aïeux. Après tout, musulmans et chrétiens sont cousins, n’est-ce pas ? Nous n’adorons pas le même prophète mais bien le même Dieu.
— Je n’adore aucun Dieu, dit Aziz.
— Moi non plus, reprend Paul.
— Et tes enfants ? demande Sophie à Lydia, ennuyée par le tour que prend la discussion.
— Ils choisiront leur religion quand ils seront en âge de le faire.
— Non, non, je voulais dire, comment vont-ils ?
Ahmed attrape la perche. Il devient urgent de changer de sujet de conversation.
— Le plus grand est à l’université de Bagdad, répond-il. Il est en première année de biologie. On verra ce que cela donnera. Notre fille le rejoindra sans doute l’année prochaine. Elle est attirée par la médecine. Et les vôtres ?
Blême, les yeux rougis par la fumée, Paul se lève pour ouvrir le volet du moucharabieh. Alors qu’il tend la main, le bruit sourd de l’explosion s’engouffre dans l’appartement. Telle une vague féroce surgie de l’enfer, elle fait trembler les vitres et tinter les verres. Paul aperçoit une éphémère fleur de feu orangé éclore au-dessus des toits. La lumière s’éteint avant de se rallumer. Quelques bruits de bris de vitres. Puis les alarmes des voitures. Chez les Lemonnier comme partout ailleurs, les gens se sont figés.
4
La force est l’unique chose qu’ils comprennent.Nous devons utiliser la force absolue jusqu’à ce que les Européens viennent ramper devant nous.
Fouad Sehebani Bey, chef d’état-major de l’émirat de Grenade
Paul fonce dans la nuit comme on tombe dans un puits sans fond, négociant chaque virage à la limite de la perte de contrôle, accélérant pied au plancher jusqu’au bout de chaque ligne droite. Les rues défilent, angoissantes, désespérantes de longueur. Sur le pare-brise se reflète la vision d’Iskander agonisant sur un trottoir. Quand il a aperçu tout à l’heure la lueur de l’explosion, Paul a tout de suite su que le quartier touché était celui où se trouvait le cinéma préféré de son fils. Son monde s’est alors recroquevillé. Les autres ont disparu de son champ de conscience. Après avoir tenté de joindre Iskander sur son portable, il a abandonné tout le monde derrière lui pour filer à sa recherche. Durant les brefs répits que lui accorde sa panique, Paul se rend compte du caractère irrationnel de son comportement. Entre deux battements de cœur fébriles, il se convainc presque de retourner chez lui. D’y attendre un coup de téléphone, un signe de vie ou autre chose. Mais l’image d’Iskander s’impose, son visage, un sourire, un regard, des souvenirs de bonheur, et Paul appuie sur l’accélérateur.
Alors qu’il se rapproche de l’épicentre du séisme, la nuit s’emplit de hurlements sinistres. Les sirènes d’ambulance, de pompiers, de police s’appellent et se répondent, attisant l’angoisse. Brusquement, un barrage se matérialise devant lui. Baigné dans un kaléidoscope de lueurs bleutées clignotantes, un policier lui fait signe de s’arrêter. D’un seul élan, Paul se gare et sort de sa voiture, s’apprêtant à poursuivre sa mission à pied. Alors qu’il surgit de l’habitacle, le policier fait un pas en arrière et porte la main vers son arme de poing. Apercevant le regard farouche de l’agent, Paul se rend compte qu’ils frôlent tous deux la panique. Dans les circonstances présentes, c’est courir un risque mortel. Il stoppe, tend les mains en signe d’apaisement. Puis il entreprend d’expliquer la raison de sa présence et de son impatience. L’autre hoche la tête, rassuré. Mais il lui est impossible d’autoriser Paul à pénétrer dans ce qu’il nomme le périmètre. Au cœur de celui-ci, les sirènes se font de plus en plus nombreuses, pressantes. Paul supplie, cajole, exige, menace. Rien n’y fait. Deux autres policiers arrivent à la rescousse de leur collègue, lui faisant comprendre qu’un passage en force est impossible. À insister davantage, il risque l’arrestation. Paul bat en retraite, repoussé mais pas vaincu.
Après s’être garé hors de vue des policiers, il poursuit à pied, prudemment. Il chemine par des ruelles de traverse que la police n’a pas encore eu le temps de couvrir. Il arrive finalement sur la place Al-Ayyûbî. C’est l’un des lieux de rendez-vous de la jeunesse dubaïote, attirée par les cinémas, les salons de thé, les discothèques qui cerclent l’esplanade. La place, garnie en son centre d’un énorme croissant islamique en béton armé, est méconnaissable. L’explosion a dispersé une multitude de débris aux alentours, comme si le souffle avait éventré toutes les poubelles du quartier. Plusieurs ambulances sont garées, lumières allumées devant un bâtiment en feu. Des policiers courent dans tous les sens, sans but apparent. Des pompiers se fraient un chemin vers l’incendie en tirant leurs lances derrière eux. Des brancardiers escortés de médecins les croisent, emmenant des victimes extraites des décombres. Des photographes mêlent leurs flashs argentés aux lueurs bleues, jaunes et rouges des services de secours. Paul s’approche de l’immeuble éventré. Dans l’ambiance de chaos et d’urgence, personne ne fait attention à lui. Il survole du regard le capharnaüm, sans trop insister, craignant de reconnaître parmi ces amas informes un lambeau de corps arraché par la déflagration. À l’insu des policiers, un groupe de curieux s’est rassemblé de part et d’autre pour regarder les secouristes à l’œuvre. Et soudain, éclatant comme le premier rayon de soleil qui déchire les nuages après l’orage, la figure d’Iskander apparaît entre deux spectateurs anonymes.
Quand il aperçoit à son tour son père, Iskander se met à courir dans la direction opposée. Il s’enfuit, slalomant entre les ambulances, sautant au-dessus des tuyaux. D’instinct, sans réfléchir, sans prendre la mesure de sa surprise, Paul se lance à sa poursuite. Entre deux foulées, il crie son nom. C’est la panique, sans doute, qui le pousse à fuir. À peine a-t-il fait quelques mètres qu’Iskander se prend les pieds dans un débris et s’étale de tout son long sur les pavés de la place. Paul le rattrape, s’accroupit. Iskander se retourne, lui lance un regard d’épouvante.
— Calme-toi, Iskander. C’est moi, ton père.
— Mais… qu’est-ce que tu fais ici ?
— Je suis venu te chercher. J’ai eu tellement peur que tu… Tu n’es pas blessé ?
— Je… je n’ai rien. C’est une discothèque qui a explosé. Il… il s’est fait sauter à l’entrée, dans la file. Je n’étais pas là. Je… j’étais… Je vais bien, papa.
— Tu n’es pas blessé. Tu n’as rien. Oh merci, merci…
Paul serre son fils dans ses bras, sentant venir des larmes de soulagement. Iskander se débat, repousse son père, sans violence mais avec force, fronçant les sourcils.
— Laisse-moi. Puisque tu es là, rentrons à la maison, dit-il en se redressant, frottant son saroual.
Paul remarque qu’il tient un objet dans sa main, un objet qu’il reconnaît aisément : un appareil photo. Celui qu’il lui a offert pour ses seize ans. Croisant le regard de son père, Iskander le remet rapidement en poche.
— Tu as raison, rentrons, dit Paul en écartant les questions qui lui viennent. Ta mère doit être folle d’inquiétude.
5
Mis à part quelques membres des élites citadines aux idées pacifistes, peu de gens en Castille apprécient les Grenadais et toutes les négociations de paix n’y changeront rien. À l’école, les enfants apprennent la longue et sanglante histoire de la Reconquista depuis la bataille fondatrice de Las Navas de Tolosa au XIIIe siècle jusqu’aux campagnes de guérilla du comandante Guillerez en passant par la défaite amère, objet de regrets éternels, de Ferdinand le Catholique face aux armées arabo-turques de Gâzi Ahmed Pacha devant Grenade en 1492. Une pareille litanie de combats, de victoires et de défaites, de défaites surtout, ne peut laisser indifférent.
Don Pedro Cordoba,ministre des Affaires étrangères de Castille
San Juan de Moya, Castille, le lendemain,
Fulgurante flèche de métal surgissant de l’arrière des collines, l’avion de chasse perce le ciel sans nuage d’un coup de tonnerre. En contrebas, réunis sur le parvis crayeux de l’église à l’issue de la messe dominicale, les villageois, méfiants, l’observent tel un blasphème.
L’avion, un Dogan de dernière génération de fabrication turque, vole à basse altitude et le bruit de ses réacteurs se mêle à celui des cloches. On peut distinguer sur son empennage un croissant blanc sur fond vert. Rodrigo Obregón ne se soucie pas de ce signe distinctif. Qui d’autre que l’émirat de Grenade possède le pouvoir et l’outrecuidance d’envoyer ses chasseurs dans le ciel de la Castille libre ? Il est plus concerné par les roquettes Yıldırım que l’avion porte sous ses ailes. C’est le signe que le prédateur n’a pas encore trouvé sa victime. Il n’est pas le seul à être inquiet. Les mères battent le rappel de leurs enfants pour les mettre à l’abri. Seuls les hommes sont encore présents lors du second passage de l’oiseau de proie. Les Grenadais ont pour habitude de répondre aux attaques qui les frappent par des raids de représailles sur les villes et villages de Castille libre. Ces bombardements laissent à chaque fois derrière eux une poignée de civils déchiquetés, des morts que le porte-parole de l’émirat présente invariablement comme d’inévitables victimes collatérales, causées par la présence des terroristes au sein de la population et pour lesquels il offre les sincères excuses de l’état-major. Mais les Castillans ne sont pas dupes. Ils savent que ces conférences de presse d’après coup, destinées aux opinions publiques orientales, ne les concernent en rien.
L’attentat que le curé vient de célébrer, et ses paroissiens avec lui aux cris d’Alabado sea Dios





























