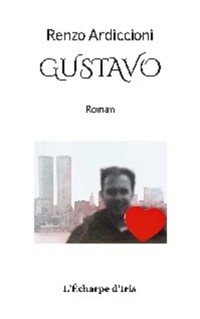
7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Les éditions L’Écharpe d’Iris
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
GUSTAVO
© Éditons L’Écharpe d’Iris, 2024
2 allée Jacques-Offenbach 76520 Franqueville-Saint-Pierre
ISBN : 978-2-9592628-8-3
Édition revue de la version Hippocampe 2019
Dépôt légal : Avril 2024
Tous droits de reproduction, traduction et adaptation réservés pour tous pays.
GUSTAVO
Roman
Renzo Ardiccioni
Titre original : Ippocampo
Traduit de l’italien par Murielle Hervé-Morier
Collection L’Écharpe rouge
L’Écharpe d’Iris
À Véronique
« I saw the best minds of my generation
destroyed by madness... »
Allen Ginsberg, Howl
1
Je n’ai pas vu mes parents mourir. Ils sont partis sans bruit. Comme ça. Ils m’ont mis devant le fait accompli. À mon avis, ils sont morts debout. En effet, ils étaient de ceux qui savent encore mourir debout. Devant leur cercueil sans couvercle, je n’ai rien ressenti. Presque rien. À part une immense envie de rire et d’en finir au plus tôt avec ces funérailles en série.
La nouvelle était tombée alors que je nageais dans un rêve tout éveillé. J’étais peut-être moi-même en train de mourir quand on m’annonça le décès de mes parents à dix jours d’intervalle. Je n’en éprouvai aucune souffrance sur le moment. Chez nous, nous avions coutume de vivre dans une léthargie continuelle, pareils à des professionnels du sommeil qui se seraient eux-mêmes anesthésiés. C’était la sieste permanente. Un beau jour, nous nous serions tous endormis devant la télé sans jamais plus nous réveiller. Nous étions tous amorphes, alors que les programmes continuaient de se dérouler. Il n’y avait ni haine ni amour dans la famille. Il n’y avait rien, il n’y avait jamais rien eu ; jamais une gifle, jamais une caresse. Une famille apathique et des sentiments engourdis. Ou peut-être trop intenses, va savoir. Donc, je ne souffrais pas. Mon âme errait depuis toujours dans un désert froid et ensoleillé, sans eau et sans soif. Le jour de ma naissance, j’ai déboulé dans ce monde. C’est arrivé comme ça. Et je ne saurais pas non plus expliquer pourquoi mon père et ma mère sont aussi arrivés en ce monde. Ça aussi, c’est simplement arrivé. Comme ça.
Après le sentiment d’indifférence envers les miens, des questions intimes s’immisçaient à présent en moi ; autant d’états d’âme par lesquels je n’étais pas encore passé avec autant d’intensité. Mes parents m’avaient-ils vraiment désiré ou étais-je le pur fruit du hasard ? Étais-je bien leur fils ? D’ailleurs d’étranges rumeurs couraient dans mon village. Pourtant, mes yeux étaient la copie conforme des yeux de mon père et ma bouche ressemblait trait pour trait à celle de ma mère. D’éternelles questions affluaient dans ma tête : qui j’étais, d’où je venais, où j’allais et ce que j’allais devenir ; les questions que tout le monde se pose. Des questions à la con et je mourrai peut-être moi aussi sans en connaître les réponses.
Chacun sait ce que signifie la disparition d’un être cher. Mais en pareil cas, on n’est pas forcément pris par une irrépressible envie de rire. Moi, je ne pouvais pas contenir mon hilarité. Je me souviens de leurs corps glacials, d’un froid irréel, une sensation qui m’était inconnue jusqu’ici. Existait-il une température au-delà de la sensibilité connue ? La barbe de mon père était froide. Maman avait les cheveux encore plus blancs que la neige du matin. Ce froid déclencha en moi un frisson d’allégresse.
Aux enterrements de mes parents, un vieux chien errant crasseux rejoignait à chaque fois le cortège de sa démarche indolente. J’appris qu’il avait l’habitude de suivre ainsi tous les convois. Mais lui, qui l’accompagnera un jour à son dernier repos ? Qui s’occupera d’organiser ses obsèques ? Eh bien oui, je m’attache à certains détails et je dois bien admettre qu’enfant déjà, dans la crèche de Noël, c’étaient surtout le bœuf et l’âne qui m’intéressaient.
L’étape la plus sociale du deuil commença alors, parce que dans les petites bourgades comme Pacentro, un deuil regarde tout le monde. Et deux deuils successifs, en si peu de temps, ce n’était pas rien.
Nous partageâmes en famille quelques souvenirs, des lambeaux de mémoire contenus dans une première boîte d’un métal gris brillant ayant appartenu à ma mère et dans une seconde, en bois d’acajou, propriété de feu mon père. Elles contenaient toutes deux peu de chose. Quelques photographies, des bricoles sans valeur et des pièces de monnaie qui n’avaient plus cours. Tout ceci était dérisoire. Ce fut ma plus grande part d’héritage.
Le lendemain de l’enterrement de ma mère, je rentrai à Florence en train. Pendant le trajet, j’entamai une grille de mots croisés. Mais au final, je résolus seulement deux ou trois rébus. Derrière leur calme apparent, ces énigmes me semblaient aussi tristes et compliquées que mon existence, lisses et mystérieuses ; comme la vie en général, il faut croire. J’arrivai tard à la gare de Santa Maria Novella, une légère sensation nauséeuse m’avait accompagné pendant tout le trajet. Je vis par terre un paquet de Gauloises vide. Il y avait écrit dessus : « Fumer peut entraîner une mort lente et douloureuse ». J’écrasai avec rage le paquet de mon pied gauche.
Je perçus de la lueur filtrer par l’embrasure de la porte quand j’arrivai sur le palier. Je tournai la clé dans la serrure. La lumière était restée allumée. Je me l’expliquai parce que j’étais parti précipitamment à Pacentro… J’entrai. D’abord j’éteignis et dus rallumer aussitôt. Je fixai mon regard sur un vieux trente-trois tours du groupe Dik Dik, Senza Luce. Une fois encore, l’envie de rire me reprit. Décidément, les enterrements avaient le don de dissiper mes parcelles de mélancolie. Le moment était arrivé d’éteindre la lumière pour la nuit. Je me suis retrouvé alors face à moi-même, les yeux regardant le plafond. Je percevais avec clarté tous les bruits de la nuit.
L’obscurité s’était déjà bien répandue et la lueur des réverbères de la ville pénétrait dans la pièce, l’inondant d’une douce lumière artificielle. Si quelqu’un m’avait épié, juste en cet instant, il aurait vu un petit animal recroquevillé sur un fauteuil, la tête blottie entre ses pattes, la gueule légèrement ouverte. Je compris rapidement qu’il était temps d’aller au lit. J’étais vidé, mais heureux. Je me sentais toujours heureux aux prémices de la nuit.
La sonnerie du téléphone vint troubler ma quiétude.
– Allô, c’est toi ?
– Évidemment, qui veux-tu que ce soit…
– J’ignorais quand tu devais rentrer… je t’ai appelé un peu plus tôt dans la journée, mais tu n’étais pas là.
– Je suis là, maintenant.
– Comment ça s’est passé ? Cela a dû être dur, non ? Deux morts en si peu de jours…
– Oui, mais finalement non. Au fond, non. J’ai cru fondre en larmes et pourtant non. Au contraire, rien ne s’est passé. J’étais là, c’est tout. Ils sont tous venus.
– Pouvons-nous nous voir ? Maintenant, si tu veux… Ou peut-être demain.
– Non, non, pas maintenant. Demain par contre, je pensais aller à la mer, je veux y aller seul. En effet, j’ai envie de me retrouver…
– Pas de problème, comme tu veux. Je te rappelle demain soir, ça te va ?
– Bonne nuit, bise.
– Tu dois être triste ?
– Non, pas tant que ça, je viens de te le dire. Beaucoup de gens pleuraient, mais pas moi. Il y en avait plein qui me regardaient, ils attendaient de moi je ne sais quoi… Ils m’examinaient tous, mais moi, j’étais sans réaction.
– Tu ne changeras donc jamais…
– Il y avait un chien, ça avait l’air d’être lui le plus malheureux. Bon à demain, Luna. Bonne nuit.
C’était Luna, l’une de mes collègues. Je fréquentais modérément les autres praticiens du cabinet de psychothérapie. Du reste, je me mélangeais peu aux autres. Luna était la seule qui ne laissait jamais échapper la moindre occasion de me prouver combien elle m’aimait et qu’elle était pour moi une véritable amie. « Allons, haut les cœurs ! Tu n’es pas seul au monde », disait-elle souvent. Je me rendormis, bercé par ces pensées anodines.
Très tôt le lendemain matin, je me levai avec un goût âcre dans la bouche, dans la même position que celle où je m’étais endormi. C’était comme si une chape de plomb archi lourde m’était soudain tombée sur les épaules. Comme si un train de marchandises d’une longueur infinie m’était passé dessus. J’allai péniblement dans la cuisine, j’ouvris le frigo, afin de m’assurer si mon décor quotidien était encore à sa place. Formidable, il ne manquait rien. Rassuré, je refermai le frigo et je fis bouillir l’eau pour me faire un thé. Le téléphone sonna une, deux, trois fois, puis quatre et enfin le silence retomba. Je regardai, impassible, l’objet. Encore des voix venues de l’enfer. La voix des autres. L’enfer, quoi. Mais les autres étaient-ils vraiment là ? Existaient-ils pour de bon ? Et où étaient-ils, d’abord ? Le thé n’était pas fameux. Il avait un goût rance qui s’obtient quand on laisse séjourner trop longtemps les sachets dans un placard pendant les chaleurs humides de l’été. Je l’avalai en quelques gorgées tout en regardant par la fenêtre. Je réfléchissais à la manière dont j’allais bien pouvoir occuper ces quelques jours de congé forcé avant de reprendre le travail. Et une idée me vint. Ce n’était peut-être pas la meilleure idée, mais c’était néanmoins une idée. Je passai dans la salle de bains. Devant le miroir, j’ouvris la bouche en grand en m’aidant de mon index droit. Je déplaçai ma langue sur la gauche et je remarquai que la troisième molaire inférieure à droite n’était pas aussi cariée que je croyais. Elle pourrait encore tenir quelques mois, un an si ça se trouve, donc pas besoin d’aller chez le dentiste tout de suite. Alors que je refermais la porte de la maison, il me sembla, encore une fois, entendre sonner le téléphone.
Je fis route en direction de la gare en empruntant le chemin le plus long et le moins fréquenté. Depuis le Ponte Santa Trinita, le Ponte Vecchio au loin m’apparut plus beau qu’à l’ordinaire. La journée était chaude, mais pas étouffante. On pouvait respirer à pleins poumons et il y avait un magnifique ciel dégagé et bleu. D’un bleu intense, comme le jour de l’enterrement de ma mère. Une superbe étrangère, tout droit sortie d’une revue de mode, marchait sur le trottoir d’en face. Elle portait un grand chapeau blanc à large bord, une jupe mi-longue à fleurs et un voile de mousseline multicolore flottait sur son pull-over en coton blanc. Son foulard recouvrait par intermittence un joli visage d’une grande sobriété, sans fioritures, presque austère. J’aurais dit qu’il s’agissait d’une Suissesse ou bien d’une d’Allemande, une Autrichienne peut-être. Elle s’arrêta un instant pour prendre une photo du fleuve, des quais de l’Arno. Ensuite, elle ouvrit son petit sac et en sortit un carnet. Je continuai à marcher vers la gare, persuadé qu’une telle apparition était d’excellent augure pour le reste de la journée. J’entendis quelqu’un m’appeler, c’était peut-être elle. Non, ce devait être l’effet de la fatigue.
Le ciel me semblait toujours plus bleu. Turquoise, cette fois. L’esquisse discrète d’un croissant de lune se dessinait dans un coin. Je me retournai et il me sembla que la splendide gravure de mode était en train d’écrire quelques mots. Le vrombissement pétaradant d’un pot d’échappement me sortit de ma rêverie.
J’arrivai à la gare, campée dans son décor immuable. Je vis par terre un paquet de Nazionali avec la mention : « Fumer détruit les spermatozoïdes et réduit la fertilité ». Je l’écrasai du pied droit et je lui donnai un coup de pied violent. Je pris ma place dans la queue pour acheter un billet. C’était ça mon idée : je devais partir sans savoir par avance où aller. Il y avait une longue file d’attente. J’avais donc tout le temps de me décider pour la destination. J’observai les personnes qui faisaient la queue dans les différentes files. Ce matin, tout le monde me sembla moche et bête. Exactement comme je me sentais. Moi aussi, je devais être moche et bête.
J’avisai un kiosque à journaux au loin et je vis un couple de touristes bedonnants, flanqués de chariots métalliques avec dessus un cabas à provisions et des ridicules valises à carreaux écossais. À première vue, le mari et la femme. J’aurais parié qu’il allait s’acheter un journal sportif et qu’elle prendrait un magazine people. J’en étais sûr. Mais les choses ne se sont pas passées comme je l’avais imaginé. Ils tournèrent les talons sans rien acheter. Bizarre, bizarre. Je me remis à détailler les personnes de la file d’à côté, sur ma droite. Il y avait là l’étudiant du sud, élégant et prétentieux, portant des lunettes aux verres fumés, apparemment fier d’avoir tout juste soutenu un examen. Il semblait poisseux, les cheveux gominés parsemés de quelques fils argentés. Juste derrière lui, il y avait une grande fille grassouillette aux cheveux roux, avec des fesses dont les bourrelets comprimés par le liseré apparent de son slip se devinaient dans un pantalon foncé. Elle avait un fort accent du nord et parlait dans son portable tout en manipulant ses longs cheveux cuivrés. Elle semblait joyeuse. Juste derrière elle, se trouvait une petite vieille traînant une valise à roulettes qui couinait. Tous ses cheveux étaient blancs avec des reflets d’une nuance bleutée. L’expression de son visage laissait présager qu’elle s’apprêtait probablement à rejoindre sa fille ou sa belle-fille. À en juger par son apparente bonne humeur, je me dis qu’elle était veuve. Ce devait être une veuve joyeuse.
Mon tour arriva. Je n’avais pas encore fait mon choix. Je déduisis que l’employé me parlait quand j’entendis une voix déformée et incompréhensible à travers la vitre du guichet. N’importe quelle destination ferait mon affaire. J’eus soudain l’envie d’une virée à la mer. Je pensai à Quercianella. J’y allais autrefois, bien des années auparavant, avec l’une de mes ex. L’endroit m’avait bien plu. C’est le seul endroit qui me vint à l’esprit. J’annonçai alors : Un aller-retour pour Quercianella. « En deuxième classe ? » « Oui, en deuxième classe, merci. » Le guichetier me regarda satisfait sous son épaisse moustache arquée. J’eus le temps de lire sur son badge qu’il s’appelait Oscar. Oscar truc chose. Je payai la somme qui s’affichait sur l’écran vert et je fis glisser les pièces rendues dans ma poche. Je me retournai en quête des horaires de départ. C’est alors que le guichetier marmonna des mots indistincts, mais il était fort possible qu’il ne s’adressait plus à moi.
Le train attendait sur le quai sept. Il devait partir à 7 heures 57 et arriverait à peu près deux heures plus tard. Je devais donc patienter trois quarts d’heure. J’achetai un journal au kiosque. Je m’assis ensuite sur un chariot à bagages, ses tubes de métal froid formaient un je-ne-sais-quoi d’insolite dans le décor. Comme un caddie de supermarché dans un lieu incongru, une œuvre post pop art, post quelque chose ; en tout cas en rapport avec l’art contemporain. Il me sembla que le journal ne renfermait que des pages vierges, mes pensées étaient ailleurs.
Un train rouge et blanc arriva sur le dernier quai. C’était un train de banlieue tout à fait ordinaire, celui qu’empruntent les voyageurs tous les jours, une navette banale. De loin, j’eus l’impression d’apercevoir Luna qui en descendait, noyée dans une marée humaine. Souvent, quand elle entendait à la radio qu’il y avait trop de circulation, ou tout bonnement si elle n’avait pas le courage de prendre sa voiture, alors Luna prenait le train. Luna, habillée en vert. Luna aux yeux clairs et au nez retroussé.
C’était bien elle. Elle marchait tête baissée en cherchant à éviter tous ceux qui se ruaient vers la sortie du quai et qui ressemblaient à des petites fourmis affolées cherchant à attraper à temps une correspondance. Bousculades à droite, à gauche et au milieu. Luna continuait de marcher tête baissée, quand un personnage imposant lui fonça dessus pour lui arracher son sac. Luna le poursuivit un petit peu en criant au voleur jusqu’à ce qu’elle chute. Je suivis de loin toute la scène. Je vis un petit groupe de policiers s’approcher d’elle. Il me sembla la voir sangloter. Ou tout du moins, c’est ce que j’imaginais maintenant.
Le train pour la mer s’ébroua avec quelques minutes de retard. Une ambiance de fête régnait dans tout le compartiment, car une petite bande d’ados chantait des airs à la mode. C’est toujours ce qui se passe dans les trains qui partent à la mer. Chacun se sent heureux et participe à la liesse. Dans le wagon, il y avait un petit chien bizarre, un croisement entre un basset et un setter, en admettant que l’on puisse trouver dans la nature un spécimen de ce genre. Cet animal n’arrêtait pas de me fixer en montrant ses crocs acérés, alors que je ne pensais qu’à Luna et à son agression. Je trouvais curieux que le réflexe d’intervenir ne m’ait pas effleuré, ou tout au moins d’aller la réconforter. Il s’agissait d’une amie ; la seule, peut-être. Elle avait dû être terrifiée. Mais ma seule préoccupation avait été de ne pas rater mon train et en effet, je ne l’avais pas raté.
Il était maintenant neuf heures moins le quart. Dorénavant, l’enthousiasme de la joyeuse troupe était retombé et le train traçait sa route. Il me sembla entendre sonner mon portable, d’une sonnerie mélodieuse qui reflétait l’humeur du jour. Je le pris dans la poche de mon blouson en jean et je vis qu’il était toujours éteint. Mon voisin de droite porta le sien à sa bouche et commença à parler : « Où tu es ? » cria-t-il.
Le train poursuivait son chemin à son rythme, sans cahotements. L’air fraîchissait de plus en plus et l’on sentait déjà quelques effluves marins. Un autre portable retentit une, deux, trois fois jusqu’à ce qu’un passager le sorte de sa poche de chemise et dise : « Comment ? Répète, je ne t’entends pas ! » Je vis un gus qui s’évertuait à pianoter sur deux téléphones portables en même temps. Et encore des bribes de paroles au loin : « Salut ! Qu’est-ce que tu fais ? » Des sonneries tous azimuts, des signaux et des ondes en pagaille. Je regardais ma voisine de gauche. Elle avait l’air d’une charmante et timide ado de seize ans. Parfum Kenzo, coquelicot estival. Je rêvais d’échanger un sourire avec elle. Je rêvais de la pousser avec rudesse dans les toilettes du train. Je rêvais de l’embrasser et de faire l’amour avec elle, debout, sans échanger un mot. Je rêvais ensuite de regagner ma place à côté d’elle. Sa mère me toiserait de haut en bas, pendant que… Pendant que nous nous serions regardés avec insistance, nous jetant des œillades complices… Je rêvais que nous ne nous serions alors plus jamais revus. Je rêvais de tant de belles choses. Son téléphone sonna et me tira de mon demi-sommeil. Quelle chierie, ces téléphones, pensai-je. Mon énervement me surprit. Quel homme serais-je devenu si ma famille avait été différente ? Cette pensée m’envahit l’espace d’un instant.
Le train arriva presque à l’heure. Le soleil était déjà haut dans le ciel, aujourd’hui sans le moindre voile de nuages. La petite troupe chantante descendit du train dans une complète anarchie. Je m’acheminai d’un pas lent vers la sortie. Pas de passage souterrain. Il fallait traverser les rails. « Attention en traversant les rails. » Un haut-parleur était là pour le rappeler, en tout cas à ceux qui pouvaient l’entendre. Le bleu du ciel contrastait avec la haute silhouette sombre des cyprès et des pins qui se dressaient tout autour de la gare. Je repensai à Luna, à la façon dont elle avait réagi à la fâcheuse affaire de ce matin. J’y réfléchissais encore en sortant de la gare de Quercianella. L’édifice était bordé d’une rue, qui d’un côté montait vers une petite colline et de l’autre descendait jusqu’aux rochers du rivage. Il n’y a pas de plages à Quercianella. Il y a seulement des galets, des rochers et d’inaccessibles cabanons hissés avec peine sur leur éperon rocheux. C’est mission quasi impossible de planter un parasol sur la plage.
Je fis la descente à pied.
La mer était peu agitée. De faibles rouleaux se brisaient sur les écueils, les souffletant avec délicatesse. J’entendais le bruit des vagues. Des embruns tonifiants, une injection de vitalité dans le corps et l’âme, que la vie citadine à la longue ternissait et ramollissait. C’est ce que tout le monde disait. L’océan et son écume triomphaient de n’importe quelle langueur. Je m’assis sur un rocher. Il s’agissait peut-être de celui sur lequel j’avais déjà fait une halte aux côtés de mon ex, il y a quelques années. Il me sembla même que l’empreinte de nos corps était encore moulée là, sur cette roche noirâtre, comme à Pompéi. J’avais l’impression de voir les marques de nos fesses et même nos jambes croisées, nos dos, l’ébauche de nos visages. Mon ex s’appelait Clara. Ou peut-être Vittoria.
Moi, je m’appelle Gustavo. « Bonjour ! » Mon prénom ne m’a jamais plu. Mais on ne choisit pas, on vous l’impose. Il correspond à la conjugaison du verbe goûter en italien, à la première personne de l’imparfait, c’est-à-dire « je goûtais ».
Il est vrai que je goûtais intensément au plaisir de ce moment à la mer.
Les vagues enchaînaient inlassablement leur va-et-vient, pulvérisant à intervalles réguliers sur mon corps et mon visage de fines particules. J’avais l’impression de mieux respirer.
J’imaginais les paroles de Luna devant la police :
– D’où est venu votre agresseur, madame ?
– L’homme est arrivé par-derrière. J’ai senti un coup comme si j’étais heurtée involontairement. Cela arrive souvent dans la cohue, je n’ai donc pas réagi à temps et ensuite…
– Ensuite ?
– Ensuite, j’ai vu un mec en jean, un gros malabar qui s’enfuyait avec mon sac. J’ai commencé à lui courir après, il y avait des gens qui poussaient des cris et moi aussi je criais. Une femme est tombée, une vieille, je crois… et patatras ! Moi aussi, j’ai atterri les quatre fers en l’air, sur le quai.
– Ce genre de vol, malheureusement, ça arrive tous les quatre matins. Si on réussit à attraper les voleurs, vous savez quoi ? Eh bien, deux jours après, ils sont relâchés, libres comme l’air. Alors, que voulez-vous qu’on fasse ? Aviez-vous beaucoup d’argent dans votre sac ? Des clés peut-être ? Des papiers ? Un portable ?
– Non, non, mon portable est toujours dans ma poche. J’y tiens beaucoup. De l’argent, j’en avais peu, juste le strict nécessaire pour la journée. Par contre, il y avait ma carte bleue, ma carte d’identité et mes clés et… ah oui, maintenant que j’y pense, il y avait aussi ma carte d’abonnement au cercle d’arts martiaux. Disons que pour celle-ci, je pourrai la refaire sans problème.
– Vous avez dit arts martiaux ?
– Oui, je m’entraîne quelquefois.
Depuis quelque temps, elle s’était mis en tête de devenir une experte en self-défense. Elle voulait contrôler ses émotions. Où pouvait bien être Luna en ce moment ? Dieu sait comment elle avait encaissé le choc. En se consacrant trop aux autres, elle risquait de se faire du mal. Elle disait parfois qu’elle aurait préféré être un homme. La vie aurait été plus facile, affirmait-elle. C’est pourquoi elle avait songé à l’autodéfense. Étonnant pourtant qu’une psychologue aussi douée ait à se défendre de ses propres émotions.
Je me sentais soudain las, probablement le contrecoup des émotions de ces derniers jours. Pourtant, cette stimulante brise marine et ce bruit régulier des vagues semblaient me requinquer en un énergique coup de fouet. Mais mes yeux se fermaient doucement. Le sommeil m’aurait conduit à ne pas douter dans un jardin fertile et luxuriant. J’en avais l’intuition.
Pourquoi n’avais-je pas porté secours à Luna ? Pourquoi ?
Je m’endormis.
Dans le lointain, la sonnerie d’un portable me tira de mes rêveries. Une voix tonna : « Je suis là, et toi, où es-tu ? » En vérité, toutes ces personnes avec leur portable me rappelaient ces poissons à la recherche d’oxygène qui se débattent dans les mailles inextricables d’un filet.
Luna revenait dans mes pensées.
– Bien madame, signez le procès-verbal, ici, après quoi, vous pourrez partir. Nous vous tiendrons au courant, Quoi qu’il en soit, ne vous inquiétez pas, nous avons déjà fait opposition sur votre carte de crédit.
– Oh merci… Où dois-je signer ?
– Ici en bas.
Luna se sentait épuisée quand elle sortit du bureau de la police. Une policière lui sourit, comme en signe de solidarité entre femmes. Luna la salua poliment, puis sortit son portable de la poche de sa veste et appela sa secrétaire.
– Marina, pouvez-vous annuler tous mes rendez-vous d’aujourd’hui, s’il vous plaît ? Oui, tous, ajouta-t-elle d’une voix blanche.
– Vous êtes sûre que tout va bien, tu as peut-être besoin de quelque chose ?
– Oui, oui, ça va, ne t’en fais pas. C’est-à-dire que… On vient juste de me voler mon sac, mais rien de grave. Je vais bien. Il y avait peu d’argent à l’intérieur et seulement quelques papiers… J’avais aussi ma carte bleue, mais on a déjà fait opposition. Ah, oui, il y avait aussi mes clés. Non, pas celles du cabinet, celles de chez moi. C’est vrai… quelle poisse, justement celles-ci. Ma voisine en a un double. Mais je devrai quand même en refaire et aussi changer la serrure, on ne sait jamais. Bon, je vais me reposer maintenant…
– Très bien, à demain !
– Bye !
Elles avaient coutume d’alterner le vouvoiement au tutoiement. La secrétaire de notre cabinet faisait ça avec tout le monde. Par moments, c’était juste Marina, d’autres fois c’était plus formel avec Madame ou Monsieur. Et nous nous adaptions toujours à son rôle du moment. Elle adorait changer d’attitude. Un coup nous étions Tu, une autre fois Vous. Mais ça nous allait.
Luna ne prit pas la direction des quais, mais regarda sa montre. Elle était plongée dans une profonde perplexité, comme au moment d’un choix capital et se dirigea pour finir vers le centre-ville. Il était neuf heures et quart. L’heure de déguster un bon café. Elle se retrouva soudain place de la République, étourdie par le flot de ses pensées. Désormais Luna se repassait constamment le film des événements. Elle voyait le violent arrachage de sac, puis la tentative de poursuite du voleur, sa chute, les policiers, la confusion, le procès-verbal, le coup de téléphone à Marina. Et de nouveau la confusion.
Luna entra au café Giubbe Rosse. Elle commanda un déca à la caisse. Elle esquissa un sourire avant de boire à lentes gorgées. Ensuite, elle passa sa langue sur ses lèvres maculées de mousse, prit un Kleenex, s’essuya soigneusement, salua le serveur et sortit, les mains enfoncées dans les poches de sa veste. Elle se rendit compte qu’elle avait aussi perdu son porte-monnaie, mais il lui restait quelque chose dans la poche droite. Elle sentit la forme d’une carte plastifiée, qui n’était pourtant pas sa carte de crédit. Pour ça non, celle-ci s’était envolée avec son sac. C’était la carte du Cyber Espace où elle allait de temps en temps, quand elle avait un peu de temps libre. Elle avança d’un pas mécanique, rue Calimala, Fontana del Porcellino jusqu’à la rue Condotta.
Luna entra au cybercafé de la rue Pandolfini, non loin du Bargello. Elle s’assit à sa place favorite, sous une petite lucarne face au dernier ordinateur. Elle inséra sa carte, il lui restait plus d’une heure de connexion. Avant de taper son code personnel et son mot de passe, elle songea à appeler Gustavo. Elle éprouvait une grande envie de lui raconter en détail sa mésaventure. Et peut-être même lui remonter le moral en riant sur ses propres misères. Elle essaya plusieurs fois. Pas de réponse. Elle sonna aussi chez lui. Toujours rien. Il semblait évident que Gustavo voulait rester seul.
Luna inséra son pseudo et son mot de passe pour se connecter à Internet. À peine entrée dans sa boîte de courriers, elle supprima tous les spams qui s’agglutinaient. De pures inepties venues polluer ses messages. Pas de nouveautés. Luna se connecta ensuite au site web de La Repubblica. Elle voulait lire les nouvelles du jour. Elle sauta d’une image à l’autre, d’un reportage à l’autre en pensant à Gustavo.
Elle aperçut, par la fenêtre de la salle, deux églises jumelles de style baroque qui trônaient l’une à côté de l’autre. Séparées par un léger espace, elles présentaient toutes deux la même couleur orange effrayante, bien que la tonalité de celle de droite était sensiblement plus soutenue. Un prêtre se promenait d’un porche à l’autre. Vêtu d’un strict habit ecclésiastique, il marmonnait des propos obscurs. Deux palmiers trônaient devant chaque édifice, ce qui faisait un total de quatre arbres. À y regarder de plus près, quelques signes distinctifs singularisaient les deux monuments, comme des jumeaux dizygotes issus d’œufs différents. La jumelle nord et la jumelle sud, en quelque sorte. Des églises sœurs qui indéniablement se ressemblaient beaucoup, mais dont les divergences de caractère ne pouvaient pas échapper à un regard aiguisé. L’inscription AfterEight brillait de mille feux au-dessus de l’église nord.
Un bracelet en métal rouge foncé serrait le poignet droit du prêtre. Il s’agissait d’une montre agrémentée de deux gardes suisses minuscules ; armés chacun d’une aiguille, ils dansaient un Rock Around the Clock endiablé pour ensuite faire bip-bip. Les gardes pontificaux s’immobilisèrent et lancèrent les aiguilles comme un javelot. Huit heures vingt sonnèrent. Le prêtre reprenait son incessant mouvement de bascule en émettant un bruit de coucou mécanique déréglé. L’avancée du crépuscule accentuait la teinte orangée des deux églises, qui à présent viraient carrément au rouge. Le prêtre continuait à proférer ses curieux versets tout en levant au ciel un exemplaire du Times. Luna vit qu’une église avait son clocher proche d’elle, tandis que l’autre était jouxtée d’une tour surmontée d’une immense horloge en fer. Mais Luna ne pouvait y distinguer l’heure. Elle entendit seulement que le mécanisme égrenait la mélodie de Big Ben, au moment où les cloches reprenaient Ding Dang Dong. Au-dessus de la tour de l’horloge, des merles exhibaient de curieuses queues d’hirondelle, en forme de créneaux au sommet d’un beffroi.
La nuit tomba brusquement. Luna ramassa les petites lunettes qui traînaient sur la table. Elle les chaussa. Leurs verres étaient filtrants, car elle ne discerna plus les deux églises orange. À leur place, elle aperçut deux tours, nimbées d’une lumière irréelle, d’un glaçant vert fantomatique. Plus personne ne s’attardait dans ces décombres funestes, hormis quelques corbeaux au plumage verdâtre. Le prêtre était à présent enveloppé dans une longue soutane sombre couverte de boutons nacrés. Il pendouillait à l’une des nombreuses pointes en acier. La tête à l’envers. Son étrange montre s’était arrêtée pour toujours, à jamais figée dans un éternel présent. Luna remarqua sa grosse figure livide, bouffie. Il avait les yeux exorbités et tirait la langue. Tout devenait clair. Elle pensa : « Il est encore en vie ! » Luna frissonna. Au même instant, un croissant de lune olivâtre s’éleva dans le ciel de Manhattan.
On aurait dit un ciel de Magritte.
2
Luna se réveilla avec la bouche pâteuse et les cils collés. Elle eut la sensation d’avoir fait l’un de ces rêves qui vous marque pour la vie. Le genre de rêve dont le souvenir grandit avec le temps, s’intensifie, évolue, au point de se déformer parfois, mais qui laisse, malgré tout, son empreinte à tout jamais. Elle pensa à moi, Gustavo, comme à ce prêtre maudit. Elle se sentit tout à coup libérée de tout repère temporel. Comme si le temps fuyait sur son écran d’ordinateur, et qu’en spectatrice, elle le voyait défiler inexorablement. Luna eut l’impression d’être arrivée cinq ou dix ans plus tard. Elle réfléchit encore à moi et commença à écrire.
Soudain, j’eus faim. Je pris conscience que le temps où je pouvais me vautrer dans une serviette de bain poissée de crèmes solaires était révolu. Qu’était devenue la saison pendant laquelle je respirais toutes ces odeurs ? Mais à quoi bon se retourner sur son passé ? Je m’étais lassé de scruter la mer, parce qu’à force, un horizon infini et des rêves de bonheur, ça suffit. Il était donc l’heure de se lever. J’eus envie de m’étirer un peu pour entendre bêtement craquer mes articulations. Je mis ensuite les mains sur mes hanches pour vérifier si mon maillot de bain était toujours bien en place. Puis, je feignis de regarder l’horizon. Je fis mine de m’apprêter à faire trempette. Bref, je fis semblant de tout. Et, au bout du compte, je finis par me gratter en toute discrétion.
Je secouai ma serviette blanche imprimée en son centre d’un aigle noir aux ailes déployées. Je la remuai énergiquement sans façon ni cérémonie. Soudain, j'aperçus un papillon blanc déboussolé, désorienté peut-être par un paysage si déroutant. Il traça dans le ciel quelques ellipses maladroites avant de se poser sur mon pied droit. Il me sembla qu’il restât là une éternité. Je restai de marbre, n’osant pas bouger. Une image d’enfant me revint clairement. Une image triste. L’enfant attrapait les papillons avec un filet. Il capturait surtout les plus groggy ; ceux que la lumière du soleil semblait gêner le plus. Il les mettait ensuite dans une boîte en fer percée de petits trous, qui leur permettaient tout juste de respirer. Il les maintenait prisonniers à l’intérieur. Après quelques jours, il rouvrait la boîte pour tenter de les faire voler avec leurs ailes tout abîmées. Il voulait les voir s’envoler vers un ciel qui ne les attendait plus. L’enfant triste éclatait en sanglots parce que ces fleurs ailées tombaient par terre et ne pouvaient plus s’envoler. Il essayait, malgré tout, de les faire voler en rafistolant leurs pétales effilochés. Les fleurs devaient voler. Dans le monde de l’enfant triste, les fleurs devaient obligatoirement voler. Et par dépit, il finissait par les pulvériser. Il organisait ensuite une cérémonie funèbre en bonne et due forme pour ces fleurs mortes. Mais à présent, tout avait changé, j’étais quelqu’un d’autre, j’étais un homme. Aujourd’hui, j’étais du genre à demander pardon aux bactéries avant d’avaler un antibiotique. C’est sûr que j’aurais évité de bouger la moindre parcelle de mon corps pour ne pas influer sur le destin de ce papillon blanc. Oui, aujourd’hui, j’étais une autre personne. J’aurais agi avec patience. Le papillon était tétanisé, tout comme moi. Mais à la fin, il se retira vivement et s’envola en décrivant de ses ailes une courbe. Un peu comme s’il dessinait la parabole de ma propre existence : abrupte et sans passion.
Je rejoignis la ruelle qui longeait les rochers. Quelques promeneurs s’attardaient. Ils bavardaient, fumaient, s’observaient. Après le bain, les mamans enveloppaient leurs enfants dans d’immenses draps de plage en éponge aux couleurs vives et gaies, desquels émergeaient des mèches de cheveux hirsutes comme des piquants de hérisson. Des enfants frigorifiés, transis, qui sous peu allaient réclamer à grands cris l’en-cas de dix heures, arrosé d’un jus d’orange, d’un Coca ou d’un Chinotto. Dieu sait si on boit encore du Chinotto de nos jours. Je regardai en l’air. Le soleil était encore haut. C’était vraiment une belle journée de fin d’été. Je retirai mes Lozza noires et je fixai le soleil à la manière d’un aigle en essayant d’en mémoriser tous les détails, d’en capter la lumière, la vie, d’en saisir même le rythme silencieux. Il était auréolé d’une lumière irrégulière verdâtre. Non, ses rayons n’avaient rien à voir avec les coups de crayons longs et courts que les maîtresses d’école nous faisaient dessiner autour. Son halo se courbait jusqu’à se déformer. Sa couronne verdâtre changeait progressivement de couleur pour devenir d’un bleu céruléen et brillait de nouveau d’un jaune intense. Le soleil, le vrai, ressemblait à une image de ce genre. Son intensité dorée se déclinait en nuances bleu clair et orangées. Il changeait constamment de couleur. Oui, c’est ça, il change bien de couleur. Il prend toutes les couleurs de l’arc-en-ciel. On devrait sans cesse le redessiner, l’actualiser pour ainsi dire. Je fermai les yeux en comptant jusqu’à cent, son image persistait sur ma rétine. Puis je les rouvris peu à peu. Sa beauté m’aveugla. J’entendis un brusque coup de frein. Je vis une guirlande de lumières multicolores. Malgré tout, j’aperçus une voiture rouge plantée au beau milieu de la route et un enfant s’éloignant en courant.
– Petit con ! Tu ne peux pas regarder avant de traverser ? On ne te l’a jamais dit qu’il faut faire attention aux voitures ? Mais qu’est-ce qu’ils vous apprennent en classe ? s’écria l’homme au volant.
Le garçonnet se retourna un instant. Puis il continua sa course sans rien dire. Quand il vit que l’auto était repartie, il revint sur ses pas. Il se baissa pour ramasser le cahier qui lui avait échappé des mains. Intrigué, je m’approchai de lui.
– Sacrée frousse, hein ? dis-je.
– C’est lui qui ne m’a pas vu, dit l’enfant. Ses lèvres en tremblaient encore.
– D’accord, mais fais quand même gaffe. Il faut bien regarder partout, fis-je. Comment tu t’appelles ?
– Leonardo. Leonardo Lari. J’ai huit ans et demi.
– Leonardo, c’est un beau prénom. Tu es seul ?
– Oui. Je rentre à la maison. Papa et maman sortent toujours plus tard pour aller à la mer. Je préfère y aller en ce moment parce que je n’aime pas rester à la maison. Alors, je pars faire un petit tour tout seul.
– Et qu’est-ce que tu fais de beau avec ce cahier ? Tu écris des poèmes ?
– Des poèmes ?
– Oui, des poèmes.
– Comme les poésies qu’on apprend à l’école ?
– C’est ça. Tu pourrais en écrire ?
– Mais ce n’est pas pour les enfants, c’est pour les grandes personnes.
– C’est vrai, c’est pour les grands. Mais il faut un cœur d’enfant pour les écrire. Tu en penses quoi ?
– Je ne sais pas.
– Mais tu pourrais essayer.
– Comment on fait ça ?
– Ma foi, je n’en sais pas plus que toi, je ne suis pas poète. Alors qu’est-ce ce que tu écris dans ton cahier ?
– J’inscris les numéros des plaques.
– Quelles plaques ?
– Les plaques des voitures. Il me regarde avec des yeux un peu étonnés et pleins de malice.
– Toutes les plaques que tu vois ? Le sujet avait éveillé ma curiosité.
– Non, seulement les plus belles. Tiens regarde ce que j’ai écrit ce matin. C’est la dernière que j’ai notée. R-A-1-3-8-9-6-1.
– Très jolie cette plaque. C’est intéressant, harmonieux, joyeux et raffiné. Mais c’est une vieille plaque, Leonardo. On n’en fait plus aujourd’hui. Maintenant, il y a les plaques européennes.
– Oui, je sais que c’est une vieille plaque. Mais celle-ci, je ne l’avais encore jamais vue.
– C’est une voiture de la province de Ravenne. Tu sais où c’est Ravenne ?
– Non, où c’est ? En Italie ?
– Oui, c’est en Italie, sur l’Adriatique. L’Adriatique, c’est la mer qui se trouve de l’autre côté de là où nous sommes. À Ravenne, on peut trouver la tombe d’un grand poète.
– C’est vrai ?
– Oui.
– Et qui c’était ?
– Un génie. Un poète ronchon et solitaire qui a été chassé de Florence, il y a bien longtemps…
– Moi aussi je viens de Florence, tu sais ? Tu es supporter de la Fiorentina ? Moi, je le suis… Allez, allez Viooola… Vi-o-la-Vi-o-la-Vi-o-la… s’exalta Leonardo. Les plaques sont des poèmes ? Regarde, regarde, j’en ai une autre, elle est belle, non ?
– Oui, elle est très belle.
Il était écrit : 137ASS69 sur son cahier orange à fleurs. Ça m’avait l’air d’une plaque étrangère. Mais une plaque d’une grande poésie. Vraiment.
– Leonardooo, Leonardoooo.
Quelqu’un criait.
– J’arrive maman ! répondit Leonardo de sa petite voix aiguë.
C’était le petit prince, poète des plaques d’immatriculation.
– Au revoir, monsieur, ajouta-t-il avec un petit sourire.
– Eh ! Leonardo, regarde là-bas. Tu vois, derrière, la 124 ?
– La 124 ?
– Oui, celle-là, la Fiat 124. Regarde derrière, il y a une autre vieille voiture, une Alfa Romeo Giulietta, tu la vois ?
– MI TO… oh là là… Mais, c’est comme si c’étaient deux plaques, deux villes. Milan et Turin, c’est bien ça ?
– Pas exactement, c’est Milan T Zéro. C’est une belle plaque, hein ?
– Leonardooooooo.
– Ouiiii, j’arrive maman !
– Leonardo. Je compte sur toi, n’arrête jamais de rechercher les plus belles plaques d’immatriculation. Mais fais bien attention aux voitures, elles déboulent sans crier gare. Au fait, moi c’est Gustavo.
– Ciao, ciao, monsieur Gustavo, me dit-il en saisissant avec fierté le bic rouge dans sa main gauche, comme s’il s’agissait de l’épée d’un chevalier. Leonardo cherchait la plaque parfaite, à la manière du Saint Graal. C’était un vrai poète de la rue. Le prince des plaques, de la trempe de ceux qui écrivent avec leur sang.
J’achetai un sandwich thon mayonnaise dans la première échoppe que je vis. Je le mangeai, assis à l’ombre d’un pin en regardant le golfe. Il n’était pas mauvais ce sandwich. Je retournai au comptoir pour demander un café. Suite à quoi, une idée germa dans mon esprit. Je pensai à Internet. Le point Internet le plus proche se trouvait à environ trois cents mètres. J’y étais déjà allé de nombreuses fois. Ce n’était pas bien compliqué de remonter la petite côte, bordée des cabines de plage qui n’avaient pas trouvé leur place sur les rochers. Donc remonter, puis tourner à droite, passer entre les coquets pavillons fleuris, et finalement arriver à la bonne rue. Peu après, j’entrai par une banale porte vitrée laissée entrouverte. Il y avait écrit dessus : « Cyber Espace de Quercianella ». On pouvait remarquer que le dernier quart de l’enseigne avait volontairement été gratté. On peinait à lire Quercia. Nella était carrément effacé. J’achetai une carte de connexion d’une heure à une fille en minijupe noire qui me souriait. Elle avait le type méridional d’une vraie fille du sud au tempérament chaleureux. C’est à ce moment que j’entendis au loin le bruit sec d’un autre coup de frein, suivi par la détonation d’un pot d’échappement percé provenant d’une auto qui redémarrait en trombe. Je crus entendre la voix du chauffard de Leonardo. Je cherchai un ordinateur libre. Autant que possible près d’une fille intéressante. Comme à mon habitude. Je m’assis à la seule place laissée vacante. L’ordinateur se trouvait dans le fond contre une vitre sur laquelle la mer se reflétait. À côté de moi, il y avait une fille bien en chair portant une polaire à carreaux roses et marron. En m’asseyant je pensai : « Écran, mon bel écran, dis-moi qui est le plus beau du monde ? » Juste comme ça, histoire de penser à quelque chose. Ça m’arrivait de temps à autre de me dire ce genre d’imbécillités. J’entrai la carte pour me plonger dans l’enfer d’Internet et je commençai à naviguer à bâbord, ne lâchant jamais des yeux le véritable océan, qui lui se trouvait à tribord. Je tapai mon mot de passe. J’entrai dans ma boîte pour découvrir « Tu as gagné ma photo ! Embrasse-moi. » J’effaçai tout. Ô Seigneur, délivrez-nous du Mail, amen.
Je vis sur un courriel l’adresse [email protected]. Je cliquai sur le lien. Sujet : tu es là ? Oui, bien sûr que je suis là. Punaise. Mon ordinateur venait de planter et j’avais brutalement été déconnecté. J’essayai de revenir. Le mail de Luna réapparut sur l’écran. Mais oui, je suis toujours là. Je cliquai dessus et commençai à lire en bâillant.
Mon très cher Gustavo,
J’empoigne ma timidité à bras-le-corps… Comment peux-tu continuer à ne pas comprendre ? Je n’ai jamais voulu contrarier ta personnalité et ton besoin de solitude, mais comment peux-tu continuer à ignorer ce qui se passe ? Depuis un bout de temps déjà, ce que tu considères comme notre amitié est devenue pour moi une douce obsession. L’obsession de te voir tous les matins au travail. La douce obsession de te regarder dans les yeux ; ces yeux souvent mi-clos, comme s’ils voulaient filtrer la lumière de la vie. J’aime te regarder pour essayer de savoir si tu as bien dormi, si tu es fatigué, si, par hasard, tu as envie de me parler, de jouer un peu avec moi, peut-être même de te promener main dans la main dans le parc comme deux adolescents amoureux… Combien d’autres choses j’aimerais encore te dire, ô mon doux Gustavo. Il y a tant de choses que je n’arrive pas à formuler, alors que de chaudes larmes glissent sur mes joues à l’idée de penser à toi. À la pensée de savoir si tu as beaucoup souffert de la mort de tes chers parents parce que, j’en suis sûre, tu dois avoir beaucoup souffert. Mais tu ne l’avoueras jamais parce que tu es ainsi fait. Non par fierté, mais en raison d’une forme d’indifférence aux choses qui te caractérise depuis toujours. Cette curieuse indifférence qui, pourtant, me fait te percevoir comme la plus douce des créatures, tel un poussin ébouriffé, apeuré après un plongeon dans l’eau et qui a besoin d’amour et de protection…
On aurait dit une missive d’une autre époque. Quelle romantique, cette Luna. Mes messages, eux, ne dépassaient jamais trois lignes. Je n’avais vraiment aucune envie de lire sa très longue déclaration. Je ne voulais carrément pas lire parce qu’elle disait toujours la même chose. J’avais envie de ne penser à rien. Je bâillai de nouveau. J’ouvris le navigateur. En voyant toutes ces publicités sur la Toile, je me dis que j’avais encore envie de vacances à la mer, une envie inassouvie d’océan ; une envie de vagues puissantes de nature à exalter les tourments de mon âme. Quelques années plus tôt, un collègue belge m’avait parlé de thalassothérapie à Saint-Malo. Harald y était allé à l’occasion d’un congrès sur Sighele. Je me souvenais de l’adresse. Voyons un peu. Oui, c’est bien ça. Il me fallut peu de temps pour trouver le site des thermes de Saint-Malo, en France. Je me rappelais les aventures fantastiques des corsaires, liées pour toujours à l’histoire de la cité malouine, une ville fortifiée aux mille anecdotes. Je voyais sur la vidéo les mouvements de la mer sur la grande plage du Sillon, devant le Grand Hôtel de l’Atlantique. J’avais l’impression de la toucher, de l’entendre tonner, cette mer violente et bouillonnante. Sur la digue, on distinguait quelques flâneurs et des accros du footing. À chacun son rythme. C’était un lieu exceptionnel. Aucune route ne semblait s’interposer entre les thermes et la mer. Le long de la digue, blotties les unes contre les autres, des constructions s’élevaient très haut vers le ciel, comme pour se protéger des charges de l’océan.
Pour remonter aux origines de la merveilleuse histoire du Grand Hôtel de l’Atlantique, on devait obligatoirement interroger la mer, unique témoin des temps passés. L’Hôtel était né de l’océan, lequel regardait sa progéniture depuis plus de cent vingt ans. C’est ce qu’il y avait écrit sur le descriptif. Et, comme les amoureux qui se jurent un amour éternel, l’établissement mythique et la mer échangeaient encore d’intenses serments, toujours renoués. Ils renouvelaient leurs vœux au rythme du flux et du reflux, du sac et du ressac. C’était l’endroit que je cherchais : il m’appelait. Les prix étaient déjà convertis en euros. C’était cher, certes. Mais tout bien considéré, je méritais ces vacances de rêve dans un tel lieu. Tout de suite, ou bien dans un an. Mais quoi qu’il en soit, je méritais de passer des vacances là, tôt ou tard. Harald était revenu enchanté de son séjour. Je les contactai. Une bafouille très brève dans un français scolaire dépouillé. Je voulais en savoir plus.
Le message de Luna s’affichait toujours en entier. Je le déplaçai vers le bas de l’écran. Luna avait encore écrit :
Mon Dieu, comme j’aimerais que tu me demandes de faire quelque chose avec moi. Que sais-je ? Un voyage, par exemple… Ce que j’aimerais être près de toi et soulager ta solitude, ta tristesse. Je voudrais tant me sentir exister à travers tous tes désirs… Mais je ne veux pas jouer au fantassin de l’Armée du Salut, d’autant que ce comportement d’adolescente pourrait paraître un peu ridicule, s’agissant de nous. Quand on sait que nous exerçons tous les deux une profession “sérieuse”. On devrait non seulement avoir les nerfs solides dans notre métier, mais surtout un cœur à toute épreuve pour pouvoir venir en aide à ceux qui nous appellent au secours. Un transfert entre nous, ça aurait l’air de quoi ? Un transfert qui prendrait les traits d’une histoire d’amour semble vraiment le comble.





























