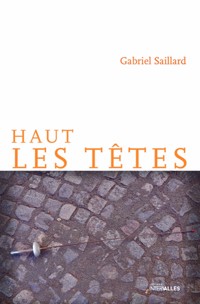
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Intervalles
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Paul est avocat dans un grand cabinet parisien. Féru d’histoire, il s’est lancé dans l’écriture d’un livre sur Georges Clemenceau et Winston Churchill. Pendant ce temps, à l’Assemblée nationale, l’avancement posthume d’Alfred Dreyfus au grade de général de division fait bondir les extrêmes de tous bords et embrase le débat public. Et si le projet littéraire de Paul s’avérait plus délicat que prévu ? Haut les têtes est un roman mordant et enlevé sur la liberté d’expression à l’heure de l’affaissement culturel. Dans une époque minée par les dérives identitaires et les ravages du conformisme, le personnage de Paul, bercé par un imaginaire fait de Krak des chevaliers et de cadets de Gascogne, nous plonge dans la folie d’un monde où même les hussards les plus hardis peinent à garder la tête haute. Gabriel Saillard est né à Paris en 1985. Haut les têtes est son premier roman.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Gabriel Saillard est né à Paris en 1985. Après des études de droit, il part travailler à New Delhi puis devient avocat. Il exerce en contentieux avant de quitter le barreau de Paris en 2021. Haut les têtes est son premier roman.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 312
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Page de titre
À mes enfants
Et vous vous en alliez ainsi, ô saintes loques glorieuses, déployant vos déchirures, balayant le pavé tristement comme des oiseaux aux ailes cassées ! Vous vous en alliez avec la honte des belles choses souillées, et chacune de vous emportait un peu de la France.
Alphonse Daudet, Le porte-drapeau, 1872
Haut les têtes, la mitraille n’est pas de la merde !
Colonel Lepic aux grenadiers à cheval de la Garde, bataille d’Eylau, 8 février 1807
I
C’était en octobre 2005, dans un amphi de droit administratif des biens. En ce temps-là on savait écrire, avait coutume de nous dire le professeur Delvolvé en citant la grande ordonnance de la marine de 1681, moment de grâce où Colbert convoqua le grand flot de mars afin de délimiter le bord et le rivage de la mer. Et Delvolvé de se lancer dans une longue diatribe contre la médiocrité abyssale de nos législateurs contemporains. Il n’avait sans doute pas tort, je n’en savais rien, je crois même que je m’en foutais. J’avais vingt ans. La seule chose susceptible de m’intéresser eût été de connaître le nom de cette fille assise à quelques rangées de moi, les cheveux négligemment attachés en chignon, emmitouflée dans un col roulé crème ; l’université Panthéon-Assas était considérée comme la plus émérite concentration de petites minettes de Paris. Ce jour-là, je n’avais presque rien écouté ; j’avais apporté un vieux livre déniché par hasard à la maison. Au milieu de mes condisciples qui noircissaient fébrilement leurs feuilles A4, plongé dans ma lecture, j’avais découvert l’Histoire. Si je l’avais déjà étudiée au collège et au lycée, cette matière était restée inerte pour moi, je n’en avais pas saisi la substance. J’étais resté à mille lieues de comprendre les raisons pour lesquelles nous étions rassemblés en différents pays, sous autant de drapeaux, si prompts à nous entretuer, et pourquoi le siècle où nous vivions alors avait succédé de la sorte au précédent.
Deux ans plus tôt, à l’université Panthéon-Assas, la découverte du discours de la Flagellation devant le Parlement de Paris avait constitué un premier jalon. D’un naturel pourtant flegmatique et réservé, notre professeur d’histoire du droit avait été à deux doigts de se dénuder complètement, délaissant veste, chemise et cravate afin de déclamer face à ses étudiants, le corps moulé dans un t-shirt noir de videur de boîte de nuit, la proclamation revue et corrigée par Louis XV en personne :
Entreprendre d’ériger en principe des nouveautés si pernicieuses, c’est faire injure à la magistrature, démentir son institution, trahir ses intérêts et méconnaître les véritables lois fondamentales de l’État ; comme s’il était permis d’oublier que c’est en ma personne seule que réside la puissance souveraine, dont le caractère propre est l’esprit de conseil, de justice et de raison.
L’excellent homme voulait que nous nous souvenions de ce rappel royal des principes de la monarchie française face à la fronde parlementaire, cette affirmation du pouvoir absolu vingt-trois ans avant la Révolution. Il y réussit ; son strip-tease digne d’un John Keating debout sur le bureau de sa salle de classe ancra les mots discours de la Flagellation dans ma mémoire. Mais cela n’alla pas plus loin. Ces mots vinrent s’ajouter à quelques autres, aux principes généraux et aux adages que l’on apprend en première année de droit ; rien de plus. Ma véritable découverte de l’Histoire n’intervint que deux ans plus tard lorsque, un matin, je tombai sur un vieux livre négligemment rangé dans la bibliothèque du salon de mes parents ; une couverture souple, jaune pâle, où se détachaient quelques mots : Jacques Bainville – Histoire de France – Paris Arthème Fayard & Cie, éditeurs – 18-20, Rue du Saint-Gothard. Intrigué tant par le titre que par l’épaisseur raisonnable du volume, je saisis le bouquin et partis à la fac.
II
Le professeur Delvolvé avait commencé son cours. Dans l’amphi 2000 de l’université Panthéon-Assas, debout sur l’estrade face à ses étudiants, la tête inclinée sur le côté, tenant le micro à deux mains, il ressemblait à Johnny Hallyday. Déclamer les conclusions du commissaire du gouvernement avec une allure de rocker, tenir en haleine une audience de plus de mille personnes en citant le GAJA, les grands arrêts de la jurisprudence administrative, voilà un homme fait pour la profession qu’il avait choisie. Était-il question de l’ordonnance de Colbert et de la marine de Louis XIV ? Impossible de m’en souvenir. De marchés publics ? Je n’aimais pas les arcanes de la procédure de passation des marchés publics ; cela m’ennuyait profondément et je n’y comprenais rien. S’il avait été question de marchés publics, je me serais mis en quête d’une âme charitable qui eût accepté de me passer ses cours ; pourquoi pas la fille au col roulé crème ? C’eût été un bon prétexte pour aller lui parler, voire pour lui taper son 06. En attendant, je m’installai au dernier rang de cet amphithéâtre lugubre, mal chauffé et non rénové depuis les années 1960. J’ouvris le livre que j’avais chipé à la maison : un monde apparut. Au cours de ces cinq cents et quelques pages prodigieuses, stupéfiantes d’érudition, Bainville rappelle d’emblée que le peuple français est un composé : « c’est mieux qu’une race, c’est une nation ». Décrivant la France comme une « œuvre de l’intelligence et de la volonté », l’auteur n’a de cesse de rappeler qu’elle peut être envahie à tout moment. Bainville était un spécialiste des affaires internationales, un maître dont les articles de L’Action française étaient lus avec attention jusque dans les rangs de la gauche.
Un pigeon vola à basse altitude au-dessus des premiers rangs ; cet amphi était trop grand, même les volatiles parisiens parvenaient à s’y frayer un chemin. Je devais découvrir au fil des pages que le livre de Bainville n’avait jamais eu vocation, de son propre aveu, à être une œuvre d’historien ; c’était un ouvrage de seconde main, une entreprise de vulgarisation comme on dirait aujourd’hui. Si la notion de vulgarisation reçut un jour ses lettres de noblesse, ce fut sans doute à cette époque. À elle seule, l’évocation de la fameuse anecdote du vase de Soissons donne une idée de la plume de l’auteur, qui, évoquant l’exécution sommaire par Clovis d’un soldat sacrilège, estime que l’« on reconnaît le grand homme d’État à ces audaces qui créent des images immortelles. »
– Qu’est-ce que tu fais, me demanda mon voisin, tu t’es cru à la maison ?
– Je m’emmerde, et toi ?
– Pareil, je joue au serpent.
– 3310 ?
– Ouais. Incroyable la différence avec le 3210.
J’enfonçai le nez dans mon écharpe pour tenter de disparaître. Le fait qu’un intrus s’immisçât dans ma vie à cet instant, de surcroît un joueur de serpent visiblement attardé, me dérangeait et me dégoûtait presque. Mon univers avait vu le jour quelques minutes auparavant ; il était envahi. Si j’avais eu des écouteurs comme la grande majorité de mes condisciples, sympathiques zombies qui vivaient quotidiennement avec ces petits objets dans les oreilles, j’eusse pu fermer les écoutilles, mais je n’en avais pas. J’allais me replonger dans ma lecture lorsqu’une envolée lyrico-administrative du professeur Delvolvé me fit sursauter.
– Et le Conseil d’État d’écrire en toutes lettres, dans son arrêt Prince Napoléon du 19 février 1875, que, dans ces conditions, le prince Napoléon-Joseph Bonaparte n’est pas fondé à se plaindre de ce que son nom a cessé d’être porté sur la liste de l’état-major général de l’armée… Sa requête est rejetée, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la décision est transmise au ministre de la Guerre ! C’est l’abandon de la théorie du mobile politique !
Mon voisin esquissa un geste rageur et leva vers le plafond de l’amphi un regard désespéré ; son serpent avait probablement percuté une des parois pixelisées de sa cage. Les lointaines désillusions d’un prince Napoléon semblaient ne l’émouvoir que très modérément.
*
La science politique portée à son plus haut niveau, un art consommé de la synthèse et le style admirable de Bainville interpellèrent l’étudiant que j’étais ; non que son livre suscitât une vocation particulière ou une envie soudaine d’abandonner mes études de droit, mais parce qu’il fit naître un besoin insatiable d’en apprendre toujours plus. Il fut la première pierre d’un édifice que je ne devais pas cesser de bâtir durant les semaines, les mois et les années qui suivirent, sorte de cathédrale de papier dont j’avalais les milliers de pages de façon compulsive et désordonnée. Ces semaines, ces mois, ces années filèrent à la vitesse de la lumière. Progressivement, les Nokia 3210 et 3310 disparurent du paysage, tout comme les téléphones fixes ; ils cédèrent la place à des smartphones. Personne ne jouait plus au serpent. Les connexions Internet à haut débit se multiplièrent, les réseaux sociaux firent leur apparition. L’université Panthéon-Assas fut quant à elle rénovée de fond en comble. À quoi pouvait bien ressembler l’amphi 2000 de nos jours ? Je n’en avais aucune idée, je n’étais jamais revenu en ces lieux. Après quelques pérégrinations exotiques, dont deux ans passés au Pakistan afin de me persuader que l’aventure existait toujours à notre époque, je m’inscrivis au barreau de Paris dont j’avais contre toute attente réussi l’examen d’entrée. Mon destin semblait tracé. Je postulai dans quelques cabinets internationaux aux noms ronflants et fus accepté dans l’un d’entre eux. Mon sort était scellé. Wicket & Fairway LLP, tel était le nom du cabinet où j’atterris. Fondé à la City de Londres au milieu du XIXe siècle, il était difficile de faire plus chic sur la place de Paris. Sans le moindre enthousiasme, je commençai à exercer en tant qu’avocat, profession si noble et admirable lorsqu’on en a la vocation, si triste et ennuyeuse lorsqu’on s’est trompé de voie. Rapidement, j’eus dix ans de barreau ; dix ans de barre, comme on disait dans le jargon.
III
Mercredi matin, neuf heures. Grand-messe de la réunion d’équipe chez Wicket & Fairway. Quarante avocats assis autour d’une table aux dimensions soviétiques : une vingtaine de cravates, presque autant de robes et de tailleurs sombres, les sourires de façade, les blagues de circonstance, les traits tirés, les cernes, les teints cireux des semaines à rallonge, l’étrange fierté d’être surchargé de travail et de n’avoir le temps de rien faire d’autre, la conscience aiguë de se trouver dans le saint des saints, dans un temple du contentieux des affaires ; tant de fragiles paravents dressés pour dissimuler la vie personnelle sacrifiée, les vexations quotidiennes, les aspirations enfouies, les rêves brisés. Café, jus d’orange pressé, croissants, pains au chocolat ; un des intérêts majeurs de ce type de structure anglo-saxonne résidait dans ce petit-déjeuner cinq étoiles servi une ou deux fois par mois. J’avais également quelques heures de sommeil en retard, mais pas pour les mêmes raisons que les jeunes loups qui m’entouraient : la veille, à la lueur de ma lampe de bureau Ikea, j’avais planché sur mon chapitre 10 jusqu’à deux heures du matin.
Une jeune recrue du cabinet – un collab’ junior de vingt-six ou vingt-sept ans, fraîchement diplômé, tiré à quatre épingles, non encore essoré par la vie professionnelle dans laquelle il s’était engagé avec enthousiasme – se leva de son fauteuil afin de nous parler de l’adoption récente par le Parlement européen de la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. Peu assuré dans les premières secondes, les mains tremblantes, il maîtrisa rapidement son stress et parvint à poser sa voix. Il avait du mérite, il avait bossé ; il se lançait la fleur au fusil à l’assaut de cette quarantaine d’egos surdimensionnés quoiqu’encore somnolents. Ce qu’il racontait m’intéressait toutefois peu ; je décrochai au bout de trois ou quatre minutes. Je fixai ses slides avec un regard vide. Je pensais à mon chapitre 10, cet inextricable chapitre 10 sur lequel je m’arrachais les cheveux depuis des semaines.
Trois années auparavant, ne trouvant plus aucun sens à ce métier que je vouais chaque jour davantage aux gémonies, je m’étais lancé dans l’écriture d’un livre, un roman mettant en scène deux personnages qui m’accompagnaient depuis longtemps, depuis ces années étudiantes où Jacques Bainville m’avait ouvert toutes grandes les portes de l’Histoire : il s’agissait de Georges Clemenceau et de Winston Churchill. Après de longues années de barreau teintées de frustration et d’amertume, j’en étais presque venu à accepter mon sort ; les choix que j’avais faits à vingt-trois ans m’avaient mis sur cette voie et les chances d’en sortir pour quelque chose qui en valût la peine étaient à peu près nulles. Alors que la résignation était proche, une idée simple avait germé dans mon esprit, celle de consacrer le temps libre dont je disposais à ce qui m’intéressait. Ce projet de bouquin sur Clemenceau et Churchill s’était alors imposé presque naturellement. Dès les premières pages, j’avais relevé la tête ; en quelques semaines, j’étais redevenu maître de mon destin ; le monde m’appartenait. Il y avait tant de choses à dire. À la même époque, la statue londonienne de l’ancien Premier ministre britannique, érigée face à la Chambre des communes, avait été vandalisée. Un obscur militant en mal d’inspiration avait cru faire œuvre de justice en barrant le nom immortel de Churchill et en écrivant les mots « was a racist ». J’avais été sidéré qu’il eût pu venir à l’esprit de quelqu’un de s’en prendre à la statue de ce personnage considérable, à la mémoire de cet homme qui avait sauvé le monde en s’opposant à l’un des hommes les plus racistes de tous les temps. Churchill était un maître de vie ; j’avais passé tant de temps avec lui. Parmi la cinquantaine de livres qu’il avait écrits, le hasard avait voulu que je commençasse par Mes jeunes années, un récit allant de sa naissance à sa première élection à la Chambre des communes. Il l’avait écrit pendant les années 1930, alors qu’il était politiquement en pleine traversée du désert. S’il était une seule chose à retenir des slides de notre jeune impétrant, c’était celle-ci : il fallait quitter cette fichue salle de réunion pour lire et relire Mes jeunes années de Winston Churchill. Petit bijou de la littérature anglaise, ce livre est la meilleure façon d’appréhender le personnage de Churchill pour la simple raison que tout y est : l’humour, le style, le danger, le courage, l’alcool, l’ambition et les doutes.
Ma voisine de gauche s’empara perfidement d’un pain au chocolat qui restait sur le plateau posé devant nous ; c’était le dernier. Je me retins de la fusiller du regard et replongeai dans mes pensées. Avant d’avoir l’occasion de combattre les ennemis de l’humanité qui ne manqueraient pas de se manifester au cours de sa longue carrière, le jeune Winston avait traqué jusqu’aux confins les plus reculés de l’Empire britannique le moindre théâtre d’opérations, la moindre escarmouche rendue possible par la paix victorienne afin de se distinguer. Les combats contre les Pathans dans la vallée de Mamund, la dernière charge de cavalerie de l’Histoire contre les Derviches du Mahdi à Omdurman, pistolet Mauser à dix coups en main, au cours de laquelle il manqua d’être tué, son évasion des geôles boers constituent des pages inoubliables, ponctuées par le sifflement des balles ainsi que par les dépêches envoyées au Pioneer et au Daily Telegraph. De la frontière du nord-ouest de l’empire des Indes à l’Afrique du Sud en passant par les bords du Nil, Winston Churchill avait inventé le métier de correspondant de guerre, précédant Jack London, Joseph Kessel et Ernest Hemingway. Mon choix de m’exiler quelques années au Pakistan, aux Indes comme on disait à l’époque, n’avait pas été totalement étranger aux récits de ce glorieux prédécesseur. Malheureusement, hormis le gin and tonic, quelques matches de polo et la palanquée de bouquins dévorés sur mon roof-top d’Islamabad, nous n’avions pas vécu la même expérience.
– Le text and data mining a été exclu du champ d’application de la directive, précisa le collab’ junior d’une voix ferme, il s’agit d’une technique d’analyse automatique des textes et des données sous une forme digitale en vue de générer des informations ; les reproductions et les extractions qui sont effectuées par des organismes de recherche publics pour procéder à une fouille de textes et de données bénéficient donc d’une exception au droit d’auteur.
À la bonne heure, la fameuse exception du text and data mining… et nous n’étions que mercredi matin, pensai-je en me resservant une tasse de café. Plus les slides défilaient, plus mon esprit s’échappait de cette salle de réunion. Face à Churchill, il m’avait fallu trouver un interlocuteur de poids, un Français évidemment ; j’avais choisi Clemenceau. Les cultures politiques des deux hommes étaient très différentes. Quoi de commun entre le petit-fils du 7e duc de Malborough et le maire de Montmartre qui, le 23 septembre 1870, fit afficher cette proclamation martiale dans Paris assiégé ?
Nous sommes les enfants de la Révolution. Inspirons-nous de l’exemple de nos pères de 1792, et comme eux nous vaincrons.
Leurs points de ressemblance étaient néanmoins innombrables ; le sens de la répartie, le goût des bons mots, une ironie mordante rapprochaient ces deux esprits libres. Surtout, fascinés comme ils l’étaient par le danger et le fracas des batailles, ils avaient du panache ; cet état d’esprit héroïque, léger, mêlant grâce et bravoure, qui faisait tant défaut à notre époque. En 1916, à Verdun, aux officiers qui l’invitaient à mettre un casque eu égard à la dangerosité du secteur, Clemenceau leur avait demandé ce qui pourrait lui arriver de mieux que de mourir dans cette tranchée. Quant à Churchill, il avait voulu débarquer en Normandie le 6 juin 1944, au milieu des troupes alliées, obligeant George VI à intervenir personnellement afin de l’en dissuader. Ces deux hommes rempliraient jusqu’au bout les devoirs de leurs charges ; les peuples dont ils menaient les destinées le comprirent.
Dans le monde parallèle qui m’entourait, une image floue se dessina au loin : je crus distinguer le collab’ junior se rasseyant et un associé le remerciant pour sa présentation. Il avait vraisemblablement fini de nous bassiner avec l’adoption par le Parlement européen de la proposition de directive sur le droit d’auteur dans le marché unique numérique. La réunion n’était pas terminée. L’image floue se dissipa, le monde parallèle reprit son inexorable marche et Clemenceau revint. Il restera dans l’Histoire, assis à la table des plus grands, comme celui qui sut insuffler une énergie nouvelle à une nation saignée à blanc par trois longues années de combats atroces. « L’heure voulait quelqu’un d’immodéré et il l’était », écrit sobrement Bainville dans La Troisième République. Héritier des républicains de l’An II, son éducation l’avait amené à faire sienne la thèse de Péguy selon laquelle, en République, la seule politique qui vaille en temps de guerre est celle de la Convention nationale. Fidèle à la tradition jacobine et mû par une volonté de fer, le Tigre avait exhorté les Français à se battre jusqu’au dernier quart d’heure, la victoire ayant vocation à se remporter sur le fil, au tout dernier moment de la lutte, lorsqu’un des deux belligérants s’effondrerait sous le coup des millions de morts et des milliards partis en fumée. L’opiniâtreté et l’incroyable énergie de Clemenceau avaient suscité l’admiration de Churchill, qui estima qu’à lui seul, le Tigre avait été la France. De Gaulle ne pensait pas autrement, me dis-je en réprimant un bâillement ; dans la pénombre de son bureau de La Boisserie, il avait confié à Malraux son sentiment à propos du Tigre : « sa rage exprime la France. » Cette réunion d’équipe de deux heures exprimait quant à elle l’ennui. Et Churchill deviendrait l’équivalent britannique de Clemenceau vingt ans plus tard lorsque, refusant obstinément toute paix séparée avec l’Allemagne, il déciderait de poursuivre la guerre et de défendre son île whatever the cost may be.
– Paul, t’as booké quelle salle pour la réunion de onze heures ?
Je tournai un regard de somnambule vers mon voisin de droite qui venait de me poser cette question. C’était un type de ma promo ; nos relations n’avaient jamais dépassé le stade de la stricte cordialité professionnelle. Il était intelligent, mais son regard un peu bovin, rehaussé de petites lunettes d’informaticien, avait tendance à induire en erreur les gens qui ne le connaissaient pas. Je lui répondis mécaniquement.
– La 3.
– Parfait.
Il marqua une légère pause. Fixant mes épaules d’un air perplexe, il ajouta.
– C’est marrant de porter des bretelles comme ça.
Mes bretelles avaient toujours exercé une fascination sur ce genre de personnage mal dégrossi. Je ne souhaitais pas engager de conversation particulière avant la réunion de onze heures ; il me restait une dizaine de minutes de liberté avant que celle-ci commençât. Nos relations devaient néanmoins demeurer cordiales ; je me sentis obligé de lui répondre quelque chose.
– Qu’est-ce que tu veux… Michel Charasse est mon idole ; j’ai des posters de lui dans ma piaule.
Le léger malaise que j’aperçus dans son regard m’informa qu’il ignorait si je me payais sa tête ou si j’étais sérieux. Je n’étais ni moqueur ni sérieux, je désirais simplement qu’il me fichât la paix.
– Ça marche, à tout à l’heure en salle 3, me lança-t-il avec un petit sourire pincé.
Le mirage clemencisto-churchillien s’était évanoui. La réunion d’équipe était terminée.
IV
Quelques jours plus tard, je me trouvais au nouveau palais de justice ; c’était un bâtiment ultramoderne situé aux Batignolles, trois cubes de verre géants qui avaient succédé au palais de Saint-Louis. Il était dix-neuf heures quinze. Mon téléphone portable vibra. Texto de Wenceslas : « Ô capitaine mon capitaine, petite bière ce soir ? » Je coupai le vibreur et remis le portable dans ma poche ; l’audience n’était pas terminée, nous attendions les délibérés. L’idée de la petite bière n’était pas mauvaise ; la journée avait été longue, j’avais enchaîné des dossiers de comparution immédiate depuis dix heures du matin et je ne parvenais plus à penser à rien. Dès que la justice daignerait être rendue, je ne serais pas contre le fait de boire une mousse. Je ressortis le portable de ma poche : « Yes, je t’appelle quand je sors d’audience dans 20 min max. »
La sonnerie nous avertissant du retour du tribunal retentit ; toute la salle se leva. Un des prévenus, que j’avais défendu, me jeta un regard inquiet ; c’était un gamin de dix-huit ans qui s’était fait pincer pour le vol d’un Pass Navigo et d’un billet de cinquante euros. Le président appela les prévenus un à un afin de leur signifier la décision que le tribunal avait prise à leur endroit. Le premier, un homme âgé d’une quarantaine d’années qui comparaissait pour une affaire de vol aggravé, écopa d’une peine de prison ferme. Cela était prévisible ; il n’en était pas à son coup d’essai. Son avocat avait tout tenté, sans succès. En outre, le prévenu s’était fait remonter les bretelles par le président lorsqu’il apparut au cours de l’interrogatoire qu’il s’était marié religieusement, selon le rite musulman, sans s’être marié civilement. Le président n’avait pas dissimulé son agacement, rappelant au prévenu qu’en République un mariage civil préalable s’imposait avant tout mariage religieux, et que c’était comme cela depuis Napoléon. Le président avait également déploré auprès du procureur qu’aucun ordre n’eût été mis sur ces sujets depuis de nombreuses années. Le procureur n’avait rien dit, se limitant à griffonner quelques mots sur un papier. Le président fit droit au mandat de dépôt requis par le parquet ; le condamné partit directement en prison.
Ce fut ensuite le tour de mon gamin de dix-huit ans. Le pauvre bougre avait été mis à la porte de chez lui le jour de son anniversaire ; il n’avait nulle part où aller. Il s’exprimait dans un mélange d’argot des cités et de français, ponctué de quelques expressions issues de l’arabe. Son nom évoquait les montagnes enneigées de l’Atlas et les traits de son visage traduisaient la peur la plus absolue. Bien qu’il se fût fait pincer quinze jours auparavant pour des faits similaires, il écopa d’un simple rappel à la loi. Soulagement. Derrière les cernes qui marquaient ses yeux après une nuit passée en garde à vue, il me lança un regard d’une reconnaissance infinie. À cette seconde précise, j’aimais profondément mon métier. J’avais défendu quelqu’un qui ne représentait rien pour notre société, à part des emmerdements, et cela avait payé ; au moins jusqu’à la prochaine connerie de sa part. J’espérais sans trop y croire qu’il n’aurait plus affaire à la justice. Les dossiers défilaient et les condamnations pleuvaient. On eût presque cru que nos prisons avaient de la place pour accueillir tous ces mômes, racketteurs de téléphones portables et de Pass Navigo ; leur taux d’occupation était en ce temps-là de 150 %. Plaider l’école du crime et de la radicalisation religieuse, rappeler l’état déplorable des prisons françaises constituaient certains des arguments qui revenaient le plus souvent chez les avocats commis d’office.
Mon second client fut appelé. À peine plus âgé que le précédent, il s’était fait pincer pour le même type de délit commis cette fois en bande organisée. Le dossier fit l’objet d’un renvoi à une audience ultérieure en raison de l’incertitude pesant sur l’âge d’un des coprévenus, lequel prétendait être mineur. Estimant à juste titre qu’il n’avait pas à comparaître devant un tribunal pour adultes, son avocat avait demandé la réalisation d’une expertise osseuse. C’était la seule mesure d’instruction susceptible de prouver que son client avait bel et bien dix-sept ans. J’avais donc plaidé sur le seul mandat de dépôt requis par le parquet. La principale garantie de représentation dont je disposais était un contrat de travail temporaire qui m’avait été faxé à la dernière minute par la sœur du prévenu, accompagné d’un mot de son employeur. Mon client n’était pas toujours très assidu, mais il faisait du bon travail et son patron avait confiance en lui. J’avais tout misé là-dessus, implorant le tribunal de ne pas briser ce contrat de travail – seul fil qui reliait encore ce gamin à la société – en l’envoyant en prison. Le prévenu se leva. Il serait convoqué à la prochaine audience et aucun mandat de dépôt n’était retenu. Mission accomplie. Avant qu’il ne repartît, escorté par les policiers (ce n’étaient plus les gendarmes, mais les policiers qui escortaient désormais les prévenus du dépôt jusqu’à la salle d’audience), je lui rappelai les deux impératifs absolus qui devaient guider sa vie au cours des prochains mois : se lever tous les matins pour aller travailler et se présenter à la prochaine convocation du tribunal.
L’audience fut levée. Mon portable vibra une nouvelle fois : « T’en es où ? » Je sortis de la salle d’audience et descendis en trombe les escaliers du grand bâtiment de verre. J’appelai Wenceslas. Nous convînmes de nous retrouver Chez Aimé, à Montmartre. J’avisai alors une trottinette électrique qui gisait non loin de l’entrée du tribunal ; je scannai le QR code grâce à mon téléphone portable. La trottinette était libre et se déverrouilla. Après une course folle à travers le dix-septième et le dix-huitième arrondissement, je laissai mon engin rue des Trois-Frères, à un jet de pierres de l’immeuble où le docteur Clemenceau avait installé son petit dispensaire au début des années 1870.
V
Wenceslas m’attendait devant le bar. Comme de rigueur, nous nous fîmes un check et jetâmes notre dévolu sur la petite table de l’entrée que nous affectionnions. Chez Aimé était l’un des rades les moins chers du quartier. C’était le seul endroit où nous étions certains de ne jamais croiser un touriste : l’intérieur était minuscule, les tables collantes, les toilettes d’une propreté douteuse et les habitués avaient de vraies têtes d’habitués.
– Alors, ton audience ?
Je lui racontai dans les grandes lignes. J’avais le sentiment de ne pas avoir perdu ma journée, voire d’avoir été utile à mon prochain. Je fus ainsi plus disert qu’à l’accoutumée.
– Je ne savais pas que tu faisais du pénal pur et dur comme ça.
Je n’en faisais pas tant que cela. Wenceslas continua à me poser quelques questions sur mon métier, ce métier que j’exécrais chaque jour davantage, mais qui remontait parfois dans mon estime comme aujourd’hui. Il semblait intéressé. Ne travaillant pas lui-même, boursicotant vaguement sur Internet et squattant depuis de nombreuses années le grand appartement familial, il était souvent intrigué par le rythme de travail de la majeure partie de ses amis. Nous sentions que cela l’inquiétait, comme s’il pressentait qu’il devrait passer un jour, lui aussi, à la casserole des heures facturables et de la vie de bureau. Nous bûmes une première pinte et en commandâmes une deuxième. Wenceslas avait une bonne descente. C’était mon meilleur ami et nous nous connaissions depuis l’école maternelle. Passionné d’alpinisme, atteint depuis toujours par l’ivresse des sommets, son père avait dévissé sur la face nord de l’Eiger quelques mois avant sa naissance ; il était mort à l’âge de vingt-huit ans. Enfant posthume, Wenceslas avait été élevé par sa mère et son grand-père paternel.
Âgé de plus de quatre-vingt-quinze ans, le grand-père de Wenceslas était une légende vivante. Issu d’une des plus grandes familles de la noblesse française, une famille si ancienne que ses débuts précédaient de quelques années l’élection du premier des Capétiens, cet homme avait refusé très tôt de mener la vie désuète et surannée à laquelle il était destiné. Engagé volontaire à l’âge de vingt ans dans le régiment de chasse Normandie-Niémen, il avait combattu pendant deux ans dans les rangs de la France libre aux côtés des Soviétiques contre les pilotes de la Luftwaffe. Par une ironie de l’histoire, il était sans doute le seul pilote, voire l’unique combattant de toute la Seconde Guerre mondiale, à être en mesure de se prévaloir des titres de duc et de Héros de l’Union soviétique, chose qu’il ne fit d’ailleurs jamais, ni pour l’un ni pour l’autre. Cette expérience du front marqua profondément sa vie. Servant sous les ordres du commandant René Calmette, il soutint de nombreux combats aériens. Manquant d’être abattu à plusieurs reprises, il remporta dix-sept victoires homologuées, ce qui constituait un palmarès de tout premier ordre au sein du Normandie-Niémen. Meneur d’hommes hors-pair, profondément patriote et haïssant le régime collaborationniste de Vichy de toutes ses forces, la personnalité étincelante du commandant Calmette le fascina tout particulièrement. S’il accueillit très cordialement le grand-père de Wenceslas au sein de son escadrille – lui offrant même un petit manuel d’apprentissage de russe –, René Calmette veilla néanmoins à respecter cette froideur et cette distance toutes gaulliennes, faisant comprendre à ses jeunes recrues qu’il n’avait pas à les féliciter pour leur engagement sur le front russe, le plus meurtrier qui fut, estimant qu’ils ne faisaient là que leur devoir. Au fur et à mesure des missions, si l’admiration du jeune pilote pour son commandant ne fit que croître, Calmette développa de son côté une réelle estime pour ce gamin de vingt ans, rejeton de mille ans d’histoire de France, venu risquer sa vie dans les pires conditions qui fussent alors que tant d’autres s’étaient fait porter pâle. Ce compagnonnage de guerre prit fin une année plus tard dans des circonstances tragiques. En 1944, alors qu’ils effectuaient en binôme un vol de reconnaissance au-dessus du fleuve Niémen, ils furent pris en chasse par quatre Messerschmitt. En contact radio permanent avec son commandant, alors que tous deux se démenaient pour échapper aux chasseurs allemands, un bruit terrible retentit dans le casque du grand-père de Wenceslas. L’avion de Calmette avait été touché ; une épaisse fumée noire s’échappait du fuselage. René Calmette avait emmené son mécanicien ; ils étaient encore en vie ; il fallait à tout prix sauter. Le mécanicien, un Ukrainien d’une vingtaine d’années, n’avait pas de parachute ; ils étaient réservés aux seuls pilotes. Par le biais de la radio, le grand-père de Wenceslas entendit le commandant Calmette dire à son mécanicien qu’il refusait de sauter en utilisant le seul parachute disponible et que s’il ne parvenait pas à poser son Yak, il mourrait à ses côtés. L’avion s’écrasa quelques dizaines de secondes plus tard, emportant à jamais un des plus brillants chefs d’escadrille du Normandie-Niémen et son mécanicien. Pendant les minutes interminables qui suivirent, sans avoir le temps de réaliser ce qui venait de se produire, le grand-père de Wenceslas, âgé tout juste de vingt-et-un ans, dut lutter de toutes ses forces afin d’échapper aux Messerschmitt qui ne l’avaient pas lâché. Prenant tous les risques, volant à une altitude si basse qu’il crut heurter les cimes des sapins bordant le Niémen, il parvint à rejoindre les lignes alliées.
Wenceslas était habité par cette histoire qu’il m’avait racontée à plusieurs reprises au cours de nos trois décennies d’amitié. Son grand-père termina la guerre brillamment. Il se maria avec une jeune infirmière française rencontrée à Paris à son retour du front russe, mariage qui fut considéré à mi-voix par sa famille comme une mésalliance, ce dont il se moqua éperdument. Futur chef d’un des « noms les plus éclatants de France » pour reprendre les mots de Zweig, venant de surcroît de faire une très belle guerre comme on disait en ce temps-là, le grand-père de Wenceslas se retrouva dans la situation, somme toute assez rare, de pouvoir vivre sa vie comme il l’entendait. C’est ainsi qu’il se détourna de l’existence étriquée d’hobereau qui l’assommait d’avance, se lançant dans l’industrie aéronautique et abandonnant à son frère cadet le château familial qui eût dû lui échoir. Son mariage heureux lui donna trois enfants, le père de Wenceslas étant l’aîné. S’il inculqua à ses enfants et ses petits-enfants, tout particulièrement à Wenceslas qu’il avait quasiment élevé après la mort prématurée de son père, les valeurs d’honneur et de courage propres à la gloire militaire, celles-ci étaient directement inspirées de René Calmette, pilote de chasse, commandant des Forces françaises libres, héros de la Seconde Guerre mondiale, tué à l’ennemi en 1944 au-dessus du fleuve Niémen, et non de lointains ancêtres qu’il n’avait pas connus.
La mère de Wenceslas, d’origine tchèque, était issue d’une vieille famille d’Europe centrale qui avait régné sur la Bohême aux alentours du XIIIe siècle. Née en France après la guerre de parents ayant fui l’invasion allemande de mars 1939, elle eut un parcours en tout point opposé à celui qui faillit être le sien compte tenu de l’éducation des filles de son milieu à cette époque. Très brillante, elle fut admise au début des années 1970 à l’École normale supérieure de jeunes filles de Saint-Cloud. Veuve très jeune, tout juste quelques mois après son mariage avec le père de Wenceslas qu’elle avait à peine connu, elle ne se remaria jamais et effectua toute sa carrière à l’Institut Pasteur. Également maître de recherches au CNRS, elle fut responsable du laboratoire de microscopie électronique du service des virus. Alors que ses propres parents avaient revendiqué jusqu’à leur dernier souffle le prédicat d’Altesse Royale, la mère de Wenceslas négligea toujours ce monde qu’elle assimilait au néant le plus absolu et dont l’occupation principale était de se complaire dans le passé. Enfermée dans son laboratoire pendant des décennies, n’en sortant que pour participer aux colloques où elle était invitée dans le monde entier, l’éducation de son fils unique ne constitua pas non plus une priorité.
Les personnalités de son grand-père et de sa mère avaient exercé une influence déterminante sur Wenceslas. De ses origines aristocratiques, voire royales, il n’avait jamais tiré la moindre gloire, veillant de surcroît à faire preuve de la plus grande discrétion à ce sujet. Les visions du monde de son grand-père et de sa mère avaient toujours été fondées sur l’action et l’avenir : par l’audace et la gloire militaire d’un côté, par les études et la recherche scientifique de l’autre. Cela l’avait façonné et rendu parfaitement étranger à tout orgueil déplacé ou à toute fierté un peu nigaude liée à l’éclat du sang qui coulait dans ses veines. À plusieurs occasions, lorsqu’il était entouré de ses amis les plus proches, je l’entendis se gausser de la vacuité d’un monde qui, ne se résignant pas à disparaître, avait élevé l’illusion et le mensonge social au rang de Table de la Loi. Cette autodérision qui participait au charme du personnage entraînait toutefois quelques conséquences : Wenceslas tolérait difficilement que d’autres s’abandonnassent à faire ce que lui-même avait toujours abhorré. En cela, il avait un côté Cyrano de Bergerac, pourchassant de ses moqueries et de ses sarcasmes les petits marquis de notre époque, les pioupious de régiment qui se poussaient du col, les faibles d’esprit qui estimaient que la présence de tel ancêtre sur telle branche les dispensait de vivre leur propre vie, les porteurs de chevalières suintant la fatuité, les petits sacs à merde,





























