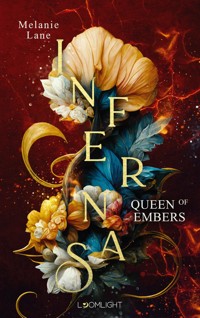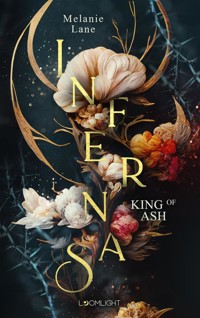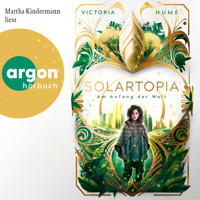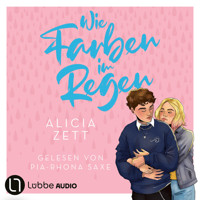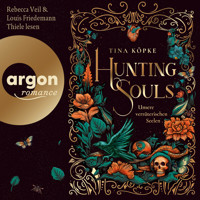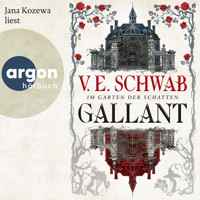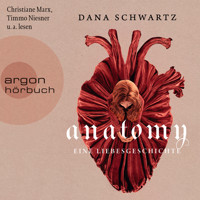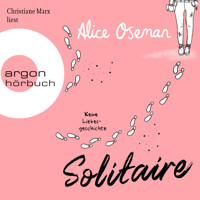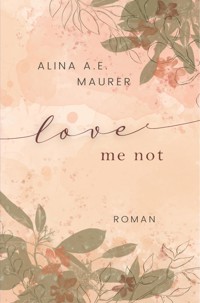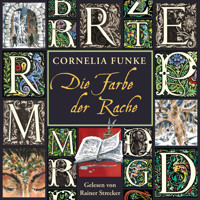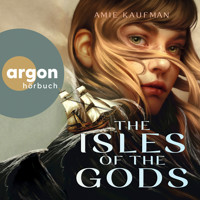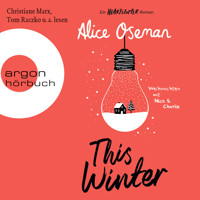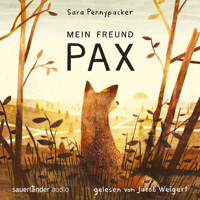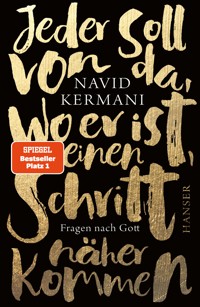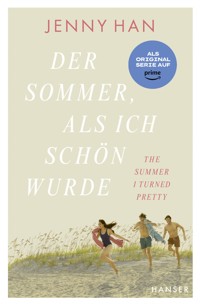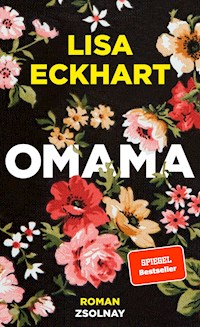Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Librofilio
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
La grande figure historique de
Napoléon Ier est du domaine de l’histoire : les événements politiques ne peuvent nullement altérer le jugement de la postérité, qui a déjà commencé pour elle.
Cette histoire de
Napoléon écrite pour la jeunesse par
Charles Richomme est particulièrement complète et agréable à lire. Elle a été publiée en 1857 par Magnin, Blanchard et Cie (dans sa deuxième édition).
À PROPOS DE L'AUTEUR
Charles Richomme est un homme de lettres français né en 1816 et mort en 1866. Il fut employé à la Bibliothèque impériale (département des Imprimés). Il a également écrit avec
Léon Guérin un ouvrage sous le pseudonyme collectif "Léonide de Mirbel".
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 290
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
HISTOIRE DE NAPOLÉON POUR LA JEUNESSE
Charles Richomme
– 1857 –
LA FAMILLE BONAPARTE
La famille de Bonaparte ou Buonaparte1 était une des maisons les plus illustres et les plus anciennes de l’Italie. Alliée aux Médicis, elle fut longtemps toute-puissante à Florence, souveraine à Trévise, et lorsque Napoléon entra vainqueur à Bologne, en 1796, les députés de la ville lui présentèrent le Livre d’or où se trouvaient inscrits les noms et les armoiries de sa famille. Ces armoiries représentent un râteau entouré de fleurs de lis semblables à celles des Bourbons. Au quinzième et au seizième siècles, les Bonaparte s’illustrèrent dans les lettres et dans la politique. L’un d’eux, Jacques, qui se trouvait à Rome en 1527, lorsque la ville sainte fut saccagée par les troupes du connétable de Bourbon, écrivit, avec talent et impartialité, l’histoire de cet événement mémorable. Son oncle, Nicolas, l’un des meilleurs légistes de l’Italie, créa dans l’université de Pavie une chaire de jurisprudence, et on lui attribue La Veuve, l’une des bonnes comédies italiennes du siècle de la renaissance. Enfin la mère du pape Paul V était une Bonaparte. Les aïeux de Napoléon combattirent toujours pour l’indépendance de cette Italie, qu’il devait soumettre à ses armes. Proscrits par une faction ennemie, les Bonaparte de Florence vinrent, au quinzième siècle, chercher un refuge à Sarzane, ville de l’État de Gênes, puis en Corse, à Ajaccio, où leur maison devint bientôt, par ses alliances, l’une des plus puissantes familles du pays.
Tels étaient les ancêtres de l’homme extraordinaire dont nous allons raconter la vie. Certes, il importe peu à sa gloire qu’il ait été noble ou roturier ; mais ces détails généalogiques sont une introduction nécessaire à cette histoire. Au reste, Napoléon, en homme supérieur, se souciait fort peu de ses aïeux. Il laissait le soin de recueillir ces titres de noblesse à son frère Joseph, qu’il appelait le Généalogiste de la famille. « Quant à moi, disait-il, je ne mets aucun prix à ces vieux parchemins ; j’aime mieux être le fondateur que le descendant d’une race illustre. »
1Ce nom s’écrit en italien des deux manières. Pendant les campagnes d’Italie, la politique fit à Napoléon un devoir de conserver la nuance indigène ; mais dans la suite il francisa son nom, et signa Bonaparte.
UNE MAISON DE LA RUE SAINT-CHARLES, A AJACCIO.
Les villes ont leur destinée comme les hommes ; les circonstances les font sortir de leur obscurité. Ajaccio (l’ancienne Urcinum), qui, suivant un vieil historien, tire son nom du vaillant Ajax, est une petite ville assez triste, quoiqu’elle soit aujourd’hui le chef-lieu de la Corse. Elle n’a rien qui puisse attirer l’attention, et cependant son nom seul évoque de grands souvenirs. L’homme de génie lègue aux lieux qui l’ont vu naître un rayon de sa gloire.
Le monument le plus remarquable de cette ville n’est point l’antique cathédrale, ni la jolie citadelle, ni la charmante église des Grecs, d’où l’on aperçoit le golfe dans toute son étendue, c’est une maison de modeste apparence, dans la rue Saint-Charles. Rien ne la distingue des autres, pas même une inscription ; mais les étrangers se découvrent avec respect, lorsque les habitants leur disent d’un air d’orgueil : « Ici est né Napoléon. » Cette maison, exhaussée d’un étage mais assez bien conservée, quoiqu’elle ait été pillée en 1793, pendant la révolution qu’excitèrent les Anglais, indique, malgré sa simplicité, la demeure d’une noble famille. Les anciens Corses, de mœurs sévères et patriarcales, n’aimaient pas le luxe.
Che due case tiene Una ne piove.
« Quand on a deux maisons il pleut dans une, » disait un de leurs proverbes. Au-devant de la casa des Bonaparte est une petite place qui a reçu le nom de la mère de Napoléon, Letitia, et qui est plantée aux angles de quatre acacias. Suivons le cicerone, et pénétrons dans cette demeure. Un sentiment involontaire de respect et d’admiration vous saisit aussitôt ; l’imagination devient toute-puissante, elle déroule à vos yeux la vie du grand homme, et vous transporte d’Ajaccio à Sainte-Hélène. Un beau portrait de l’empereur, peint par Gérard, est suspendu aux murs du salon ; c’est ce qui attire les premiers regards du visiteur. La chambre à coucher a quelque chose de mystérieux ; on y voit encore au plafond les traces de l’ancienne alcôve. Une commode, dont le dessus est une table en marbre serpentin du pays, quelques fauteuils et des chaises sont, dit-on, les débris de l’ancien mobilier ; et on les préserve avec soin de la rapacité fanatique des visiteurs. Le berceau de Napoléon a été dérobé par petits fragments, et se trouve chez tous les amateurs de la Grande-Bretagne. On a également volé, il y a quelques années, le premier joujou du grand homme ; c’était un fort joli canon de bronze. Lorsque le prince de Joinville débarqua, en 1832, à Ajaccio, on lui fit hommage d’un fauteuil qui avait appartenu à Napoléon enfant.
Tous les ans à Pâques, suivant un usage italien pratiqué en Corse, chaque propriétaire fait bénir sa maison. Le curé, dans les villages, reçoit en payement un certain nombre d’œufs, selon l’aisance des paysans. Cette cérémonie se fait encore avec pompe chaque année pour la casa des Bonaparte.
Parlons maintenant de la famille qui occupait cette petite maison de la rue Saint-Charles. — Le chef, Charles Bonaparte, était un homme remarquable par ses talents et son patriotisme. Il avait combattu avec le célèbre Pascal Paoli, pour l’indépendance de son pays, et il eût émigré comme lui, en 1769, lorsque les Français s’emparèrent de la Corse, si l’un de ses parents, l’archidiacre Lucien, homme de talent, vénéré dans le pays, qui exerçait une grande influence sur la famille, et en dirigeait les affaires, ne s’y était opposé. La femme de Charles, Letitia Ramolino, que sa beauté et son caractère héroïque distinguaient également, le suivit à cheval dans toutes ses expéditions, et partagea ses dangers. Lorsque le calme fut rétabli dans la Corse, M. et Mme Bonaparte revinrent à Ajaccio, et Napoléon naquit peu de temps après, le 15 août 1769, jour de l’Assomption, vers midi. Sa mère se rendit à l’église pour assister à la grand-messe, mais elle ne tarda pas à rentrer, et, quelques instants après, Napoléon vint au monde. Il ne fut baptisé que deux ans après, le 21 juillet 1771 ; c’est un usage qui n’est pas rare en Corse ; on voit encore dans la cathédrale d’Ajaccio la grande cuve de marbre blanc où il reçut l’eau sacrée du baptême.
Madame Letitia eut treize enfants, dont huit seulement survécurent, et ces huit enfants ont tous joué un grand rôle. L’aîné, Joseph, que l’on destinait à l’église, fut roi de Naples, puis roi d’Espagne ; Louis, roi de Hollande ; Lucien, président du conseil des cinq-cents ; Jérôme, roi de Westphalie ; Elisa (Marianne), fut grande-duchesse de Toscane ; Marie-Pauline, princesse Borghèse, et Caroline, reine de Naples. Mais ils n’arrivèrent que par leur frère cadet, Napoléon, sur qui ses parents fondèrent, dès sa plus tendre jeunesse, toutes leurs espérances. Le bon archidiacre Lucien avait étudié avec soin le caractère remarquable de son neveu, et lorsqu’il mourut, il prophétisa sa grandeur future : « Je ne songe point, dit-il, à assurer la fortune de Napoléon... Il la fera lui-même... Il sera le chef de la famille. » Charles Bonaparte, à son lit de mort, ne pensa, lui aussi, qu’à son fils cadet ; dans son délire, il l’appelait sans cesse, pour qu’il vînt à son secours avec sa grande épée.
L’enfance de Napoléon n’eut rien d’extraordinaire. « Je n’étais, a-t-il dit lui-même, qu’un enfant obstiné et curieux. » Dès l’âge de trois ans, il montrait beaucoup de goût pour les exercices militaires. « Vous me gâtez cet enfant, dit un jour le père aux officiers de la garnison qui l’emmenaient aux revues ; vous m’obligerez à en faire un soldat. » Dans les escarmouches entre les enfants de la ville et ceux du faubourg, il commandait les premiers. Turbulent, vif, adroit, il passait la plus grande partie du temps à se battre, à courir dans les montagnes, pour manger avec les bergers le broccio, ce bon fromage de lait caillé, ou à dénicher des nids de merles. Vêtu d’un petit pelone (manteau à capuchon, en poil de chèvre), un bâton de buis à la main, il se promenait sur les côtes pittoresques, couvertes de vignes, qui avoisinent Ajaccio, ou dans le jardin d’oliviers des Metelli, propriété de sa famille. On y montre encore un vieux chêne, planté près de la maison, sous l’ombrage duquel l’illustre enfant aimait à se reposer. C’est en s’habituant ainsi, dès ses premières années, à supporter la fatigue et l’intempérie des saisons, que Napoléon acquit cette constitution robuste qui lui fut si utile. L’éducation sévère et bien dirigée de madame Letitia, les sages conseils de son père et de son oncle, développèrent en même temps les bonnes qualités dont la nature avait été prodigue envers lui.
Malgré la violence de son caractère, jamais Napoléon ne causa le moindre chagrin à sa mère, qu’il aimait tendrement, et qui savait s’en faire obéir. Il redoutait également sa nourrice Saveria, excellente femme, qui rachetait par de grandes qualités son épouvantable laideur. Elle est morte à Rome, chez madame Letitia, il y a quelques années ; sa petite maison existe toujours à Ajaccio. Napoléon montra toute sa vie beaucoup d’attachement pour sa vieille nourrice : il la fit venir aux Tuileries à l’époque de son couronnement, et lui fit présent de l’Esposata, la première vigne de la Corse, qui appartenait depuis longues années à la famille Bonaparte.
Le petit Napoléon était heureux, mais, un beau matin, il lui fallut quitter la maison paternelle. Plus de ces bonnes promenades dans les makis ; plus de visites au mari de Saveria, qui avait toujours dans ses poches des gâteaux excellents, des ravioli ou des oranges d’Aregno ; plus de conversations au coin du feu avec le vieil oncle, ou sur les genoux du père, qui racontait ses exploits avec Paoli, tandis que madame Letitia préparait le souper. — Adieu, ma mère ! adieu, Saveria ! adieu, mes frères et mes sœurs ! ne pleurez pas, je vous écrirai souvent. — Il faut partir pour le collège ! mot affreux qui nous a tous fait pleurer, qui révèle à l’enfant son premier chagrin sérieux, qui rompt toutes ses habitudes, alors que les habitudes sont si douces.
Charles Bonaparte n’était pas riche ; profitant de l’influence de son nom et de la considération qui l’entourait, il désira placer Napoléon à l’école militaire de Brienne, et la petite Elisa à l’école de Saint-Cyr. Sa demande fut accueillie avec empressement, grâce à la protection d’un ami de la famille, M. de Marboeuf, gouverneur de l’île. Il venait d’être nommé député de la noblesse corse, et se rendait à Paris ; il emmena avec lui Napoléon et sa sœur, et mourut quelques années après à Montpellier d’un squirre à l’estomac. Son corps repose aujourd’hui à Saint-Leu, dans la vallée de Montmorency2.
Les registres du P. Berton, principal de l’école de Brienne-le-Château, portent que M. Napoléon de Buonaparte, écuyer, est entré dans cet établissement le 23 avril 1779, à l’âge de neuf ans et demi.
2Voyez à la fin du volume le tableau de la famille Bonaparte.
L’ÉCOLE DE BRIENNE.
LE CHIEN, LE LAPIN ET LE CHASSEUR.
Par une belle matinée de printemps, un enfant de douze à treize ans se promenait solitairement dans le jardin de l’école militaire de Brienne. C’était l’heure de la récréation ; mais, absorbé dans ses réflexions, le promeneur ne songeait point à partager les jeux de ses camarades. Il semblait gravement préoccupé ; car il fronçait de temps en temps les sourcils, marchait à grands pas et se heurtait contre les arbres. Ce manège dura longtemps.
—Napoléon est fou, disaient les camarades, qui l’examinaient de loin. — Il est malade. — Il a le mal du pays.
Tout à coup Napoléon jeta un cri de joie et courut s’asseoir sur un petit banc de gazon. Tirant ensuite de sa poche du papier et un crayon, il se mit à écrire.
« Las ! j’en étais bien sûr, dit un des élèves qui examinaient le travailleur ; cet enragé piocheur s’occupe de géométrie, même pendant les récréations. Au prochain examen, il sera le premier, comme d’habitude. »
Ne vous découragez point, enfants ! Napoléon ne fait point de calculs, il ne songe point aux problèmes de votre vénérable professeur, le père Patrault. Il compose... devinez, je vous prie... il compose une fable ! A son entrée à l’école, Napoléon ne parlait pas très-bien le français, il y mêlait l’idiome corse. Grâce aux leçons de Dupuis, le sous-principal, il parvint bientôt à parler et à écrire assez correctement, et il cherchait sans cesse à perfectionner ses études. Ce fut dans ce but qu’il conçut l’idée de devenir fabuliste, et, après plusieurs essais et un travail opiniâtre, il eut le bonheur d’avoir une fable de sa composition ; elle est intitulée : Le Chien, le Lapin et le Chasseur :
César, chien d’arrêt renommé, Mais trop enflé de son mérite, Tenait, arrêté dans son gîte, Un malheureux lapin, de peur inanimé. « Rends-toi, lui cria-t-il d’une voix de tonnerre, Qui fit. au loin trembler les peuplades des bois. Je suis César, connu par ses exploits,
Et dont le nom remplit toute la terre. » A ce grand nom, Jeannot lapin. Recommandant à Dieu son âme pénitente, Demande d’une voix tremblante : « Très-sérénissime mâtin, Si je me rends, quel sera mon destin ? —Tu mourras.—Je mourrai, dit la bête innocente ;
Et si je fuis ?—Ton trépas est certain. —Quoi ! reprit l’animal qui se nourrit de thym, Des deux côtés je dois perdre la vie ! Que votre auguste seigneurie Veuille me pardonner, puisqu’il me faut mourir, Si j’ose tenter de m’enfuir. » Il dit et fuit en héros de garenne. Caton l’aurait blâmé ; je dis qu’il n’eut pas tort,
Car le chasseur le voit à peine, Qu’il l’ajuste le tire... et le chien tombe mort ! Que dirait de ceci notre bon La Fontaine ? Aide-toi, le ciel t’aidera. J’approuve fort cette méthode-là.
LES BOULES DE NEIGE ET L’HABIT DE BURE.
L’hiver de 1783 à 1784 fut des plus rigoureux, et les pensionnaires de Brienne ne purent aller au jardin ; leurs récréations se passaient assez tristement dans une salle immense, où ils cherchaient à tuer le temps. Les uns causaient avec le principal, le père Berton, d’autres mangeaient des gâteaux et des fruits qu’ils achetaient à madame Hauté, la femme du concierge de l’école ; tous bavardaient, en dégradant les bancs avec leurs couteaux, ou en inscrivant leurs noms sur le mur, genre d’amusement qui existe toujours dans les collèges et les pensions. Quelques élèves, groupés dans un coin de la salle, causaient plus sérieusement que les autres ; ils agitaient une grave question de théorie militaire. Parmi eux se faisait reconnaître, à son teint olivâtre et à son attitude réfléchie, le célèbre auteur de la fable Le Chien, le Lapin et le Chasseur. Appuyé nonchalamment contre une fenêtre, il jetait, de temps en temps, des regards ennuyés sur la cour de l’école, dont les pavés disparaissaient sous une épaisse couche de neige. Non loin de ce groupe, se trouvaient des espiègles, qui riaient à gorge déployée. L’un deux avait apporté, dans son mouchoir, une énorme boule de neige, et il cherchait des yeux une victime. Il aperçut Napoléon.
— Je parie vingt sous de pommes, s’écria t-il, que j’abats le chapeau de notre estimable Corse, sans casser les vitres de la fenêtre.
La boule est aussitôt lancée ; elle effleure le visage de Napoléon et va se briser contre le mur, au milieu des éclats de rire universels. Mais Bonaparte, lui, ne riait pas ; il s’avança, rouge de colère, et les poings fermés, en cherchant des yeux son adversaire. Tous les camarades se jetèrent aussitôt entre les deux antagonistes et calmèrent l’offensé.
— Est-il rageur, ce Paille-au-nez ! s’écria l’espiègle.
— Je n’aime pas toutes ces plaisanteries, reprit Bonaparte, elles sont de fort mauvais goût, ainsi que cette manie d’estropier mon nom de baptême.
Ce sobriquet de Paille-au-nez lui avait été donné, lors de son entrée à l’École, parce que son accent corse lui faisait prononcer Napoilloné pour Napoléon.
— Allons, allons, le mal n’est pas grand, dit le père Berton.
— Non, sans doute, monsieur, reprit Bonaparte, mais on attaque loyalement, on n’attend pas que son adversaire ait le dos tourné ; ce n’est pas de bonne guerre.
Les groupes s’étaient formés de nouveau, et personne ne songeait plus au petit incident qui avait interrompu les conversation. Tout à coup Napoléon, qui depuis un quart d’heure écrasait machinalement les débris de la boule de neige, pousse un cri de joie, et s’élance d’un air joyeux au milieu de la salle :
— Messieurs, dit-il, je demande la parole pour cause d’utilité générale !... Depuis quelques jours, nos récréations sont bien monotones, n’est-ce-pas ?
Il y eut dans la jeune assemblée un murmure d’approbation.
— Eh bien ! je viens d’imaginer un nouvel amusement que nos supérieurs encourageront, j’en suis certain, car cette fois-ci, du moins, nos jeux serviront à notre instruction.
— Bravo ! bravo ! — Qu’est-ce donc ? — Parlez. — C’est délicieux ! Et tous les élèves accoururent d’un air curieux auprès de Napoléon, qui monta sur un banc.
— Voici le fait en deux mots, dit le jeune orateur. La neige remplit la cour, à sept ou huit pieds de hauteur : il faut l’utiliser, avant que la pluie ou le soleil ne l’aient fait fondre. Le froid n’est point si vif que nous ne puissions le braver ; d’ailleurs, messieurs, ne devons-nous pas nous habituer à supporter les rigueurs de la saison, nous tous qui devons être soldats ? Eh bien ! descendons dans la cour avec des pelles, des pioches, tous nos instruments de jardinage, et construisons avec la neige des parapets, des demi-lunes, enfin des fortifications complètes. Quand ces travaux seront terminés, nous pourrons nous diviser en compagnies, et, au moyen de boules de neiges, les uns attaqueront le fort, les autres le défendront. Je me charge, messieurs, de diriger l’attaque. »
Vous comprenez l’enthousiasme qui accueillit cette proposition. La récréation était trop avancée pour exécuter ce magnifique projet ; mais à la suivante, les élèves descendirent dans la cour, et commencèrent les travaux sous la direction de Napoléon. Le fort fut construit rapidement ; puis les élèves se divisèrent en deux bandes pour l’attaquer et le défendre. Ces jeux militaires durèrent quinze jours ; mais les directeurs de l’école les firent enfin cesser. Dans la chaleur de l’action, plusieurs élèves avaient été assez grièvement blessés, entre autres Bourrienne, qui fut depuis le secrétaire particulier de Napoléon. On balaya la cour, et M. le général en chef rentra dans la salle d’étude, ainsi que ses vaillants soldats.
Quelque temps après, un nouvel incident vint attirer l’attention sur Napoléon. Sa conduite était fort régulière, et il se soumettait de bon coeur à la discipline. Mais un jour, je ne sais dans quelle occasion, il lui arriva de commettre quelque faute. « Monsieur de Bonaparte, lui dit le maître de quartier, homme brutal et sans éducation, vous échangerez votre uniforme contre l’ habit de bure, et vous dînerez à genoux au milieu du réfectoire. » Le pauvre enfant devint pâle, des larmes brillèrent dans ses yeux ; mais le respect de la discipline l’emporta sur son indignation ; il ne répliqua pas, et se disposa à subir son supplice. Il avait trop compté cependant sur son courage. Lorsqu’arriva le moment fatal, Napoléon ne put vaincre plus longtemps sa douleur ; ses traits se contractèrent, il lui prit un vomissement subit, qu’accompagna une violente attaque de nerfs. Aux cris de consternation que jetèrent ses camarades, les supérieurs de l’école accoururent. Le père Patrault, l’un des professeurs de Napoléon, se mit, pour la première fois de sa vie, dans une grande colère, et s’écria qu’on dégradait son premier mathématicien. Le directeur, non moins indigné, tança vertement le maître d’étude, et lui défendit d’infliger désormais à ses élèves un aussi humiliant et ridicule châtiment. Cet incident prit place dans les souvenirs de Napoléon, qui en parlait encore vers la fin de sa vie. Il nous montre dans tout son jour le caractère de ce grand homme, mélange bizarre d’orgueil et de sensibilité.
Cette anecdote, ainsi que les précédentes, sont les seuls renseignements que nous ayons sur le séjour de Napoléon à Brienne. On a exagéré sa jeunesse comme tout le reste de sa vie. Les uns l’ont représenté comme un enfant méchant, presque féroce ; les autres comme un petit génie. Napoléon, à Brienne, n’était ni l’un ni l’autre. C’était un brave garçon, un piocheur, comme disent les écoliers ; mais ses manières rudes et sauvages, la sévérité de son caractère, ne le firent pas très-bien accueillir de ses camarades, qui ne cessaient de le plaisanter sur son prénom et sur son pays ; ils finirent tous cependant par l’estimer, et rendirent justice à ses bonnes qualités. Du reste, il était peu communicatif, se promenait tout seul pendant les récréations, ou discutait sur des matières sérieuses avec Bourrienne et quelques autres. Le plus souvent, il se renfermait dans la bibliothèque, où il lisait avec avidité les beaux récit de l’historien Polybe, et les Hommes Illustres de Plutarque. Mais il travaillait surtout avec assiduité les sciences mathématiques, et il devint, dans ces facultés, l’un des meilleurs sujets de l’école3. Par un effet singulier du hasard, l’un des professeurs de Bonaparte joua lui-même un grand rôle pendant la révolution ; mais la gloire du maître devait pâlir devant celle de l’élève. Le général Pichegru a conquis la Hollande : Napoléon, empereur des Français, a donné des lois à l’univers entier.
LES DEUX ÉPOQUES.
Octobre 1784.
Le tambour bat le rappel : les directeurs de l’école courent çà et là d’un air affairé ; les élèves, en grand uniforme, descendent dans la cour et se rangent par compagnies. C’est un jour solennel pour les pensionnaires de Brienne. M. de Keralio, l’inspecteur général, vient présider les examens que doivent subir les candidats pour l’École militaire de Paris. — Le vieux gentilhomme distingua Napoléon, qui était âgé de quinze ans ; il fut étonné de son intelligence, de son bon sens, de sa lucidité d’esprit. Aussi, lorsque les bons moines, à la nouvelle du départ de Napoléon, demanderont à le garder encore un an, pour le perfectionner dans la langue latine, M. de Keralio s’écria vivement : « Non, non, mes pères, c’est impossible ; j’aperçois dans ce jeune homme une étincelle qu’on ne saurait trop cultiver. » Nous lisons dans le compte rendu qu’il adressa au roi, après les examens : « M. de Buonaparte (Napoléon), né le 15 août 1769. — Taille de quatre pieds, dix pouces, dix lignes. — A fait sa quatrième. — De bonne constitution, santé excellente. — Caractère soumis, honnête, reconnaissant ; conduite très régulière ; s’est toujours distingué par son application aux mathématiques. — Il sait très-passablement son histoire et sa géographie. Il est assez faible pour les exercices d’agrément et pour le latin, où il n’a fait que sa quatrième. — Ce sera un excellent marin. — Il mérite de passer à l’École militaire de Paris. »
Le 17 octobre 1784, Napoléon sortit de l’école de Brienne pour se rendre à Paris, et son ami Bourrienne l’accompagna jusqu’au coche de Nogent-sur-Seine, dans une modeste carriole.
Avril 1805.
Vingt-et-un ans après, par une belle matinée du mois d’avril, deux voitures, richement attelées, s’avançaient de toute la vitesse de leurs chevaux sur la route de Troyes à Brienne. Dans la première se trouvait un homme encore jeune, mais dont la figure fatiguée portait les traces des soucis et des travaux d’esprit. Il portait une redingote grise, un chapeau d’une forme particulière, orné seulement de la cocarde tricolore qu’attachait une ganse de soie noire, et à sa boutonnière brillait la plaque de la Légion d’honneur avec une simple croix d’argent. Ce personnage, dont la suite et l’équipage indiquaient le haut rang, puisait à chaque instant dans une tabatière d’argent, et regardait attentivement la campagne avec une lunette de poche. Ses traits calmes et sévères prenaient de temps en temps une riante expression ; la vue d’un arbre lui arrachait un sourire ; mille souvenirs semblaient l’assiéger ; et dès qu’il aperçut les murs noircis de la vieille école de Brienne, il ne put retenir un cri de joie.
L’arrivée de ce personnage était attendue avec impatience. La foule encombrait les rues de Brienne, et des curieux, échelonnés sur les toits, portaient leurs regards avides sur la grand-route de Troyes. Ils découvrirent enfin les deux voitures, qui arrivaient au galop. A cette nouvelle, l’enthousiasme s’empara de la foule, les cris de vive l’empereur ! partirent de toutes parts, et la population devint ivre de joie, lorsque le personnage à redingote grise descendit de voiture. Celui-ci fit aux spectateurs un salut militaire, qui fut accueilli par de nouvelles acclamations, et se dérobant à cette ovation populaire, qui semblait l’importuner, il se dirigea vers l’ancienne école militaire, avec trois personnes de sa suite.
A peine fut-il entré dans la première cour du collège, qu’une vive émotion se peignit sur ses traits : des larmes roulèrent dans ses yeux. Il s’appuya contre un pilier, et resta longtemps plongé dans ses réflexions. — C’est qu’il n’était pas étranger à ces lieux. Cet homme, que des -25populations
-25populations accueillaient avec enthousiasme, et saluaient du nom glorieux d’empereur, avait passé cinq ans de sa jeunesse à l’école de Brienne. C’était l’auteur de la fable, Le Chien, le Lapin et le Chasseur, le héros du combat des boules de neige, le pauvre petit écolier qui s’était modestement embarqué sur le coche de Nogent-sur-Seine, au mois d’octobre 1784, fort inquiet de son avenir, et ne pouvant prévoir sa glorieuse destinée, c’était Napoléon Bonaparte, le vainqueur de l’Europe, que le pape avait couronné empereur des Français, et qui, avant d’aller prendre à Milan le sceptre de l’Italie, venait retrouver à Brienne la mémoire de ses premières années.
Napoléon visita aussitôt tous ces lieux, si féconds pour lui en souvenirs, et son émotion ne fit que s’accroître. Il se promena silencieusement dans ce parc, où il avait rêve si souvent ; il alla voir à l’extrémité du jardin, l’ermitage, où se trouvaient les tableaux de la Tentation de saint Antoine, qui jadis l’avaient si fort émerveillé ; il parcourut enfin tout le collège, interrogeant ses souvenirs, riant et pleurant à la fois, rompant de temps en temps le silence, pour communiquer ses vives impressions à ceux qui le suivaient. Peut-être même chercha-t-il avec attention la trace de son nom ou celui d’un ami, incrusté jadis dans le mur avec le classique canif.
Napoléon se souvint également des hommes qui avaient pris soin de son enfance, à l’école de Brienne. Il demanda avec empressement un de ses anciens sous-directeurs. Le bon prêtre, qui était alors vicaire dans un village voisin, accourut en toute hâte, vêtu d’une redingote brune. Cette infraction aux règlements de l’Église ne put échapper à Napoléon, qui, même dans ses moments d’effusion et de sensibilité, n’oubliait pas ses maximes d’ordre et de discipline. « Pourquoi n’êtes-vous pas en soutane ? dit-il au vicaire, d’un ton sévère. Un prêtre, monsieur, ne doit jamais quitter son habit. Allez vous habiller. » Le pauvre ecclésiastique se retira tout tremblant ; mais il ne put s’empêcher de sourire, en pensant que, lui aussi, il avait rudement mené Bonaparte, lorsque le puissant empereur n’était qu’un écolier. Il revint bientôt avec la soutane, et Napoléon l’accueillit avec tant de cordialité, que le bon vicaire oublia en quelques minutes la réprimande qu’il avait essuyée. Tous les anciens serviteurs de l’école furent également bien reçus4, et personne ne put se plaindre du passage de l’empereur à Brienne.
Il y resta vingt-quatre heures, et certes ce fut un des jours les plus heureux de sa vie. Le présent et l’avenir, l’un si lourd et l’autre si chanceux, ne l’occupèrent pas un seul instant ; il ne songea qu’au passé, et peut-être se prit-il à regretter ce temps de calme et d’insouciance, où il s’occupait à composer des fables et à résoudre des problèmes. Napoléon revit Brienne neuf ans après, mais ce fut à la tête d’une armée ; il venait défendre sa couronne et l’indépendance de la France.
3Lorsqu’il obtint le prix de mathématiques, il fut couronné par le duc d’Orléans, père du roi Louis-Philippe.
4Le P. Dupuis, sous-principal du collège, mourut bibliothécaire à la Malmaison. Hauté, qui avait été portier de l’Ecole de Brienne, devint concierge du même château. Le P. Patrault, professeur de mathématiques, rentra, en 1790, dans la vie séculière, ainsi que Pichegru ; il fut secrétaire de Bonaparte à l’armée d’Italie. L’aumônier était le P. Charles, que Napoléon aimait beaucoup ; il lui avait enseigné le catéchisme et l’avait préparé à sa première communion. Au commencement de l’empire, un pauvre homme vint réclamer des secours aux Tuileries, comme ancien maître d’écriture à Brienne. — « Ma foi, dit l’empereur en riant, je ne vous en félicite pas, vous avez fait là un bel élève, » et il lui accorda une pension de douze cents francs.
L’ÉCOLE MILITAIRE DE PARIS.
Napoléon conserva, pendant toute sa vie, cette aptitude au travail et ce zèle infatigable qu’il montrait dans sa jeunesse. Il ne cessa pas de s’instruire jusqu’à ses derniers moments ; art, sciences, histoire, littérature, il ne négligea rien. Aussi regarda-t-il toujours l’activité comme l’une des plus belles qualités de l’homme. Lorsqu’il donnait une mission importante, il ajoutait : « Allez, monsieur, dépêchez vous, et souvenez-vous que le monde a été créé en six jours. » « On apprend tout ce qu’on veut apprendre, » disait-il souvent. Enfin, visitant un jour une école, il adressa aux élèves les paroles suivantes, qu’on ne saurait trop méditer : « Jeunes gens, chaque heure de temps perdu est une chance de malheur pour l’avenir. »
Napoléon enfant eut toujours présente à la pensée cette sage maxime ; à l’École militaire de Paris, comme à Brienne, le jeune Corse fut un élève laborieux et zélé. Il étudiait surtout les mathématiques, pour lesquelles il avait une véritable vocation ; mais tous ses professeurs savaient l’apprécier et admiraient son caractère original. M. Domairon, qui avait la chaire de littérature, disait en parlant de ses compositions de rhétorique : « C’est du granit chauffé au volcan. » M. de l’Eguille, le professeur d’histoire, homme de science et de talent, qui sut se concilier l’amitié de Bonaparte, laissa sur son élève cette note remarquable : « Corse de nation et de caractère, il ira loin si les circonstances le favorisent. » Mais le maître d’allemand, le vénérable Bauer, n’eut point ce talent de divination ; il faisait peu de cas de Napoléon, qui négligeait tout à fait l’allemand. Un jour, celui-ci n’assistait pas à la classe : « Où est donc M. de Bonaparte ?—Il passe son examen de sortie.— Bah ! mais est-ce qu’il sait quelque chose ?—C’est le plus fort mathématicien de l’École. —Cela ne signifie rien, les mathématiques ne réussissent qu’aux imbéciles. » L’empereur, qui se plaisait à raconter, dans sa captivité de Sainte-Hélène, les souvenirs de sa jeunesse, disait, en riant, qu’il serait curieux de savoir si M. de Bauer avait toujours conservé sur lui la même opinion.
Élève studieux et soumis, Napoléon avait néanmoins un esprit vif, remuant et frondeur. Tout le monde connaît sa répartie à l’archevêque qui vint le confirmer à l’École de Paris. Le prélat parut s’étonner au nom de Napoléon, et dit que ce saint n’était pas dans le calendrier : « Ce n’est pas une raison, répliqua vivement le jeune homme, nous avons plus de saints dans le martyrologe que de jours dans l’année. » Le bon archevêque ne put s’empêcher de sourire. — Vingt ans plus tard, le pape devait fixer la fête de Napoléon au 15 août, jour de l’Assomption.
L’École militaire de Paris, fondée par Louis XV, était tenue avec une grande magnificence ; ce luxe choqua de suite l’esprit droit et observateur de Napoléon ; il comprit qu’avec ce plan d’éducation, on ne parviendrait jamais à avoir de bons soldats, et il adressa un mémoire au chef de l’École pour remédier aux abus existants. « Au lieu, disait-il, d’entretenir un nombreux domestique autour des élèves, de leur donner journellement des repas à deux services, de faire parade d’un manège très coûteux, tant pour les chevaux que pour les écuyers, ne vaudrait-il pas mieux, sans toutefois interrompre le cours de leurs études, les astreindre à se suffire à eux-mêmes, c’est-à-dire moins leur petite cuisine qu’ils ne feraient pas, leur faire manger du pain de munition ou d’un qui en approcherait, les habituer à battre, brosser leurs habits, à nettoyer leurs souliers et leurs bottes, etc. ? Puisqu’ils sont loin d’être riches, et que tous sont destinés au service militaire, n’est-ce pas la seule et véritable éducation qu’il faudrait leur donner ? » Napoléon n’avait que seize ans, lorsqu’il rédigea ce mémoire remarquable. Ses directeurs n’y attachèrent point d’importance et regardèrent l’auteur comme un écervelé. Mais celui-ci n’oublia pas les sages idées de sa jeunesse, et, lorsqu’il fut tout-puissant, il créa ces belles écoles de Fontainebleau et de Saint-Cyr, dont les règlements faisaient contraste avec ceux de l’ancienne école de Paris.
Ce caractère frondeur et original ne plaisait point aux supérieurs. Ils résolurent de s’en délivrer le plus tôt possible, et devancèrent l’époque du dernier examen de Napoléon, qui fut nommé, le 1er septembre 1785, lieutenant en second de la compagnie des bombardiers d’Autun au régiment d’artillerie de la Fère ; sur trente-six places d’officiers, il avait obtenu la douzième.
NAPOLÉON, LIEUTENANT ET CAPITAINE D’ARTILLERIE.
Bonaparte arriva à Valence où était son régiment à la fin d’octobre. Ce fut une des époques les plus heureuses de sa vie. Ses talents, son caractère loyal et qui était devenu assez enjoué, le firent rechercher par la meilleure société de la ville5 ; mais les plaisirs du monde ne l’empêchèrent point de continuer ses travaux et ses études, dans les garnisons de Valence, de Lyon, de Douai et d’Auxonne, où son régiment passa successivement. Il adressa au célèbre abbé Raynal le commencement d’une Histoire de la Corse, que le philosophe honora de ses suffrages, et qui a été retrouvée, il y a quelques années. En 1791, sur la demande de Raynal, l’Académie de Lyon proposa la question suivante : « Quels sont les principes et les institutions à inculquer aux hommes pour les rendre les plus heureux possible ? » Napoléon concourut sous le voile de l’anonyme, mais il ne remporta pas le prix, comme on l’a écrit et répété bien des fois ; le concours fut prorogé à l’année 1793, et la couronne fut décernée à M. Daunou.
Le jeune lieutenant resta à Auxonne depuis le 1er mai 1788 jusqu’en avril 1791 ; mais il fit quelques voyages à Paris et en Corse, où il avait été nommé lieutenant-colonel de la garde nationale d’Ajaccio. On se souvint longtemps à Auxonne de ce petit officier maigre, pâle, soucieux, au regard imposant, qui vivait modestement et travaillait sans cesse. C’est à cette époque de sa vie que se rapportent les deux anecdotes suivantes que Napoléon aimait à raconter, lorsque, prisonnier à Sainte-Hélène, il se rappelait les temps heureux de sa jeunesse.
LES BOULETS ESCAMOTES.