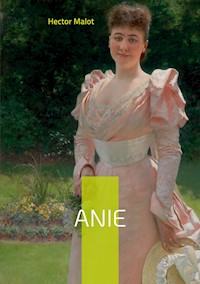1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DigiCat
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Dans 'Ida et Carmelita' de Hector Malot, l'auteur explore les thèmes de la famille, de l'amitié et de la lutte contre l'adversité à travers l'histoire de deux jeunes filles que tout oppose mais qui développent une relation forte et symbiotique. Le style littéraire de Malot est riche en détails et en émotions, captivant le lecteur dès les premières lignes. Situé dans le contexte du 19ème siècle en France, le roman offre un aperçu de la société et des relations humaines de l'époque. Hector Malot, un romancier français renommé, a pu ressentir la profondeur des émotions et des relations humaines, ce qui l'a inspiré à écrire 'Ida et Carmelita'. Son expérience personnelle et son talent pour raconter des histoires captivantes sont évidents dans ce roman. Malot a créé des personnages complexes et authentiques qui restent avec le lecteur bien après avoir terminé le livre. Je recommande 'Ida et Carmelita' à tous les lecteurs qui recherchent une histoire émouvante et bien écrite, pleine de personnages mémorables et de thèmes intemporels. Ce roman de Hector Malot ne manquera pas de toucher votre cœur et de vous captiver jusqu'à la dernière page.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Ida et Carmelita
Table des matières
I
Tout le monde sait que la Suisse est la patrie des hôtels, qui poussent spontanément sur son sol comme les pins et les champignons; pas de village, pas de hameau, si pauvre qu'il soit, pas de site, pour peu qu'il offre une curiosité quelconque, qui n'ait son auberge, son hôtel ou sa pension.
C'est ainsi qu'au hameau du Glion, au-dessus de Montreux, à une altitude de six à sept cents mètres, à la pointe d'une sorte de promontoire qui s'avance vers le lac a été construit l'hôtel du Rigi-Vaudois.
La position, il est vrai, est des plus heureuses, à l'abri des chaleurs comme des froids, au milieu d'un air vif et salubre, en face d'un merveilleux panorama.
Si l'on ne veut pas sortir, on a devant soi les sombres rochers de Meillerie, que couronnent les Alpes neigeuses de la Savoie, et, à droite et à gauche, la nappe bleue du lac, qui commence à l'embouchure du Rhône pour s'en aller vers Genève, jusqu'à ce que ses rives s'abaissent et se perdent dans un lointain confus.
Au contraire, si l'on aime la promenade, on n'a qu'un pas à faire pour se trouver immédiatement sur les pentes herbées ou boisées qui descendent des dents de Naye et de Jaman.
Deux chemins conduisent au Glion: l'un est une bonne route de voiture qui monte du lac par des lacets tracés sur le flanc de la montagne; l'autre est un simple sentier qui grimpe à travers les pâturages et le long d'un torrent.
C'était à cet hôtel du Rigi-Vaudois que le colonel s'était arrêté en venant de Paris; et séduit par le calme autant que par la belle vue, il y avait pris un appartement de trois pièces ouvrant leurs fenêtres sur le lac: une chambre pour lui, une salle à manger où on le servait seul, et une chambre pour Horace.
Il sortait le matin de bonne heure, son alpenstock ferré à la main, un petit sac sur le dos, les pieds chaussés de bons souliers à semelles épaisses et garnies de gros clous et il ne rentrait que dans la soirée, quand il rentrait; car il arrivait souvent que ses excursions l'ayant entraîné au loin, il couchait dans un chalet de la montagne ou dans une auberge d'un village éloigné.
On ne le voyait guère, et le soir quand on entendait de gros souliers ferrés résonner dans le corridor, on savait seulement qu'il rentrait; le matin, en entendant le même pas, on savait qu'il sortait.
Ceux qui occupaient les chambres situées sous les siennes entendaient aussi parfois, dans le silence de la nuit, la marche lente et régulière de quelqu'un qui se promenait, et l'on savait que cette nuit-là, ne pouvant rester au lit, il avait arpenté son appartement.
Enfin ceux des pensionnaires qui, dans la soirée, allaient respirer le frais sur l'esplanade qui domine le lac, apercevaient souvent, en se retournant vers l'hôtel, une grande ombre accoudée à une fenêtre. C'était le colonel, qui restait là à regarder la lune brillant au-dessus des montagnes sombres de la Savoie et frappant les eaux tranquilles du lac de sa lumière argentée.
C'étaient là les seuls signes de vie qu'il donnât, et souvent même on aurait pu penser qu'il était parti, si l'on n'avait pas vu son valet de chambre promener mélancoliquement, dans le jardin de l'hôtel et dans les prairies environnantes, son ennui et son impatience.
—Cela durera donc toujours ainsi? se disait Horace.
Mais ce mot, il le prononçait tout bas et lorsqu'il était seul.
Car, bien qu'il s'ennuyât terriblement au Glion et qu'il regrettât Paris au point d'en perdre l'appétit, il respectait trop son maître pour se permettre une seule question sur ce séjour.
S'il avait pu seulement écrire à Paris, au moins il aurait ainsi expliqué son absence, qui devait paraître incompréhensible. Que devait-on penser de lui? Il avait la religion de sa parole, et c'était pour lui un vrai chagrin d'y manquer. A vrai dire, même, c'était sa grande inquiétude; car de croire qu'on pouvait l'oublier ou le remplacer, il ne le craignait pas.
Un jour qu'il avait été s'asseoir sur la route qui monte de Montreux au Glion, à l'entrée d'une grotte tapissée de fougères qui se trouve à l'un des détours de cette route, il vit venir lentement, au pas, une calèche portant trois personnes: deux dames assises sur le siège de derrière, un monsieur placé sur le siège de devant.
Et tout en regardant cette calèche qui s'avançait cahin-caha, il se dit que les voyageurs qu'elle apportait allaient être bien désappointés en arrivant, car il n'y avait pas d'appartement libre en ce moment à l'hôtel.
Ah! comme il eût volontiers cédé sa chambre et celles de son maître, à ces voyageurs, à condition qu'ils lui auraient offert leur calèche pour descendre à la station, où il se serait embarqué pour Paris.
Cependant la voiture avait continué de monter la côte et elle s'était rapprochée.
Tout à coup il se frotta les yeux comme pour mieux voir. L'une des deux dames était vieille, avec des cheveux gris et une figure jaune; l'autre était jeune, avec des cheveux noirs et un teint éblouissant, qui renvoyait les rayons de la lumière.
Il semblait que ces deux femmes fussent la comtesse Belmonte et sa fille, la belle Carmelita.
Il s'était avancé sur le bord de la route pour mieux regarder au-dessous de lui. Mais à ce moment la voiture était arrivée à l'un des tournants du chemin, et brusquement les deux dames, qu'il voyait de face, ne furent plus visibles pour lui que de dos.
Seulement, par une juste compensation de cette déception, le monsieur qui lui faisait vis-à-vis devint visible de face.
C'était un homme de grande taille, avec une barbe noire, mais cette barbe était tout ce qu'on pouvait voir de son visage; car, en regardant d'en haut, l'oeil était arrêté par les rebords de son chapeau, qui le couvraient jusqu'à la bouche.
A un certain moment, il releva la tête vers le sommet de la montagne, et Horace le vit alors en face.
Il n'y avait pas d'erreur possible, c'était le prince Mazzazoli accompagnant sa soeur et sa nièce.
Pendant que la voiture avançait, Horace se demanda quel effet cette arrivée allait produire sur son maître.
Quelle heureuse diversion cependant pourrait jeter dans leur vie la belle Italienne, si le colonel voulait bien ne pas se sauver au loin comme un sauvage.
Quel malheur qu'il n'y eût pas de chambres libres en ce moment à l'hôtel du Rigi-Vaudois!
Pendant qu'il cherchait à arranger les choses pour le mieux, c'est-à-dire à trouver un moyen de garder le prince et sa nièce, la calèche était arrivée vis-à-vis la grotte.
—Comment! vous ici, Horace? s'écria le prince en se penchant en avant.
Horace s'était avancé.
—Est-ce que le colonel est en Suisse? demanda la comtesse Belmonte.
A cette question de la comtesse, Horace se trouva assez embarrassé; car sans savoir si son maître serait ou ne serait pas bien aise de voir des personnes de connaissance, il n'avait pas oublié la consigne qui lui avait été donnée.
Comme il hésitait, ce fut mademoiselle Belmonte qui l'interrogea.
—Comment se porte le colonel? dit-elle.
Il était ainsi fait, qu'il ne savait ni résister, ni rien refuser à une femme.
—Hélas! pas trop bien, répondit-il.
—Et où donc êtes-vous présentement? demanda le prince.
Horace en avait trop dit pour refuser maintenant de répondre.
Il dit donc que son maître et lui étaient à l'hôtel du Rigi-Vaudois.
—A l'hôtel du Rigi-Vaudois, vraiment? Quelle bizarre coïncidence! c'était là justement qu'ils allaient.
—Le cocher nous disait qu'il n'y avait pas de chambres vacantes en ce moment, continua la comtesse. Est-ce que cela est vrai? le savez-vous?
Hélas! oui, il le savait et il fut bien obligé d'en convenir.
A l'hôtel, le Kellner répéta au prince Mazzazoli ce qu'Horace avait déjà dit:
—Il n'y avait pas d'appartement disponible en ce moment. Si Son Excellence avait pris la peine d'envoyer une dépêche, quelques jours à l'avance, on aurait été heureux de se conformer à ses ordres; mais on ne pouvait pas déposséder les personnes arrivées depuis longtemps, pour donner leurs appartements à des nouveaux venus, si respectables que fussent ceux-ci.
Horace voulut intervenir, mais ce fut inutilement.
—La seule chambre libre en ce moment est celle qui sert de salle à manger à votre maître, et encore n'est-ce pas ce qu'on peut appeler une chambre libre; elle ne le deviendrait que s'il voulait bien la céder.
A ce mot, le prince, qui avait tout d'abord montré un vif mécontentement, se radoucit, et, se tournant vers Horace:
—Est-ce que le colonel tient beaucoup à cette chambre? demanda-t-il; en a-t-il un réel besoin? Si je me permets cette insistance, c'est que nous nous trouvons placés dans des conditions toutes particulières. Le séjour de Paris, dans un air mou et vicié, a été contraire à la santé de madame la comtesse Belmonte; on lui a ordonné, comme une question de vie ou de mort, l'habitation, pendant quelque temps, dans une haute station atmosphérique, et c'est là ce qui nous a fait choisir le Glion, où, nous assure-t-on, son anémie et sa maladie nerveuse disparaîtront comme par enchantement, par miracle, dans cet air raréfié.
—Nous avons bien en haut, tout en haut, sous les toits, deux chambres ou plus justement deux cabinets, mais qui ne sont pas habitables pour des dames; si Son Excellence tient essentiellement à loger au Rigi, il n'y aurait qu'un moyen, ce serait que M. le colonel cédât la chambre lui servant de salle à manger, en même temps ce serait que M. Horace Cooper voulût bien abandonner aussi sa chambre et se contenter d'un cabinet sous les toits. Alors les deux dames auraient un appartement convenable. Il est vrai que Son Excellence et M. Horace Cooper seraient horriblement mal logés. Mais comment faire autrement en attendant le départ de quelques pensionnaires, départ prochain d'ailleurs, et qui ne dépasserait pas deux ou trois jours?
—Il faudrait voir le colonel, dit le prince, car, malgré l'ennui que tout cela pourra lui causer, je suis certain qu'il ne nous refusera pas ce service dans les conditions critiques où nous nous trouvons.
Horace accueillit avec empressement cette idée qui le tirait d'embarras.
Car, malgré son envie de retenir mademoiselle Belmonte, et de la voir se fixer au Glion, il n'osait prendre sur lui d'accepter l'arrangement proposé par le prince Mazzazoli; il y aurait eu là, en effet, un acte d'autorité un peu violent.
Et tandis que le prince Mazzazoli faisait venir ses bagages de Montreux, en homme qui ne doute pas de l'acceptation de ses combinaisons, Horace quittait l'hôtel pour aller se poster sur le chemin par lequel il supposait que le colonel devait revenir de sa promenade.
Les heures s'écoulèrent sans que le colonel parût.
Déjà les ombres qui avaient envahi les vallées les plus basses commençaient à monter le long des montagnes et l'air se rafraîchissait.
Comme Horace se demandait s'il ne devait pas rentrer à l'hôtel, il aperçut son maître qui descendait le sentier au bout duquel il l'attendait.
Le colonel marchait lentement, le bâton ferré sur l'épaule, la tête inclinée en avant, comme un homme préoccupé qui suit sa pensée et ne se laisse pas distraire par les agréments du chemin qu'il parcourt.
Il vint ainsi sans lever la tête, jusqu'à quelques pas d'Horace.
Mais l'ombre que celui-ci projetait sur le chemin l'arrêta et le fit lever les yeux.
—Toi? dit-il.
—C'est M. le prince Mazzazoli qui est arrivé à l'hôtel, ainsi que madame la comtesse Belmonte et mademoiselle Carmelita.
—Et qui leur a dit que j'habitais cet hôtel du Rigi.
—Ils ne savaient pas trouver mon colonel. C'est le prince lui-même qui me l'a dit.
Et Horace expliqua comment il avait par hasard rencontré la calèche qui amenait le prince à l'hôtel du Rigi, et comment le prince lui avait expliqué qu'il venait en Suisse pour la santé de la comtesse. Il fallait à celle-ci une habitation à une altitude élevée: c'était disaient les médecins, une question de vie ou de mort.
—Je croyais qu'il n'y avait pas de chambres disponibles en ce moment à notre hôtel, interrompit le colonel.
—Justement il n'y en a pas.
—Eh bien! alors?
Horace entreprit le récit de ce qui s'était passé, comment le sommelier avait été amené par hasard, par force pour ainsi dire, à parler de la chambre que le colonel transformait en salle à manger, et comment le prince attendait l'arrivée du colonel pour lui demander cette chambre.
A ce mot, le colonel frappa fortement la terre de son alpenstock.
—C'est bien, dit-il, je ne rentre pas; le prince se décidera sans doute à chercher plus loin; tu diras que tu ne m'as pas rencontré. Je ne reviendrai que dans quelques jours.
—Ah! mon colonel.
Et Horace qui voyait s'évanouir ainsi le plan qu'il avait formé, essaya de représenter à son maître combien cette explication serait peu vraisemblable.
Pendant quelques secondes le colonel resta hésitant; puis, tout à coup, comme s'il avait pris son parti:
—C'est bien, dit-il, rentrons à l'hôtel.
—Puis-je prendre les devants pour annoncer votre arrivée?
—Non; je désire m'expliquer moi-même avec le prince.
En arrivant à l'hôtel, il aperçut le prince installé avec sa soeur et sa nièce dans le jardin où ils prenaient des glaces; vivement le prince se leva pour accourir au devant de lui: jamais accueil ne fut plus chaleureux.
Après le départ d'Horace, le prince avait fait monter son bagage dans le cabinet qui lui était donné sous les toits, mais il avait voulu que les malles de sa soeur et de sa nièce restassent dans le vestibule de l'hôtel.
Avant de s'installer dans la salle à manger du colonel, il fallait attendre le retour de celui-ci.
Il était convenable de lui demander cette chambre.
Seulement, en même temps, il était bon de le mettre dans l'impossibilité de la refuser.
Où coucheraient la comtesse et Carmelita?
Devant une pareille question, la réponse ne pouvait pas être douteuse.
C'était donc en costume de voyage que la comtesse et Carmelita avaient dîné à table d'hôte, où leur présence avait fait sensation.
Pour Carmelita, elle se contenta de tendre la main au colonel et de poser sur lui ses grands yeux, qui s'étaient éclairés d'une flamme rapide.
Mais ce n'était pas seulement pour avoir le plaisir de serrer la main de ce cher colonel que le prince Mazzazoli attendait son retour avec impatience.
Il avait une demande à lui adresser, une prière, la plus importune, la plus inconvenante, mais qui lui était imposée par la nécessité.
—Je sais par Horace de quoi il s'agit, interrompit le colonel, et je suis heureux de mettre deux de mes chambres à la disposition de ces dames. Je regrette seulement que vous n'en ayez pas déjà pris possession en m'attendant, car vous deviez bien penser que je m'empresserais de vous les offrir.
Comme le prince se confondait en excuses en même temps qu'en remercîments, le colonel l'interrompit de nouveau.
—Je vous assure que vous ne me devez pas tant de reconnaissance. Au reste le sacrifice que je vous fais est bien petit, et je regrette même que les circonstances le rende si insignifiant.
—Il n'en est pas moins vrai que, pour nous, vous vous privez de vos chambres, dit Carmelita.
—Pour une nuit....
—Comment! pour une nuit? s'écria le prince.
—Je pars demain soir.
Carmelita attacha sur le colonel un long regards qui fit baisser les yeux à celui-ci.
Pour échapper à l'embarras que ce regard de Carmelita lui causait, il se jeta dans des explications sur son départ, arrêté depuis longtemps, dit-il, et qui ne pouvait être différé.
Puis presqu'aussitôt, prétextant la fatigue, le prince demanda au colonel la permission de conduire la comtesse à sa chambre.
Dans son état, elle avait besoin des plus grands ménagements.
Et tout bas il dit au colonel que la pauvre femme était bien mal et qu'un accès de fatigue pouvait la tuer.
II
Ce que le colonel eût voulu savoir et ce qu'il se demandait curieusement, c'était pourquoi le prince était venu au Glion.
Il n'avait point oublié, bien entendu, ce que madame de Lucillière lui avait si souvent répété à propos des projets du prince et de ses espérances matrimoniales.
Il se pouvait donc très bien que ce voyage au Glion n'eût pas d'autre but que l'accomplissement de ces projets et la réalisation de ces espérances.
Sachant ce qui s'était passé avec madame de Lucillière, le prince avait trouvé que le moment était favorable pour mettre Carmelita en avant et la présenter comme une consolatrice.
Alors la maladie de la comtesse Belmonte n'était qu'un prétexte pour expliquer ce voyage.
Il faut dire que le colonel n'était nullement disposé à l'infatuation, et que de lui-même il n'eût très probablement jamais imaginé qu'on pouvait courir après lui pour le marier avec une jolie fille. Mais madame de Lucillière lui avait si souvent parlé de ce projet du prince, que le souvenir de ces paroles ne pouvait pas ne pas l'inquiéter en présence d'une arrivée si étrange.
En tout cas, il n'y avait pour lui qu'une chose à faire.
Quitter le Glion.
Lorsqu'il monta à sa chambre, il ouvrit sa porte avec précaution et il marchait doucement en évitant de faire du bruit, de peur de déranger ses voisines, lorsqu'il entendit frapper quelques petits coups à la cloison.
En même temps, une voix,—celle de Carmelita,—l'appela.
—Colonel, c'est vous, n'est-ce pas!
On parlait contre la porte qui mettait les deux chambres en communication intérieure et qui, alors qu'il occupait ces deux chambres, restait toujours ouverte.
—Oui, c'est moi, dit-il.
—Je vous ai bien reconnu aux précautions que vous preniez pour ne pas faire de bruit; ne vous gênez pas, je vous prie. C'est moi qui suis votre voisine. J'ai le sommeil bon; quand je dors, rien ne me réveille. Bonsoir.
—Bonsoir.
Comment? il serait exposé tous les soirs à des dialogues de ce genre; à chaque instant dans le jour, il verrait Carmelita! Ah! certes non, et le lendemain il quitterait le Glion.
Le lendemain matin, comme il sortait de sa chambre, il trouva dans le vestibule le prince Mazzazoli qui se promenait en long et en large.
—Auriez-vous deux minutes à me donner? demanda-t-il en serrant la main du colonel.
—Mais tout ce que vous voudrez.
—Connaissez-vous Champéry? j'entends, y êtes-vous allé?
—Non.
—Et les Diablerets?
—Je n'y suis pas allé non plus.
—Et le val d'Anniviers?
—Je ne le connais que par les livres.
—Voilà qui est fâcheux. J'avais compté sur vous pour me tirer d'embarras: les livres, les guides, c'est parfait, mais dans notre situation ce n'est pas suffisant.
—Et que vous importe Champéry ou le val d'Anniviers?
—Il faut être franc, n'est-ce pas? D'ailleurs je voudrais ne pas l'être, que cela me serait impossible. Je vous demande des renseignements sur Champéry et les Diablerets, parce que mon intention est d'aller aux Diablerets, ou à Champéry, ou au val d'Anniviers, enfin dans un pays où ma pauvre soeur trouvera les conditions atmosphériques qui sont ordonnées; et si je choisis ces pays, c'est parce qu'ils ne sont qu'à une courte distance du Glion.
—Mais le Glion lui-même?
—J'avais choisi le Glion, parce que je le connaissais et que je savais que c'était la station par excellence pour ma malheureuse soeur. Mais nous ne pouvons pas rester au Glion. Vous m'avez demandé d'être franc, je veux l'être jusqu'au bout. Avec une bonne grâce parfaite, avec un élan spontané, vous avez voulu nous céder vos chambres; mais il est bien évident que notre présence vous gêne.
—Comment pouvez-vous penser?
—Je ne pense pas, je suis certain. Pour des raisons que je n'ai pas à examiner, vous désirez être seul; notre voisinage vous incommode et vous trouble. Alors vous partez. Eh bien, mon cher colonel, cela ne doit pas être. Ce n'est pas à vous de partir, c'est à nous de vous céder la place.
—Permettez....
—Je vous en prie, laissez-moi achever. Nous sommes ici dans des conditions tout à fait particulières. Si vous n'aviez pas habité cet hôtel, nous n'aurions pas pu nous y faire recevoir. Nous ne sommes donc ici que par vous, par votre complaisance. Eh bien, mon cher colonel, il serait tout à fait absurde que vous fussiez victime de votre complaisance. Nous vous gênons; vous désirez la solitude, que vous ne pouvez plus trouver, nous ayant pour voisins. Nous nous en allons: rien n'est plus simple, rien n'est plus juste. Voilà pourquoi je vous demandais des renseignements sur les hôtels des environs, pensant que vous les connaissiez et ne voulant pas me lancer à l'aventure avec une malade.
—Jamais je n'accepterai ce départ.
—Et moi, jamais je n'accepterai le vôtre.
—Mon intention n'était pas de rester au Glion.
—Elle n'était pas non plus d'en partir aujourd'hui. De cela, je suis bien certain; j'ai interrogé Horace, qui ne savait rien, et qui assurément eût été prévenu si votre départ avait été arrêté avant notre arrivée.
Le colonel demeura assez embarrassé. Il ne lui convenait pas en effet de reconnaître qu'il quittait l'hôtel pour fuir la présence du prince et de Carmelita: c'était là une grossièreté qui n'était pas dans ses habitudes, ou bien c'était avouer sa faiblesse pour madame de Lucillière, ce qui le blessait dans sa pudeur d'amant malheureux.
—Devant partir un jour ou l'autre, il est bien naturel cependant que je vous cède tout de suite une chambre qui vous est indispensable, car vous ne pouvez pas rester dans le trou où vous avez passé la nuit.
—Un jour ou l'autre, je vous le répète, je comprends cela; ce que je ne comprends pas, c'est aujourd'hui. Ainsi, voilà qui est bien entendu: si vous persistez dans votre intention de partir ce soir, c'est nous qui partons ce matin pour les Diablerets ou pour Champéry, peu importe; si au contraire vous restez pour quelques jours, nous restons, nous aussi, tout le temps qui sera nécessaire pour la santé de ma soeur.
Dépossédé de la chambre dans laquelle il prenait ses repas, le colonel dut déjeuner dans la salle à manger commune.
Au moment où il allait entrer dans cette salle, il se rencontra avec le prince, et celui-ci lui proposa de prendre place à la table qu'il s'était fait réserver, au lieu de s'asseoir à la grande table.
Il se trouva donc placé entre la comtesse et Carmelita, et, au lieu de lire tout en mangeant, comme il en avait l'habitude lorsqu'il était seul, il dut soutenir une conversation suivie.
Il avait une crainte assez poignante, qui était que la comtesse ou Carmelita vinssent à parler de madame de Lucillière; mais le nom de la marquise ne fut même pas prononcé, et, comme s'il y avait eu une entente préalable pour éviter les sujets qui pouvaient le gêner, on ne parla pas de Paris.
La comtesse ne s'occupa que de sa maladie, et Carmelita que du pays dans lequel elle allait passer une saison.
Elle montra même tant d'empressement à connaître ce pays, que le colonel se trouva pour ainsi dire obligé à se mettre à sa disposition pour la guider après le déjeuner.
—Nous commanderons une voiture, dit le prince, et et nous emploierons notre après-midi à visiter les villages environnants.
Pendant que la comtesse et sa fille allaient revêtir une toilette de promenade, le prince prit le colonel par le bras et l'emmena à l'écart.
—Est-ce que vous avez reçu des lettres de Paris depuis votre départ? demanda-t-il.
—Non.
—Alors vous ignorez l'effet que ce départ a produit?
C'était là un sujet de conversation qui ne pouvait être que très pénible pour le colonel; il ne répondit donc pas à cette question.
Mais le prince continua:
—Personne ne s'est mépris sur les causes qui ont provoqué votre brusque détermination.
Le colonel leva le bras, comme pour fermer la bouche au prince; mais celui-ci parut ne pas comprendre ce geste.
—Et tout le monde vous a approuvé, dit-il; il n'y a qu'une voix dans tout Paris.
Disant cela, le prince Mazzazoli tendit sa main au colonel comme pour joindre sa propre approbation à celle de tout Paris.
La situation était embarrassante pour le colonel. Que signifiaient ces paroles? Pourquoi et à propos de quoi l'avait-on approuvé? C'était une question qu'il ne pouvait pas poser au prince cependant.
—Je vous dirai entre nous, continua celui-ci, que madame de Lucillière elle-même n'a pas caché son sentiment.
Ce nom ainsi prononcé le fit pâlir et son coeur se serra, mais la curiosité l'empêcha de s'abandonner à son émotion.
—Quel sentiment? demanda-t-il.
—Mais celui qu'elle a éprouvé en apprenant votre départ. D'abord, quand on a commencé à croire que vous aviez véritablement quitté Paris, on a été fort étonné; tout le monde avait pensé qu'il ne s'agissait que d'une excursion de quelques jours. Mais, en ne vous voyant pas revenir, on a compris que c'était au contraire un vrai départ. Pourquoi ce départ? C'est la question que chacun s'est posée, et, chez tout le monde, la réponse a été la même.
Sur ce mot, le prince Mazzazoli fit une pause et regarda le colonel en se rapprochant de lui.
—Trouvant votre responsabilité trop gravement compromise dans votre association avec le marquis de Lucillière, vous vouliez bien établir que vous n'étiez pour rien dans les paris engagés sur Voltigeur.
Le colonel respira: l'esprit et le coeur remplis d'une seule pensée, il n'avait nullement songé à cette explication, et il avait tout rapporté, dans ces paroles à double sens, à madame de Lucillière.
—Un jour que l'on discutait votre départ mystérieux dans un cercle composé des fidèles ordinaires de la marquise, le duc de Mestosa, le prince Sératoff, lord Fergusson, madame de Lucillière affirma très nettement que vous aviez bien fait de quitter Paris. «Le colonel est un homme violent, dit-elle, un caractère emporté; il eût pu se lâcher en entendant les sots propos qu'on colporte sur les gains extraordinaires de Voltigeur, et avec lui les choses seraient assurément allées à l'extrême. Il a voulu se mettre dans l'impossibilité de se laisser emporter; je trouve qu'il a agi sagement.» Vous pensez, mon cher ami, si ces paroles ont jeté un froid parmi nous. Personne n'a répliqué un mot. Mais la marquise, s'étant éloignée, on s'est expliqué, et tout le monde est tombé d'accord sur la traduction à faire des paroles de madame de Lucillière. Évidemment la femme ne pouvait pas accuser le mari franchement, ouvertement; mais, d'un autre côté, l'amie ne voulait pas qu'on pût vous soupçonner de vous associer aux procédés du marquis. De là ce petit discours assez obscur, en apparence, mais au fond très clair. Qu'en pensez-vous?
Ainsi la marquise n'avait pas craint d'expliquer leur rupture en jetant la suspicion sur son mari. «Ce n'est pas avec moi qu'il a rompu, avait-elle dit; c'est avec M. de Lucillière.»
Elle tenait donc bien à ménager la jalousie de ses fidèles, qu'elle ne reculait pas devant une pareille explication.
A ce moment, la comtesse Belmonte et Carmelita descendirent dans le jardin, prêtes pour la promenade, et l'on monta en voiture.
Le prince s'étant placé vis-à-vis de sa soeur, le colonel se trouva en face de Carmelita.
Il ne pouvait pas lever les yeux sans rencontrer ceux de la belle Italienne, posés sur les siens.
La promenade fut longue et ils restèrent plusieurs heures ainsi en face l'un de l'autre.
—Est-ce qu'il y a des chemins de voiture pour aller sur les flancs de cette montagne? demanda Carmelita en rentrant à l'hôtel et en montrant du bout de son ombrelle les pentes boisées du mont Cubli.
—Non, répondit le colonel; il n'y a que des sentiers pour les piétons.
—Ne me demande pas de t'accompagner, dit le prince; tu sais que les ascensions sont impossibles pour moi.
—Oh! quand je voudrai faire cette promenade, ce ne sera pas à vous que je m'adresserai, mon cher oncle, dit-elle en riant; ce sera au colonel.
III
Le colonel, le lendemain matin, était parti en excursion de manière à n'être pas exposé à refuser Carmelita, ce qui était presque impossible, ou à l'accompagner, ce qui n'était pas pour lui plaire dans les conditions morales où il se trouvait présentement.
Il resta absent pendant deux jours, et ne revint qu'assez tard dans la soirée, bien décidé à repartir le lendemain matin. Il n'y avait pas deux minutes qu'il était dans sa chambre, lorsqu'il entendit frapper deux ou trois petits coups à la porte cloison; en même temps une voix,—celle de Carmelita—l'appela:
—Vous rentrez?
—A l'instant.
—Vous avez fait bon voyage?
—Très bon, je vous remercie.
—Est-ce que vous êtes mort de fatigue?
—Pas du tout.
—Ah! tant mieux. Est-ce que la porte est condamnée de votre côté!
—Elle est fermée à clef.
—Et vous avez la clef?
—Elle est sur la serrure.
—De sorte que, si vous voulez, voue pouvez ouvrir cette porte?
—Mais pas du tout; il y a un verrou de votre côté?
—Je sais bien. Je dis seulement que, si vous voulez tourner la clef en même temps que je pousse le verrou, la porte s'ouvre.
—Parfaitement.
—Eh bien! alors, si vous n'êtes pas mort de fatigue, vous plaît-il de tourner la clef? moi, je pousse le verrou.
Carmelita apparut, le visage souriant, la main tendue:
—Bonsoir, voisin, dit-elle.
—Bonsoir, voisine.
Et ils restèrent en face l'un de l'autre durant quelques secondes.
—Ma mère est endormie, et son premier sommeil est ordinairement difficile à troubler; cependant, en parlant ainsi à travers les cloisons, nous aurions pu la réveiller. Voilà pourquoi je vous ai demandé d'ouvrir cette porte.
Elle ne montrait nul embarras et paraissait aussi à son aise dans cette chambre qu'en plein jour, au milieu d'un salon.
—Depuis plus d'une heure je guettais votre retour, dit-elle, et je croyais déjà qu'il en serait aujourd'hui comme il en avait été hier.
—Hier j'ai été surpris par la nuit à une assez grande distance, et je n'ai pas pu rentrer.
—Et où avez-vous couché?
—Sur un tas de foin dans un chalet de la montagne.
—Mais c'est très amusant, cela.
—Cela vaut mieux que de coucher à la belle étoile, car les nuits sont fraîches dans la montagne; mais il y a quelque chose qui vaut encore beaucoup mieux qu'un tas de foin, c'est un bon lit.
—Vous aimez ces courses dans la montagne.
—J'aime la vie active, la fatigue; ces courses me délassent de la vie sédentaire que j'ai menée en ces derniers temps.
—Ah! vous êtes heureux.
Comme il ne répondait pas, elle continua:
—J'entends que vous êtes heureux de faire ce que vous voulez, d'aller où vous voulez, sans avoir à consulter personne. Savez-vous que depuis que je ne suis plus une toute petite fille, je n'ai pu faire un pas sans la permission de mon oncle, et il faut dire que presque toutes les fois que je lui ai demandé d'aller à gauche il m'a permis d'aller à droite.
Elle s'avança dans la chambre, et, prenant une chaise, elle s'assit.
—Je vous donne l'exemple, dit-elle, car je ne veux pas tenir sur ses jambes un homme qui a marché toute la journée.
Il s'assit alors près d'elle, assez intrigué par la tournure que prenait cet entretien bizarre.
—Quel but pensez-vous que j'aie eu en vous priant d'ouvrir cette porte? demanda-t-elle.
—Dame!... je n'en sais rien... à moins que ce ne soit pour causer un instant.
—Vous n'y êtes pas du tout: j'ai une prière à vous adresser.
—A moi?
—Et qui me rendra très heureuse si vous ne la repoussez point.
—Alors il est entendu d'avance que ce que vous souhaitez sera fait.
—Non, rien à l'avance: écoutez-moi d'abord, et puis, selon que ce que je vous demanderai vous plaira ou ne vous plaira point, vous me répondrez. Vous souvenez vous d'un mot que j'ai dit l'autre jour, à notre retour de notre promenade en voiture?
—A propos de quoi ce mot?
—A propos d'une excursion dans la montagne.
—Parfaitement.
—Eh bien! ce mot m'a valu une vive remontrance de mon oncle, et, quand je dis remontrance, c'est pour ne pas employer une expression plus forte. Cependant cela ne m'a pas fait renoncer à mon idée, et plus mon oncle m'a dit que j'avais commis une sottise et une inconvenance en manifestant le désir de vous accompagner dans une de vos excursions, plus ce désir a été ardent. Cet aveu va peut-être vous donner une assez mauvaise idée de mon caractère, mais au moins il vous prouvera que je suis franche. Et puis ce désir n'est-il pas bien justifiable, après tout? Je suis enfermée dans cet hôtel; ma mère est empêchée de sortir par sa maladie, mon oncle est retenu par son horreur de la fatigue et de la marche. Moi, qui ne suis pas malade et qui n'ai pas horreur de la marche, j'ai envie de voir ce qu'il y a derrière ces rochers qui se dressent du matin au soir devant mes yeux comme des points d'interrogation. N'est-ce pas tout naturel? Et voilà pourquoi je veux vous demander de vous accompagner quelquefois. Voilà ma prière. Enfin voilà comment j'ai été amenée à pousser ce verrou.