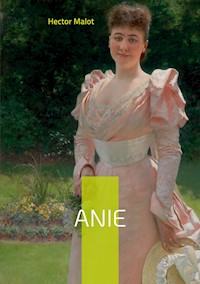0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 0,00 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DigiCat
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Dans son roman 'Romains Kalbris', Hector Malot nous plonge dans la Rome antique avec une intrigue captivante et des descriptions saisissantes de la vie quotidienne à cette époque. Son style d'écriture est à la fois poétique et réaliste, capturant l'essence même de l'époque romaine. Malot mêle savamment l'histoire et la fiction pour créer une œuvre littéraire immersive et enrichissante, offrant un regard unique sur la civilisation romaine. 'Romains Kalbris' se distingue par son approche unique de la narration historique, offrant aux lecteurs une expérience littéraire inoubliable.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Romains Kalbris
Table des matières
I
De ma position présente, il ne faut pas conclure que j’ai eu la Fortune pour marraine. Mes ancêtres, si le mot n’est pas bien ambitieux, étaient des pêcheurs; mon père était le dernier de onze enfants, et mon grand-père avait eu bien du mal à élever sa famille, car dans ce métier-là plus encore que dans les autres le gain n’est pas en proportion du travail; compter sur de la fatigue, du danger, c’est le certain, sur un peu d’argent, le hasard.
A dix-huit ans, mon père fut pris par l’inscription maritime; c’est une espèce de conscription, au moyen de laquelle l’État peut se faire servir par tous les marins pendant trente-deux ans, — de dix-huit à cinquante. Il partit ne sachant ni lire ni écrire. Il revint premier maître, ce qui est le plus haut grade auquel parviennent ceux qui n’ont point passé par les écoles du gouvernement.
Le Port-Dieu, notre pays, étant voisin des îles anglaises, l’État y fait stationner un cotre de guerre, qui a pour mission d’empêcher les gens de Jersey de venir nous prendre notre poisson, en même temps qu’il force nos marins à observer les règlements sur la pêche: ce fut sur ce cotre que mon père fut envoyé pour continuer son service. C’était une faveur, car, si grandement habitué que l’on soit à faire de son navire la patrie, on est toujours heureux de revenir au pays natal.
Quinze mois après ce retour, je fis mon entrée dans le monde, et comme c’était en mars, un vendredi, jour de nouvelle lune, on s’accorda pour prédire que j’aurais des aventures, que je ferais des voyages sur mer, et que je serais très-malheureux, si l’influence de la lune ne contrariait pas celle du vendredi: — des aventures, j’en ai eu, et ce sont elles précisément que je veux vous raconter; — des voyages sur mer, j’en ai fait; — quant à la lutte des deux influences, elle a été vive; c’est vous qui direz à la fin de mon récit laquelle des deux l’a emporté.
Me prédire des aventures et des voyages, c’était reconnaître que j’étais bien un enfant de la famille, car de père en fils tous les Kalbris avaient été marins, et même, si la légende est vraie, ils l’étaient déjà au temps de la guerre de Troie. Ce n’est pas nous, bien entendu, qui nous donnons cette origine, mais des savants qui prétendent qu’il y a au Port-Dieu une centaine de familles, précisément celles des marins, qui descendent d’une colonie de Phéniciens. Ce qu’il y a de certain, c’est qu’avec nos yeux noirs, notre teint bistré, notre nez fin, nous n’avons rien du type normand ou breton, et que nos barques de pêche sont la reproduction exacte du bateau d’Ulysse tel que nous le montre Homère: un seul mât avec une voile carrée; ce gréement, très-commun dans l’Archipel, est unique dans la Manche.
Pour nous, nos souvenirs remontaient moins loin, et même leur uniformité les rendait assez confus; quand on parlait d’un parent, l’histoire n’était guère variée: tout enfant, il avait été à la mer, et c’était à la mer ou au delà des mers, chez des peuples dont les noms sont difficiles à retenir, qu’il était mort dans un naufrage, dans des batailles, sur les pontons anglais; les croix portant le nom d’une fille ou d’une veuve étaient nombreuses dans le cimetière, celles portant le nom d’un garçon ou d’un homme l’étaient peu; ceux-là ne mouraient pas au pays. Comme dans toutes les familles pourtant, nous avions nos héros: l’un était mon grand-père maternel, qui avait été le compagnon de Surcouf; l’autre était mon grand-oncle Flohy. Aussitôt que je compris ce qui se disait autour de moi, j’entendis son nom dix fois par jour; il était au service d’un roi de l’Inde qui avait des éléphants; il commandait des troupes contre les Anglais, et il avait un bras d’argent; des éléphants, un bras d’argent, ce n’était pas un rêve.
Ce fut le besoin d’aventures inné dans tous les Kalbris qui fit prendre à mon père un nouvel embarquement peu d’années après son mariage: il eût pu commander comme second une des goëlettes qui partent tous les ans au printemps pour la pêche d’Islande; mais il était fait au service de l’État et il l’aimait.
Je ne me rappelle pas son départ. Mes seuls souvenirs de cette époque se rapportent aux jours de tempête, aux nuits d’orage et aux heures que j’allais passer devant le bureau de poste.
Combien de fois, la nuit, ma mère m’a-t-elle fait prier devant un cierge qu’elle allumait! Pour nous, la tempête au Port-Dieu c’était la tempête partout, et le vent qui secouait notre maison nous semblait secouer en même temps le navire de mon père. Quelquefois il soufflait si fort qu’il fallait se relever pour attacher les fenêtres, car notre maison était une maison de pauvres gens; bien qu’elle fût abritée d’un côté par un éboulement de la falaise, et de l’autre par un rouf qui avait autrefois été le salon d’un trois-mâts naufragé, elle résistait mal aux bourrasques d’équinoxe. Une nuit d’octobre, ma mère me réveilla: l’ouragan était terrible, le vent hurlait, la maison gémissait, et il entrait des rafales qui faisaient vaciller la flamme du cierge jusqu’à l’éteindre; dans les moments d’apaisement, on entendait la bataille des vagues contre les galets, et, comme des détonations, les coups de mer dans les trous de la falaise. Malgré ce bruit formidable, je ne tardai pas à me rendormir à genoux: tout à coup la fenêtre fut arrachée de ses ferrures, jetée dans la chambre où elle se brisa en mille pièces, et il me sembla que j’étais enlevé dans un tourbillon.
— Ah! mon Dieu, s’écria ma mère, ton. père est perdu!
Elle avait la foi aux pressentiments et aux avertissements merveilleux; une lettre qu’elle reçut de mon père quelques mois après cette nuit de tempête rendit cette foi encore plus vive; par une bizarre coïncidence, il avait été précisément, dans ce mois d’octobre, assailli par un coup de vent et en grand danger. Le sommeil de la femme d’un marin est un triste sommeil: rêver naufrage, attendre une lettre qui n’arrive pas, sa vie se passe entre ces deux angoisses.
Au temps dont je parle, le service des lettres ne se faisait pas comme aujourd’hui; on les distribuait tout simplement au bureau, et quand ceux auxquels elles étaient adressées tardaient trop à venir les prendre, on les leur envoyait par un gamin de l’école. Le jour où le courrier arrivait de Terre-Neuve, le bureau était assiégé, car, du printemps à l’automne, tous les marins sont embarqués pour la pêche de la morue, et un étranger qui arriverait au pays pourrait croire qu’il est dans cette île dont parle l’Arioste et d’où les hommes étaient exclus; aussi les femmes étaient-elles pressées d’avoir des nouvelles. Leurs enfants dans les bras, elles attendaient qu’on fît l’appel des noms. Les unes riaient en lisant, les autres pleuraient. Celles qui n’avaient pas de lettres interrogeaient celles qui en avaient reçu: ce n’est pas quand les marins sont à la mer qu’on peut dire: «Pas de nouvelles, bonnes nouvelles.»
Il y avait une vieille femme qui venait tous les jours depuis six ans, et qui depuis six ans n’avait pas reçu une lettre; on la nommait la mère Jouan, et l’on racontait qu’un canot monté par son mari et ses quatre garçons avait disparu dans un grain, sans qu’on eût retrouvé ni le canot ni les hommes. Depuis que ce bruit s’était répandu, elle venait chaque matin à la poste. «Il n’y a encore rien pour vous, disait le buraliste, ce sera pour demain.» Elle répondait tristement: «Oui, pour demain. » Et elle s’en retournait pour revenir le lendemain. On disait qu’elle avait la tête dérangée: si folle elle était, je n’ai depuis jamais vu folie triste et douce comme la sienne.
Presque toutes les fois que j’allais au bureau, je la trouvais déjà arrivée. Comme le buraliste était à la fois épicier et directeur de la poste, il commençait naturellement par s’occuper de ceux qui lui demandaient du sel ou du café, et nous donnait ainsi tout le temps de causer; méthodique et rigoureux sur les usages de sa double profession, il nous allongeait encore ce temps par toutes sortes de cérémonies préparatoires: épicier, il portait un tablier bleu et une casquette; directeur de la poste, une veste de drap et une toque en velours. Pour rien au monde, il n’eût servi de la moutarde la toque sur la tête, et, sachant qu’il avait entre les mains une lettre de laquelle dépendait la vie de dix hommes, il ne l’eût pas remise sans ôter son tablier.
Tous les matins, la mère Jouan me recommençait son récit: «Ils étaient à pêcher, un grain est arrivé si fort, qu’ils ont été obligés de fuir vent arrière au lieu de regagner le Bien-Aimé ; ils ont passé à côté de la Prudence sans pouvoir l’accoster. Mais tu comprends bien qu’avec un matelot comme Jouan il n’y avait pas de danger. Ils auront trouvé quelque navire au large qui les aura emmenés: ça s’est vu bien des fois; c’est comme ça qu’est revenu le garçon de Mélanie. On les a peut-être débarqués en Amérique. Quand ils reviendront, c’est Jérôme qui aura grandi! il avait quatorze ans; quatorze ans et puis six ans, combien que ça fait? — Vingt ans. — Vingt ans! ça sera un homme.»
Elle n’admit jamais qu’ils étaient perdus. Elle mourut elle-même sans les croire morts, et elle avait confié peu de jours auparavant au curé trois louis pour qu’il les remît à Jérôme quand il reviendrait; malgré le besoin et la misère, elle les avait toujours gardés pour son petit dernier.
II
L’embarquement de mon père devait durer trois années, il en dura six: l’état-major fut successivement remplacé, mais l’équipage tout entier resta dans le Pacifique jusqu’au jour où la frégate menaça de couler bas.
J’avais dix ans lorsqu’il revint au pays.
C’était un dimanche, après la grand’messe; j’étais sur la jetée pour voir rentrer la patache de la douane. A côté du timonier, on apercevait un marin de l’État; on le remarquait d’autant mieux qu’il était en tenue et que les douaniers étaient en vareuse de service. Comme tous les jours au moment de la marée, la jetée avait son public ordinaire de vieux marins, qui, par n’importe quel temps, soleil ou tempête, arrivaient là deux heures avant le plein de la mer pour ne s’en aller que deux heures après.
— Romain, me dit le capitaine Houel en abaissant sa longue-vue, voilà ton père. Cours au quai si tu veux y être avant lui.
Courir, j’en avais bonne envie: mais j’avais les jambes comme cassées. Quand j’arrivai au quai, la patache était accostée et mon père était débarqué ; on l’entourait en lui donnant des poignées de main. On voulait l’emmener au café pour lui payer une mocque de cidre.
— A ce soir, dit-il; ça me presse d’embrasser ma femme et mon mousse.
— Ton mousse! tiens, le voilà.
Le soir, le temps se mit au mauvais; mais on ne se releva pas à la maison pour allumer un cierge.
Pendant six années de voyage, mon père avait vu bien des choses, et j’étais pour lui un auditeur toujours disposé. En apparence impatient et rude, il était, au fond, l’homme le plus endurant, et il me racontait avec une inaltérable complaisance non ce qui lui plaisait, mais ce qui plaisait à mon imagination d’enfant.
Parmi ses récits, il y en avait un que je ne me lassais pas d’entendre et que je redemandais toujours: c’était celui où il était question de mon oncle Jean. Pendant une relâche à Calcutta, mon père avait entendu parler d’un général Flohy, qui était en ambassade auprès du gouverneur anglais. Ce qu’on racontait de lui tenait du prodige. C’était un Français qui était entré comme volontaire au service du roi de Berar; dans une bataille contre les Anglais, il avait par un coup hardi sauvé l’armée indienne, ce qui l’avait fait nommer général; dans une autre bataille, un boulet lui avait enlevé la main; il l’avait remplacée par une en argent, et quand il était rentré dans la capitale, tenant de cette main les rênes de son cheval, les prêtres s’étaient prosternés devant lui et l’avaient adoré, disant que dans les livres saints il était écrit que le royaume de Berar atteindrait son plus haut degré de puissance lorsque ses armées seraient commandées par un étranger venu de l’Occident, que l’on reconnaîtrait à sa main d’argent. Mon père s’était présenté devant ce général Flohy et avait été accueilli à bras ouverts. Pendant huit jours, mon oncle l’avait traité comme un prince, et il avait voulu l’emmener dans sa capitale; mais le service était inexorable, il avait fallu rester à Calcutta.
Cette histoire produisit sur mon imagination l’impression la plus vive: mon oncle occupa toutes mes pensées, je ne rêvai qu’éléphants et palanquins; je voyais sans cesse les deux soldats qui l’accompagnaient portant les mains d’argent; jusqu’alors j’avais eu une certaine admiration pour le suisse de notre église, mais ces deux soldats qui étaient les esclaves de mon oncle me firent prendre en pitié la hallebarde de fer et le chapeau galonné de notre suisse.
Mon père était heureux de mon enthousiasme; ma mère en souffrait, car avec son sentiment maternel elle démêlait très-bien l’effet que ces histoires produisaient sur moi:
— Tout ça, disait-elle, lui donnera le goût des voyages et de la mer.
— Eh bien! après? Il fera comme moi, et pourquoi pas comme son oncle?
Faire comme mon oncle! mon pauvre père ne savait pas quel feu il allumait.
Il fallut bien que ma mère se résignât à l’idée que je serais marin; mais dans sa tendresse ingénieuse elle voulut au moins m’adoucir les commencements de ce dur métier. Elle décida mon père à abandonner le service de l’État; quand il aurait un commandement pour l’Islande, je ferais mon apprentissage sous lui.
Par ce moyen, elle espérait nous garder à terre pendant la saison d’hiver, alors que les navires qui font la pêche rentrent au port pour désarmer. Mais que peuvent les combinaisons et les prévisions humaines contre la destinée?
III
Mon père était revenu en août; au mois de septembre, le temps, qui avait été beau pendant plus de trois mois, se mit au mauvais; il y eut une série d’ouragans comme il y avait eu une série de calme. On ne parlait que de naufrages sur nos côtes; un vapeur s’était perdu corps et biens dans le raz Blanchard; plusieurs barques de Granville avaient disparu, et l’on disait que la mer aux alentours de Jersey était couverte de débris; à terre, les chemins étaient encombrés de branches rompues; les pommes encore vertes couvraient le sol, aussi drues que si elles avaient été gaulées; bien des pommiers étaient les racines en l’air ou tordus par le milieu du tronc, et les feuilles pendaient aux branches, roussies comme si elles avaient été exposées à un feu de paille.
Tout le monde vivait dans la crainte, car c’était le moment du retour des Terreneuviers.
Cela dura près de trois semaines, puis un soir il se fit une accalmie complète à la fois sur la terre et sur la mer: je croyais la tempête passée, mais au souper mon père se moqua de moi quand je lui demandai si nous n’irions pas le lendemain relever nos filets qui étaient tendus depuis le commencement du mauvais temps.
— Demain, dit-il, la bourrasque se mettra en plein à l’ouest; le soleil s’est couché dans un brouillard roux, il y a trop d’étoiles au ciel, la mer gémit, la terre est chaude; tu verras plus fort que tu n’as encore vu.
Aussi le lendemain, au lieu d’aller à la mer, nous nous mîmes à charrier des pierres sur le toit du rouf. Le vent d’ouest s’était élevé avec le jour; pas de soleil, un ciel sale, éclairé de place en place par de longues lignes vertes, et, bien que la mer fût basse, au loin un bruit sourd semblable à un hurlement.
Tout à coup mon père, qui était sur le toit du rouf, s’arrêta dans son travail, je montai près de lui. Au large, à l’horizon, on apercevait un petit point blanc sur le ciel sombre: c’était un navire.
— S’ils n’ont point d’avaries, ils veulent donc se perdre! dit mon père.
En effet, par les vents d’ouest, le Port-Dieu est inabordable.
C’était une éclaircie qui nous avait montré le navire. Il disparut presque aussitôt à nos yeux. Les nuages s’entassaient dans une confusion noire; ils montaient rapides, mêlés, roulant comme des tourbillons de fumée qui s’échappent d’un incendie; la courbure extrême de l’horizon était le foyer d’où ils s’élançaient.
Nous descendîmes au village; on courait déjà vers la jetée, car déjà tout le monde savait qu’il y avait un navire en vue, c’est-à-dire en danger.
Au loin comme à nos pieds, à droite, à gauche, tout autour de nous, la mer n’était qu’une écume, une neige mouvante; elle montait plus vite qu’à l’ordinaire, avec un bruit sourd qui, mêlé à la tourmente, paralysait l’ouïe; les nuages, bien que poussés par un vent furieux, étaient si bas, si lourds, qu’ils semblaient appuyer de tout leur poids sur cette mousse savonneuse. Le navire avait grandi; c’était un brick; il était presque à sec de toile.
— Voilà qu’il hisse son guidon, dit le capitaine Houel, qui avait sa longue-vue; c’est celui des frères Leheu.
Les frères Leheu étaient les plus riches armateurs du pays.
— Il demande le pilote.
— Ah! oui, le pilote; il faudrait pouvoir sortir.
Ce fut le pilote lui-même, le père Housard, qui répondit cela; et comme il n’y avait là que des gens du métier, on ne répliqua point; on savait bien qu’il avait raison et qu’il était impossible de sortir.
Au même moment, on vit arriver du côté du village l’aîné des frères Leheu. Il ne savait assurément pas quelle était la violence du vent, car à peine eut-il dépassé l’angle de la dernière maison qu’il tourna sur lui-même et fut rejeté dans la rue comme un paquet de hardes. Tant bien que mal, trébuchant, tournoyant, piquant dans le vent comme le nageur dans la vague, il arriva jusqu’à la batterie derrière laquelle nous étions abrités; en chemin, il perdit son chapeau sans essayer de courir après, et tout le monde vit bien par là qu’il était terriblement tourmenté, car il était connu pour ne jamais rien perdre.
On sut en une minute que le brick lui appartenait; il avait été construit à Bayonne, il était monté par un équipage basque, c’était son premier voyage; il n’était pas assuré.
— Vingt sous du tonneau si vous l’entrez, dit M. Leheu en tirant le père Housard par son suroit.
— Pour l’aller chercher, il faudrait d’abord pouvoir sortir.
Les vagues sautaient par-dessus la jetée; le vent était devenu comme un immense balaiement qui emportait avec lui l’écume des vagues, les goëmons, le sable du parapet, les tuiles du corps de garde; les nuages éventrés traînaient jusque dans la mer, et la blancheur savonneuse de celle-ci les rendait plus noirs encore.
Quand le brick vit que le pilote ne sortait pas, il vira à moitié de bord pour tâcher de courir une bordée en attendant.
Attendre, c’était le naufrage sûr; entrer sans pilote, c’était le naufrage plus sûr encore.
On accourait du village; en tout autre moment, c’eût, été un risible spectacle de voir les trouées que le vent faisait dans les groupes, comme il les soulevait, les bousculait; il y avait des femmes qui se couchaient par terre et qui tâchaient d’avancer en se traînant sur les genoux.
M. Leheu ne cessait de crier: «Vingt sous du tonneau! quarante sous!» Il allait, venait, courait, et dans la même seconde passait des supplications aux injures.
— Vous êtes tous les mêmes, à la mer quand on n’a pas besoin de vous, dans votre lit quand il y a danger.
Personne ne répondait: on secouait la tête ou bien on la détournait.
Il s’exaspéra:
— Vous êtes tous des propres à rien! c’est trois cent mille francs de perdus; vous êtes des lâches!
Mon père s’avança:
— Donnez-moi un bateau, j’y vas.
— Toi, Kalbris, tu es un brave.
— Si Kalbris y va, j’y vas aussi, dit le père Housard.
— Vingt sous du tonneau, je ne m’en dédis pas, cria M. Leheu.
— Rien, dit le père Housard, ce n’est pas pour vous; mais si j’y reste et que ma vieille vous demande deux sous le dimanche, ne la refusez pas.
— Kalbris, dit M. Leheu, j’adopterai ton gars.
— Ce n’est pas tout ça, il nous faut le bateau à Gosseaume.
Ce bateau, qu’on appelait le Saint-Jean, était célèbre sur toute la côte pour bien porter la toile par n’importe quel temps.
— Je veux bien, dit Gosseaume cédant à tous les yeux ramassés sur lui, mais c’est à Kalbris que je le prête, il faut qu’il me le ramène.
Mon père m’avait pris par la main; nous nous mîmes à courir vers la cale où le Saint-Jean était à sec: en une minute, il fut appareillé de sa voile et de son gouvernail.
Outre mon père et le pilote, il fallait un troisième marin, un de nos cousins se présenta: on voulut le retenir.
— Kalbris y va bien, dit-il.
Mon père me prit dans ses bras, et d’une voix dont je me rappelle encore l’accent:
— On ne sait pas, dit-il en m’embrassant; tu diras à ta mère que je l’embrasse.
Sortir du port avec ce vent debout était la grande difficulté ; les haleurs qui tiraient sur l’amarre du Saint-Jean n’avançaient pas; il y avait des secousses qui leur faisaient lâcher prise et les éparpillaient en les bousculant. La pointe extrême de la jetée était balayée par les vagues; il fallait cependant que le Saint-Jean fût halé en dehors de cette pointe pour prendre le vent. Le gardien du phare se noua autour des reins un grelin, et, pendant que les haleurs maintenaient tant bien que mal le Saint-Jean dans le chenal, il se baissa le long du parapet et s’avança en tenant à deux mains la rampe en fer qui y est fixée. Il n’avait pas la prétention, vous le sentez bien, de sortir à lui tout seul la barque, que cinquante bras pouvaient à peine entraîner, mais seulement, et c’était un rude travail, de passer l’amarre autour de la poulie de bronze qui est à l’extrémité de la jetée, de telle sorte que la barque, trouvant là son point d’appui, pût s’avancer en sens contraire des haleurs revenant sur leurs pas. Trois fois il fut couvert par la vague, mais il avait l’habitude de ces avalanches d’eau, il résista et parvint à enrouler le grelin. Le Saint-Jean recommença à avancer lentement en plongeant si lourdement dans les lames que c’était à croire qu’elles allaient l’emplir. Tout à coup l’amarre mollit et vint d’elle-même; elle avait été larguée et le Saint-Jean doublait la jetée.
Je sautai sur le glacis de la batterie et j’embrassai si solidement de mes bras et de mes jambes le mât des signaux, que je pus m’y cramponner; il ployait et craquait comme si, vivant encore, il se fût balancé sur ses racines dans la forêt natale.
J’aperçus mon père au gouvernail: auprès de lui les deux hommes étaient appuyés contre le bordage, le dos au vent. Le Saint-Jean s’avançait par saccades; tantôt il s’arrêtait, tantôt il filait comme un boulet qui ricoche sur des flots d’écume; tantôt il disparaissait entièrement dans cette poussière d’eau que les marins nomment des embruns.
Le brick, dès qu’il le vit, changea sa route et gouverna en plein sur le phare; aussitôt que le Saint-Jean se fut assez élevé dans le vent, il changea aussi sa bordée et gouverna pour couper le brick; en quelques minutes ils se joignirent: la barque passa sous le beaupré du grand navire et presque aussitôt pivota sur elle-même; ils étaient attachés l’un à l’autre.
— La remorque ne tiendra pas, dit une voix.
— Quand elle tiendrait, ils ne pourront jamais s’affaler le long du brick, dit une autre.
Il paraissait, en effet, impossible que le Saint-Jean pût s’approcher assez du brick pour permettre au père Housard d’y grimper: ou le Saint-Jean devait être broyé ou le père Housard devait tomber à la mer.
Joints l’un à l’autre, emportés dans la même rafale, poussés par la même vague, le navire et la barque approchaient. Quand le beaupré plongeait, on voyait le pont se dresser et l’équipage, incapable de tenir pied, s’accrocher où il pouvait.
— Monte donc! monte donc! criait M. Leheu.
Trois ou quatre fois déjà le père Housard avait essayé de s’élancer, mais les deux navires s’étaient violemment séparés: la barque, lancée à vingt ou trente mètres au bout de la remorque, allait devant, derrière, au hasard des lames qui l’emportaient. Enfin le brick fit une embardée du côté du Saint-Jean, et, quand la vague qui l’avait soulevé s’abaissa, le pilote se cramponnait à son bord sur le porte-haubans.
Il semblait que le vent avait vaincu toute résistance, nivelé, démoli, emporté les obstacles: il passait sur nous et au travers de nous irrésistiblement, sans ces intervalles de repos et de reprise qui laissent au moins un moment pour respirer. On ne sentait plus qu’une violente poussée, toujours dans le même sens; on n’entendait plus qu’un soufflement qui rendait sourd. Sous cet aplatissement, les vagues étaient soulevées avant de se former; elles s’écroulaient les unes sur les autres en tourbillons.
Le brick arrivait rapide comme la tempête elle-même, portant seulement tout juste ce qu’il fallait de toile pour gouverner. Bien que la mer parût aplatie, il avait des mouvements de roulis et de tangage dans lesquels il s’abattait furieusement de côté et d’autre, comme s’il allait virer: au milieu d’une de ces secousses, on ne vit plus que des lambeaux de toile; son hunier avait été emporté ; n’ayant plus de point d’appui pour gouverner, il vint par le travers; il était à peine à deux ou trois cents mètres de l’entrée.
Un même cri sortit de toutes les poitrines.
Le Saint-Jean, à bord duquel étaient restés mon père et mon cousin, suivait le brick à une petite distance; pour ne pas se heurter contre cette masse, il prit au large, mais au même moment une trinquette fut hissée à bord du brick; celui-ci revint dans la passe, en coupant une fois encore la route à la barque, qu’il masqua entièrement de sa masse noire. Deux secondes après, il donnait dans le chenal.
C’était la barque que je suivais bien plus que le brick: quand je la cherchai, celui-ci entré, je ne la vis plus. Puis presque aussitôt je l’aperçus en dehors de la jetée; gênée par la manœuvre du grand navire, elle avait manqué la passe trop étroite, et elle courait vers une sorte de crique à droite de la jetée, où ordinairement dans les jours d’orage on trouvait une mer moins tourmentée.
Mais ce jour-là, comme partout, à perte de vue, la mer y était furieuse, et il fallait une impossibilité absolue de remonter dans le vent pour s’y laisser affaler; la voile fut amenée, une ancre fut mouillée, et aux vagues qui se précipitaient du large le canot présenta l’avant; entre lui et la plage se dressait une ligne de rochers qui ne devaient pas être couverts d’eau avant une demi-heure. L’ancre tiendrait-elle? La corde ne serait-elle pas coupée? Le Saint-Jean pourrait-il toujours s’élever à la lame sans plonger?
Je n’étais qu’un enfant, mais j’avais assez l’expérience des choses de la mer pour calculer l’horrible longueur de cette attente.
Autour de moi, j’entendais aussi se poser ces questions, car nous avions couru sur la grève et nous étions groupés en tas pour résister au vent:
— S’ils tiennent encore, ils pourront échouer; si le Saint-Jean vient au plein, il sera brisé en miettes.
— Kalbris est un rude nageur.
— Ah! oui, nager!
Une planche elle-même eût été engloutie dans ces tourbillons d’eau, d’herbe, de cailloux, d’écume, qui s’abattaient sur la plage, où ils creusaient des trous. Les vagues, repoussées par les rochers, produisaient un ressac qui, en reculant, rencontrait celles venant du large, et, ainsi pressées, elles montaient les unes par-dessus les autres et s’écroulaient en cascades.
Tandis que je restais haletant, les yeux sur le Saint-Jean, je me sentis saisir à deux bras; je me retournai, c’était ma mère qui accourait à moi éperdue; elle avait tout vu du haut de la falaise.
On vint nous entourer, le capitaine Houel et quelques autres; on nous parlait, on tâchait de nous rassurer: sans répondre à personne, ma pauvre mère regardait au large.
Tout à coup un grand cri domina le bruit de la tempête:
— L’ancre a lâché !
Ma mère tomba à genoux et m’entraîna avec elle.
Quand je relevai les yeux, je vis le Saint-Jean arriver par le travers sur la crête d’une vague immense; soulevé, porté par elle, il passa par-dessus la barrière de rochers; mais la vague se creusa pour s’abattre; la barque se dressa tout debout en tournoyant, et je ne vis plus rien qu’une nappe d’écume.
Ce fut seulement deux jours après qu’on retrouva le corps de mon père horriblement mutilé ; on ne retrouva jamais celui de mon cousin.
IV
Pendant six années, la place de mon père avait été vide au bout de la table, mais ce n’était pas le vide effrayant et morne qui suivit cette catastrophe.
Sa mort ne nous réduisit pas absolument à la misère, car nous avions notre maison et un peu de terre; cependant ma mère dut travailler pour vivre.
Elle avait été autrefois la meilleure repasseuse du pays, et comme le bonnet du Port-Dieu est une des belles coiffures de la côte, elle retrouva des pratiques.
Les messieurs Leheu crurent devoir venir à notre aide.
— Mon frère vous prendra tous les quinze jours, dit l’aîné à ma mère, et moi tous les quinze jours aussi; une journée assurée toutes les semaines, c’est quelque chose.
Et ce fut tout. Ce n’était pas payer bien cher la vie d’un homme.
La journée de travail, au temps dont je parle, se réglait sur le soleil; j’eus donc, le matin et le soir, avant comme après l’école, des heures où, en l’absence de ma mère, je fus maître de faire ce qui me plaisait.
Or, ce qui me plaisait, c’était de flâner sur la jetée ou sur la grève, selon que la mer était haute ou basse. Tout ce que ma pauvre maman essayait pour me retenir à la maison était inutile; j’avais toujours des raisons pour m’échapper ou me justifier; heureux encore quand je n’en avais pas pour faire l’école buissonnière, c’est-à dire quand les navires ne rentraient pas de Terre-Neuve, quand il n’y avait pas de grande marée, quand il n’y avait pas gros temps.
Ce fut dans un de ces jours de grande marée et d’école buissonnière que je fis une rencontre qui eut une influence capitale sur mon caractère et décida de ma vie.
On était à la fin de septembre, et la marée du vendredi devait découvrir des rochers qu’on n’avait pas vus depuis longtemps. Le vendredi matin, au lieu d’aller à l’école, je me sauvai dans la falaise, où, en attendant que la mer descendît, je me mis à déjeuner: j’avais plus de deux heures à attendre.
La marée montait comme une inondation, et si les yeux se détournaient un moment d’un rocher, ils ne le retrouvaient plus, il avait été noyé dans cette nappe qui se soulevait avec une vitesse si calme, que c’était le rocher qui semblait avoir lui-même coulé à pic; pas une vague, mais seulement une ligne d’écume entre la mer bleue et le sable jaune; au large, au delà de l’horizon voûté des eaux, le regard se perdait dans des profondeurs grises; on voyait plus loin qu’à l’ordinaire; sur les côtes, le cap Vauchel et l’aiguille d’Aval, ce qui n’arrive que dans les grands changements de temps.
La mer resta étale bien longtemps pour mon impatience, puis enfin elle commença à se retirer avec la même vitesse qu’elle était venue. Je la suivis; j’avais caché dans un trou mon panier et mes sabots et je marchai pieds nus sur la grève, où mes pas creusaient une souille qui s’emplissait d’eau.
Nos plages sont en général sablonneuses; cependant on y rencontre, semés çà et là, des amas de rochers, que la mer, dans son travail d’érosion, n’a pas encore pu user et qui forment à marée basse des îlots noirâtres. Comme j’étais dans un de ces îlots à poursuivre des crabes sous les goëmons, je m’entendis héler.
Ceux qui sont en faute ne sont pas très-braves, j’eus un moment de frayeur; mais en levant les yeux je vis que je n’avais rien à craindre, celui qui m’avait hélé n’allait point me renvoyer à l’école: c’était un vieux monsieur à barbe blanche que dans le pays nous avions baptisé Monsieur Dimanche, parce qu’il avait un domestique qu’il appelait Samedi. De vrai, il se nommait M. de Bihorel et il habitait une petite île à un quart d’heure du Port-Dieu; autrefois cette île avait tenu à la terre, mais il avait fait couper la chaussée de granit qui formait l’isthme et l’avait ainsi transformée en une île véritable, que la mer, lorsqu’elle était haute, baignait de tous côtés. Il avait la réputation d’être le plus grand original qui existât à vingt lieues à la ronde; et cette réputation il la devait à un immense parapluie qu’il portait toujours tendu au-dessus de sa tête, à la solitude absolue dans laquelle il vivait, surtout à un mélange de dureté et de bonté dans ses relations avec les gens du pays.
— Hé ! petit, criait-il, qu’est-ce que tu fais là ?
— Vous voyez bien, je cherche des crabes.
— Eh bien! laisse tes crabes et viens avec moi, tu me porteras mon filet, tu ne t’en repentiras pas.
Je ne répondis pas; mais ma figure parla pour moi.
— Ah! ah! tu ne veux pas?
— C’est que...
— Tais-toi, je vais te dire pourquoi tu ne veux pas; dis-moi seulement ton nom.
— Romain Kalbris.
— Tu es le fils de Kalbris, qui a péri pour sauver un brick l’année dernière; ton père était un homme.
J’étais fier de mon père; ces paroles me firent regarder M. de Bihorel moins sournoisement.
— Tu as neuf ans, continua-t-il en me posant la main sur la tête et en plongeant ses yeux dans les miens, c’est aujourd’hui vendredi, il est midi, tu fais l’école buissonnière.
Je baissai les yeux en rougissant.