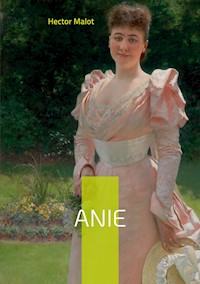1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: DigiCat
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Séduction, écrit par Hector Malot, est un roman captivant qui explore les thèmes complexes de l'amour, de la passion et de la trahison. L'œuvre est écrite dans un style littéraire raffiné, avec des descriptions détaillées et une intrigue qui tient en haleine tout au long de l'histoire. Situé dans le contexte social et culturel de la France du XIXe siècle, le livre offre un aperçu fascinant de la société de l'époque et des relations humaines. Malot utilise des dialogues ciselés pour créer une atmosphère réaliste et immersive pour les lecteurs.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Séduction
Table des matières
PREMIÈRE PARTIE
I
Le personnel domestique du collège communal de Condé-le-Châtel était sur les dents; on procédait à l’installation et à l’emménagement du nouveau principal, M. Margueritte, qui venait d’être nommé, et comme il n’y avait plus que quatre jours avant le premier lundi d’octobre, cette date fatale qui a fait verser tant de larmes aux mères et aux enfants, il ne fallait pas perdre de temps pour que tout fût prêt.
Comme si ce n’était pas assez des travaux que nécessitait cette installation précipitée, M. Margueritte avait encore compliqué les choses en commandant un déjeuner de gala pour cette journée du mercredi.
En recevant cet ordre, la cusinière avait poussé les hauts cris en levant au ciel ses bras désespérés:
–Et comment le servir, ce déjeuner, quand rien n’est en place. Si encore c’était dans le réfectoire.
M. Margueritte n’avait rien écouté; il attendait sa mère ainsi que l’une de ses tantes, chez laquelle celle-ci demeurait depuis de longues années, à Bezu-Bas, un un gros et riche village à trois lieues de Condé, et il tenait à les fêter en les recevant de son mieux.
C’était donc un remue-ménage général dans les vieux bâtiments du collège,–un ancien couvent de cordeliers qui, tant bien que mal, et plutôt mal que bien, a été transformé en collège, comme le château-féodal des comtes du Perche, qui a donné son nom à la ville, a été transformé en sous-préfecture, en palais de justice, en mairie, en bibliothèque et en musée.
De la cave au grenier, de la cuisine au parloir, des dortoirs aux études, dans les escaliers sonores, dans les longs et sombres corridors, on rencontrait des gens de service, des peintres, des menuisiers, des tapissiers qui allaient et venaient d’un air affairé, car tout devait se faire en même temps, l’installation du nouveau principal et le nettoyage des pièces à l’usage des élèves.
Et au milieu des travailleurs M. Margueritte circulait du matin au soir, un trousseau de clefs à la main, qu’il balançait avec un bruit de tintenelle, annonçant de loin son arrivée.
Le plus souvent c’était seul qu’il parcourait ainsi son collège, donnant à chacun et à chaque chose le coup d’œil du maître, faisant ses observations; mais quelquefois aussi il était accompagné d’une grande et belle jeune fille de dix-huit à dix-neuf ans,–mademoiselle Hélène Margueritte.
Lorsqu’on les voyait ensemble il n’y avait pas besoin de les connaître pour deviner les liens de parenté qui les unissaient, tant ils se ressemblaient.
Le père, haut de stature, souple malgré ses cinquante ans, dispos, bon pied, bon œil, bien bâti, bien découplé, en tout un superbe échantillon du Normand de pur race: pommettes un peu saillantes, nez droit, lèvres charnues, œil bleu, cheveux blonds, teint rosé, charpente osseuse, solide et bien proportionnée. Sur un seul point ce type se démentait: on trouvait en lui trop de raideur, trop de compassé. Mais il y avait là évidemment une déformation due au métier; le professeur avait modifié l’homme; l’éducation, la convention, la volonté, l’habitude avaient enlaidi la nature.
La fille, de taille élancée comme le père; blonde de cheveux avec des reflets dorés; la peau fine et transparente, d’une carnation rosée vraiment admirable; les yeux bleus, mais d’une nuance plus claire que chez le père; le regard franc et droit, mais timide cependant, velouté, pénétrant, lumineux; Ja figure d’un ovale parfait avec le front élevé, le nez droit, les lèvres en arc; très mince de la taille, elle avait un port de tête qui la grandissait encore, mais pourtant sans donner rien de grave à l’expression habituelle de ses traits et de son sourire, qui était la douceur et la candeur.
Quand Hélène venait ainsi rejoindre son père, ce n’était point pour lui parler des choses du collège, dont elle ne s’occupait en rien, mais c’était pour le consulter sur leur installation personnelle et surtout sur celle de sa grand’mère.
Elle la connaissait très peu cette grand’mère, car ayant jusqu’à ce jour habité le nord et l’est de la France, elle n’était que rarement venue à Condé-le-Châtel et à Bezu-Bas, que la bonne femme n’avait jamais quitté; mais elle savait quelles étaient les intentions de son père, et cela suffisait pour qu’elle eût à cœur de veiller à ce qu’elles fussent exactement réalisées.
–Il faut que la brave femme trouve dans la dernière. –partie dé sa vie le repos et le bien-être qui lui ont par malheur si complètement manqué dans la première, avait dit M. Margueritte, et je compte sur toi pour les lui assurer.
Bien que sa grand’mère fût une vieille paysanne de soixante-treize ans, qui avait toute sa vie travaillé à la terre et qui n’avait aucune idée de ce qu’était le bien-être bourgeois, Hélèneavait voulu que la chambre qu’elle lui organisait fût aussi confortable et aussi élégante que celle qu’elle se faisait arranger pour elle-même;–confortable et élégance bien modestes, il est vrai: faïence pour la toilette, merisier pour le meuble, cretonne pour l’étoffe; mais enfin considérables encore pour quelqu’un qui, depuis quarante ans, se débarbouillait à la pompe et n’avait pas de rideaux à sa lucarne.
Si M. Margueritte en avait eu la liberté, il aurait attendu quelques jours encore pour recevoir sa mèra chez lui, car au milieu des embarras de son installation et de la rentrée des classes, il ne trouverait guère le temps ’être à elle comme il l’aurait voulu; mais cette liberté il ne l’avait point eue.
Le lendemain de son arrivée à Condé il avait été à Bezu-Bas pour voir sa mère et lui annoncer son désir de l’avoir désormais avec lui. Et, en route, il avait préparé le discours conforme aux règles de la rhétorique qu’il lui adresserait: exorde qui éveillerait son attention, narration qui exposerait le sujet, confirmation qui prouverait la vérité et la justesse des faits avancés, réfutation qui irait au-devant des objections probables, enfin péroraison qui récapitulerait ce discours en appuyant surtout sur le bonheur de la vie de famille.
Mais, à sa grande surprise, elle ne l’avait point laissé aller jusqu’à la confirmation. Il avait cru qu’il ne pourrait que difficilement la décider à quitter les champs où elle avait toujours vécu: jeune fille auprès de ses parents, mariée auprès de son mari, veuve auprès de son frère, qui l’avait recueillie, et voilà qu’à peine il était arrivé à la fin de sa narration, elle avait accepté son offre avec empressement et avec joie.
–Certainement, mon fils, que je serai heureuse de vivre avec toi et avec ma petite-fille, et je te remercie bien de ta proposition que j’accepte de bon cœur. Si tu n’avais point été si loin d’ici et toujours en changement de pays, il y a longtemps que je t’aurais demandé ça moi-même, le jour précisément où tu as perdu ta défunte femme, et depuis aussi vraiment plus d’une fois.
Chose curieuse, au moins pour lui, les objections à sa proposition étaient venues précisément de celle qui, croyait-il, devait être la dernière à en faire, c’est-à-dire de sa tante, madame Françoise, qui vingt fois, cent fois, avait laissé entendre qu’elle ne gardait sa belle-sœur chez elle que par générosité, par bonté, par amour de la famille et aussi par amitié pour son mari, son brave François, qui était très attaché à sa sœur.
–Croyez-vous que c’est prudent, mon neveu, d’emmener à la ville une personne d’âge qui est habituée aux champs; ça va bien la dérouter; sans compter le deuil que ça fera à mon François, qui est si affectionné à sa sœur pour l’avoir eue depuis si longtemps avec lui. Et puis il y a nos dindes.
Ce mot avait été le trait de lumière qui avait éclairé la situation et avait montré à M. Margueritte ce qu’il n’y avait pas vu: dans cette maison où on la gardait par générosité et par amour de la famille, sa mère était une servante à laquelle on tenait d’autant plus qu’on ne la payait point.
Or, ce devait être un dur métier que celui de servante chez madame Françoise ou plutôt madame Tout cha, comme on l’appelait familièrement, parce qu’elle avait l’habitude, lorsqu’elle promenait quelqu’un aux environs de sa ferme, de dire avec un geste circulaire, la tête haute et le regard orgueilleux: «Vous voyez tout cha, eh bien, c’est à nous tout cha, et puis encore tout cha.»
Comment n’avait-il pas compris, comment n’avait-il pas vu cela plus tôt? Comment n’avait-il pas deviné le sens des demi-mots de sa mère, qui, sans se plaindre jamais franchement et sans lui demander à se retirer près de lui, en avait assez dit cependant pour lui ouvrir les yeux s’ils n’avaient point été aveuglés.
Mais maintenant qu’il voyait et comprenait, il n’était pas homme à abandonner sa mère; il avait parlé en maître.
–Eh bien, alors, je vous mènerai ma sœur le jour de la foire Saint-Michel, avait dit la tante Tout cha.
–J’irai bien à pied, répondit la bonne femme.
–Ça serait du propre, vraiment, que vous partiez de chez nous à pied; je vous conduirai en menant les dindes à la foire. Faut bien que je les vende, puisque vous les abandonnez.
II
C’était la Saint-Michel, c’est-à-dire le grand jour de fête pour Condé, la foire la plus importante de l’année; et à dix lieues à la ronde, longtemps à l’avance on fixe à cette époque son voyage «à la ville» pour ses affaires comme pour ses plaisirs: on parle de la Saint-Michel six mois avant qu’elle arrive.
Toute la nuit les rues de la ville, ordinairement calmes et silencieuses, avaient été pleines de mouvement et de tapage; depuis minuit jusqu’au matin ç’avait été un va-et-vient continuel, surtout dans le quartier du champ de foire, un roulement incessant de charrettes, des piétinements de bestiaux, des hennissements de juments et de poulains, des beuglements de bœufs et de vaches, des bêlements de moutons, des gémissements de veaux, des grognements de cochons que de temps en temps dominaient tout à coup des cris rauques qui faisaient trembler les bêtes domestiques déjà installées sur le champ de foire,–ceux des animaux féroces d’une ménagerie dont les voitures étaient rangées sous les arbres du cours.
Ce tapage avait été particulièrement assourdissant pour les habitants du collège, qui n’est séparé du champ de foire que par un de ces hauts murs de clôture de dimensions démesurées qu’on construisait autrefois pour les couvents.
Vers le matin il était devenu tel que M. Margueritte et sa fille, ne pouvant plus dormir, s’étaient levés plus tôt que de coutume, tout en se disant cependant que la tante Tout cha ayant trois lieues à faire pour venir à Condé, n’arriverait pas dès le matin sans doute.
Mais en raisonnant ainsi, M. Margueritte se trompait. C’était mal connaître la tante Tout cha que de croire qu’ayant quelque chose à vendre, elle ne serait pas installée sur le champ de foire avant ses concurrentes.
Dès six heures la sonnette avait retenti et presque aussitôt la grande porte avait roulé lourdement en grinçant sur ses gonds rouillés.
A ce moment, M. Margueritte et Hélène, appelés par la cloche, arrivaient dans la cour; ils virent entrer une carriole découverte, moitié charrette, moitié char à bancs, traînée par une magnifique poulinière aux flancs rebondis suitée de son poulain qu’elle allaitait encore; sur le banc de devant étaient assises la tante Tout cha, le fouet et les guides en main, se carrant à son aise, et près d’elle, se faisant aussi petite que possible, madame Margueritte; derrière elles étaient superposées des grandes cages pleines de jeunes dindes qui, le cou passé à travers les barreaux, piaulaient lamentablement.
–Ho! cria la tante Tout cha.
Et jetant son fouet et les guides à sa belle-sœur, elle descendit de voiture assez légèrement, mais avec précaution cependant pour ne pas salir sa belle robe de stoff couleur bleu de roi contre le marchepied ou la roue.
–Bonjour, mon neveu; bonjour, ma nièce; c’est nous; v’la mon poulain.
La présentation n’était pas inutile, car si M. Margueritte attendait sa mère et sa tante, il n’attendait ni cette carriole, ni ce chargement de dindons, ni le poulain.
Mais sans répondre, il s’occupa à aider sa mère à descendre de voiture.
Pendant qu’il la soutenait avec précaution, car la vieille femme, ankylosée par le travail, n’était plus souple, la tante Tout cha continuait:
–Vous m’avez dit que vous aviez une écurie; alors j’ai pensé qu’on pourrait y mettre Cocotte et son poulain. Pourquoi payer un droit d’attache au Bœuf couronné quand on peut en faire l’économie? C’est toujours ça de venu, n’est-il pas vrai? et puis j’ai toujours peur qu’il arrive quelque chose à Cocotte, qui est une poulinière de prix, vous savez, et qui nous a rapporté gros avec ses primes; sans compter que les garçons d’écurie volent la moitié de l’avoine qu’on apporte et n’ont pas honte de la retirer de dessous le nez d’une pauvre bête quand le propriétaire a le dos tourné.
Tout en parlant, elle arrangeait sa toilette fripée par le voyage: sa robe à taille courte qu’elle lissait avec le plat de la main; son fichu à plis régulièrement étagés qu’elle tirait en avant; sa grosse chaîne d’or qu’elle replaçait symétriquement sur ses épaules, car elle avait mis ses atours de cérémonie autant pour faire honneur à son neveu, «M. le principal du collège», que pour qu’on n’osât pas lui marchander ses dindes en voyant qu’elle était une femme cossue qui ne vendait point ses élèves sous le coup du besoin et qui pouvait attendre.
Près d’elle, madame Margueritte, beaucoup plus simplement habillée, plus que simplement même, se tenait immobile, n’ayant pas de chaîne d’or à relever et ne pensant pas à arranger sa robe de droguet qui, datant de douze ou quinze ans, ne gardait ses plis que trop facilement, et pendant que sa belle-sœur parlait, elle la regardait presque craintivement, en tous cas avec une attention soumise comme si elle attendait un ordre; elle restait là les bras ballants et l’on voyait se détacher sur le gris éteint de sa vieille robe ses mains rouges, ridées par les ans, tannées et encroûtées par le travail.
Pendant ce temps le domestique qui avait ouvert la porte, entendant parler d’écurie, se mit à dételer la jument.
–Allons, ma sœur, dit la tante Tout cha, défaisons nos cages et portons-les au champ de foire.
Instantanément, presque automatiquement, comme si elle obéissait à un ressort, madame Margueritte s’était avancée vers la voiture, mais son fils la retint et, s’adressant à sa tante:
–Je vais vous donner quelqu’un pour vous aider.
–Ne faites point perdre le temps à vos gens, mon neveu, dit la tante. Tout cha, ma sœur et moi, nous viendrons bien à bout de porter nos cages, ça nous connaît. Allons, sœur, allons.
Mais M. Margueritte étendit la main avec un geste de dignité:
–Pardon, dit-il, je désire que ma mère ne soit pas vue au champ de foire portant des dindons.
La tante Tout cha resta un moment interloquée, le regardant; mais ce n’était point son habitude de se laisser interloquer: c’était elle, au contraire, qui interloquait les gens et leur imposait silence. Pour qu’elle fût restée bouche close devant son neveu, il fallait qu’elle eût vu en lui «M. le principal»; mais ce mouvement de respect instinctif dura peu, elle reprit vite son assurance.
–Après m’avoir obligée à vendre mes dindes, allez-vous m’en empêcher maintenant? dit-elle.
–Je ne vous ai point obligée à vendre vos dindes, ma tante.
–Vraiment! Et qu’est-ce que vous avez donc fait en m’enlevant votre mère? Pour savant que vous êtes, croyez-vous qu’on vende à la Saint-Michel des dindes maigres aussi cher qu’on les vendrait grasses à Noël? C’est une perte de plus de cinq cents francs que vous m’imposez.
–Quelqu’un n’aurait-il pas pu remplacer ma mère.
–Au prix où sont les servantes au jour d’aujourd’hui, n’est-ce-pas? Non, mon neveu. Il fallait les vendre, je les vends. Mais maintenant vous n’allez pas m’imposer une nouvelle perte; il ne faut pas mépriser la culture, mon neveu.
–Je ne méprise pas la culture, ma tante; mais je ne trouve pas convenable que ma mère se montre au marché comme votre servante, voilà tout. Je vais vous donner tout le monde qui vous sera nécessaire pour vous aider, et si vous avez besoin d’un domestique, il restera à votre disposition tant que vous voudrez.
–Si c’est comme ça.
Et comme cet arrangement faisait, en somme, son affaire, elle s’en contenta, pensant seulement tout bas et sans le dire que M. le principal était bien fier, lui qui n’était que le fils d’un père charpentier et d’une mère sans le sou.
Sans perdre de temps, elle avait pris une cage d’un côté tandis qu’un domestique du collège la prenait de l’autre, et elle était partie pour le champ de foire.
–Pourquoi n’as-tu pas voulu me laisser avec sœur Françoise? dit madame Margueritte à son fils quand la tante Tout cha se fut éloignée; ça l’a fâchée.
–Parce que tu n’as été que trop longtemps sa servante et que je ne veux plus que tu la sois, même pour une heure, même pour une minute. Pardonne-moi, maman.
–Te pardonner! Et que veux-tu que je te pardonne, mon garçon?
Il avait pris sa mère par la main et il la conduisait, accompagnée d’Hélène, à la chambre qu’ils avaient préparée pour elle.
–Ce que je veux que tu me pardonnes, dit-il, c’est d’avoir été aveugle et de m’être imaginé que tu pouvais être heureuse dans la maison de madame Tout cha parce que tu gardais tes habitudes de jeunesse et que tu étais chez ton frère. Tu étais chez ta belle-sœur, non chez ton frère, je m’en aperçois aujourd’hui. C’est cela qu’il faut que tu me pardonnes, car mon aveuglement est cause qu’on a fait de toi-une servante.
–Je ne t’ai pas adressé de plaintes.
–Non, mais tu as souffert en silence, ce qui n’a été que plus cruel encore. Que veux-tu, je m’imaginais qu’étant chez ton frère qui t’aime.
–Oh! pour sûr.
–Tu vivais en famille.
–Il ne faut pas en vouloir à François; vois-tu; il n’ose pas lever le doigt sans la permission de sa femme.
–Voilà le mal.
–Il ne faut pas en vouloir non plus à Françoise; ce n’est pas pour rendre le monde malheureux qu’elle le fait trop travailler.
–C’est pour s’enrichir.
–Elle travaille trop elle-même.
–Enfin, ta peine est finie, pauvre maman; nous allons vivre ensemble désormais, et, ma fille et moi, nous nous appliquerons à te faire oublier ce que tu as souffert. Si par malheur je venais à te manquer, Hélène serait là, et elle ne te laisserait pas retomber en esclavage.
Sans répondre, Hélène mit la main dans celle de son père et la lui serra.
Ils étaient arrivés devant la porte de la chambre que la vieille femme devait habiter:
–Voilà ta chambre, dit M. Margueritte.
Elle regarda autour d’elle d’un air ébahi, et un sourire éclaira son visage placide.
–Oh! non, dit-elle, c’est trop beau pour moi.
III
La tante Tout cha n’était pas ce qu’on appelle une brave femme, ni commode, ni facile, ni aimable; non qu’elle fût foncièrement méchante cependant, mais âpre –au gain, dure au travail, insensible à la peine, elle voulait que tout autour d’elle: gens, bêtes et choses, concourût à son but, qui était de gagner. «C’est à nous tout cha, et puis encore tout cha.» Mère de huit garçons, elle était le seul homme de la famille, et c’était d’une main ferme, souvent même leste dans ses mouvements, qu’elle régentait son mari aussi bien que ses garçons, qui tous tremblaient également devant elle.
En pensant que son neveu, «monsieur le principal», pouvait l’empêcher de gagner sur la vente de ses dindes parce qu’il la privait du concours de sa belle-sœur, elle s’était fâchée, et si la dignité de M. le principal ne lui avait imposé une certaine crainte respectueuse, elle se serait abandonnée à l’un de ses accès de colère où, comme elle le disait elle-même, «tout dansait»; mais, lorsque, après avoir vendu ses dindes, il se trouva que son bénéfice était supérieur à celui qu’elle s’était fixé d’avance, elle revint au collège de belle humeur, et dans les meilleures dispositions pour faire honneur au déjeuner de son neveu. Il avait eu vraiment bonne idée de se faire nommer principal à Condé. Cela serait très commode les jours de marché et de foire, non seulement pour Cocotte et ses poulains, mais encore pour elle; les aubergistes d’aujourd’hui ont si fort augmenté leurs prix qu’il faut être fou pour manger chez eux. Et puis, tout en déjeunant avec le neveu, on pourrait lui vendre à bon prix la provision de bois, de cidre, de beurre, d’œufs, de pommes de terre, dont il allait avoir besoin pour ses élèves. Elle avait tout cha; et dame! ma foi, ce n’est pas un crime, n’est-ce-pas, de gagner avec sa famille, honnêtement sans doute, mais enfin le plus, et le plus souvent qu’on peut.
Lorsqu’elle entra dans la salle à manger et qu’elle vit, sur une table, servie avec un certain luxe de linge et de vaisselle, une grosse truite pour pièce de milieu avec une galantine à un bout et un homard à l’autre, elle gronda son neveu.
–Il ne faut pas de ces prodigalités-là pour moi, dit-elle d’un ton de parfaite naïveté, en femme qui n’admet pas l’idée qu’on puisse vouloir fêter une autre personne qu’elle, ou bien vous me mettrez mal à l’aise pour venir vous demander à déjeuner, d’amitié, les jours de marché; c’est trop.
M. Margueritte ne répondit pas; en réalité, que pouvait-il dire? Que ce déjeuner était pour sa mère. Sans doute cela était vrai. Mais, jusqu’à un certain point, il était aussi pour la tante Tout cha. Ce qu’il avait vu et compris en ces derniers temps à propos des souffrances de sa mère ne pouvait pas empêcher que cela fût.
Lorque après une absence de trente ans, il était revenu dans sa ville natale, il n’avait pas été ramené seulement par l’amour du pays, il l’avait été aussi par le sentiment de la famille.
Pendant trente ans il avait mené la triste existence des fonctionnaires, aujourd’hui là, demain ailleurs, toujours sur les grands chemins, véritable juif-errant de l’Université,–alma parens,–sans lendemain, sans relations suivies, sans amis sur lesquels il pût compter, puisqu’il devait les quitter d’un moment à l’autre. Supportable dans la jeunesse, cette vie nomade lui était devenue intolérable en vieillissant, et surtout du jour où, ayant perdu sa femme, il était resté seul avec sa, fille.
Si depuis près de dix ans il avait attendu sa nomination à Condé, ce n’avait pas été uniquement la situation de principal qu’il avait si patiemment poursuivie; car il eût pu en obtenir ailleurs une autre aussi bonne et même peut-être davantage: ç’avait été celle de principal à Condé, avec tout ce qu’elle allait lui donner: le retour au berceau, la société de ses anciens camarades, la vie de famille, la tranquillité, la sécurité.
Que de projets n’avait-il pas faits, que de variations n’avait-il pas brodées sur ce thème. avec toutes sortes de citations classiques.
Maintenant allait-il renoncer à l’une de ses espérances parce qu’il ne trouvait pas dans sa tante la femme qu’il aurait voulue?
Après tout elle avait des qualités, la tante Tout cha, et c’était à ces qualités qu’il fallait penser, c’étaient elles qu’il fallait voir. Que deviendrait la vie de famille si l’on exigeait la perfection chez ses parents?
Sous l’influence de cette idée, la mauvaise impression que la tante avait produite s’effaça bien vite.
C’était un gai convive que la tante Tout cha, qui mangeait bien quand cela ne lui coûtait rien, qui ne laissait pas son verre plein et qui caquetait joyeusement ses morceaux.
M. Margueritte l’ayant à sa gauche, avec sa mère à sa droite et sa fille en face de lui, se trouvait l’homme le plus heureux du monde. Ses yeux émus allaient de sa mère à sa fille, et de sa fille à sa mère, et quand ce mouvement s’arrêtait sur la vaisselle de sa table ou sur l’ameublement de la salle à manger, il éprouvait un sentiment de bonheur complet.
Enfin il était donc chez lui, et autour de lui il avait ceux qu’il aimait.
–Quel malheur que mon oncle ne soit pas venu avec vous, dit-il tout à coup.
–Et qui est-ce qui aurait gardé la maison? demanda la tante; mais je vous enverrai vos cousins quelquefois si vous voulez.
–Comment, si je veux!
Il eût été vraiment heureux de les avoir à sa table, ces huit cousins.
C’était une des qualités de la tante Toutcha de ne pas oublier les affaires pour le plaisir. Si sensible qu’elle fût au déjeuner de son neveu, le meilleur qu’elle eût fait de sa vie, elle ne pensait qu’à son bois, son beurre, ses œufs, en guettant l’occasion d’introduire à propos son offre amicale.
–Quel bon déjeuner vous nous donnez, dit-elle, on n’en ferait pas un pareil chez Mgr Guillemittes.
–Vous trouvez, dit M. Margueritte, enchanté. Et toi, maman?
–C’est trop bon, dit la vieille femme, qui n’était pas comme sa belle-sœur, sensible à la gourmandise.
–Il n’y qu’une chose qui n’est pas fameuse, continua la tante Tout cha, revenant à son sujet, c’est le cidre: faible, pas de corps, pas même de couleur. Qui est-ce qui vous vend ça?
–Un fermier de Saint-Réau, qui le vendait à mon prédécesseur.
–Saint-Réau, mauvais cru. Je ne dis pas que ce fernier ne soit pas un honnête homme, quoique son cidre, –elle but une gorgée et claqua de la langue,–quoique son cidre me fasse l’effet d’être drogué; mais quand même il ne le droguerait pas, il ne pourra jamais vous fournir rien de bon. Si vous voulez, je vous ferai votre provision moi, mon neveu. Vous savez que Bezu-Bas est le premier cru de la contrée, et puis ça serait en famille, au cours du jour bien entendu. C’est important, le bon cidre pour des jeunes gens: ça leur fait l’estomac; et puis, quand on boit quelque chose de bonne qualité, on mange moins.
–C’est entendu, ma tante, j’accepte avec reconnaissance.
–C’est comme pour votre provision de bois, je vous la ferai si vous voulez. Vous les chauffez, n’est-ce pas, ces jeunes gens?
–Sans doute.
–Eh bien, vous savez mieux que moi qu’il y a bois et bois: celui de Bezu-Bas, qui ne pousse pas dans des terres humides, est sec et dur; ça résiste au feu et ça chauffe.
–J’accepte votre bois, ma tante.
–Et des pommes de terre, il vous en faut aussi, hein?
–Et une grosse provision.
–Vous savez, vous qui êtes un savant, qu’il n’y en a pas de meilleures qu’à Bezu-Bas, farineuses, sucrées, nourrissantes; un boisseau de mes pommes de terre en vaut deux de partout ailleurs.
Après les pommes de terre vinrent les œufs, le beurre, le lait, «du bon lait pur sans une goutte d’eau pour ces pauvres enfants», les noix, le fromage, les haricots; elle émit même l’idée que son neveu aurait intérêt à lui acheter le blé nécessaire à la nourriture des élèves, il Ile ferait moudre, il donnerait la farine au boulanger; ce a serait très économique.
Cependant, si bien disposé que fût M. Margueritte à tout accepter, il repoussa cette idée et elle eut la déillicatesse de ne pas insister; il faut savoir se contenter, n’est-ce pas?
Elle ne lui en voulut pas de ce refus, et même elle trouva des paroles aimables pour le complimenter, elle pqui n’avait jamais que bousculé les gens.
Pour madame Margueritte, elle ne parlait pas, mais elle s’oubliait de temps en temps à regarder son fils avec une curiosité émue, comme si elle se disait: «Est-ce qpossible? Est-ce bien mon enfant que je retrouve dans
le principal?»
Et lui, voyant ce regard et en comprenant l’expression, sentait son cœur se remplir de joie en même temps que d’orgueil: sa famille était fière de lui; alors, se comparant à ce qu’il avait été et à ce qu’il était maintenant, mesurant le chemin parcouru depuis le jour où il était entré dans ce collège petit écolier boursier, fils d’un pauvre veuve, jusqu’à ce moment où il y rentrait MM. le principal, il était fier de lui aussi.
On était au dessert: il quitta la table en disant qu’on continuât, qu’il allait bientôt revenir.
Ce bientôt se prolongea assez longtemps; mais enfin la porte se rouvrit, et il apparut en grande tenue, dans son costume de principal: robe noire, avec bandes jaunes moirées, ceinture jaune, épitoge jaune avec hermine, et toque jaune à bande de velours noir.
Les deux compagnardes restèrent interdites, le contemplant avec admiration.
–O mon fils! dit madame Margueritte, que tu es beau!
Il avait voulu se montrer dans sa gloire.
IV
M. Margueritte avait repris sa place à table, et c’était, la toque sur la tête, les manches de sa robe retroussées, qu’il dégustait son café, voluptueusement, béate-ment, grisé par le bonheur, le sien propre, comme celui des trois personnes qui l’entouraient et le regardaient avec des yeux émus ou souriants:
Sa mère, glorieuse de son fils et confiante dans l’avenir, elle qui, depuis soixante ans, avait vécu dans la crainte du lendemain;
Sa fille, heureuse et attendrie de la joie de son père;
La tante Tout cha enfin, calculant gaiement les bénéfices qu’elle allait faire sur ses fournitures de cidre, de bois, de beurre, d’œufs, de lait, de fromage, de pommes de terre, tout en digérant un bon déjeuner qui ne lui avait rien coûté.i
–Eh bien, maman, dit M. Margueritte, après un temps assez long de cette douce béatitude, aurais-tu cru cela quand tu me cousais ma première veste de drap que tu avais taillée dans l’habit de mon pauvre père pour m’envoyer au collège décemment vêtu?
–M’a-t-elle donné du mal, cette veste-là! Je voulais que tu fusses comme tes camarades, et, dame! c’était là le difficile pour nous.
–C’est justement parce que je ne pouvais pas être comme les autres que j’ai voulu être plus qu’eux par le travail, puisque j’étais moins qu’eux sous tant de rapq ports; et c’est peut-être ce sentiment qui m’a fait ce que je suis; j’ai plus d’une fois souffert de ma veste râpée et de mes souliers rapiécés; mais quand on donnait les places le mardi et que le principal disait: «Prenmier, Augustin Margueritte,» j’oubliais ma veste et nmes souliers. Je l’ai portée longtemps, cette pauvre veste, et c’est peut-être pour cela que j’ai cédé tout à l’heure à un sentiment de vanité naïve qui m’a fait revêtir ce costume. Enfin, les mauvais jours sont passés, les bons commencement.
Il y avait une pensée qui tourmentait la tante Tout cha depuis qu’elle avait engagé ses marchés pour ses différentes fournitures. Quelle était la solvabilité de son neveu? Comment serait-elle payée?. M. le princiqpal, c’est bien; mais l’argent comptant ou des sûretés, c’est mieux. Elle crut le moment favorable pour poser lla question qui déjà plusieurs fois lui était venue aux lèvres:
–Alors, mon neveu, les affaires ont bien marché? dit-elle.
–Elles vont marcher.
•–Je veux dire: vous avez mis de l’argent de côté.
–J’ai vécu; j’ai élevé ma famille.
–Et les économies.
–Je n’en ai point fait.
–Ah!
Et une contraction plissa son visage épanoui.
–Je n’en ai pas pu faire, ma tante, car ce que gagnent les professeurs est peu de chose. 1
–Oh! mon neveu, ce n’était pas pour vous blâmer, mais par amitié; vous savez, je ne demande pas à connaître vos affaires.
–Elles sont bien simples et je n’ai pas de raisons pour les cacher, à vous surtout. Je n’ai rien, car, ainsi que je vous le disais, ce que j’ai gagné jusqu’à ce jour a été employé par nous à vivre. Je n’aurais même pas pu obtenir cette place de principal à Condé, qui était mon ambition, si un de mes amis n’était pas venu à mon aide. Le professeur n’a besoin que d’être digne de la situation qu’il veut remplir; mais il n’en est pas de même du principal, qui est un administrateur et qui, par conséquent doit offrir certaines garanties pécuniaires.
–Ça c’est bien juste, dit la tante, pensant à ses fournitures; quand on achète, il faut pouvoir payer.
–C’est précisément ces garanties que mon ami a bien voulu fournir pour moi qui ne les avais pas, et c’est à lui que je dois ma position, de même que si je fais fortune ce sera à lui que je devrai cette fortune.
–Alors, mon neveu, vous espérez faire fortune? demanda la tante, poursuivant son idée et cherchant à savoir au juste avec qui elle allait traiter.
–Oh! une modeste fortune. Mais enfin, je peux mettre de côté, si les choses restent telles qu’elles sont en ce moment, six ou huit mille francs tous les ans. Si, comme je l’espère, je les améliore, je pourrai en mettre. douze ou quinze mille.
–C’est beau cela, mon neveu; ce n’est pas à travailler la terre qu’on en gagne autant.
–J’ai cinquante ans. Si je travaille encore quinze ans, je peux donc prendre ma retraite avec deux cent mille francs de capital. J’en donnerai cent mille à ma chère fille, et avec les cent mille qui me resteront je vivrai parfaitement heureux jusqu’au jour où je n’aurai plus besoin de rien.
–Tu es un bon garçon, dit la vieille mère.
–Un bon garçon, maman, parce que je dis que je donnerai cent mille francs à Hélène; il n’y a pas de bonté à donner à ses enfants, on se fait plaisir à soi-même. C’est tout naturel. Et je voudrais précisément pouvoir faire quelque chose d’extraordinaire pour elle: un sacrifice, quelque chose de grand qui soit digne d’elle.
Se levant vivement, Hélène vint à son père et tendrement elle l’embrassa en lui mettant la main sur la bouche par un geste d’enfant gâté.
–Veux-tu bien ne pas parler ainsi, dit-elle.
Mais cela ne l’arrêta pas:
–Vous ne la connaissez pas, ma chère fille, dit-il, vous ne savez pas comme elle est bonne, affectueuse, tendre, dévouée, douce, docile.
–Avec toi peut-être, dit Hélène en souriant, et il n’y pas grand mérite à être dévouée avec un aussi bon père, ni d’être docile pour t’obéir.
:–Quand je pense, continua M. Margueritte, qu’avant qu’elle fût née je voulais un garçon.
–Pour l’appeler Homère, Virgile ou Nestor, interrompit Hélène sur le ton d’une douce raillerie.
–Et que j’ai été désolé quand le médecin m’a crié: «Une fille!» Je n’ai commencé à me consoler qu’en voyant qu’elle était blonde.
–Ce qui t’a permis de m’appeler Hélène.
:–Cela était bien imprudent, car rien ne disait alors que tu deviendrais la belle fille que tu es devenue.
C’était l’habitude d’Hélène de plaisanter quand son –père lui adressait des compliments qui la mettaient mal à l’aise.
–Si j’avais été un monstre, cela n’aurait rien été pour moi, n’est-ce pas? Mais pour «Hélènè aux bras blancs» quel déshonneur!
La vieille mère et la tante les écoutaient en les rega dant, se demandant sans aucun doute quelle était cette «Hélènè aux bras blancs».
–Une parente du côté de votre femme, mon neveu demanda la tante Tout cha qui aimait à aller au font des choses et qui n’avait jamais peur de poser une question.
–Justement, dit M. Margueritte avec enjouement c’est d’elle que ma fille descend; elle lui ressemble.
–Alors c’était pour sûr une belle personne, dit la tante Tout cha d’un air entendu et convaincu.
–Tu vois, dit M. Margueritte en regardant sa fill avec un sourire glorieux, je ne l’ai pas soufflé, c’est le cri de la conscience et du cœur.
–Certainement, dit la tante, ce n’est point mentir que dire de ma nièce qu’elle est belle, tout le monde le voit
Hélène coupa la parole à sa tante en lui offrant un verre d’anisette.
–Encore un, j’accepte; mais c’est le dernier. Elle est si bonne! Ce n’est pas ici qu’on en trouve de cette qualité. Il faudra que vous me disiez où vous avez eu celle-ci pour que j’en fasse venir une bouteille si c’est possible. Oh! pas pour moi, mais pour mon pauvre François, ça lui réchauffera l’estomac. Ce pauvre homme! il ne faut pas l’oublier, n’est-ce pas? lui qui ne prend pas sa part de ces bonnes choses.
–Si vous voulez nous faire l’amitié d’en emporter une bouteille, dit Hélène.
–Eh bien! oui. tout de même, sans cérémonie; mais à condition que nous ferons un échange: je vous enverrai une bouteille de cassis; vous me direz comment je le réussis.
–C’était donc un fils que je voulais, continua M. Margueritte, j’espérais le faire travailler avec moi, lui apprendre ce que je sais, l’élever en camarade et en ami. A cette époque je ne voyais que cela dans la paternité, qui est un sentiment assez faible et très confus quand on ne l’a pas exercé. Ce fut cette enfant qui m’apprit qu’il y avait autre chose. J’avais vu des gens rester en admiration devant le sourire d’un enfant, et cela, je l’avoue, m’avait paru assez ridicule; mais quand je reçus à mon tour dans mes yeux le sourire de cette petite, ce fut plus que de l’admiration que j’éprouvai, un attendrissement profond, un mélange de joie orgueilleuse et d’espérance confiante. Il me sembla que l’avenir était assuré et que, quoi qu’il arrivât, tant que j’aurais ma fille, je ne pourrais pas être entièrement malheureux. Et, de fait, je ne l’ai pas été. au moins complètement, désespérément. J’ai perdu ma femme cependant, que j’aimais tendrement. J’ai trouvé dans Hélène la force de supporter ce malheur. Elle était là, près de moi; sa tendresse m’enveloppait, me soutenait. J’ai eu bien des traverses dans ma vie, bien des souffrances, bien des colères, bien des indignations; j’ai été comme tout le monde, exposé au passe-droit, à l’injustice, à la trahison, et je suis rentré plus d’une fois à la maison indigné ou découragé; mais jamais l’indignation ou le découragement n’ont résisté au sourire de cette enfant. Un garçon aurait produit le même effet sur moi, direz-vous. Je ne crois pas. Il m’eût distrait, il eût occupé mon esprit; il ne m’eût peut-être pas ému et rempli le cœur comme cette petite fille, si affectueuse et si tendre, car c’est par là qu’elle m’a pris, la tendresse; c’est par là qu’elle me tient, c’est pour sa tendresse que je l’aime si profondément.
Il parlait avec entraînement, avec élan, en homme qui est heureux de trouver l’occasion longuement at tendue de dire enfin ce qu’il a dans le cœur.
Ce fut ce qu’il exprima lui-même:
–Il y a longtemps que je voulais dire tout cela devant Hélène, continua-t-il, ne pouvant le lui dire quand nous sommes en tête-à-tête, et il n’y a jamais eu moment plus propice que celui-ci qui, pour la première fois, nous réunit en famille; c’est ma dette de reconnaissance que je commence à payer.
–Oh! père, peux-tu parler ainsi! s’écria Hélène. N’est-ce pas moi qui te dois tout? Qu’ai-je fait pour toi?
–Tu m’as rendu heureux. N’est-ce rien cela?
Et avec des yeux mouillés, il la regarda.
–Mais s’il est juste de commencer à payer ses dettes, continua-t-il, c’est à condition qu’on ira jusqu’au bout, et j’espère que j’irai. C’est pour cela que j’ai si vivement désiré venir à Condé, où, comme je vous le disais, je puis acquérir une petite fortune.
–Vous l’acquerrez, mon neveu, personne ne le souhaite plus que moi, , croyez-le.
–C’est simplement une question de durée: si je vis, les économies s’entasseront toutes seules.
–Et pourquoi ne vivrais-tu pas, mon garçon? demanda la mère.
–C’est une question que j’émets, maman, ce n’est pas un doute. Pourquoi ne vivrais-je pas encore dix ans?
–Encore vingt ans, dit la tante Tout cha.
–J’ai soixante-treize ans, dit la mère, et je ne me sens pas prête à m’en aller, je t’assure. Si ton père n’avait pas été victime d’un accident, il serait encore de ce monde. Mon père et ma mère ont dépassé quatre-vingts ans; leurs père et mère ont vécu très vieux.
–Il n’y a pas besoin de me rassurer, je n’ai aucune inquiétude; je suis solide et la vie que je mène, celle que j’ai toujours menée ne doivent pas me tuer. Ma santé a toujours été bonne. Et les quelques petits accidents que j’ai éprouvés sont insignifiants.
–Quels accidents? demanda la mère.
–Rien ou presque rien. J’ai bien quelques douleurs qui courent de ci de là, mais jamais cela n’a été au point de m’aliter. J’ai bien aussi l’humeur un peu changeante, de même j’ai le cœur facile aux palpitations après des excès de travail, des veilles prolongées ou bien des marches forcées, mais cela ne vaut pas qu’on en parle.
–Bien sûr, dit la tante, qui, de sa vie, n’avait eu une seconde d’indisposition, mais qui cependant «par peur de quitter tout cha», se croyait à chaque instant en danger et dépensait largement son argent, auquel elle tenait tant cependant, en visites aux médecins qui arrivaient dans la contrée et en pèlerinages à tous les saints des environs.
–Ce qu’il y a eu de plus grave dans mon état, poursuivit M. Margueritte, si toutefois il est permis de se servir du mot grave à propos de cela, ç’a été qu’à plusieurs reprises j’ai senti mon cœur battre comme s’il voulait rompre la poitrine qui l’enserrait, et qu’au lendemain de ces fatigues du cœur je n’étais plus le même homme: le cœur me manquait, l’aptitude au travail me faisait défaut, j’étais apathique, sans ressort moral, intellectuel et physique; je me sentais détraqué, je ne digérais plus, je ne dormais guère, mes jambes étaient cotonneuses, ma parole était traînante.
–Tu as consulté un médecin? demanda la mère.
–Oh! assurément, dit Hèlène.
–Des attaques légères de rhumatisme, poursuivit M. Margueritte. Mais qui n’a pas des rhumatismes? Cela ne mérite pas qu’on s’en occupe quand on ne souffre pas, et depuis longtemps je ne souffre pas. Je puis donc espérer; je dirai plus, je dois espérer que le rêve que j’ai formé se réalisera et que les dix ou quinze années que je demande me seront accordées.
–N’en doutez pas, mon neveu.
–Oh! je n’en doute pas; je trouve même qu’elles me sont dues et que je serais volé si je ne les obtenais pas. Mais je ne le serai point. Et si je n’ai pas les quinze années de mon calcul, j’en aurai toujours quelques-unes sans doute qui me permettront de ne pas laisser Hélène dans la misère.
–Oh! père, ne parlons pas de cela.
–Et pourquoi? Cela ne fait pas mourir. D’ailleurs quand même je viendrais à mourir demain et à ne te rien laisser par conséquent, puisque présentement je n’ai rien, tu ne serais pas pour cela dans la misère et exposée à souffrir la faim.
Cessant de s’adresser à sa fille pour se tourner vers sa mère:
–Telle que tu vois cette belle fille, maman, qui est assez belle pourn’avoir pas besoin d’autre mérite que sa beauté, c’est une savante. Je l’ai fait travailler, non comme un garçon bien entendu, mais plus que les femmes ne travaillent ordinairement. Elle a tous ses diplômes.
–C’est-à-dire, grand’maman, interrompit Hélène en souriant, que je pourrais être directrice d’une salle d’asile pour les petits enfants, ou bien directrice d’une école primaire, ou bien institutrice.
–J’espère bien, continua M. Margueritte, qu’elle n’aura pas besoin de cela; mais enfin, si je venais à disparaître subitement, elle ne serait pas perdue: elle a un gagne-pain.
–C’est là l’essentiel, dit la tante sentencieusement, quand on peut gagner on gagne, c’est la loi de la nature.
–D’autre part, poursuivit M. Margueritte, Hélène a une dot.
–Ah! dit la tante.
–Sa beauté. Si, pour l’homme, le don par excellence est l’intelligence, pour la femme ce don est la beauté. Jusqu’où ne monte pas un homme supérieur par l’intelligence? A quelle position ne peut pas prétendre une femme supérieure par la beauté?
–Vous comptez sur un beau mariage? dit la tante.
–Je n’y compte pas, mais je dis qu’un beau mariage serait possible pour Hélène si elle voulait en faire un; je dis même qu’elle n’aurait qu’à vouloir.
Hélène ne répondit pas; mais un sourire passa sur son visage, dont l’expression disait clairement qu’elle ne partageait nullement les illusions enthousiastes de Son père et qu’elle ne croyait pas n’avoir qu’à vouloir pour faire ce beau mariage.
–N’allez pas supposer, continua M. Margueritte, que j’ambitionne un beau mariage pour ma fille; la vérité est, au contraire, que, loin de le rechercher ce mariage, je tâcherais de l’éviter s’il se présentait, car je ne crois pas que le bonheur se rencontre sur les sommets. On est exposé là à trop de dangers, et ce que je veux avant tout pour ma fille, c’est le bonheur, c’est qu’elle aime son mari et qu’elle en soit aimée; c’est qu’ils vivent étroitement unis, n’ayant pas d’autres désirs et d’autres joies que de se rendre mutuellement heureux. Au reste, puisque nous sommes sur ce sujet, je ne veux pas vous cacher que, bien que rien ne soit arrêté, j’ai en vue ce mari qui doit lui donner le bonheur que je veux pour elle.
–C’est quelqu’un d’ici? demanda vivement la tante, incapable d’imposer silence à sa curiosité.
–Je vous dis que rien n’est arrêté; et même les choses sont si peu avancées que je ne peux pas en parler; il y a un projet, voilà tout; s’il prend corps, vous serez une des premières, ma tante, à en être informée.
Il fallut que la tante Tout cha, malgré son désir d’en apprendre davantage, s’en tînt à cela. Elle voulut, en quittant la table, interroger Hélène; mais celle-ci se renferma dans ce qu’avait dit son père.
–Au moins est-ce pour bientôt? demanda la tante.
–Comment voulez-vous que je vous dise quand cela se fera, puisque je ne sais même pas si cela se fera.
L’heure du départ était arrivée. La tante demanda qu’on attelât Cocotte. Puis, après avoir promis de ne rien oublier de ce qu’elle devait fournir à son neveu, elle monta en char à bancs, et, faisant claquer son fouet mais sans toucher la jument, elle partit grand train.
Lorsque la grande porte fut refermée, madame Margueritte s’approcha de son fils avec un certain embarras que M. Margueritte ne vit pas, mais qu’Hélène remarqua:
–Vous voulez quelque chose, grand’maman? demanda-t-elle.
–C’est à mon fils que je voudrais parler, dit elle.
Hélène fit un pas pour se retirer, mais sa grand’mère la retint:
–Je peux parler devant toi, ma fille; ce que j’ai à dire c’est relativement à ta tante, mon garçon, et aux fournitures qu’elle doit te faire. Il faudra être attentif.
–Sois tranquille, les prix seront ceux du cours du jour.
–Ce n’est pas seulement du prix que je veux parler, .
–Je veillerai encore à la qualité.
–Il y a aussi.–elle hésita un moment en regardant autour d’elle,–il y a aussi la quantité. Je te dis ça, tu sais, ce n’est pas pour l’accuser; mais ce ne serait pas bien à moi de ne pas te prévenir.
–Pauvre maman, dit-il, comme tu as dû souffrir près d’elle, toi si droite, si délicate!
–Tu sais, l’intérêt lui trouble l’esprit; sans cela elle ne serait pas méchante femme; mais quand il s’agit de son intérêt, rien n’existe plus; il n’y a plus ni parentsr ni enfants, ni bon Dieu.
–Eh bien, je me défendrai et je m’arrangerai de façon à lui prouver dès le premier jour que, moi aussi, j’ai souci de mon intérêt et que je sais le défendre. Tu m’aideras.
–Oh! mon garçon!
–Ne vas-tu pas avoir peur d’elle maintenant. Qu’as-tu à craindre? Nous sommes réunis pour toujours, et tu n’auras pas d’autre maison désormais que la mienne. Nous allons vivre heureux tous les trois jusqu’au jour où nous serons quatre, puis cinq, puis six, tes petits-enfants que tu surveilleras. Car je dois te dire ce qu’il ne me convenait pas de raconter à la tante Tout cha: si le mariage que je désire pour Hélène se réalise, mon gendre vivra avec nous, et nous ne nous quitterons plus. Tu vois que tu n’a pas à t’inquiéter de la tante, et quand tu croiras devoir prendre ma défense, tu pourras le faire librement.
V
Il y avait à peu près une heure que la tante Tout c’ était partie, et M. Margueritte surveillait ses ouvriei lorsque le portier vint le prévenir qu’on le demanda
–Qui? Des parents? dit M. Margueritte, qui pensa à la rentrée.
–M. Radou, répondit le portier.
Au premier étage, M. Margueritte ouvrit la porte son appartement où se trouvait en ce moment sa mè et sa fille.
–Hélène! cria-t-il du seuil.
Hélène était avec sa grand’mère dans la chambre ( celle-ci; elle accourut à l’appel de son père.
–Tu as besoin de moi?
–Radou vient d’arriver.
M. Radou, qui attendait dans le salon où d’ordinai on recevait les parents, était un beau jeune homn de vingt-quatre à vingt-cinq ans très soigné dans tenue, peut-être même trop soigné, au moins po un homme du monde: redingote noire non boutonné gilet en cœur laissant voir le plastron de la chemis pantalon gris mastic, gants de chevreau jaunes, ma chettes bien empesées recouvrant la moitié de la mai] Pendant tout le temps qu’il était resté seul, au lieu regarder les livres placés sur la table ou les cadres accrochés aux murs et qui représentaient, les uns, des modèles d’écriture avec entourages d’oiseaux et de feuillages à la plume, les autres des sujets académiques au crayon noir et au fusain, il s’était regardé lui-même dans la glace et, s’étant déganté de la main droite, il avait à plusieurs reprises passé ses doigts dans ses cheveux frisés pour les faire bouffer; puis à plusieurs reprises aussi il avait élevé, droit au-dessus de la tête, sa main dégantée et l’avait agitée vivement pour faire descendre le sang qui la rougissait. Alors, à mesure qu’elle blanchissait, il l’avait complaisamment admirée.
C’était à cela qu’il s’occupait pour la quatrième ou cinquième fois et toujours avec un plaisir nouveau, lorsque la porte du salon s’ouvrit. S’interrompant aussitôt, mais sans se troubler, il vint au-devant de M. Margueritte, sa main droite tendue et la regardant avec un sourire de satisfaction: elle était blanche.
–Comment, vous, mon cher Radou, dit M. Margueritte d’un ton affectueux.
–Vous ne m’attendiez pas de sitôt.
–Il est vrai.
–J’ai voulu avoir le temps de m’organiser avant la rentrée. Je ne vous demande pas de vos nouvelles, car je vois à votre belle mine florissante que vous êtes toujours bien portant; mais mademoiselle Hélène, comment est-elle?
–Très bien; vous allez la voir, car vous dînez avec nous.
–Mais.
–Pas de mais. Vous arrivez, vous ne connaissez que nous à Condé, vous nous appartenez.
–Alors j’obéis pour la discipline. et aussi pour mon plaisir.
Si la phrase était prétentieuse, la manière dont elle fut dite l’était plus encore; mais M. Margueritte ne fit attention, bien évidemment, qu’au sens même de la réponse: son invitation était acceptée, cela lui suffisait et le satisfaisait.
–C’est parfait, dit-il, c’est parfait. Vous savez que je suis de Condé; demandez-moi donc tous les renseignements qui peuvent vous être nécessaires.
–Avant de rien demander, je dois commencer par vous remercier.
–Vous m’avez écrit pour m’envoyer vous remerciements.
–Ce n’est point assez: je dois, je veux vous les réitérer de vive voix.