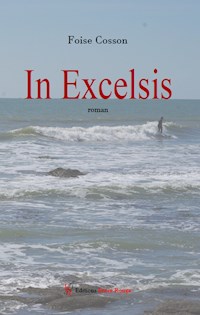
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Éditions Encre Rouge
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
La mort de son mari bouscule la vie de Sophie. La jeune femme devra trouver la force à l'intérieur d'elle-même pour réussir à se libérer, à se reconstruire et à vivre à nouveau.
Sophie cherche l’air pour respirer encore. Elle est au seuil d’une nouvelle vie, en ce matin d’octobre, son mari vient de mourir. Dans ce petit village au bord de l’océan où elle est aide-ménagère, les vents mauvais de l’hiver emporteront-ils ses oppressants secrets ? Sous ses paupières, les souvenirs défilent comme autant de kaléidoscopes.
Découvrez cette histoire terrible, bouleversante mais pleine d'espoir avec ce premier roman de Foise Cosson, une nouvelle auteure à suivre au talent d'écriture indéniable.
EXTRAIT
Les nuits ne se ressemblent pas, il y a celles où je m’écroule anéantie de sommeil, en moyenne une sur trois, et puis les autres. Je les appréhende et traîne ma solitude récente devant la télé. Je pensais que cela aurait été plus facile, que l’absence allait me donner des ailes, que cette liberté nouvelle me ferait danser.
Je me suis trompée.
Je revis le passé, ma mémoire le convoque sans prévenir. La nuit dernière, je me suis endormie bien après une heure, j’avais tricoté toute la soirée devant un film que je n’arrivais pas à suivre, je ne comprenais pas l’intrigue. J’avais des absences et du mal à fixer mon attention, j’avais sauté des mailles, défait le tricot bleu dragée et pesté, puis m’étais fait couler un café pour me réchauffer et bien évidemment, à trois heures, j’étais assise sur les toilettes devisant comme en plein jour, énervée avec des idées noires plein la tête, de quoi devenir folle.
CE QU'EN DIT LA CRITIQUE
"L’originalité du roman de Foise Cosson réside précisément dans la volonté manifeste d’éviter toute idée reçue et tout schéma manichéen. La (re)conquête d’une dignité qui fut piétinée et saccagée jusqu’à l’indicible peut emprunter des chemins insoupçonnables et insouçonnés, que je vous invite vraiment à découvrir en lisant In Excelsis." -
Roffi sur le blog de Martine Roffinella
À PROPOS DE L'AUTEUR
Foise Cosson est née à Nantes en 1950 et vit dans un petit village vendéen sur la côte atlantique, elle se consacre à l’écriture depuis une quinzaine d’années.
In Excelsis est son premier roman publié.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 277
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foise Cosson
Cet ouvrage a été composé par les Éditions Encre Rouge
®
Déchiré mon cœur, déchiré mes rêves
Que de leurs débris, une aube se lève.
Louis Aragon
(Les pages lacérées)
Le seul plafond que la vie a, est celui que vous lui donnez
Sépulture
Je jette les gobelets et ramasse les bouteilles vides. Trois litres de rosé ont suffi puisqu’il n’en reste plus. La cafetière aussi est vide, ainsi que les deux packs de jus d’orange, les deux barres de quatre-quarts sont parties également, pas formidables pourtant. J’ignorais qui viendrait et combien de personnes. Je n’ai pas compté mais je me souviens avoir disposé avant la cérémonie, sur la nappe blanche en papier, une vingtaine de verres en plastique que j’avais acheté la veille et je constate qu’ils ont tous servi.
Je m’affale lourdement sur une chaise, soudain la fatigue me tombe des épaules et me scie les bras. Je voudrais ne pas penser mais une petite musique m’envahit, celle du cantique que j’ai choisi et qui s’invite dans mon cerveau encore et encore… Ajoute un couvert, Seigneur à tatable, tu auras aujourd’hui un convive de plus… Il ne reviendra plus manger à cette table que je viens de débarrasser.
Je vais manger seule maintenant.
J’avais lu et relu l’autre, dans la villeoù tu t’en vas, puis le prêtre impatient avait voulu trancher, alors j’avais choisi dans ce petit bureau de la sacristie, sans hésiter. Comme j’avais choisi la veille le cercueil et la croix au funérarium. Un chapelet dans ses doigts, avait ajouté l’ecclésiastique ? Non, avais-je affirmé sans réfléchir davantage, et puis on avait fixé le jour et l’heure de la sépulture. Dans ma vie d’avant, je n’avais plus l’habitude de décider et de prendre des dispositions. Tout mon corps, bien avant mon esprit, avait compris que j’avais les cartes en main et que dorénavant personne ne ferait les choses à ma place.
Après toute cette énergie déployée, là sur cette chaise, je me sens lessivée, rincée.
Entre les nuages, le soleil perce. Un bandeau de ciel bleu arrive sur la droite du côté de la mer, effilochant le blanc des nuages qui s’enfuient. La pluie semble avoir lavé les cieux. Il a plu toute la cérémonie, à l’entrée, à la sortie et au cimetière.
Des hallebardes s’abattaient sur le cercueil et sur les couronnes de fleurs posées quelques instants sur le parvis alors que le prêtre m’accueillait et invitait les porteurs à monter vers le chœur. J’avais été prise d’un fou rire nerveux quand dans l’église, le bouquet de roses blanches que j’avais acheté avait été posé sur le catafalque, inondant la photo du défunt qui se mit à gondoler fâcheusement, déformant le visage de mon époux. J’avais mis une main sur ma bouche pour calmer le hoquet qui avait saisi mon corps tendu, puis fermé les yeux après avoir croisé le regard intrigué de ma mère, son haussement de sourcils réprobateur. Alors mon sourire se figea dans une grimace et en simulant les pleurs, les larmes se mirent à couler, des larmes chaudes de fatigue et de solitude, des larmes qui prenaient leurs sources dans d’insondables ravins. Les vannes ouvertes laissaient place à un torrent qui emporta tout ; j’avais pleuré une partie de la messe, silencieusement, sans tenter d’enrayer le flot. Cela avait été tellement rapide, la mort et ses manières brutales, ses non-retours et ses silences. Il avait fallu avancer et changer le cours des choses. Les nœuds de mes nerfs se dénouaient et me délivraient enfin.
Après l’enterrement, tout serait bouclé, je reprendrai ma vie. Je ressentais quelque chose d’inconnu, une forme de bonheur léthargique. Quelque chose à venir indéniablement. Il y avait une percée de lumière dans cet horizon morose, parce que bien évidemment, je le sentais dans tout mon être, la mort était une fin.
Les gens du village défilaient devant mes yeux mouillés, aspergeant le cercueil avec le goupillon que le prêtre avait placé sur un tabouret dans un petit seau doré. Les pièces qu’ils jetaient dans une corbeille en osier tintaient au rythme de leur passage, certains levaient les yeux vers moi, d’autres ignoraient cette jeune femme assise sur le banc inconfortable, et puis quelqu’un toucha mon épaule chaleureusement, alors un autre s’arrêta pour m’embrasser, ralentissant le triste cortège. Je décidai de baisser les yeux et me mis à scruter les pieds qui passaient devant les miens, à mater les chaussures, distinguant les hommes des femmes, relevant la tête parfois pour identifier le propriétaire. Je détaillai ainsi baskets et souliers, escarpins et mocassins, les bottines féminines de toutes formes, noires souvent. Mes sanglots se tarirent à cette inspection incongrue.
Ils étaient nombreux et je me demandai si l’église était pleine. Le défilé dura dans le silence alors que les couplets du cantique étaient épuisés.
Je me surpris à gratter mon avant-bras avec force, une plaque rouge apparut et nerveusement, je tirai la manche de mon vêtement puis me mouchai avec discrétion. Les hommes des pompes funèbres s’appliquaient lentement dans une chorégraphie connue d’eux seuls, ils prenaient les fleurs et s’apprêtaient à descendre l’allée, me faisant signe d’un geste théâtral de suivre le mouvement. Les quatre porteurs, des hommes connus de mon défunt mari, soulevèrent la boite avec précaution comme s’ils avaient fait ça toute leur vie et derrière eux dans un grand silence, j’entamai, le souffle retenu, la descente de la grande nef sous les yeux des curieux. Dans un bref regard circulaire, je perçus tout de suite mes collègues de travail sur un même banc à droite, puis mes voisins sur un autre, je baissai les yeux, honteuse d’être leur cible en cet après-midi d’automne pluvieux.
Quand les deux battants de la grande porte s’ouvrirent, je vis la pluie qui striait la place, je tirai sur mon visage la capuche de ma parka, m’y planquant en soupirant. Encore quelques heures, il faut que je tienne, pensai-je, les membres cisaillés par l’angoisse de ce moment singulier. Je n’avais dormi que trois heures la nuit précédente, j’avais imaginé, en me tournant sans cesse, les détails de cette longue et difficile journée qui, je ne l’ignorais pas, me verrait au premier plan.
Là où je ne souhaite pas me trouver.
***
Le téléphone fixe me fait sursauter, je le regarde et me demande ce qu’il peut m’apporter d’intéressant après une pareille journée ; je le laisse s’égosiller tout seul et pense que je suis libre de faire ce que je veux maintenant, dans cette maison. Mes yeux sont attirés par les traces sur le carrelage. Après la cérémonie, les gens sont entrés sans s’essuyer les pieds, je maudis l’allée du jardin détrempée, depuis le temps que je réclame du ciment et des dalles devant cette porte d’entrée !
Je prends le seau et la serpillière, y jette du vinaigre blanc et du produit à vaisselle et entreprends le nettoyage. Je vais récurer jusqu’à ce que ce soit nickel, je mets les chaises pieds en l’air sur la table, déplace sans ménagement les fauteuils et le meuble de télé. Bousculé par mes gestes brusques, un petit canard en porcelaine s’est écrasé sur le sol, je saisis au creux de ma main les morceaux brisés et contemple silencieuse les fragments jaunes et verts. C’est son préféré, sa première acquisition, le colvert. Une angoisse m’étreint soudainement, enserre ma poitrine, je me mets à trembler puis me souviens qu’il n’est plus là, que je suis seule. Je cherche du regard les autres canards, le mandarin doré aux taches blanches et l’autre en bois exotique brun et noir, sur l’étagère j’attrape celui en laiton, puis le petit rose en verre fumé. J’ouvre la porte du placard sous l’évier et d’une main ferme, je jette les objets dans la poubelle où ils atterrissent dans un cliquetis léger. Insidieusement, un soupir vainqueur s’échappe de ma poitrine.
Je vais faire le ménage par le vide, un grand ménage, me dis-je en essuyant les meubles. Le soleil couchant tamise au travers de la fenêtre les particules de poussière incandescentes que je soulève.
Je souris à l’idée que cela ne fait que commencer, je parcours des yeux la pièce, les deux tableaux de scène de chasse et la bestiole empaillée que j’exècre, les armes et les cartouches qu’il va falloir donner ou vendre, toutes les bouteilles de vin, d’apéritif et ses vêtements. Je reprends le travail dans trois jours, j’aurai le temps, je pense. J’ai les mains sur les hanches et scrute la pièce en mordillant l’intérieur de ma joue puis je file dans la cuisine et pense au congélateur et au gibier qui le remplit comme celui du garage et de l’arrière-cuisine. J’ai l’impression que je ne mangerai plus jamais d’animaux sauvages de ma vie, je vais devenir végétarienne. Je ne supportais plus de cuisiner les faisans, les lapins et le sanglier tant détesté. Mon mari n’avait plus le palais fin avec l’alcool qui l’anesthésiait, à quoi bon cuisiner, me disais-je, le goût n’a plus d’importance. Il consommait des bières dès le réveil et tout au long de la journée et puis du pastis le soir, autant de tournées que de potes, une excellente adresse pour les alcooliques du village. Il suffisait de se garer près de la grange, de frapper un petit coup à la porte du garage et puis s’asseoir autour de la table de la cuisine à l’heure où le soleil descend dans l’océan. Le petit jaune coulait dans les verres, des doses au bon vouloir du maître de maison que l’alcool rendait tout puissant, orgueilleux et colérique. Les heures défilaient et les conversations devenaient hachées et inaudibles, l’alcool engourdissant les langues et les cerveaux déjà imbibés.
Je me couchais souvent sans manger, appréhendant la suite qui était pourtant tristement banale, mais hop hop… J’obtempère… Méthode Coué… Tout va bien, oui tout va bien, chaque chose en son temps, le rangement d’abord, puis viendront les changements et la vie d’après.
Et le couvercle sur les choses difficiles. Pour l’instant.
Trois heures du matin
Les nuits ne se ressemblent pas, il y a celles où je m’écroule anéantie de sommeil, en moyenne une sur trois, et puis les autres. Je les appréhende et traîne ma solitude récente devant la télé. Je pensais que cela aurait été plus facile, que l’absence allait me donner des ailes, que cette liberté nouvelle me ferait danser.
Je me suis trompée.
Je revis le passé, ma mémoire le convoque sans prévenir. La nuit dernière, je me suis endormie bien après une heure, j’avais tricoté toute la soirée devant un film que je n’arrivais pas à suivre, je ne comprenais pas l’intrigue. J’avais des absences et du mal à fixer mon attention, j’avais sauté des mailles, défait le tricot bleu dragée et pesté, puis m’étais fait couler un café pour me réchauffer et bien évidemment, à trois heures, j’étais assise sur les toilettes devisant comme en plein jour, énervée avec des idées noires plein la tête, de quoi devenir folle.
***
C’est à cette heure de la nuit que je l’avais trouvé mort, huit jours plus tôt. À cet endroit-là. J’y pensais à chaque fois. J’aurais bien voulu faire mes besoins ailleurs.
Je l’avais entendu bouger, grommeler puis se lever. Je m’étais rendormie puis, sentant le frais sur mes jambes à demi découvertes, m’étais arrachée péniblement du lit pensant qu’il n’avait pas encore dessaoulé. Il était assis sur le siège des toilettes, la tête tombée sur les genoux. Afin de le réveiller, j’avais juste touché son épaule et il était tombé sur le sol devant mes pieds nus, plié en trois. Raide.
J’avais compris. Il était de marbre glacé, dur comme du bois. Je n’avais pas crié. La stupeur avait saisi mon esprit. Mon corps s’était figé devant cet amas de membres tordus. Reculant d’un pas, j’avais fixé interdite le corps maigre et flétri, il était nu, son visage avait noirci, son ventre gonflé par l’alcool ne dissimulait pas le sexe minuscule que je raillai d’un raclement de gorge et d’une grimace dégoutée. De mon estomac jaillit mon écœurement tout entier quand je vis en m’accroupissant la bouche ouverte et le blanc des yeux révulsés, je n’eus que le temps de me jeter sur le lavabo de la salle de bains où je vomis, secouée de sanglots bruyants.
Je le compris ensuite, c’était lui que je vomissais !
Mon corps avait encore la marque des coups de la veille et des autres jours… Et j’avais dû me tenir au mur après m’être levée péniblement.
***
Aucune tristesse, aucune joie ne m’habitaient. C’était terminé. Je devais l’accepter, il me fallait du temps. Je n’avais pas imaginé une telle fin, j’avais bien pensé à des choses en regardant des séries télévisées, je me disais que je devais accepter puisque je ne fuyais pas. J’attendais que le pire arrive, songeant à la petite valise au-dessus de l’armoire, à l’argent que j’y planquais depuis plusieurs années. Le pire arrivait tous les jours depuis quelque temps, mais je ne voulais pas le voir, le niais en partant au boulot le matin, mettant les idées noires de côté, tentant de gommer la monstruosité de mes nuits. Mon autre vie m’a toujours sauvée, j’enchaîne avec joie les clients, les toilettes, les ménages et les courses, les réunions avec mes collègues aide-ménagères.
En compartimentant mes vies, j’ai trouvé la paix et la force d’exister. En me réfugiant au fond de moi-même, je me suis libérée de mes chaînes. J’étais au chaud dans une sécurité que je maîtrisais encore parfaitement. À chaque jour suffit sa peine, me disais-je pour me donner de l’élan.
J’avais, en fait, une grande pratique de l’évitement, car ces moments s’agglutinaient, s’empilaient. J’ignorais à quel point je les stockais. Je pensais naïvement que le dernier chassait le précédent.
Par la baie du jardin, je croise le regard fixe du setter. Il me cherche au travers de la vitre, son museau humide trace des rubans opaques tout le long du carreau à cinquante centimètres du sol, il me fixe, ne cille pas. J’ouvre machinalement la porte du placard au-dessus du frigo et tire la boite en fer, sors une longue tranche de pain grillé que je lui tends en ouvrant la baie ; il la saisit dans sa gueule sans bouger, attendant la caresse sur le dessus de la tête, puis il remue son arrière-train, me jette un œil reconnaissant et s’enfuit avec son trésor, quand je lui dis :
À la niche mon pépère…
Nous irons marcher dans la dune et au bord de la mer tous les deux, la chasse ne lui manquera pas, les coups non plus. C’est peut-être à cause de lui que je ne suis pas partie ! Un dimanche soir, il était revenu loin derrière le maître, en traînant la patte arrière, gémissant, il n’était pas venu quémander sa gourmandise devant la vitre, je l’avais trouvé devant sa niche en train de se lécher.
Il lui avait foutu un coup de fusil !
Quel connard ce clébard, avait-il éructé mauvais, il m’a fait rater un lapin, la prochaine fois, je lui fais la peau, c’est lui que je ne raterai pas !
Depuis, j’attendais angoissée les retours de chasse, parfois le chien saignait du nez, il avait pris un coup de crosse, un coup de pied ou une pierre et le maître jurait, lui promettant le tas de fumier comme fin de vie, et je tremblais croisant l’œil soumis du compagnon fidèle qui ignorait que nous étions logés lui et moi, à la même enseigne…
***
J’ai repris mon tricot pour un garçon de quatre ans, toujours le même bleu, le même motif simple, la même forme. J’ai fait la même taille en rose. Parfois je vérifie dans l’armoire ancienne de ma grand-mère la pile des pulls. Je prends le dernier, celui du dessus, et mesure la carrure ou les manches suivant le travail effectué. J’ai une rangée de bleu de un à quatre ans et une rangée de rose aux mêmes âges… Le bébé que j’ai perdu aurait quatre ans cette année, alors je tricote deux pulls par an, un rose d’abord parce que j’aurais aimé une fille et ensuite un bleu parce qu’un garçon aurait été bien aussi. Je fais celui de la fille avant l’été, puis l’autre ensuite, je suis en train de terminer le huitième. C’est un rituel inéluctable, je ne sais pas quand je m’arrêterai. Quand je tricote, je sens mon ventre et mon esprit s’évade, c’est comme une drogue. Je sais que ce n’est pas ordinaire car je cache ce petit manège comme je peux, aux yeux des autres, je ne cherche pas à comprendre, c’est juste une façon de faire exister cet enfant que j’ai porté.
Pourtant, j’aurais préféré la couture. À l’école, j’avais appris à bâtir un ourlet, à broder des boutonnières, j’étais douée, j’aurais aimé m’acheter une machine à coudre mais il n’a jamais voulu, en même temps qu’aurais-je fait avec ? Si j’avais eu une fille, j’aurais fait des vêtements de poupée, des déguisements de princesse, des draps et des rideaux pour une maison miniature, des robes et des corsages. Pour un garçon, des déguisements de pirate ou de renard auraient pris forme sous mon regard comblé.
Malgré mes résolutions et mes désirs d’enfouir le passé, j’ai en mémoire qu’il y a plus d’un mois, il a découvert les tricots. J’en ai la chair de poule.
Pris de colère, il les a jetés par la fenêtre !
J’avais tremblé ensuite toute la journée en lissant et caressant les petits pulls et le papier de soie qui les enveloppait. C’était un dimanche matin, il traînait au lit comme d’habitude, j’étais dans la salle de bains, levée depuis plusieurs heures. Je me séchais les cheveux que je porte longs depuis mon enfance, quand je l’entendis appeler avec ce ton mielleux qui me fait frémir, il avait plus d’une heure d’avance, je me croyais à l’abri, tranquille :
Il est où mon petit bijou ?
Je continuai tremblante à faire tourner le séchoir pour ne pas entendre et pour qu’il comprenne que je ne percevais pas son appel, me demandant interdite comment me tirer en douce de la salle de bains qui faisait face à la chambre. J’avais enfilé un jean et un débardeur après une douche dominicale rapide, il allait faire chaud, l’été s’attardait et le soleil était déjà haut quand dans la glace soudain je le vis derrière moi, hirsute, nu, contrarié par mon silence à n’en pas douter, la bouche tordue d’un rictus mauvais. Il tira la prise du séchoir qu’il m’arracha des mains et le jeta contre le mur, puis d’une poigne ferme, il attrapa ma chevelure et m’embarqua dans la chambre, sans ménagement. Le tapis humide de la douche me fit déraper au passage, je glissai, il tira plus fort. Je hurlai tentant de me relever, il me poussa jusqu’au bas du lit où il me lorgna hargneux, après m’avoir donné deux coups de pied dans le thorax, il hurla :
Et le câlin du dimanche !
J’avais mal à la cheville, ma poitrine me brûlait. Il me chopa sous les bras et me jeta sur le lit en arrachant mon débardeur, mes seins jaillirent et je décelai affolée ses yeux sur eux, son excitation les exorbita. Il tenta de tirer mon jean en marmonnant des grossièretés entre les dents, toujours les mêmes. Elles avaient sur moi un effet anesthésiant car je connaissais la suite, les gestes humiliants, les rires lubriques et les grognements satisfaits.
Je ne pouvais mettre des mots sur ce qu’il me faisait, même au médecin je n’avais pu dire où je souffrais et pourquoi… La honte, c’était la honte et rien d’autre. La honte d’être à la merci d’un homme qui me prenait malgré moi depuis des années et parfois me sodomisait pour ne pas me mettre enceinte.
La pudeur n’avait rien à voir là-dedans.
Autrefois, quand j’étais plus jeune et qu’il avait commencé à me tripoter dans sa voiture, je baissais volontiers ma culotte et acceptais avec curiosité qu’il me lèche la chatte, comme il disait, ou bien qu’il mette entre mes seins ronds son pénis dressé, je savourais la volupté de son regard et riais surprise des mots impudiques qu’il prononçait dans mon cou. J’avais dix-sept ans et lui plus de trente-cinq. Je n’étais pas du tout coincée comme certaines de mes copines qui bavaient lorsque je leur racontais mes exploits. J’étais amoureuse. Il était le premier homme de ma vie et ce n’était pas un gamin comme ceux que je fréquentais à l’école. Il était vendeur de matériel agricole, avait sa maison à lui et avait promis de m’épouser alors qu’il écartait mes cuisses pour la première fois… Plus de dix années avaient passé, il n’avait tenu que cette promesse. L’amour s’était enfui aussi vite qu’il était venu. Avec l’alcool était arrivée la violence. Un jour qu’il était ivre et que je me refusais, ma vie avait irrémédiablement basculé. Je ne voulais pas m’en souvenir. Un autre quotidien s’était installé dans notre maison, bien loin des promesses amoureuses.
***
Ce dimanche-là, je m’étais fait piéger.
D’ordinaire, dans la journée il se faisait discret, il tournait en rond dans la maison depuis trois ans, depuis qu’il avait perdu son boulot. Il réservait pour le soir, l’alcool aidant, ses menaces et leurs mises à exécution. Depuis quelque temps, je me soumettais sans broncher, sentant instinctivement que cela ne durerait pas, il avait des insuffisances respiratoires qui en disaient long sur sa santé, des hoquets qui parfois le faisaient vomir, des trop-pleins de bières qui l’empêchaient de bander, alors il me martelait de coups de poing dans les seins et m’insultait avant de sombrer dans un sommeil bruyant.
Je tentais de me protéger, me verrouillant aux douleurs, mais quand il était le plus fort, je lui abandonnais ce corps que je finissais par renier et dont je m’éclipsais miraculeusement, m’enveloppant d’une ataraxie. Mais la veille au soir, j’avais morflé comme le jour d’avant, j’avais des maux récurrents que je tentais de calmer avec du doliprane, aussi je hurlai de douleur lorsqu’il m’écarta violemment les cuisses. D’un coup de pied puissant vers son thorax, je le poussai. Il trébucha et tomba entre le mur et le lit en gueulant, le cul en premier, les jambes et les bras en l’air.
J’en profitai pour attraper mon t-shirt et remonter mon jean en me tenant le ventre, je glissai mes pieds dans mes tongs en sortant et en criant au secours deux fois de suite, je savais que ça le calmerait à cause des voisins, qu’ensuite je le paierai cher mais je me disais, chaque chose en son temps. J’avais, comme on dit, une certaine habitude.
Les contentieux, c’était son truc à lui ! Il en faisait tout un fromage, au moins une bonne raison de lui mettre une branlée, à cette suceuse de mes deux, comme il me qualifiait haineusement dans ces moments-là, quand il avait la dose. Je ne calculais qu’une seule chose, m’en sortir encore une fois.
Ce jour-là, je n’avais pas subi, je ne sus pourquoi. En marchant au bord de l’eau, je ressentis une victoire puis vint un arrière-goût bizarre dans ma bouche. Cela m’interpella violemment, comment allais-je vivre maintenant si tout en moi criait non, allais-je devoir me battre ? Partir ?
En rentrant, je trouvai éparpillés dans le jardin les vêtements des petits et les miens. Mon ventre se crispa, seuls culottes et soutiens-gorge gisaient sur le lit, déchiquetés comme s’il les avait détruits avec les dents ou avec un couteau.
Il était absent, s’était tiré.
Le setter noir et blanc me regardait sans jouer de la queue, il avait dû subir aussi les représailles. Je ramassai au milieu de mes sanglots délicatement les tricots dans l’herbe tondue. Oui, s’il le faut, me suis-je dit alors, en cramponnant mon ventre douloureux, s’il le faut je vais me battre ! Je chercherai dans mon cerveau comment faire, je devais y penser auparavant, échafauder un plan et combiner un programme, trouver des idées, car lorsque les derniers attardés claquaient la porte du garage, la nuit venue, et que j’entendais de la cuisine les promesses de me « fourrer », mon esprit se dérobait et tout mon être se tétanisait.
Chez le coiffeur
Songeuse, je contemple mes cheveux qui tombent sur le sol, j’ai précisé aux épaules… La coiffeuse, assise sur un tabouret à roulettes, tourne autour de moi comme un moustique un soir de juin, en jacassant curieuse :
Nouvelle coiffure, nouvelle vie ?
Elle tire le peigne sur mes cheveux humides et manie les ciseaux qui font clic, c’est la première fois que je vais chez le coiffeur. Je connais bien cette femme blonde peroxydée aux yeux charbonneux, j’aide sa mère qui ne peut plus marcher. Je fais ses courses et sa cuisine depuis au moins cinq ans, une femme douce et discrète.
On sèche ? Elle a une voix de fumeuse, éraillée et forte. Je n’ai répondu ni oui ni non, la coiffeuse est dans l’action, ce n’était pas une question. Elle manie la brosse ronde et le séchoir de concert, sa main experte mène la cadence. Elle me chauffe un peu le cuir chevelu, je ne dis rien. Elle tourne et retourne en tirant vers elle les mèches dorées qui brillent sous les néons.
Alors que la commerçante insère ma carte bancaire dans son appareil, je surprends ma silhouette dans les glaces, devant, derrière et sur les côtés. Je me vois partout dans le salon violet et rose, avec la parka marine que je viens d’enfiler, mon jean délavé et ma nouvelle tête qui pour l’instant ne me fait pas sourire. Je surprends aussi les regards muets des autres clientes. La coiffeuse renchérit, me réveillant de mon inspection :
Ça vous va drôlement bien, vous avez rajeuni de dix ans, on dirait une jeune fille !
C’est un peu gonflé, non ?
Ils sont beaucoup plus épais quand ils sont plus courts, ajoute la professionnelle, vous avez une belle nature de cheveux, je voudrais bien la même ! On pourrait y faire quelques mèches blondes, la prochaine fois ?
J’ai murmuré entre les dents qu’il fallait que je m’habitue, on verra.
Je suis une autre, mon visage paraît plus fin, mes yeux clairs plus grands et j’ai l’impression qu’on voit moins ce petit nez court que je n’aime pas trop de profil. Je me contemple dans les vitrines puis dans le rétroviseur, je ne m’attendais pas à un tel changement, oui, la coiffeuse avait raison, changement de coiffure, changement de vie… J’apprends en me scrutant à être quelqu’un d’autre ou peut-être tout simplement moi-même.
Dans la glace de l’entrée, le verdict tombe. Je me surprends à sourire enfin à cette nouvelle femme, cette nouvelle jeune fille, comme a dit la coiffeuse. Je vais avoir trente-deux ans dans quelques semaines, et je pense que cette femme dans le miroir est bien éloignée de la jeune ado dont les rêves ont été piétinés et bafoués, dont le corps a été humilié. Elle peut encore faire illusion avec cette nouvelle coiffure et je m’interroge et me demande pour la première fois ce que les autres pensent de moi. Ce qu’ils savent de ma vie. J’ai toujours nié le pire en dressant une forteresse autour de moi. Ma muraille de Chine. Je ne me suis jamais épanchée sur une épaule compatissante, et pourtant parfois, dans le regard de certaines collègues, je voyais la pitié ou quelque chose qui y ressemblait, voire un début de révolte que je calmais d’un sourire franc, éloignant tous propos significatifs et toutes questions gênantes.
En aucun cas être une victime. Je ne le serai jamais, n’ai jamais voulu l’être. Ni dans mon esprit ni sur mon visage, ce qui exaspérait l’homme aviné. Je ne pouvais supporter les humiliations qu’à cette condition. Je savais que je me serais noyée dans mon chagrin si j’avais pleuré sur ma condition. J’étais forte. Il ne m’avait pas encore brisée. Le regard que je lui lançais parfois dans la journée lui faisait baisser les yeux et l’interpellait, je le savais à ses grognements et à ses gestes brusques, désordonnés ; il s’en souvenait la nuit dans les vapeurs d’alcool et me le faisait payer au centuple. Du moins, je le pensais.
***
De fait, mon regard sur ma maison est neuf. Je bazarde les choses qui ne m’intéressent pas, j’ai stocké dans la chambre les affaires de chasse, vêtements et bottes, fusils et cartouches.
J’ai vidé l’armoire et me suis installée dans la petite chambre au bout du couloir, un lit d’une personne, un bureau et un placard pour mes vêtements. J’ai réussi à passer le grand lit par la porte d’entrée, il a atterri dans le jardin. Le mari d’une collègue doit le porter à la déchetterie. J’ai fait des sacs pour le secours populaire qu’il veut bien emporter aussi. Je lui ai proposé en échange des lapins congelés et deux faisans, il a dit oui ravi, et même plus si tu veux. J’ai dit apportez une glacière, venez tous les deux, on boira un café en faisant l’inventaire.
Je ne pouvais plus dormir dans cette chambre, il ne m’avait pas fallu trois nuits pour m’en rendre compte, je n’avais rien de mieux à faire. J’ai fermé la porte en me disant, on verra plus tard.
Hier, je me suis acheté des baskets et un jean pour travailler, des boots noires avec un petit talon comme la femme de la maison de la presse dont j’ai vu les pieds à l’enterrement, celle qui me propose toujours des invendus quand je prends les mots fléchés, une femme charmante.
Aujourd’hui, je vais à la ville voisine acheter une machine à coudre, j’en ai vu une l’an passé qui me plaisait, je me sens grisée par cette acquisition qui va changer mon quotidien, j’ai des fourmis dans les mains. Je me dis aussi qu’il faut que je passe à la bibliothèque, il faut absolument que je recommence à lire, que je m’engouffre dans un roman, dans une histoire, pour stopper ce vacarme dans mon cerveau qui fonctionne tout seul à plein régime, toujours dans le même sens, la récurrence des jours passés et son lot de meurtrissures. Je ne veux pas sombrer. Pas maintenant.
Je monte sur une chaise, attrape la valise marron par la poignée et l’ouvre sur mon lit. Les billets sont là, nombreux, patients. Je n’ai aucune idée de la somme amassée. Des billets de vingt et cinquante euros subtilisés au quotidien familial depuis des années, je les soulève et les fais voler en riant.
C’est une victoire sur la radinerie de l’homme qui lui, ne comptait pas et s’offrait des fusils à plusieurs milliers d’euros, des cartouches qui coutaient la peau des fesses et des vêtements luxueux, un pantalon de cuir et des vestes onéreuses pour aller chez le châtelain quand il y avait des battues de sanglier. Il avait même fait l’acquisition sur internet d’un chapeau ridicule à plus de cent cinquante euros. J’en avais été malade de cliquer sur "acheter" quand il m’avait sommée de le faire. Il était incapable de comprendre comment fonctionnait ce qu’il appelait ce-truc-de-merde, mais avait bien su taper « chapeau de chasse » dans Google et puis hurler :
C’est celui-là que je veux, magne-toi ! Et il m’avait balancé sa carte avant de claquer la porte et s’enfuir picoler ailleurs.
Il avait guetté la factrice pendant quatre jours et ouvert le paquet, fébrile comme une midinette, puis s’était admiré dans la glace du couloir. Il avait mis pantalon, bottes, veste de circonstance et avait tourné autour du chien qui était devenu complètement fou. Ils étaient prêts à partir alors que l’ouverture de la chasse n’était pas avant une quinzaine ! Il avait fini par se déshabiller et renvoyé d’un coup de pied l’animal, le traitant de tous les noms, ironisant sur sa connerie. Dans le ruban du chapeau, il avait glissé des plumes de faisan avec un point de colle. Le soir de l’ouverture de la chasse, les plumes avaient déjà disparu et une tache de colle défigurait l’accessoire indispensable.
Le vaniteux narcissique n’avait pas demandé à son épouse si elle le trouvait beau ! Je le regardai en coin, son ventre était volumineux au-dessus de ses jambes amaigries, sous ses yeux des poches gonflées étaient apparues depuis qu’il avait fait une jaunisse. Son teint gris virait parfois au grenat foncé quand il avait bu, il avait aussi les dents qui s’abîmaient, mais avait eu des démêlés avec ce connard de dentiste, comme il le surnommait chaque fois qu’elles le faisaient souffrir, ne voulant plus y mettre les pieds. Il avait fêté ses cinquante ans avec ses copains de boisson jusqu’au petit matin, je songeai en l’inspectant discrètement qu’il n’avait plus d’âge.





























