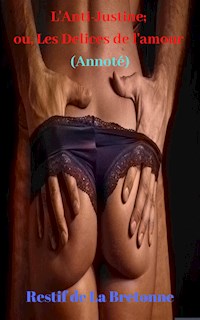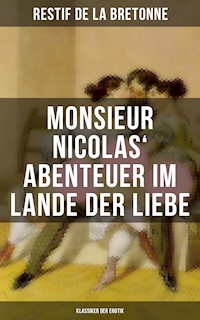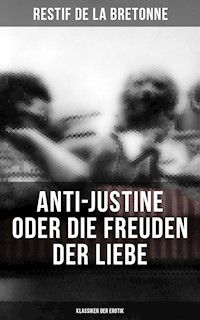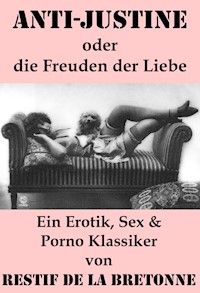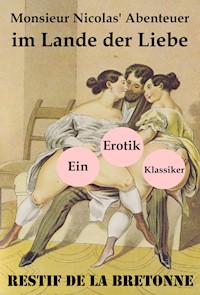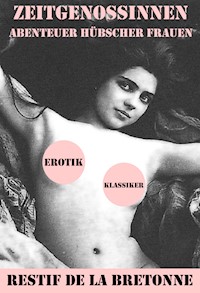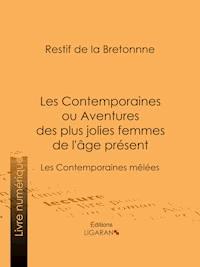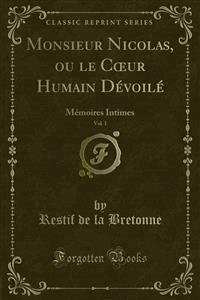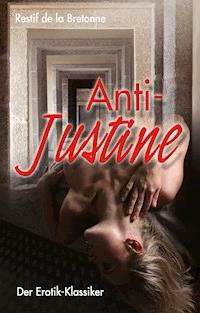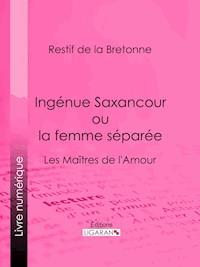
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Ligaran
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"Ingénue Saxancour ou la femme séparée est un roman de Restif de La Bretonne, publié en 1786. Ce livre raconte l'histoire d'une jeune femme, Ingénue, qui est séparée de son mari et doit faire face aux difficultés de la vie seule.
Ingénue est une femme douce et innocente, qui a été mariée à un homme plus âgé qu'elle. Mais leur mariage n'a pas été heureux et ils ont finalement décidé de se séparer. Ingénue se retrouve alors seule, sans argent ni soutien, et doit apprendre à se débrouiller dans un monde qui n'est pas toujours bienveillant envers les femmes.
Le roman de Restif de La Bretonne est un portrait poignant de la condition féminine à l'époque. Ingénue doit faire face à de nombreux obstacles, notamment la pauvreté, la solitude et le mépris de la société envers les femmes divorcées. Mais elle est également une femme forte et déterminée, qui refuse de se laisser abattre par les difficultés.
Ingénue Saxancour ou la femme séparée est un livre qui a marqué son époque par sa vision réaliste et sans concession de la vie des femmes. Restif de La Bretonne y dénonce les injustices et les préjugés qui pèsent sur les femmes, tout en dressant le portrait d'une héroïne courageuse et inspirante. Ce livre est donc un témoignage précieux de l'histoire des femmes et de leur lutte pour l'égalité.
Extrait : ""Je n'ai pas besoin de faire une préface pour indiquer le but moral de ces mémoires : je vais raconter, ingénument, et la leçon résultera de l'exemple que je mettrai sous les yeux. Heureuses mes lectrices, si elles s'instruisent à mes dépens !"""
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Il est impossible d’avoir une connaissance précise de cet être complexe que fut Restif de la Bretonne si l’on n’a pas lu, après cette si curieuse et si pittoresque autobiographie de Monsieur Nicolas, les deux ouvrages portant respectivement les titres suivants :
1° LA FEMME INFIDÈLE, recueil de lettres écrites par Restif à sa femme et à ses maîtresses, ainsi que par sa femme, Agnès Lebègue, et par les amants ou les amis de celle-ci qu’il appelle Mme Jean-de-Vert. C’est un violent réquisitoire contre son épouse infidèle.
2° INGÉNUE SAXANCOUR, ou la Femme Séparée. Histoire propre à démontrer combien il est dangereux pour les filles de se marier par entêtement et avec précipitation, malgré leurs parents. Écrite par elle-même. À Liège, et se trouve à Paris, chez Maradan, libraire, rue des Noyers, n° 33, 1789.
Ce dernier ouvrage fut publié en trois parties, en trois volumes in-12. Le premier comprend 248 pages, y compris les titres et les feuillets préliminaires ; le deuxième, 240 ; et le troisième, 260 pages.
Dans sa « Bibliographie et iconographie de Restif de la Bretonne », le Bibliophile Jacob dit qu’il existe quelques exemplaires portant seulement comme titre : Ingénue Saxancour, avec le nom de Gueffier, imprimeur-libraire, quai des Augustins, n° 17, et la date de 1790 ; mais ce doit être un subterfuge, car l’ouvrage n’a jamais été réimprimé.
Chaque partie contient, au milieu du récit, une pièce de théâtre insérée là de façon très factice ; mais d’ailleurs, d’une manière générale, la composition du roman décèle quelque relâchement, peut-être même un certain embarras. Le sujet en effet ne manque pas d’être délicat.
Ingénue Saxancour est la fille aînée de Restif, Agnès, qui conte minutieusement son existence misérable auprès d’une mère dénaturée, et l’histoire de son pitoyable mariage avec Moresquin ou l’Échiné, le monstre capable de tous les crimes. « Il est très possible, dit le Bibliophile Jacob, que ce livre ait été rédigé par Agnès, qui savait écrire et qui, à l’exemple de sa mère, composait des vers et des pièces de théâtre. »
Agnès Augé – tel fut son nom de malheureuse épouse – devait être dégagée par le divorce, en 1794, de ses liens avec le vil l’Échiné ; et Restif lui-même nous apprend, dans Monsieur Nicolas, qu’elle se remaria avec le citoyen Vignon, à côté de qui elle vécut enfin tranquille.
« Le roman d’Ingénue Saxancour était une satisfaction morale et un plaisir de vengeance que Restif avait voulu se donner ; car l’ouvrage, quoique imprimé, n’eut aucune espèce de publicité et demeura caché dans l’imprimerie de l’auteur. C’est seulement en octobre 1789 que Augé – dit l’Échiné – eut connaissance de cet ouvrage, dans lequel il était mis au pilori ; il dénonça donc son beau-père au district de Saint-Louis-la-Culture, et il l’accusa d’être l’auteur d’Ingénue Saxancour « et autres livres du même genre, ne tendant qu’au bouleversement du royaume, de la cité de chaque individu qu’il ne cesse d’outrager ». Augé n’avait pu se procurer un exemplaire d’Ingénue Saxancour que par l’entremise d’un libraire-colporteur Vieillot, et un exemplaire de la Femme Infidèle que par un abus de confiance. Dans l’interrogatoire de Restif, le commissaire lui demanda s’il était l’auteur d’Ingénue Saxancour. Restif répondit qu’il n’y avait que trois pièces de théâtre auxquelles il eût travaillé dans cet ouvrage, savoir : « Le loup dans la bergerie ; la Matinée du père de famille, et le Réveil d’Épiménide, et que, d’ailleurs, cet ouvrage était imprimé avec approbation. » (Les Nuits de Paris, t. XV, p. 122.)
Cette œuvre étrange, dont de si nombreux lecteurs de Restif réclamaient la publication, est devenue, par suite même des circonstances qui ont motivé son apparition, à peu près introuvable : soit que l’édition ait été détruite en bloc, soit que les exemplaires aient été recherchés systématiquement par les intéressés pour être détruits l’un après l’autre. À ce sujet même Paul Lacroix (Bibliophile Jacob) conte une anecdote curieuse :
« Je me rappelle, dit-il, avoir cherché aussi, mais sans succès, un exemplaire qui m’était indispensable en 1851. J’avais esquissé un roman historique sous le titre d’Ingénue, dont Restif et sa fille Agnès étaient les héros, car il n’y a pas de roman sans héros. Notre charmant et merveilleux conteur Alexandre Dumas s’était chargé d’écrire ce roman, que j’avais mis en scène ; et le roman, grâce à mon illustre collaborateur, faisait les délices des lecteurs du Siècle. La famille Restif de la Bretonne s’émut de ce genre de célébrité qu’un roman, un peu trop véridique, redonnait à son chef et à sa descendance. De là procès en diffamation. Il fallait démontrer que les auteurs n’avaient fait que puiser aux sources ouvertes par Restif lui-même, et le roman d’Ingénue Saxancour aurait suffi pour prouver l’innocence du grand romancier, qui était seul nommé au bas de ses feuilletons. On ne parvint pas à découvrir Ingénue Saxancour ; mais le procès, au moment des plaidoiries, fut arrêté et mis à néant par une bonne transaction. Le Siècle paya le dommage, et il fut convenu qu’Alexandre Dumas, dans la conclusion du roman, ferait amende honorable à Restif et à sa fille Agnès. “Vous l’avez échappé belle, dit-il à la partie adverse : le Bibliophile cherchait un exemplaire d’Ingénue Saxancour, pour le faire réimprimer. – Il ne l’a pas trouvé, et il ne le trouvera pas !” répondit gravement le fils d’Ingénue, en homme sûr de son fait. »
Plus heureux que le Bibliophile, nous avons réussi à nous procurer un exemplaire complet et en parfait état d’Ingénue Saxancour, que nous reproduisons textuellement : ce qui nous permettra de combler une légère lacune dans les collections de la Bibliothèque nationale, laquelle ne possède pas le texte de ce roman, non plus que celui de la Femme Infidèle, que nous lui fournirons un jour prochain.
J.H.
Les lecteurs trouveront à la fin du roman la clef d’Ingénue Saxancour, telle qu’elle a été établie par le Bibliophile Jacob.
Je ne connais pas d’ouvrages qui soient utiles, comme ceux qui présentent les causes du malheur, d’après des évènements réels. Que l’on dise, qu’on répète aux jeunes personnes : Il ne faut pas vous marier malgré vos parents, par caprice, par amourette ! elles ont les oreilles si souvent rebattues de ces lieux communs, que leur vérité ne fait aucune impression. Mais qu’un écrivain courageux, méprisant le gentil, l’agréable, le poli de nos insipides brochures, prenne sur lui de publier une histoire véritable, autant qu’horrible ; qu’il s’expose au non-succès qu’elle ne peut manquer d’avoir, auprès de tous nos lecteurs superficiels, de toutes nos petites maîtresses délicates, c’est une sorte d’héroïsme. Que va-t-on voir en effet dans cet ouvrage ? Une fille imprudente, qui se marie, malgré son père, à un infâme, un homme faux, qui avant le mariage a menti les mœurs et la fortune ; mais qui jamais n’a pu mentir l’esprit, parce que c’est le seul masque que l’hypocrite sot ne puisse prendre ; à un homme qui, après le mariage, laisse voir tous les vices, soumet son épouse infortunée à tous les caprices d’un libertin, à toutes les turpitudes d’un débauché, à toutes les infamies d’un scélérat corrompu, à tous les supplices que peut faire endurer un bourreau ; à un homme qui la contraint de fuir, et qui la poursuit, enragé, après qu’elle s’est dérobée à sa fureur…
On trouvera dans cet ouvrage ce qu’on nomme dans le monde des horreurs ; j’en conviens, mais je sens qu’il faut qu’elles s’y trouvent, pour que le livre soit profitable aux filles qui se marient malgré leurs parents, et surtout en bravant l’autorité sacrée d’un père éclairé. Je me rappelle que, lors de la publication de la Femme infidèle, une grande dame se plaignit, en disant qu’on ne devait pas publier de pareilles atrocités ! Ah ! l’atrocité, c’est qu’une fille se marie, malgré son père, à un homme vil qu’il a pénétré. Au reste, cette dame peut se dispenser de lire la Femme séparée, où les horreurs sont ingénument racontées. Elles étaient voilées dans la IVe partie de la Femme infidèle ; ici, elles sont à nu, et le monstre paraît aussi hideux, en récit, qu’il l’est dans la nature. Mais de pareils ouvrages ne sont utiles qu’autant qu’ils font horreur. Et, je l’avoue, j’ai frémi, en lisant, dans ces mémoires, des traits véridiques, écrits ingénument, sans être affaiblis, égayés, enjolivés, déshorribilisés (comme diraient les Anglais), par une jeune femme, qui peint ce qu’elle a senti, souffert, jusqu’au désespoir. J’avoue cependant que j’ai été charmé, que pour reposer l’esprit et calmer des idées terribles, elle nous ait donné, par intervalles, des pièces épisodiques, qui sont tantôt des jeux enfantins, comme le Loup dans la bergerie ; tantôt des idées saines sur les arts et la chasse, comme dans la Matinée du Père de famille ; tantôt un tableau de la jeunesse d’un homme de mérite, comme l’Ode et la Lettre de Piron, sur les Beaunois ; tantôt, enfin, des idées graves et intéressantes, comme celles qui entrent dans l’Épiménide. Si jamais ouvrage eut besoin d’épisodes, c’est celui-ci. Non seulement ils n’y sont pas un défaut, mais ils y étaient absolument nécessaires.
Le mariage d’Ingénue Saxancour, malgré son père, est un de ces traits fréquents dans la société, que la fausse morale de certaines pièces de théâtre rend encore plus familiers. Mais qu’ici les suites en sont terribles ! À quelles affreuses extrémités l’infortunée Saxancour n’est-elle pas sans cesse réduite ! Si elle fut coupable, qu’elle est punie !… Lisez, jeunes filles, et tremblez !
Je n’ai pas besoin de faire une préface pour indiquer le but moral de ces mémoires : je vais raconter, ingénument, et la leçon résultera de l’exemple que je mettrai sous les yeux. Heureuses mes lectrices, si elles s’instruisent à mes dépens !
Je suis née dans une ville de Bourgogne, et j’ai été nourrie dans un village de la province de Champagne, où demeurait mon aïeul maternel. Ce respectable vieillard me chérissait, parce que j’étais fille du premier de ses fils marié ; il avait déjà beaucoup de petits-enfants, mais j’étais la seule qui portait le nom de Saxancour. Je fus le charme de sa vieillesse. Mais je ne jouis pas longtemps de ce bon protecteur ; il mourut que je n’avais pas encore quatre ans. Je restai avec ma grand-mère, excellente femme, mais plongée dans la douleur. Elle m’aimait beaucoup : cependant je ne fus plus autant considérée ; je ne fus plus qu’une enfant ; auparavant j’étais l’idole du maître et de toute la maison. Telle fut la première perte que je fis, avant l’âge de la sentir.
Quelques mois après la mort de mon aïeul, mon père, qui demeurait à Paris, vint chez sa mère, pour la consoler et pour arranger les affaires de la succession avec ses frères et sœurs. J’étais endormie, sur les sept heures du soir, au mois de mars, lorsqu’il arriva. Mon aïeule, qui me regardait comme la plus belle des enfants, lui fit signe de ne pas faire de bruit et, le prenant par la main, elle le conduisit auprès de ma couchette. Elle entrouvrit mes rideaux et lui montra une fille forte, vigoureuse, ayant les plus belles couleurs et des paupières dont les cils descendaient jusqu’au milieu des joues. Mon père m’a depuis cent fois assuré que son cœur palpita de plaisir, et qu’il n’avait jamais vu de si belle enfant. Ce moment décida pour jamais dans son cœur l’attachement le plus tendre pour sa fille : il ne rêva que moi toute la nuit, et le lendemain, à mon réveil, il accourut pour m’embrasser. J’étais un peu sauvage ; cependant, ma bonne maman ne m’eût pas plutôt dit que c’était mon papa, que je lui souris, en disant : « Bon, bon, il n’est plus allé dans la procession, porté par les hommes ! » Et je regardais mon père, cherchant en lui mon aïeul. Beaucoup de traits de ressemblance facilitèrent l’illusion, et ma grand-mère, s’apercevant de ce qui se passait en moi, fondit en larmes. Elle se jeta dans les bras de son fils en lui disant : « La pauvre petite, la ressemblance du père et du fils l’a trompée ! Elle te croit ton père, mon cher fils ! »
Pendant son séjour chez mon aïeule, mon père, dans les intervalles des affaires, trouvait avec moi une satisfaction infinie ; à peine il pouvait me quitter ; il ne faisait pas une promenade que je n’en fusse, et il me portait lorsque j’étais lasse. Ce fut ce qui amena un accident, que je me rappelle avec autant de clarté que si j’avais eu quinze ans.
On était aux fêtes de Pâques. Il y avait dans un vaste enclos, au midi de la maison, une espèce de four détruit, sur lequel croissait de l’herbe ; au bas était une fontaine. Mon père se mouilla en la traversant, et voulut monter sur le four, en me tenant dans ses bras. Il glissa et, de peur de me blesser, il me laissa échapper. Il se coupa une grosse veine de la jambe, et moi je roulai dans le bassin. Il s’élance vers moi et se jette dans l’eau, m’en retire, et s’évanouit en voyant son sang. Ce fut un bonheur ! car le sang ayant cessé de couler aussitôt, il en perdit peu, et on eut le temps d’aller chercher le chirurgien, qui mit une compresse comme sur une saignée, et tout fut assuré. Cet accident me rendit encore plus chère à mon père ; il fit mettre ma couchette à côté de son lit, et il ne voulait pas qu’on m’éloignât un instant de sa vue.
Cependant il partit peu de jours après et me laissa chez ma grand-mère jusqu’au mois de novembre suivant, que ma mère vint la voir et faire ses couches. Elle accoucha de ma sœur cadette, et lorsqu’elle fut remise, elle la laissa en nourrice auprès de mon aïeule et m’emmena.
Je n’arrivai à Paris qu’au mois de janvier 1765, parce que nous nous arrêtâmes quelque temps chez une cousine de ma mère, dans une ville de Bourgogne. On s’aperçut dès lors que je n’en serais pas aimée. J’ai longtemps attribué sa rigueur aux petits défauts que pouvait m’avoir fait contracter l’excessive tendresse de mon aïeul et de mon père ; et plût à Dieu que je ne me fusse pas trompée !… La parente chez laquelle était ma mère prenait toujours mon parti : les deux cousines se brouillèrent et se quittèrent fâchées, ce qui ne devait pas augmenter l’attachement de ma mère pour moi.
À notre arrivée à Paris, mon père parut transporté de me revoir. Ma mère lui dit assez aigrement : « Gâtez-la, afin que je ne puisse plus en venir à bout ! » Il fallut qu’il se contraignît, et depuis ce fatal moment, jusqu’à celui de mon malheureux mariage, ce père tendre n’a jamais eu la liberté de m’exprimer ses sentiments.
Je justifiai malheureusement la haine de ma mère par un caractère impatient et pleureur. Je ne pouvais souffrir la contradiction. Accoutumée à être prévenue en tout, j’aurais voulu qu’on devinât tous mes besoins, sans me donner la peine de les exprimer. Je pleurais si, lorsqu’on m’avait versé un peu de vin, on n’y mettait pas sur-le-champ de l’eau, parce que j’avais ouï dire à mon grand-père qu’un enfant ne devait jamais boire de vin pur. Je pleurais si l’on ne me servait pas à table, immédiatement après la soupe. C’en fut assez pour donner des motifs à la haine de ma mère et motiver des corrections multipliées. Mais ces bagatelles ne durèrent que jusqu’au développement de la raison. À huit ou neuf ans, tout cela était disparu. Mais on sent que je ne pouvais être parfaite : l’excès de crainte, l’absence de la confiance, rendent les enfants menteurs, à cet âge où l’on commence à les traiter avec beaucoup de sévérité, sous prétexte qu’ils savent ce qu’ils font.
Je ne veux rien cacher dans ces mémoires, qui peuvent être utiles, non aux enfants qui ne lisent pas encore, mais aux mères qui ont une véritable envie d’être bonnes, quoique leur caractère, leur tempérament et les circonstances semblent s’y opposer.
Je n’avais que cinq ans et demi lorsque ma mère jugea à propos d’avoir un pensionnaire. Un avis que j’ai à donner ici à toutes les femmes qui veulent rester honnêtes, c’est de ne jamais prendre de pensionnaires, à cause de la familiarité qui en résulte. Celui qu’eut ma mère était un marchand de mousselines des environs de Mâcon, venu à Paris, depuis quelques mois, pour un procès avec la Ferme générale. Tout ce que je vais raconter à cette occasion est singulier, la manière dont se fit la connaissance et ses suites.
Il y avait environ six mois que j’étais à Paris, lorsqu’un soir, à la chute du jour, je vis arriver chez nous, conduite par mon père, une grande fille qui me parut très jolie. Elle salua ma mère du nom de sœur, et on m’ordonna de l’appeler ma tante. On lui mit un lit de sangle au milieu de la chambre, et elle s’y coucha. Pour moi, j’étais dans une petite antichambre sous une soupente. Le lendemain, on ôtait le lit, et on le remettait le soir. Cette grande fille fut bientôt prise en amitié par ma mère, et j’ai su depuis ce que signifiait tout cela.
Ma mère, dans sa jeunesse, avait l’espérance d’être un bon parti : ses parents avaient de la fortune, et elle était fille unique. Dans ce temps de prospérité, elle était voisine d’un gros marchand, qui avait un fils d’un blond roux. Ce fils, que ma mère, jeune encore (elle avait douze ans), détestait de tout son cœur, avait pour elle un goût si marqué, qu’il dégénérait en passion ; on fut obligé de le surveiller, à cause d’un attentat qu’il se permit. On l’éloigna bientôt, et monsieur Leroux vint à Paris, où il fit son chemin. Mais pendant ce temps-là, bien des choses défavorables arrivaient à ma mère. Ses parents dissipèrent leur bien et lui donnèrent une sœur. Ma mère, que toutes les riches voisines nommaient à l’envi leur bru, ne fut plus regardée de personne ; sa mère quitta le quartier, pour se retirer dans une maison à elle, et tout le passé ne fut plus qu’un beau rêve. Mon père se présenta, fut écouté, épousa ; on partit pour Paris, et là, en traversant un jour la rue de la Verrerie, ma mère fut aperçue de monsieur Leroux, magnifiquement logé dans cette même rue. Comme il vit ma mère avec un homme, il ne voulut pas se montrer ; mais il la fit suivre par son domestique, avec ordre de ne pas la perdre de vue, qu’elle ne fût rentrée dans sa demeure. Il fut bien servi. Le même soir, monsieur Leroux vint s’informer lui-même de ce que ma mère faisait à Paris. Il apprit qu’elle était mariée, et très mesquinement meublée ; qu’elle venait de rentrer avec son mari ; que celui-ci sortait dès le matin pour aller à ses occupations, revenait à midi pour dîner, et ne reparaissait que le soir.
Monsieur Leroux s’arrangea d’après ces informations, et revint le lendemain, sur les quatre heures après-midi. Ma mère s’occupait d’un travail en modes. Elle entend frapper, et comme elle ne connaissait encore à Paris que quelques pratiques, elle court ouvrir. Sa surprise fut extrême en voyant monsieur Leroux. Elle fut tentée de refermer la porte, mais il ne lui en laissa pas le temps : il se précipita dans la chambre, qui n’avait que les quatre murs, une commode de noyer, une mauvaise table, quelques chaises, et un fort mauvais lit. « Quoi ! lui dit-il, c’est là le sort de mademoiselle Balbin ! d’une fille que j’adorais, et qui eût été mon épouse, si j’avais su qu’elle avait envie de se marier ! » Ce compliment de commisération fut suivi, à ce que nous a souvent dit ma mère, des entreprises les plus vives et les plus avilissantes. Elle assure qu’elle ne voulut pas crier, de peur de scandaliser deux voisines, dont la petite chambre n’était séparée de la nôtre que par une cloison, mais qu’elle se défendit si vigoureusement, que l’ennemi se consuma en de vains efforts ; il sortit non vainqueur.
Cependant il ne se découragea pas, et revint souvent à la charge : la passion que ma mère lui inspirait était insurmontable ; ses mépris, les rebuffades, les marques de dégoût, rien ne le rebutait ; il alla même un jour, dit-on, jusqu’à lui rendre plusieurs coups de poing et de pied, pour un soufflet qu’elle lui avait appliqué. Mais ensuite il lui demanda mille pardons. Ce fut depuis cette dernière scène qu’elle lui ferma soigneusement sa porte ; elle changea même de demeure exprès, à cause de lui, et elle eut soin qu’il ne sût pas sa nouvelle demeure.
Ma mère n’était pas intéressée, non par vertu, il faut le dire, mais par une espèce d’inconséquence de caractère ; elle aimait cependant l’argent. Mais monsieur Leroux lui déplaisait et la dégoûtait au point que des offres assez brillantes, quoiqu’il fût avare, ne purent jamais surmonter son éloignement. Il faut convenir aussi qu’elle aimait alors un Anglais à la folie, et que ma mère eut toujours de grandes préférences à la sensibilité.
Quoi qu’il en soit, elle fut trois ans sans que monsieur Leroux pût la retrouver. Elle ne le revit qu’en 1765, après un second changement de domicile. Comme sa croisée donnait alors sur une grande rue, monsieur Leroux l’aperçut et monta chez nous. J’étais avec elle depuis six mois, et ma mère se trouvait à peine rétablie des suites d’une couche dangereuse, qui avait donné naissance à ma sœur cadette, cette aimable amie que je chérirai jusqu’au tombeau : elle était pâle, défaite, mal arrangée. Monsieur Leroux lui fit pourtant quelques compliments, et lui demanda si elle était veuve. Sur sa réponse que son mari se portait bien, il lui dit : « Si vous aviez été veuve, je vous aurais fait une proposition de venir chez moi gouverner ma maison ; vous seriez en même temps l’institutrice d’une fille unique que j’ai de mon mariage avec une demoiselle qui s’en est retournée à Orléans, dans sa famille, parce qu’elle ne peut me souffrir ; mais comme vous n’êtes pas veuve, cela ne se peut guère. – Cela ne se peut certainement pas ! dit ma mère. – Je m’en doutais. En ce cas, je voudrais quelqu’un de votre main : ne pourriez-vous pas me trouver une jolie fille, que j’aimerais cependant moins que vous, pour remplacer absolument ma femme ? C’est vous dire que je ne voudrais pas qu’elle fût bégueule ? – Je ne vous entends pas, répondit ma mère. » Monsieur Leroux s’expliqua si clairement, que ma mère se fâcha. Mais monsieur Leroux n’en fit que rire. Il sortit en répétant qu’il espérait qu’elle ferait sa commission.
Le soir, lorsque mon père fut arrivé, ma mère lui parla de la visite de monsieur Leroux et de la commission qu’il avait voulu lui donner. « Cet homme est un impudent, répondit mon père, qui mériterait bien qu’on le servît comme il le mérite. Quel âge a sa fille ? – Tout au plus deux ans. – En ce cas, il n’y a pas de danger. Je sais ce qu’il faut faire : nous le punirons, et nous ferons une bonne action. Je connais ici une nouvelle convertie, que des malintentionnés ont perdue. Elle a eu le malheur de donner dans le désordre, après avoir été abandonnée par son séducteur. Son frère est chanoine régulier de Sainte-Geneviève ; il est au désespoir de l’égarement de sa sœur, qui le fuit, et que le hasard m’a fait rencontrer. Je lui parlerai de la place qu’offre monsieur Leroux ; je la lui ferai envisager comme un moyen de quitter le désordre et de se réconcilier avec son frère ; c’est un degré vers le bien que nous ferons monter à cette infortunée, et Leroux ne corrompra pas une âme innocente. » Ma mère approuva fort ce parti, et depuis ce moment elle pressa mon père d’exécuter ce qu’il avait indiqué. Il le fit, et parvint à décider la jeune Sara, qui goûta ses raisons. Il fut convenu qu’elle resterait quelques semaines chez nous, pour reprendre l’air posé, avant d’être présentée à monsieur Leroux. Ce fut cette grande jolie fille que je vis entrer chez nous, et qu’on me fit nommer ma tante, parce que ma mère imagina de la faire passer pour une sœur de mon père.
Sara n’eut pas été huit jours dans la maison, qu’elle prit un air si décent, si aimable, qu’elle fut chérie de tous les voisins, de la maîtresse d’école, notre vis-à-vis, et de sa nièce, très jolie fille, de notre hôte, de sa femme, de ses quatre filles, et surtout de son fils, jeune architecte qui commençait à se distinguer. Ma mère en était enchantée. Elle disait souvent : « Il sera bien attrapé ! Il ne se doutera pas du tour que je lui ai joué ! » Tout le monde du voisinage croyait qu’effectivement Sara était ma tante : c’est principalement ce qui la faisait considérer de notre propriétaire, qui connaissait de réputation l’honnête famille de mon père. Et comme Sara était très jolie, que son fils l’architecte en était très amoureux, il vint plusieurs fois pressentir ma mère et l’interroger sur ce que ma tante pourrait avoir en mariage. Madame Saxancour, qui craignait infiniment que cette recherche ne devînt sérieuse, répondait tantôt que la sœur de son mari n’avait rien à prétendre ; tantôt qu’elle était absolument éloignée du mariage, pour lequel elle avait une sorte d’horreur. Enfin, voyant que rien ne le rebutait, elle alla jusqu’à faire entendre que sa belle-sœur avait fait une inclination ; que cet homme l’avait trompée cruellement, et que son voyage à Paris n’avait été occasionné que par la nécessité de cacher les suites de sa faiblesse. Cet aveu prétendu refroidit le père et la mère de l’architecte ; mais le fils éperdument amoureux, et qui voyait la modestie de Sara, ne se rebuta point du tout : il alla jusqu’à dire que la vertu de sa maîtresse n’en serait que plus assurée ; et comme c’était un garçon d’esprit, respecté à ce titre de son père et de sa mère, qui n’en avaient guère, il l’emporta.
Ma mère se voyait d’autant plus embarrassée qu’elle ne pouvait présenter Sara chez monsieur Leroux, qui était à Orléans, et dont il fallait attendre le retour. Elle était continuellement aux aguets, pour empêcher qu’on ne parlât en particulier à ma prétendue tante, parce qu’elle ne doutait pas que, se voyant recherchée par un parti avantageux, elle n’y donnât quelque attention. Mais elle fut bientôt rassurée : Sara, comme toutes les filles qui ont donné dans le libertinage, aimait les beaux hommes, et l’architecte était un petit crapaudin fort laid ; dans une occasion où il était question de lui, elle témoigna fort énergiquement qu’elle ne s’en soucierait pas. Ma mère, qui se crut sûre alors, ne la surveilla plus, et l’architecte eut toute liberté de parler.
Il le fit sans doute, et tout laid qu’il était, comme il avait beaucoup d’esprit, il eut l’air de faire entendre la voix de la raison. Mais Sara, depuis qu’elle s’était expliquée avec ma mère, avait compris les motifs de son embarras, qui n’était autre que la découverte de la fausse parenté, peut-être même celle de l’état malheureux d’où mon père l’avait tirée, etc. Elle enflamma son amant avec une adresse dont certaines femmes ont le secret par des demi-faveurs, par des demi-rigueurs, enfin par tout l’art dont est capable une femme qui a de l’usage. Quand elle le vit bien épris, elle feignit, un jour que ma mère était sortie, une tristesse profonde, des larmes coulèrent de ses yeux. L’amant, transporté, demanda par mille instances l’aveu des causes de la douleur qu’il voyait. « Hélas ! répondit Sara, je n’en ai pas d’autres que le malheur de ne pouvoir vous appartenir. Vous avez touché mon cœur, mais vous avez cru parler à la sœur de monsieur Saxancour ; je ne la suis pas : je suis une nouvelle convertie de Genève ; j’ai un frère génovéfain, ami de monsieur Saxancour, qui m’a prise chez lui, quoiqu’il soit peu riche, et m’a nommée sa sœur par amitié pour mon frère. – Eh ! que me fait cela, s’écria l’architecte ; c’est vous, c’est la belle Sara, et non la sœur de monsieur Saxancour, que j’aime, que j’adore. – En ce cas, mon cher ami, reprit Sara, dissimulez avec vos parents, qui estiment beaucoup la famille de monsieur Saxancour, et tâchons qu’ils ne soient détrompés que le jour, ou jamais, s’il était possible. Le père de monsieur Saxancour est mort ; il ne viendra pas ici ; vous donnerez les bans vous-même au curé ; quant au contrat, pourquoi en faire un ? Je ne vous apporterai pas une obole, et je ne demande pas que vous m’avantagiez au-delà de la coutume ? Vous ferez votre maison avec moi, puisque vous commencez et que vous êtes jeune ; j’aurai ma moitié, cela me suffira. » Ce raisonnement plut au jeune architecte. Il promit à Sara de se conformer à tout ce qu’elle prescrirait et de hâter leur union.
Il y avait à Paris, dans un hôtel garni, au coin de la rue de la Huchette, un marchand de mousselines, le même dont j’ai dit un mot, qui avait connu Sara dans le désordre et qui en avait toujours bien usé avec elle. C’était le seul homme que Sara vît secrètement, depuis qu’elle était chez nous. Elle le consulta, et cet homme, naturellement hardi, comme tous les gens bornés, lui promit de faciliter son mariage en passant pour son oncle. Sara n’avait pas acquis de la délicatesse dans l’état dont mon père l’avait tirée ; elle y consentit.
De retour chez nous, elle sentit qu’il fallait parler à ma mère de son oncle prétendu ; elle fit cette confidence avec beaucoup d’adresse : « Ma chère sœur, dit-elle en entrant, vous me voyez encore tout émue. Je viens de faire une rencontre bien extraordinaire. C’est un oncle à moi, frère de ma mère, qui m’a reconnue tout d’un coup, encore qu’il y ait dix ans qu’il ne m’ait vue. Il m’aimait beaucoup dans mon enfance, et il s’est attendri ; j’ai pleuré aussi. On lui avait parlé de moi fort en mal. Je l’ai assuré que j’avais toujours été, depuis trois ans, chez les plus honnêtes gens du monde, soit à la campagne, soit chez vous. Quand vous le verrez, ma bonne amie, il faudra le persuader. »
Ma mère crut tout cela sans hésiter. Mais curieuse de connaître l’oncle, dès le lendemain elle sortit avec Sara, et quand elles furent vis-à-vis l’hôtel garni, elle lui dit : « Si nous montions chez ton oncle ? » Sara ne parut aucunement embarrassée, quoiqu’elle ne l’eût pas prévenu ; elle monta rapidement un escalier obscur, en disant : « Ah ! que vous allez lui faire de plaisir ! Voyons, voyons s’il y est. » Ma mère ne pouvait la suivre aussi vite qu’elle montait. « Mon ami, dit Sara au marchand, tu passes pour mon oncle maternel ; tu m’as trouvée hier, au bout de dix ans, et tu m’as reconnue. » En achevant ces mots, elle revint sur le palier, pour montrer la porte à ma mère. Celle-ci arrivait en ce moment. Elle entra chez le marchand, qui lui parut un honnête homme. C’était un de ces petits Bourguignons à cheveux crépus, à trogne rouge, au parler bonasse, marquant dans tous leurs discours et dans toutes leurs manières une bonté native. Pour ma mère, elle était parfaitement rétablie, et ce jour-là elle avait une robe de gros-de-tours, sa plus belle, et qui lui allait à merveille : elle plut, elle charma, elle enchanta le petit marchand crépu, qui de ce moment n’eut des yeux que pour elle.
Ma mère n’était pas femme à ignorer sa victoire : elle la sentit dans toute sa plénitude ; et comme son Anglais n’était plus à Paris, que d’ailleurs cette passion était usée, elle résolut d’en recommencer une nouvelle. Le marchand retint les deux amies à dîner : la connaissance s’ébaucha, et avant de sortir de table la déclaration d’amour était faite.
Sara ne fut pas fâchée de cet incident : elle entrevit qu’il pourrait être très favorable à son mariage avec l’architecte, c’est pourquoi elle crut plus court de tout dire à ma mère, devant le marchand, pour ne pas avoir la peine d’intriguer, au risque d’échouer. Ma mère hésitait à donner son approbation : « Un hôte, disait-elle ; des gens qui connaissent la famille de mon mari ! » Le marchand leva la difficulté en proposant de louer sur-le-champ un autre logement pour ma mère, de se mettre en pension chez nous, et par ce moyen de perdre absolument de vue les parents de l’architecte. Il fut en même temps convenu qu’aussitôt après le mariage fait, Sara découvrirait sa non-parenté, et qu’elle disculperait entièrement ma mère, disant qu’on ne s’était appelées sœurs que pour avoir une place avantageuse, sans information ni répondants.
Tout cela ne valait pas grand-chose ; mais ma mère le trouva bon. Le marchand loua, rue de la Harpe, à l’ancien Collège de Justice ; on donna congé. Pendant ce temps-là, le jeune architecte agissait vivement : les bans furent publiés, et l’on alla aux pieds des autels sans que ses parents fussent détrompés. L’appartement que quittait ma mère fut destiné pour les nouveaux époux, et l’on avait eu l’art de persuader aux parents que c’était par complaisance pour eux que nous quittions une maison où nous étions si bien.
Mais tandis qu’on était à l’autel, et que la bénédiction commençait, le père de l’architecte voyait rédiger les actes, et au lieu de Sara Saxancour, il vit écrire Sara Krammer. Surpris, il demanda une explication. On lui montra les bans. Il courut auprès des mariés. Le oui se prononçait, et son opposition ne put le précéder. Cependant il s’approcha de son fils : « Il y a de l’intrigue ici, lui dit-il ; nous sommes trompés ! – Non, mon père, répondit gravement l’architecte ; je sais tout ; je devais vous le révéler à l’instant, si vous ne l’aviez pas vu. Ainsi, point d’inquiétude. Je suis prudent et sage. » Ce discours calma le père, qui avait une confiance aveugle dans son fils, depuis que celui-ci avait encouru la disgrâce du Gouvernement par la critique imprimée d’un monument public. Il le regardait comme un grand homme persécuté. Il approuva ce qui était fait et signa les actes.
Ce fut ainsi que se termina le mariage de ma prétendue tante. Heureusement pour elle ! car l’ayant fait savoir le même jour à son frère le génovéfain, à qui l’on n’avait pas voulu en parler, non plus qu’à mon père, le premier fulmina imprudemment, et parla de ma mère en termes peu mesurés. Ses discours indiquèrent l’état qu’avait quitté Sara ; le mari s’informa, et n’apprit que trop facilement une affreuse vérité. Mais telle était la passion de cet homme, qu’au retour de ses informations, il dit à son épouse : « Je sais ce que vous avez été ; mais vous ne me connaissiez pas ; je ne vous rendrai responsable que de ce que vous ferez me connaissant. Tâchons que mes parents ignorent ce qu’ils ne doivent jamais savoir. » Sara, pénétrée, jura une sagesse à toute épreuve, et elle tint parole.
Cependant ma mère et son pensionnaire étaient dans leur nouvel appartement, rue de la Harpe. J’avais cinq à six ans ; j’étais toujours là, n’y ayant que trois petites pièces, dont mon père en avait une pour coucher. Il était absent tout le jour pour ses affaires, et moi je jouais dans sa chambre, d’où je passais souvent dans les deux autres ; mais d’un air d’inattention qui ne donnait pas d’ombrage. J’entendais tout néanmoins, et le tutoiement particulier entre ma mère et Mulino (c’est le nom du marchand) m’étonna d’autant plus que, devant mon père, ils se parlaient avec beaucoup de réserve et de cérémonie. Je crus que c’était l’usage de se parler ainsi en particulier, et un jour que j’étais seule avec Mulino, je lui dis, en copiant l’air que j’avais si souvent remarqué : « Tiens, Mulino, porte cela dans l’antichambre avec mes joujoux. » Ce n’était pas encore l’usage, comme aujourd’hui, que les enfants tutoyassent tout le monde et bravassent dans la forme toutes les lois de la nature et de la politesse. Ce tutoiement surprit extrêmement Mulino, qui ne manqua pas d’en parler à ma mère à son retour. Madame Saxancour en sentit les conséquences ; elle me gronda, et depuis ce moment, elle s’observa devant moi. On n’aime pas ce qui gêne : cette bagatelle fortifia l’antipathie que ma mère avait prise contre moi, et qui m’a été si funeste. Mais bientôt d’autres causes vont l’augmenter encore.
Le pensionnaire de ma mère, au bout de huit mois, s’ennuya de son inutilité. Il fit venir des mousselines de Mâcon, où son frère tenait le magasin : il était encouragé par le talent que ma mère se vantait d’avoir pour le débit. Ses marchandises arrivèrent, mais ma mère ne montra pas son talent sublime, car on ne vendit presque rien. Mulino crut que c’était plutôt la faute de la capitale, que celle de sa méritante hôtesse ; il avait un cheval et une voiture ; il prit un assortiment de mousselines, et partit avec ma mère pour la Picardie et l’Artois. Mon père resta seul à Paris avec moi. Mais comme il ne pouvait me garder avec lui, attendu son absence de la maison du matin jusqu’au soir, ma mère me mit en pension chez une commère, qui avait tenu sa troisième fille, Babiche, la même qui eut l’épine du dos cassée en nourrice, et qui est morte depuis en langueur. Cette demoiselle, qui était infiniment aimable, et qui avait alors la perspective d’un mariage très avantageux, me prit en amitié de la manière la plus vive : je devins son bijou, son idole. Je n’avais jamais été si heureuse, si ce n’est avec ma grand-mère ; mais trop enfant alors, je ne l’avais pas senti ; au lieu que j’atteins ma septième année. Mon père aimait beaucoup cette commère, qui avait pour lui la plus grande estime. Quant à ma mère, la demoiselle la connaissait ; aussi n’en était-elle pas folle. Je restai chez mademoiselle Désirée pendant tout le temps de l’absence de ma mère, c’est-à-dire environ quatre à cinq mois. Ce temps suffit pour m’attacher infiniment à une fille aussi aimable, dont le charmant sourire, les caresses, les attentions, le goût à me parer ne pouvaient manquer leur effet sur un cœur déjà sensible.
J’avais passé l’hiver avec mademoiselle Désirée, et nous étions au printemps ; ma septième année venait de s’accomplir, quand ma mère arriva. Jamais retour ne fut plus triste : le marchand était malade ; ma mère était devenue noire et grosse comme une tonne ; tous deux étaient de mauvaise humeur. Mon père, à son arrivée le soir, la partagea. En un mot, je puis dire que jamais réunion ne se fit sous de plus mauvais auspices. Je retournai coucher chez mademoiselle Désirée, où ma mère me laissa encore deux ou trois jours. Enfin elle vint me chercher.
J’étais à déjeuner, lorsqu’elle entra. Elle avait toujours extrêmement considéré mademoiselle Désirée, qui lui avait rendu de grands services dans le commencement de son séjour à Paris, de sorte que cette jeune personne, habituée à la considération qu’elle avait coutume de lui marquer, la reçut avec beaucoup d’aisance. Ma mère cependant avait de l’humeur et la déguisait assez difficilement. Elle me dit qu’elle allait m’emmener, et me demanda si je ne serais pas bien aise de revenir avec elle. J’étais trop franche pour ne pas répondre la vérité. Je dis que j’aimais mieux rester avec ma bonne amie. Ma mère s’enflamma ; elle s’écria que j’étais sans naturel. Mademoiselle Désirée observa qu’on ne pouvait guère en juger à l’âge que j’avais ; qu’il était naturel, au contraire, que je m’attachasse aux personnes qui me faisaient amitié. Elle offrit en même temps de me garder, en disant à ma mère : « Faites-moi le plaisir de me la laisser jusqu’à ce que vous soyez bien solidement arrêtée à Paris ; vous pouvez voyager encore. » Ces mots, dits bonnement, furent mal interprétés. Ma mère répondit durement qu’elle ne voulait pas que des étrangers s’emparassent de l’affection de ses enfants ; que c’était elle qui avait eu la peine de les faire, et qu’elle les voulait avoir. Elle me prit en même temps si rudement par la main, qu’elle me fit pleurer. Transportée de colère, elle me donna le fouet. Ma bonne amie se mit à pleurer, en lui disant qu’elle était bien cruelle. Ce mot offensa une femme qui ne cherchait qu’à rompre ; elle me prit dans ses bras, malgré mes cris, et me descendit dans la rue, où elle me souffleta jusqu’à ce que je me tusse. Ce fut ainsi qu’elle m’emmena de chez sa meilleure amie, de chez une commère qui l’avait obligée de sa bourse, et qui lui avait sauvé la vie dans une couche par ses soins et ses secours !
Depuis ce moment, je fus détestée de ma mère ; mais elle voulut me garder auprès d’elle, sans doute pour avoir le plaisir de me tourmenter ; car il est impossible d’imaginer tout ce qu’elle me fit souffrir : coups, pénitences, privation de manger, rapports à mon père, à qui elle voulait me rendre odieuse, tout fut employé. Heureusement pour moi qu’il ne fut pas la dupe des dispositions de ma mère à mon égard, et qu’il tâcha de m’en dédommager.
Je passe une foule de petits évènements. Mon père, en 1767, alla chez ma grand-mère et y resta quatre mois. Nous demeurions alors rue Traînée-Saint-Eustache ; car ma mère et Mulino avaient le goût du changement de demeure. Mon père arriva le 1er octobre. Ma mère le reçut fort mal. Cependant il accompagna le ménage ambulant dans la rue Quincampoix, où il alla demeurer le 15 octobre. Ce fut dans cette demeure, la quatrième depuis mon séjour à Paris, que j’éprouvai les plus cruelles secousses ; je faillis perdre la vie.
Ma mère était enceinte, et d’une humeur qui approchait de la frénésie, surtout après le départ de Mulino, qui alla passer environ six mois à Mâcon. Pendant tout l’hiver, ma mère fut couverte de boutons : cependant elle me faisait coucher avec elle, l’oserai-je dire ?… parce qu’une femme de perruquier, sa voisine, lui avait fait entendre que je prendrais toute l’humeur, et que je l’en délivrerais… Je ne sais si je l’en délivrai ; mais au bout de quelques semaines je fus précisément comme elle : la démangeaison était alors insupportable, et j’en souffrais cruellement, surtout pendant la nuit. Une entre autres, au mois de mars, ma mère fut si impatientée de ce que je l’empêchais de dormir, qu’elle me frappait à chaque mouvement, avec une baguette qu’elle avait à côté d’elle. J’étais alors à terre sur un matelas. Je ne pus m’empêcher de pleurer. Mon père, qui couchait seul dans une petite chambre, m’entendit et se mit en colère contre ma mère, qu’il traita fort mal de paroles. Elle devint furieuse : elle bouda le lendemain, le surlendemain, pendant longtemps ! Mon père, qui ne la connaissait que trop, parut s’en embarrasser très peu, et il songea sérieusement à m’ôter d’auprès d’elle.
Ce fut ce qu’il exécuta au moyen d’un ami, avec lequel il était en relation d’affaires. On fit consentir ma mère à me mettre en pension chez une dame Manigre pour me traiter de mes boutons. Le traitement fut court : dès que j’eus pris le bon air, au haut de la Montagne Sainte-Geneviève, et quelques bains, les boutons disparurent. Je demeurai six mois dans cette maison, c’est-à-dire tout l’été de 1768.
Madame Manigre avait deux filles : l’une (c’était l’aînée) était laide comme sa mère ; l’autre était charmante. Il y avait des Anglais logés aux environs. Un d’eux, fort riche, et qu’on traitait de mylord, devint amoureux d’Isabelle Manigre, et parvint à lui faire connaître ses sentiments avant que personne s’en aperçût dans la maison. C’était moi qu’elle menait avec elle, lorsqu’elle se glissait chez lui ; le prétexte était de me mener promener. On me donnait des bonbons et des joujoux, un chien, un jeune chat, et je ne voyais rien. J’aimais Isabelle de tout mon cœur ; aussi lui restai-je fidèle, et jamais je ne dis un mot de ce qu’elle m’avait défendu de dire ; je n’en sentais pas la conséquence. J’étais alors parfaitement guérie. C’était mon père qui payait ma pension, ainsi ma mère ne se pressait pas de me retirer. Elle essuya d’ailleurs des suites de couches très fâcheuses ; car elle avait eu deux jumeaux, mais d’une santé si mauvaise, qu’on ne put les élever ni l’un ni l’autre, à ce que j’ai entendu dire. Elle fut à l’extrémité : toute la famille de mon père l’alla voir, et on crut lui dire le dernier adieu. On parla beaucoup de moi ; mais vu sa situation, l’on ne trouva pas extraordinaire que je fusse ailleurs ; on ignorait ma maladie.
Mon père était alors en relation particulière avec un monsieur Rapenot, libraire, qui lui avait indiqué madame Manigre, son amie. Il nous proposa de venir loger chez lui, parce qu’il tenait à bail une grande maison à moitié vide. Mon père accepta, et fut logé au cinquième, dans un grand galetas.
À peine y fut-il installé, qu’il arriva un grand changement chez madame Manigre : Isabelle se laissa enlever par l’Anglais, qui la conduisit à Londres. Cette femme en eut d’autant plus de chagrin, que cette fille était parfaitement jolie, et qu’elle espérait beaucoup de certains protecteurs, en les faisant solliciter par elle ; ce fut une désolation dans la maison. Tous les amis vinrent la voir, pour la consoler : et comme à Paris l’on ne se connaît pas aussi parfaitement qu’ailleurs, on me crut sa fille, et un de ses amis l’engageait à se remettre, en lui disant qu’elle m’élevât bien, afin que je pusse réparer sa perte. J’avais huit à neuf ans, et ma figure promettait. Depuis cet instant, la Manigre se mit à me choyer ; elle m’habilla mieux que je n’avais jamais été, sans rien porter sur son mémoire, comme elle avait fait jusqu’alors ; mais elle me remettait mes habits ordinaires lorsque mon père devait venir.
Un jour qu’il paraissait fort triste, madame Manigre lui dit : « Mon Dieu ! monsieur Saxancour, que vous êtes à plaindre d’avoir une femme comme vous l’avez ! Tenez, vous me faites compassion ! Je vais faire arrêter le mémoire de la pension de votre fille par monsieur Rapenot, qui m’a toujours bien payée en votre nom, et j’en resterai là ; je la nourrirai, je l’habillerai, comme si elle était à moi, et il ne vous en coûtera rien, rien du tout » Mon père la remercia, en lui disant que cela ne serait pas juste. « Ah ! mais ! dit cette femme, j’y mets une condition : c’est que vous ne pourrez me l’ôter avant l’âge de vingt ans. » Mon père avait la plus grande confiance dans la Manigre, parce qu’il en avait eu la connaissance par deux dévots, monsieur et madame Rapenot ; cependant, il lui dit que sa proposition demandait beaucoup de réflexions, et qu’il la priait de lui laisser le temps de les faire. Elle y consentit, et mon père alla consulter les amis communs. Monsieur et madame Rapenot ne lui répondirent qu’en lui disant qu’il était un fou de ne pas accepter ; que je serais infiniment mieux avec madame Manigre, connue, respectée, dans tout le carré Sainte-Geneviève, considérée des prêtres de la paroisse, qu’avec ma mère, femme mondaine et de mauvais exemple. Mon père convint qu’ils avaient raison ; et comme il n’avait jamais vu la fille cadette, qu’il ignorait son aventure, parce qu’il était trop occupé pour fréquenter ses voisins ou ses connaissances, il résolut en lui-même de me laisser à madame Manigre. Mais il attendit quelques jours pour lui rendre réponse. Ce fut ce qui me sauva.
Durant cet intervalle, mon père eut affaire chez un relieur : deux couseuses, dont une très jolie, qui a longtemps été depuis chez le libraire Vente, causaient ensemble d’Isabelle Manigre ; la jolie racontait à l’autre l’enlèvement, la manière dont il s’était fait, et comment on était passé à Londres. Elle parla ensuite de la Manigre mère dans des termes si singuliers, qu’ils frappèrent d’étonnement mon père, qui n’avait d’abord donné à leur entretien qu’une attention superficielle. Mais combien sa surprise augmenta lorsqu’il, entendit la jolie continuer : « Elle a une petite fille chez elle, que monsieur Rapenot y a mise en pension, et qui est fille d’on ne sait qui ; car on ne voit jamais ses parents. Madame Manigre dit, ou fait entendre, qu’elle est bâtarde de monsieur Rapenot ; elle prétend s’en emparer, car elle la fait déjà passer pour sa fille, dans ses connaissances relevées, et elle compte par là remplacer son Isabelle. C’est une fine mouche que cette grosse vilaine femme-là ! On ne comprend pas comment elle peut avoir une aussi jolie fille qu’Isabelle. – Oh ! c’est bien sa fille ! dit l’autre couseuse, car j’ai été au catéchisme avec elle. – Qu’est-ce que ça dit ? Elle l’aura volée quand elle était enfant. »
Mon père s’approcha pour lors, et demanda aux deux couseuses si elles parlaient de madame Manigre du carré Sainte-Geneviève. Elles parurent hésiter : enfin la laide dit à la jolie : « Eh ! qu’est-ce que ça fait donc !… Oui, sans doute, c’est elle. – Eh bien ! mes filles, l’enfant dont vous venez de parler, qu’elle a chez elle, et qui se nomme Ingénue, est à moi. C’est monsieur et madame Rapenot qui l’y ont mise en pension, et non pas moi, qui suis inconnu à madame Manigre ; mais monsieur et madame Rapenot, que vous estimez sans doute, sont ses grands amis. – Il est vrai, dit la laide ! mais ne nous compromettez pas ! Tout ce que nous venons de dire est vrai ; mais si vous nous mêlez dans les discours, nous vous démentirons. Voyez, informez-vous par vous-même. – Elle a une jolie fille enlevée ? – Cela est su de tout le quartier ; allez vous informer, et ne parlez pas de nous. » Mon père fut très inquiet ; il alla dans différentes maisons, et surtout chez un chirurgien, qui lui apprit des choses étonnantes.
Parfaitement convaincu, il courut chez monsieur et madame Rapenot, pour les instruire et les prier de me retirer sur-le-champ. Mais ces bons dévots, au lieu de l’écouter, se fâchèrent violemment contre lui : ce n’étaient que des calomnies qu’on avait débitées. Mon père ne savait plus que penser. Il ne pouvait douter de l’honnêteté de monsieur et madame Rapenot, ni de leur religion. Il ne pouvait, d’un autre côté, concevoir leur aveuglement. Il n’en eut la clef que quelques jours après.
Ces gens avaient pour cuisinière une fine intrigante, que mon père n’avait encore qu’entrevue. Mais comme, depuis ses découvertes au sujet de la Manigre, il venait souvent les demander, il la reconnut enfin pour l’avoir vue autrefois servante dans un endroit suspect. Il pensa en lui-même qu’on pouvait changer, et qu’il n’était pas incroyable que cette fille fût ce qu’elle voulait paraître. Mais en approfondissant, il reconnut qu’elle était la source de la connaissance de monsieur et madame Rapenot avec la Manigre, et que c’était cette femme qui leur soufflait la bonne opinion qu’ils avaient de ma maîtresse de pension. Ses inquiétudes redoublèrent alors, et il résolut absolument de m’ôter de cette maison, dût-il par là se brouiller avec monsieur Rapenot.
Ce fut effectivement ce qui arriva : le dévot, qui avait toujours payé ma pension depuis dix mois, parce qu’il avait des relations d’affaires avec mon père, lui fit faire un billet à ordre de 700 livres, à un an d’échéance, pendant lequel temps mon père le remplit par intervalles ; ce qui fit que monsieur Rapenot ne le lui rendit pas, mais lui donna une décharge séparée. Pendant ce temps-là, il faisait courir le billet dans le commerce ; ce qu’il n’aurait pu faire, s’il y avait eu des acomptes au dos. Le billet vint à échoir, et fut réellement acquitté par monsieur Rapenot, qui le retint, quoiqu’il en eût reçu la valeur de mon père. Ce lui fut dans la suite un titre aux consuls, pour suspendre le paiement d’une somme de 1 850 livres qu’il devait : il annonça un compte à faire, et produisit le billet de 700 livres. Mon père avait égaré la décharge, et ne la retrouva qu’au bout de trois mois ; il la porta au libraire arbitre, qui négligea d’agir, de sorte que Rapenot est mort sans payer. La succession se trouva dévorée par des gens de pratique, et une pension de dix mois a coûté dans le fait à mon père la somme de 1 850 livres au lieu de cent écus, prix convenu avec la Manigre, car le billet de 700 livres était un billet de confiance. Mais mon père a toujours été la dupe de ceux avec lesquels il a traité.
Un homme seul, logé dans un vaste galetas au cinquième, ne pouvait me garder avec lui. Mon père me rendit à ma mère, alors rétablie, et il fut convenu qu’ils se réuniraient dans le même logement, car monsieur Rapenot continua de traiter avec mon père.
C’est ici une époque cruelle. Je ne saurais, sans la plus vive douleur, la rappeler à mon souvenir. J’avais quitté la Manigre, malgré cette femme, qui sachant la situation de mon père et voyant l’affection que j’avais pour elle, tâcha de me ravoir par finesse. Tout parut d’abord la seconder : sa fille revint de Londres, où elle avait été entretenue ; c’était un titre pour l’être ouvertement à Paris. Il fut convenu qu’elle se logerait dans la rue Poissonnière, près celle Beauregard, presque vis-à-vis les casernes des gardes suisses : c’était un quartier perdu pour mes parents, qui jamais n’étaient sortis de celui qu’on nomme l’Université. Isabelle devait me prendre avec elle, et m’élever dans l’usage du monde, me donner des talents agréables, etc. Pour y réussir, cette jeune et jolie personne vint voir mes parents. Elle débuta par se plaindre de sa mère, qu’elle peignit sous les couleurs les plus désavantageuses. Elle gagna ainsi la confiance de mes parents. Elle leur dit ensuite qu’elle allait se marier avec un riche parti, mais âgé ; qu’elle m’était attachée comme à sa propre sœur, m’ayant toujours tendrement aimée, et que, n’espérant pas d’avoir d’enfants d’un vieillard comme son prétendu, elle serait charmée de m’avoir, non en toute propriété, mais en commun avec mon père et ma mère. Cette proposition parut avantageuse et fut goûtée : mon père était si bon, si droit, qu’il avait la plus grande confiance dans une jolie personne qui paraissait ne respirer que l’honnêteté ; il fut décidé qu’on me laisserait demeurer avec Isabelle dès qu’elle serait mariée.
La trompeuse sortit de la maison comblée de joie, le jour qu’elle obtint ce consentement. Dès le lendemain, à l’heure de l’absence de mon père, elle amena un vieux monsieur, décoré d’une plaque, qui monta jusque chez nous, avec beaucoup de peine. Isabelle dit à ma mère : « Voilà mon prétendu, Madame ; c’est ce Monsieur dont je vous ai parlé hier. Sur le bien que je lui ai dit de vous, et d’après l’amitié que vous me témoignez, il a voulu vous visiter. » Ma mère, voyant un homme très comme il faut, lui rendit tous les honneurs convenables. On fit ensuite attention à moi. Isabelle me caressa, et le vieux Monsieur m’assit sur ses genoux ; il me donna des bonbons et quelques bijoux de prix, dont ma mère s’empara très avidement, aussitôt qu’il fut parti. Cette visite parut d’un bon augure à une femme peu versée dans la connaissance du monde, et qui d’ailleurs n’avait pas une certaine délicatesse, outre qu’elle faisait très peu de cas de moi, parce que, disait-elle, j’étais le bijou de mon père.
L’escalier du Collège de Prêle, où nous demeurions alors, était fort obscur, surtout vers le bas, avant la reconstruction de celui qui existe aujourd’hui. Mon père montait, comme Isabelle et le vieillard descendaient : il se rangea sans bruit et sans reconnaître la voix de mademoiselle Manigre : « Je m’accommoderai de cet enfant, disait le vieillard, elle me convient. Tout s’arrangera ; laissez-moi faire. – Puisque c’est votre goût, je le veux bien, pourvu que vous soyez exact à tenir vos promesses. » Mon père n’entendit que ce peu de mots, et quand il fut monté, il n’en parla pas. À son arrivée, ma mère était occupée à me défendre d’ouvrir la bouche de ce qui venait de se passer. De sorte que personne ne dit mot.
Mon père était presque toujours dehors pour ses affaires ; il sortit le lendemain, à son ordinaire, pour ne rentrer que longtemps après. Isabelle revint encore avec son vieillard. Ils avaient avec eux une couturière, qui fut chargée de me prendre la mesure pour un corps souple, de la façon de monsieur Bourbon de la rue des Bourdonnais, et de différents fourreaux des plus jolies étoffes, de chaussures, etc. On annonça que je ne porterais plus que des bas de soie. Ma mère écoutait avec une sorte de surprise. Je ne sais si elle eut des inquiétudes, ou si, me haïssant, elle ressentit un mouvement de jalousie des apparences de mon bonheur ; ce qu’il y a de vrai, c’est qu’au retour de mon père, elle lui parla de la visite de la veille et de celle qu’elle venait de recevoir, enfin des projets de mademoiselle Manigre. Mon père réfléchit un instant : « À quelle heure hier sont-ils sortis ? – Vers les sept heures. – Comme je rentrais ? – Un instant auparavant ; vous devez les avoir rencontrés. – Oui, j’ai entendu au bas de l’escalier un homme, à la voix cassée, qui tenait un singulier langage. (Il répéta ce qu’il avait dit.) – Il faut s’assurer de ce que prétendent ces gens-là, dit ma mère. » Mon père fut du même avis, et on les attendit venir.
Il y avait à côté de la grande chambre un petit cabinet, qui n’était propre qu’à contenir un lit et qui avait une issue au dehors. C’était où couchait mon père. Ma mère s’y cacha, quand elle entendit frapper, et moi, qu’elle avait soigneusement instruite, j’ouvris la porte. C’était Isabelle et son vieillard ; nous n’attendions qu’eux ; personne ne venait nous voir dans cette demeure, dont nous refusions l’indication, parce que nous y étions trop mal meublés, et plus mal logés. Isabelle me demanda où était ma mère. Je répondis qu’elle reviendrait bientôt. On s’assit, et le vieillard me prit sur ses genoux. Ce fut alors qu’on s’expliqua librement, persuadés que je n’étais pas capable d’entendre les choses qu’on disait. Mais ma mère les entendait parfaitement. Elle comprit alors l’arrangement d’Isabelle : cette fille avait réellement été recherchée pour elle-même par le vieillard ; mais celui-ci lui ayant témoigné ses regrets de ce qu’elle n’était pas plus jeune (elle avait alors dix-sept ans), elle lui avait dit, en plaisantant : « Eh bien ! prenez ma petite sœur ! – Quel âge a-t-elle ? – Mais neuf ans, environ. – C’est précisément ce qu’il me faut ! s’était écrié le vieillard ; je ferai votre sort ; mais donnez-moi votre sœur : je veux former celle que j’aurai ; je veux la former toute enfant. D’ailleurs, c’est mon goût que l’enfance, à cause de sa naïveté ; vous êtes trop formées et, s’il faut le dire, trop corrompues, vous autres grandes filles ! » Depuis ce moment, il avait tant tourmenté Isabelle, qu’il l’avait forcée de le conduire chez nous. Toutes ces choses-là furent à peu près répétées ; ensuite on en dit beaucoup d’autres, une surtout qui dut irriter ma mère : c’est qu’elle avait déplu au vieillard, qui lui trouvait la physionomie fausse : « Nous faisons bien, ajouta-t-il, de lui ôter cette aimable enfant. – Ah ! oui, dit alors Isabelle ; elle serait très malheureuse ; car sa mère ne l’aime pas : c’est une très méchante femme. » On parlait néanmoins de façon que je n’entendisse pas les choses les plus claires, et on me laissa jouer et courir par la chambre.
Ma mère rentra. Dès l’abord, elle prit un air de réserve glacé. Elle répondit par des révérences et des monosyllabes ; elle finit par me refuser absolument, et de la manière la plus complète. Le vieillard lui fit quelques reproches assez aigres sur ce qu’il nommait son manque de parole ; et mademoiselle Manigre avait les larmes aux yeux. Mais on sent que ma mère devait rester ferme. Elle ne compromit pas son secret, et se défendit même avec politesse, rejetant son changement d’avis sur mon père, qui, dit-elle, aimait trop sa fille, pour s’en priver. On se quitta très froidement de part et d’autre.
Mon père arriva quelques heures après. Ma mère, qui ne doutait pas qu’on ne s’adressât à lui, tâcha d’envenimer le peu qu’elle avait entendu : ce qui ne lui fut pas difficile, les discours du vieillard et d’Isabelle pouvant recevoir l’interprétation la plus odieuse. Cependant monsieur Saxancour, qui connaissait ma mère, ne répondit presque rien ; il se contenta de l’assurer qu’il ne se prêterait pas à me confier à mademoiselle Manigre.