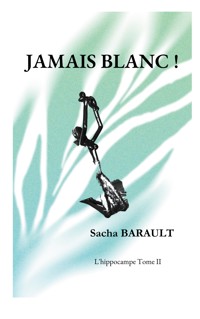
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: L'hippocampe
- Sprache: Französisch
Résumé Après ...plaisir à qui me frôle !, dans un style totalement différent du premier tome, quelquefois cynique mais toujours dans la légèreté Jamais blanc !, raconte la liberté d'un homme qui n'a jamais voulu faire de sa vie une routine. Et puis surtout, cet homme est multicolore, noir de coeur, blanc de peau, rouge de sang. Sur le continent Africain, sans limite de frontière, d'une opportunité à l'autre, d'un drame à une aventure, d'un éclat de rire à la douceur d'une peau, la liberté devient odeurs profondes de la terre, couleurs des savanes et hasard des rencontres. Voici le récit de quelques péripéties africaines de l'hippocampe. Ce livre est le deuxième tome de la série.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 144
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Du même auteur :
…plaisir à qui me frôle !
« Le code de la propriété intellectuelle et artistique n’autorisant, aux termes des alinéas 2 et 3 de l’article L.122-5, d’une part, que les « copies ou reproductions strictement réservées à l’usage privé du copiste et non destinées à une utilisation collective » et, d’autre part, que les analyses et les courtes citations dans un but d’exemple et d’illustration, « toute représentation ou reproduction intégrale, ou partielle, faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite » (alinéa 1er de l’article L.122-4).
Cette représentation ou reproduction, par quelque procédé que ce soit, constituerait donc une contrefaçon sanctionnée par les articles 425 et suivants du code pénal. »
« Vois-tu, j'aurais aimé être un compositeur ou un peintre, déclamer sur une scène, face à un public conquis, les strophes d’un texte aux mots qui transpercent l’âme et se gravent dans le cœur, dessiner un sein, un profil qui transporte, un visage ou une scène, véritables icônes de nos vies.
J’ai choisi l’écriture, pauvre parente de l’expression, contrôlée par des ponctuations militaires et des conjugaisons rigoureuses.
On ne choisit pas d’être Brel ou Van Gogh.
Écrire, c’est prendre le risque de fauter, de mal dire, d’être mal compris. Ni couleur, ni arpège. Des mots, brutaux, sans violon, sans complaisance, sans forme de bienveillance.
Des émotions sans musique, au gré du bon vouloir d’un lecteur, sans tache de couleur pour accrocher un regard blasé, à la dérive d’un espoir de séduction.
Mais ma voix est cassée, mes mains malhabiles, mes yeux hasardeux.
Alors j’écris. Au risque. Au plaisir, à l’illusion, au rire et à l’amitié, au hasard et à l’envie. Avec des notes et des palettes dans l’encre, des reflets et des accords sur les pages. Au bout de moi et de tout. »
Sacha
À tous ces visages croisés, ces mains tendues, ces sourires donnés, je suis vous.
À la rudesse, la chaleur et la poussière, le courage et la sueur, la couleur noire.
Au sang rouge, universel, à l’âme sans couleur, aux yeux des femmes, à la douceur de la peau.
À l’Afrique !
Sacha
TABLE
I PISTES AFRICAINES
TRAVERSEE
PYGMEE, ENTRE AUTRES
FOUTUE MEMOIRE
WHITE IN BLACK
ROSE PLANETE
DROLE D’OISEAU
CIRCUIT A LA COLOMBIENNE
C’EST LA FAUTE AU POKER
ESPECE DE DOLLARS
MAELSTRÖM
FIN DE PARTIE
CHAPEAU CLAQUE
II BLACK CHAOS
DJEMBE
TURN-OVER
PATRON, C’EST LA NUIT
DIMANCHE A BOBO-DIOULASSO
TORCHE
FELIX ET LES AUTRES VOUS AVEZ DECONNE…
II LES SAISONS DU FLAMBOYANT
OUM BI FO (JE TE SALUE)
BA OULI (L’ENFANT EST MORT)
TERRE MERE
THIOGO THIOGO (ON VA FAIRE CE QU’ON PEUT)
SANG D’AFRIQUE
SOUNGOUROU (PETITE AMIE)
I PISTES AFRICAINES
Traversée
Le patron du bateau de pêche s’écroule sur le pont, sonné par le coup de rame que je viens de lui administrer. Henri dérouille le marin. Le troisième lève les mains et se réfugie dans la cabine, les bras en l’air en montrant bien qu’il ne veut pas prendre part à la bagarre. Visiblement, il ne parle pas français.
À Casablanca, on s’est fait cogner par les flics avec de vifs “encouragements” à quitter la ville au plus vite. À Marrakech, Henri s’est battu avec le patron de l’auberge de jeunesse. Ici, le voyage a mal tourné. Je vais finir pas penser que la communication d’Henri est mauvaise.
Flashback.
Je m'enfuis, je fugue.
Posément, calmement, froidement. J’ai 15 ans.
Depuis quelques mois, je suis interne dans un lycée des Alpes. Tout m’est étranger, le froid, les manteaux, les gens, les odeurs, les couleurs. Je ne comprends rien à ce monde, je dois ressembler à un pingouin auquel on a mis des bottes.
L’internat est un lieu sans intimité, tout est commun, des douches aux repas, des cours jusqu’aux chiottes. Le dortoir est une immense salle de 100 gamins, découpés en box, juste séparés par une cloison à hauteur d’homme. Chacun a une petite armoire à côté de son lit. Toutes les nuits, ou presque, ce sont des batailles rangées, des lits en cathédrale et toutes les blagues de potaches imaginables. Je ne me plains pas de cette ambiance, je participe à toutes les guerres nocturnes avec un bel enthousiasme.
Je trouve un peu d’espace au fond de la grande cours en béton et goudron, moi qui n’ai fréquenté que du sable et le couvert des arbres. Entre les piliers, il y a des renfoncements et l’assise du bâtiment forme un banc. C’est là que je rencontre Aline, Patrick, Sabine, Marianne et Éliane. Nos jeans crasseux et effrangés, nos cheveux longs et nos dos courbés racontent la même histoire. L’histoire de ceux qui ne veulent pas être là. Alors, nous réunissons nos nostalgies, nos heures de cours séchés, nos colles, nos musiques et nos acnés pour construire un espace de joies, de rires et d’utopie.
Nous descendons à Aix-en-Provence le samedi, qui en bus, qui en stop, pour participer aux fêtes des étudiants et de quelques nantis venus s’encanailler dans notre univers. Je suis amoureux de Marianne et sa blondeur, sors avec Sabine et ses yeux de chatte, j’aime Aline, ses longs cheveux bruns et sa tristesse déchainée sur Led Zeppelin et Rare Earth.
Je sais que je ne vais pas rester, tout le groupe le sait. Je traîne l’Afrique sur mes épaules, dans mon sac, dans mes poches, je respire grâce aux souvenirs de l’air chaud, de l’odeur de la terre lorsque l’orage éclate.
Mon premier souvenir d’enfant est un grand arbre, un goyavier, des fleurs, des fruits sucrées avec des multitudes de petits pépins qui craquent sous la dent, la peau épaisse et délicieuse, le goût sucré qui teinte de rouge gourmand mes lèvres d’enfant. Je garde une envie passionnée pour ce fruit. Dans le jardin d’une maison coloniale, escaliers en pierre. Sous le toit, en haut des murs, des ouvertures laissent circuler l’air à l’intérieur et évacuent la chaleur. C’est le passage des oiseaux et des chauves-souris qui traversent malicieusement salle à manger et salon. Parfois, nous trouvions un serpent confortablement installé sous un fauteuil ou dans un pot de fleurs. Les margouillats avaient leurs entrées dans les habitations, venant grapiller miettes et insectes. Le soir, les tarentes sortaient de derrière les tableaux qui les cachaient la journée et entamaient sur les murs des courses poursuites avec les papillons et les moustiques qu’elles dévoraient. Personne ne les chassait, trop heureux que ces petits lézards débarrassent les humains des moustiques. Ça vivait une maison en Afrique, ce n’était pas aseptisé, climatisé, désinfecté.
La France n’est qu’un mot dans mon imaginaire d’enfant, un endroit dont parlent parfois nos parents. Un lieu qui enlève nos amis de jeux pendant quelques semaines de vacances, à la saison des pluies et qui nous les retourne avec des habits neufs et des expressions inconnues à la rentrée des classes.
Je marche pied-nus, je chasse les margouillats avec un lance-pierres, je cueille les mangues, me baigne dans les dangereuses déferlantes de l’océan, me châtaigne à l’occasion avec les gamins du quartier et rien ne m’attire vers ce drôle de pays où les gens ne se disent pas bonjour dans la rue.
Autour de moi, un boy, ma plus belle définition de l’amour et du dévouement pour des enfants, un gardien-jardinier, qui se fait engueuler lorsqu’on casse les branches des arbres pour faires des arcs et des épées, mais qui ne dit rien, de peur qu’on dérouille, des hommes, des femmes, noirs, des pagnes, des bassines de fruits, des accents forts, de la chaleur, des pluies sous lesquelles on court en riant, des flaques transformées en piscine.
Puis l’école, le collège, une tentative au lycée. Je ne bosse pas, je cumule les heures de sèche et les heures de colle. Avec les copains, c’est boîtes de nuit, copines, sorties, motos. L’insouciance sous l’été permanent et une certaine forme, je le reconnais, de chance de vivre là.
Ni la force de l’intolérance, la violence psychologique subis, ni les sévices et les abus ne m’ont fait désaimer cet univers. Au contraire, j’ai trouvé là, au cours de mes premières fugues, le goût de la solitude et de la liberté.
Lorsque le signal du départ vers la France a sonné, je ne suis pas senti concerné. C’était sans moi. Sauf quelques vagues souvenirs de vacances, je n’ai pas d’accroches, pas d’attaches avec cet univers étranger, la France. C’est ailleurs. Moi, je suis d’ici, de cette terre dans laquelle je plante mes pieds nus. Je ne suis pas propriétaire, je n’ai jamais eu l’esprit de possession ni de colonisation, au contraire, je ne veux rien en dur, rien de bâti, rien d’obligé. Je suis bêtement chez moi, sans réalité territoriale, sans revendication. Enfant comme adulte, je n’ai jamais prétendu posséder quoi que ce soit, c’est juste l’acte pacifique et intégré d’habiter quelque part.
Et pourtant.
La raison des adultes s’est heurté à mon cœur. C’était la première fois. Il y en a eu d’autres depuis.
Alors, consciencieusement, j’ai préparé ma fuite. Avec Marianne. Comme un prisonnier de guerre trouve légitime de s’évader, il me semblait naturel de regagner mon pays.
Un samedi après-midi, je suis monté dans un car vers Aix, puis Marseille et je ne regrette rien.
Marianne a préféré s’arrêter, elle a craint cette aventure, je ne lui en veux pas, c’est sans doute mieux et plus prudent. Et seul, je me sens plus à l’aise.
Devant moi, un chemin hasardeux mais tellement envié. Sur moi, une quarantaine d’euros, quelques babioles à vendre et beaucoup de culot.
Première étape, Marseille, la traversée à minuit du fameux quartier du Panier, qui n’était pas à cette époque le circuit touristique des croisiéristes, loin s’en faut. Les rues sont glauques, des visages baissés croisent mon regard, les putes m’interpellent, des bars, des sons, des cris et des rires.
J’arrive en bas des escaliers de la gare Saint Charles sans encombre. Mon sac à dos pèse sur mes épaules, j’ai marché vite. Je saute dans le train de nuit vers l’Espagne et la première épreuve, le passage de la frontière espagnole.
L’Espagne est encore franquiste, il faut montrer patte blanche, changer de train, sous le contrôle de la Guardia Civile. Je passe avec les autres voyageurs sans un accro. J’ai précieusement conservé une autorisation parentale de voyager seul, arrachée à mes parents à l’occasion d’un séjour en France l’an dernier. Il est encore valable quelques mois et c’est mon sésame frontalier.
La descente en train vers Barcelone. La ville est noire, grise aux alentours de la gare. Ceux qui visitent cette ville aujourd’hui n’imaginent pas comme elle était laide et sale alors. Puis un tortillard vers le centre de l’Espagne, je ne sais plus vraiment où je suis, j’ai perdu mes repères, je passe des heures à attendre sur des quais de gares aux noms improbables. Je me souviens de ces femmes en noir qui parlent à une vitesse folle, m’anesthésiant de leurs paroles que je ne parviens pas à déchiffrer, incapable de répondre à leurs interpellations. Et enfin Algésiras, au sud de l’Espagne, la porte vers l’Afrique.
Le soir je rencontre un groupe de routards, deux Japonais, deux Brésiliens, une Canadienne, qui nous racontera s’être fait violer deux fois sans renoncer à son tour du monde, une Allemande, auxquels je me joins, avec l’évidence que nos chemins se joignaient là. Cheveux longs, veste en daim sans manches, pattes d’éph, pieds-nus. Je parle espagnol, anglais. Les autres baragouinent l’espagnol, l’anglais, le français, tout le monde rit, c’est joyeux, insouciant. Tout cela me convient très bien. Nous prenons une seule chambre à l’hôtel, dans une atmosphère de musique et de fumée de pétards. Les Japonais s’esclaffent, les filles évoquent le Flower Power, les Brésiliens jouent de la guitare, cette chambre est l’agora du multiculturalisme heureux.
Les routards des années 60 à 80, espèce disparue, étaient des êtres formidables, curieux, joyeux de découvrir le monde sans autre ambition que le bonheur de la rencontre et des horizons nouveaux. Certes, le pétard accompagnait souvent la guitare, le sexe était libre, drugs, sex and rock and roll c’est pour de vrai, et l’hygiène parfois à la traîne mais quelle volonté d’ouverture et quelle soif de connaître les animaient. Libres, en voiture, en van, en stop, en train, tout était bon pour se balader au gré des envies. Le plus souvent fauchés, en quête du plan qui permet de continuer, assez placides et plutôt philosophes, j’ai côtoyé parmi ces gars et ces filles, des figures incroyables et inoubliables.
Certains ont leur budget, ceux-là, on les reconnaît rapidement. Ils sont propres, dorment dans les petits hôtels et les auberges de jeunesse, et ce sont eux qui, de fait, ramassent les plus jolies routardes.
Guitares, discussions, feux de camp, la vie comme tu l’as vu dans les films.
C’est le cœur léger dans les vapeurs de fumées que je m’endors, dans cette chambre bondée, amicale, rassurante.
Au matin, nous embarquons sur le ferry qui traverse le détroit de Gibraltar. Devant nous Tanger, le Maroc, L’Afrique. Derrière, le sillage du bateau efface l’Europe, le froid et la grisaille. Il fait un temps magnifique, le soleil salue de tous ses rayons la vie qui renaît.
Sur le port, je fausse compagnie à mes nouveaux amis et monte dans la vieille ville. J’y suis déjà venu l’an dernier et je sais m’y diriger. Il me faut de l’argent, j’ai épuisé mes maigres ressources du départ. Dans un café, je m’adresse au serveur, j’ai des trucs à vendre. Il me fait patienter quelques minutes puis un jeune type sympa arrive. Il me propose de le suivre dans une maison à quelques rues de là.
Sur la table du salon, face à la rade de Tanger, je déballe mes trésors. Il achète tous les petits bijoux et lorgne avec insistance vers ma gourmette gravée. Je lui vends aussi.
Puis je tente de faire de l’auto stop sous la pluie en direction de Casablanca. Échec complet, je finis dans un bus, trempé, pommé. Je reviens à Tanger dans la nuit. Un petit hôtel dans la médina, avec une vue splendide sur le yacht vert pomme d’Onassis, l’armateur grec, milliardaire. J’avoue avoir douté cette nuit-là, devant l’inconnu à affronter, le manque d’argent, la peur. Mais ça a été la seule fois.
Le petit matin me trouve dans un bus vers Casablanca. Je suis en fugue. J’adore cette liberté, personne ne sait où je suis, personne ne me connait dans ce pays. Envolées les craintes et les doutes, l’horizon m’appartient !
Seule Marianne est informée de mon périple. Sous la pression, elle raconte tout aux gendarmes et je deviens l’objet d’une recherche internationale. Je sais que je suis recherché, dorénavant, je fuis agents et postes de police et tout ce qui est officiel. D’ailleurs, le chemin classique devrait me faire descendre vers l’est via, l’Algérie mais j’ai fait le choix de descendre par la Mauritanie, le Mali pour rejoindre la Côte D’Ivoire. Dans les deux cas, il y a le désert à traverser.
A midi, le bus s’arrête en rase campagne, quelqu’un arrive avec un mouton, le tue et allume un feu. C’est totalement surréaliste. Les voyageurs sont installés sous une sorte de hangar couvert de canisses. Quelques minutes plus tard, des galettes de pains remplies de viandes sont proposées. Seul étranger, ou peut-être sens de l’hospitalité marocaine, je suis invité.
L’auberge de jeunesse est située juste en dessus de la corniche, dans la vieille ville, sur une petite place. Un grand dortoir avec des lits superposés, un aubergiste complaisant. Je rencontre Patrick et Henri. Le premier est français, il a trouvé un petit boulot aux chantiers navals. Henri est suisse.
Nous allons manger ensemble ce qui va devenir pendant une longue période le petit déjeuner, le repas de midi et le diner quotidien, pain, beurre, sardines à l’huile.
Moi aussi, il faut que je trouve un boulot, un salaire pendant quelques jours pour poursuivre mon périple. Le lendemain, je me rends aux chantiers navals avec Patrick mais ne réussis pas à tromper le contre-maître sur mon âge. Alors, je fais les bars, les restaurants et hôtels. Rien.
Après deux jours de recherche infructueuse, je comprends que je ne trouverai rien ici. Alors, je fais la manche pour acheter du pain et des sardines. Un soir, je pleure ma misère sur un grand boulevard de la ville, un homme me demande ce que je fais là. Je lui explique que je descends en Côte D’Ivoire. Sans doute interrogé par ma jeunesse, il entre dans un tabac, ressort avec une cartouche de cigarettes qu’il me tend avec quelques billets. Avec un sourire et sans me demander mon cul. Je n’ai jamais oublié cet homme. Il m’a relevé, littéralement.
Alors, je trouve des petits boulots, plutôt des petites combines.
Vendeurs de fausses Rolex aux touristes. Ce n’est pas difficile de faire croire que je me suis tout fait voler et que je vends ma montre pour rentrer chez moi. Mais un après-midi, je retombe sur le même touriste que la veille, que je n’avais pas reconnu. Lui si. La distraction est fatale dans ce métier.





























