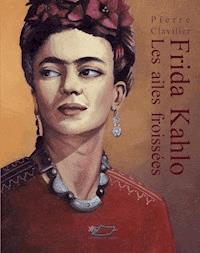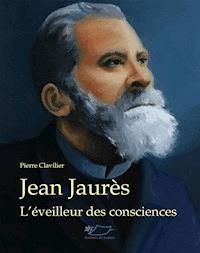
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editions du Jasmin
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Connaît-on vraiment cet homme dont la vie traverse la IIIe République ?
Qui n’a jamais entendu le nom de Jean Jaurès ? Cent ans après sa mort, des milliers d’écoles, de rues, de places portent son nom. La sincérité de son engagement, son intégrité intellectuelle et morale et ses idées ont amené des hommes politiques de tout bord à se réclamer de lui. Et pourtant, il n’a jamais exercé le pouvoir. Mais connaît-on vraiment cet homme dont la vie traverse la IIIe République ? Excellent élève, après une enfance dans le Tarn, il monte à Paris où il intègre l’École normale supérieure. Profondément républicain, il se passionne pour la politique. Député, brillant orateur, ses discours feront date dans l’histoire politique française. Fondateur du journal
l’Humanité, il deviendra une figure historique de la France.
Plongez dans la biographie de Jean Jaurès, et découvrez le parcours de cette figure historiques de la France : son enfance, ses études, sa passion pour la politique et ses discours marquants !
EXTRAIT
Même si cela est difficile, Jaurès assumera son soutien à Millerand. Il sort migraineux de la rédaction de
La Petite République. Campagnard dans l’âme, d’un naturel rêveur, il éprouve la nécessité de marcher. Les chantiers qui investissent Paris l’attirent. Jean s’évade en les regardant. Dans quelques mois, en 1900, se tiendra une nouvelle exposition universelle. Sous les chaussées pavées, on perce un tunnel où passera un train, le métropolitain. La ligne relira la porte Maillot (à l’ouest de Paris) à la porte de Vincennes (à l’est). Le déplacement sera très rapide puisqu’il s’effectuera en moins d’une heure !
CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE
Jaurès on le connait plus ou moins, on a entendu son nom à l'école, on sait que c'est un personnage politique important, qu'il a marqué son époque, que c'est le fondateur du journal "L'Humanité", mais sa vie, son combat ? Ce livre répond à ce questionnement, tout y est dit. L'auteur a fouillé, analysé et rend magnifiquement compte de la vie de Jaurès mais aussi de son oeuvre littéraire, de ses combats politiques, de son engagement pour le socialisme et pour la paix. Vous l'aurez compris avec les quelques superlatifs employés dans cette critique, j'ai simplement adoré le bouquin. Je le recommande donc vivement à tout ceux qui s'intéresse au personnage ! -
Inazuma, Babelio
Une fois de plus Pierre Clavilier nous fait découvrir un personnage atypique, une des plus grandes figures de la politique française. Une biographie qui prête à la réflexion. -
Vinykanelou
À PROPOS DE L'AUTEUR
Pierre Clavilier est historien, poète « pour élargir le temps ». Il s’enflamme pour la culture espagnole et principalement sa littérature. Voyageur, il s’envole vers le Mexique où il découvre un pays d’une grande richesse culturelle : ses poètes, ses romanciers, ses compositeurs, ses photographes, ses architectes et ses peintres l’éblouissent. À Mexico, il visite la Maison bleue où naquit en 1907 Frida Kahlo, s’enthousiasme pour ses œuvres, et se passionne immédiatement pour sa vie. « La première fois que j’ai rencontré Frida Kahlo, elle était accrochée à un mur », dit-il sur le ton de la plaisanterie, avant de préciser « Son musée lui ressemble tellement que j’ai eu l’impression que cet autoportrait était là pour m’accueillir, moi, le visiteur anonyme. » Dès lors, on comprend aisément la volonté de Pierre Clavilier de partager avec nous son exaltation pour cette femme artiste, militante, féministe et rebelle.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Couverture
Du même auteur
Du même auteur
AUX ÉDITIONS DU JASMIN
Frida Kahlo, les ailes froissées,Éditions du Jasmin, 2006
CHEZ D’AUTRES ÉDITEURS
El rey del pais de Nishadhas,Linajes Editores, Mexico, 2004
De vent et de pierres,Éditions Bérénice, Paris, 2005
La course contre la honte,Éditions Tribord, Bruxelles, 2006
Palabras de fuego/Mots de feu, El Taller del poeta, Pontevedra, 2012
COLLECTION SIGNES DE VIE
1.
Van Gogh, la course vers le soleil
José Féron Romano
& Lise Martin
2.
Jacob et Wilhelm Grimm, il était une fois…
François Mathieu
3.
George Sand, le défi d’une femme
Séverine Forlani
4.
Frida Kahlo, les ailes froissées
Pierre Clavilier
5.
Simone de Beauvoir, une femme engagée
M. Stjepanovic-Pauly
6.
Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes et au-delà
M. Stjepanovic-Pauly
7.
Frédéric Chopin, l’âme du piano
Claude Clément
8.
André Malraux, un combattant sans frontières
Marie Geffray
9.
San Martín, à rebours des conquistadors
Denise Anne Clavilier
10.
Beaumarchais, ou l’irrévérence
Marie Geffray
11.
Jean Jaurès, l’éveilleur des consciences
Pierre Clavilier
Titre
Copyright
Tous droits de reproduction, d’adaptation et de traduction réservés pour tous pays ISBN : 978-2-35284-458-7 © Editions du Jasmin
Dédicace
À mes parents
P. Clavilier
Le courage, c’est de comprendre sa propre vie… le courage, c’est d’aimer la vie et de regarder la mort d’un regard tranquille… le courage c’est d’aller à l’idéal et de comprendre le réel.
Jean Jaurès
Je suis plus sûr de lui que de moi, cet homme est d’une probité absolue.
Léon Blum, à propos de Jaurès
L’histoire se rit des prophètes désarmés.
Machiavel
Merci aux bibliothécaires, archivistes, militants, syndicalistes…qui m’ont accompagné dans mes recherches. Merci à Magali qui m’a soutenu dans mes errances.
P. Clavilier
1repartieNaissance d’un citoyen engagé
Heureusement, le passé ne meurt jamais complètement pour l’homme. L’homme peut bien l’oublier, mais il le garde toujours en lui.
Denis Fustel de Coulanges
Les premiers pas
En cette fin d’été 1859, à Castres, le soleil à son zénith éclaire la modeste maison du numéro 5 de la rue Réclusane. Accrochées à l’écorce des arbres, les cigales chantent. La chaleur écrase la rue sans mouvement. On entend les cris d’une femme en couches auxquels succèdent les pleurs d’un nouveau-né.
L’enfant sera nommé Auguste Marie Joseph Jean. Partout on ne l’appellera que par son dernier prénom. Dans le registre de baptême de la paroisse Saint-Jacques-de-Vilzgoudou, il est consigné : « L’an 1859, le six septembre, a été baptisé, en cette paroisse, Auguste Marie Joseph Jean, né le 3 courant, à midi, fils de Jean Henri Jules Jaurès, et de Marie-Adélaïde Barbaza. » À Castres, Marie-Adélaïde est une femme connue et respectée. Son grand-père revendiquait haut et fort des idéaux voltairiens bien qu’il ne manquât aucune messe dominicale.
À la naissance de Jean, l’empereur Napoléon III règne en France depuis presque sept ans. Le père de Jean a quarante ans, sa mère trente-sept. C’est le premier enfant du couple, arrivé sept ans après l’échange des alliances. Un mariage qui fut difficile à contracter. La famille Barbaza se montra hostile à l’union de l’une des leurs avec Jules Jaurès. Amoureuse, Marie-Adélaïde se révolta contre la soumission à laquelle l’exposait sa condition de fille. Elle livra de nombreux combats avant d’épouser Jules !
Les Barbaza n’apprécient guère Jules Jaurès. On lui reproche de n’avoir aucun panache même s’il a le verbe facile. Rien ne le distingue de la masse. Comment ce simple négociant peut-il prétendre épouser une fille Barbaza ? On répète en son absence que, si le nom de Jaurès doit s’unir à celui des Barbaza, les cousins germains de Jules seraient un meilleur parti. Jean Louis Charles Jaurès est un homme à marier ; de onze ans l’aîné de Jules, il jouit d’une grande notoriété. Il a participé aux campagnes d’Indochine et de Chine. N’a-t-il pas appartenu à cette expédition d’hommes valeureux qui prirent Alger en 1830 ? N’était-il pas membre de la délégation qui rapporta de Louxor l’obélisque érigé sur la place de la Concorde à Paris ?
Si Charles Jaurès, fidèle à Louis-Philippe et à ses héritiers, ne convient pas à Marie-Adélaïde pourquoi ne pas choisir son cadet Benjamin Constant ? Certes on le dit républicain et sa conscience politique le placerait au centre gauche… Quel que soit son choix, il y aurait pour sa famille matière d’être digne de l’union avec un Jaurès.
Le père de Marie-Adélaïde est conseiller municipal de Castres. Joseph Salvayra, son grand-père, fut un adjoint au maire et enseignant en belles-lettres. Louis, son frère, est un officier diplômé de l’École de Saint-Cyr. La famille compte également un capitaine d’infanterie blessé au combat, honneur qui ne souffre aucune comparaison. D’ailleurs l’empire ne lui a-t-il pas octroyé en guise de récompense la fonction très en vue de percepteur, à Puylaurens ? Les Barbaza sont fiers de leur lignée. Peuvent-ils décemment s’unir aux Jaurès ?
De la paille dans ses sabots
Onze mois seulement après la naissance de Jean, son frère Louis voit le jour. Leur faible différence d’âge entraînera une grande complicité. Quelques années plus tard, la naissance d’Adèle clôt la fratrie. Le bonheur est vite troublé par la mort qui vient emporter sans prévenir la petite. Pour fuir les souvenirs, les Jaurès quittent la ville et s’installent en pleine campagne dans une ferme, la Fédial-Haute, à seulement cinq kilomètres de la rue Réclusane.La propriété est dotée de six hectares d’une terre riche. Construite par le père de Jean, la bâtisse principale est massive et se prolonge par un hangar. Jean grandit dans un milieu rural où il partage avec ses voisins, humbles ouvriers de la terre, de nombreuses valeurs comme celles du travail manuel et de l’assiduité. Plus tard, devenu citadin, il n’oubliera jamais ses attaches avec le monde agricole dont il se revendiquera toujours l’enfant.
Aux premières froidures hivernales, la famille Jaurès délaisse son îlot de verdure jusqu’à l’arrivée des beaux jours. À la campagne, Jean rencontre pour la première fois des travailleurs. Un monde se révèle à sa conscience. Assis sur la margelle d’un puits, un livre à la main, il observe discrètement les agriculteurs dans leurs tâches. Ceux-ci sont devenus ses amis. Enfant d’une grande maturité, il leur parle de politique. Doté d’une mémoire étonnante, il cite sans se tromper de longs extraits d’articles de journaux. L’enfant surprend ses auditeurs en analysant finement les situations qu’ils lui exposent. Rapidement, son avis est recherché. Il sait écouter ses interlocuteurs, comprend leurs doléances et, plus que certains adultes, en connaît les tenants et les aboutissants. S’il examine, sans en avoir l’air, le monde rural, il y travaille parfois aussi pendant les vacances scolaires. Louis est plus adroit que lui pour les tâches agricoles. Bien que conscient de ses aptitudes limitées, Jean manie les outils et participe au début de l’été aux moissons et, à l’arrivée de l’automne, aux vendanges. Il ne tient pas seulement à développer ses facultés intellectuelles. Auprès des agriculteurs, il apprend le dialecte local. C’est un jardin secret qu’il partage avec son frère, ses parents refusant qu’ils l’apprennent sous prétexte qu’il serait dégradant de le parler et que l’usage du français serait bien plus valorisant. Pourtant eux-mêmes s’en servent lorsqu’ils désirent ne pas être compris par leurs enfants qui, en cachette, écoutent tout.
Dès ses premières années, Jean est mû par un sens de la solidarité, tout particulièrement envers le monde agricole qui ne fut pourtant jamais le secteur d’activité de son père, autrefois négociant en laine. Mais son père ne travaille plus et sa santé est dégradée par l’alcool.
Le prix du sacrifice
La mort d’Adèle a meurtri Marie-Adélaïde. Loin des siens, agenouillée sur le sol froid de l’église, elle prie encore pour le repos de l’âme de sa fillette fauchée par les Parques. Pour forte qu’elle soit, la foi n’apaise pas sa douleur. Inconsolée, Marie-Adélaïde consacre son existence à ses fils, ce qui la détourne de son chagrin. Conscients de son dévouement, ses enfants lui sont très liés. Par affection, ils la nomment « Mérotte ». Marie-Adélaïde ne marque aucune préférence entre ses fils.Elle les habille même de façon identique. Afin qu’ils reçoivent la meilleure instruction possible, elle décide de les envoyer à l’école primaire où ils prépareront le concours d’admission au collège. C’est un projet ambitieux, mais la mère a totalement confiance dans leurs capacités.
En France, à la fin du Second Empire, les lois de Jules Ferry rendant l’école primaire publique et gratuite puis, dans un second temps, obligatoire, ne sont pas encore instaurées. Un enfant qui ne rapporte pas de salaire est un luxe. Comment Marie-Adélaïde pourra-t-elle financer la scolarité de ses enfants lorsque les revenus familiaux sont faibles, voire inexistants ? Certes, il y a l’épargne, mais celle-ci n’est pas sans fond et finit par s’épuiser. Marie-Adélaïde demande l’assistance de son frère Louis. Vieux garçon assez fortuné, il règle la moitié des frais. Mérotte, pour subvenir aux besoins restants, est contrainte de vendre ses bijoux un à un. Le jeune Jean est lucide et devine les sacrifices maternels. Il comprend que l’obtention de bons résultats scolaires sera un réconfort et un encouragement pour sa mère. Travailleur, il étudie à s’en étourdir. Il dévore les livres jusqu’à s’écrouler de fatigue. Les bonnes notes régulières et les prix de fin d’année couronnent ses efforts. Doué, distingué par ses enseignants, Jean se fait un nom.
Cependant l’ambiance du foyer familial oscille entre le deuil et l’humiliation d’un père sans travail ni argent. Cette atmosphère confère à Jean une attitude que les villageois qualifient de grave.
Un collégien patriote
À la rentrée scolaire 1869, Jean et son frère sont reçus au collège de Castres. Les conclusions des professeurs font la fierté de Jules Jaurès. Il voit se dessiner une réussite pour ses fils qu’il n’a lui-même jamais connue. Malade, il sait qu’elle lui est à jamais refusée.
Pour Jean et Louis, la gloire des cousins paternels, Jean Louis Charles et Benjamin Constant, se substitue à l’autorité naturelle du père, anéantie par une situation sociale désastreuse. Souvent éloignés de Castres, ces deux hommes sont cependant bien présents dans l’esprit des adolescents. Ils incarnent l’ambition sociale, et constituent un modèle.
Un soir, avec cette audace qui frôle parfois l’insolence caractéristique de l’adolescence, Jean formule à ses parents le souhait de devenir receveur à la Poste. Il est attiré par cette profession qui exige une proximité avec les habitants. Comme il y a beaucoup de bureaux de poste, Jean suppute qu’il sera affecté dans un village qui lui permettra de rester près de Mérotte. Il sait déjà que Louis, pour sa part, est appelé à s’en éloigner : il prépare le concours d’entrée à l’École navale. Il doit être brillant, il ne peut le passer qu’une fois. En cas d’échec… Non ! ce mot n’existe pas pour lui. Louis sera élève de la prestigieuse académie ! Il deviendra officier dans la marine comme d’autres déjà dans la famille. Que Louis présente une quelconque faiblesse dans une matière, il trouve l’aide de son aîné pour combler ses lacunes. Au collège, Jean ne se distingue pas seulement par ses résultats, mais aussi par un altruisme inhabituel.
Plus que l’enseignement reçu au collège, l’actualité nationale forge le caractère de Jean. Les événements politiques et militaires façonnent un inébranlable patriotisme où se mêlent à la fois une grande fierté et une profonde humilité. Contrairement à beaucoup de ses contemporains, ce sentiment puissant ne l’empêchera en aucun cas d’être un grand internationaliste. Jean sera convaincu que les peuples d’Europe doivent travailler en bonne intelligence plutôt que de se livrer à des luttes d’influence, notamment pour étendre leurs empires coloniaux. Il comprendra que les risques encourus sont de déboucher sur des guerres.
Mais pour le moment que se passe-t-il en cet été 1870 ? Une heure sombre sonne en Prusse et en France. Coup de tonnerre, son écho noir résonnera pour les Français pendant plus de quarante ans. Décisive pour le sort de l’Europe, cette heure funeste l’est tout autant pour Jean.
En juillet 1870 se tient une rencontre entre le roi de Prusse, Guillaume Ier, et Benedetti, l’ambassadeur de France. Les discussions portent sur la succession au trône d’Espagne. Guillaume rend compte de son entretien à son ministre Otto Von Bismarck. Dans un télégramme qu’il lui adresse, il annonce ne plus soutenir la candidature de son cousin, le prince Léopold de Hohenzollern Sigmaringen, à la couronne espagnole. Mais Bismarck, cherchant à renforcer l’unité allemande, sous domination prussienne, pour aboutir au deuxième Reich, déforme les propos du roi. Sans scrupules, il leur donne une tournure belliqueuse : « l’on a refusé de voir l’ambassadeur de France » avant de lui faire savoir « qu’il n’y avait plus rien à lui communiquer ». Offensé, fier, sûr de la suprématie de ses forces armées, Napoléon III déclare la guerre à la Prusse le 19 juillet. En France, comme chez les Jaurès et les Barbaza, ils ne sont pas nombreux à contester la décision impériale. Le nationalisme triomphe… Soucieux de comprendre la raison de cette soudaine émotion collective, Jean est attentif aux conversations des adultes.
En France, dès les premiers jours de la guerre, la consternation l’emporte : l’armée impériale que l’on prétendait imbattable est impuissante face aux troupes adverses. L’ennemi si longtemps méprisé se révèle d’une force redoutable. L’ennemi fait mal. L’ennemi écrase les espoirs. L’ennemi piétine l’Empire. L’ennemi humilie la France. L’ennemi semble invincible. L’armée est bousculée jusque dans ses retranchements improvisés. Les uns après les autres, les régiments français rendent les armes. Les royalistes et les républicains s’en prennent à l’Empire. C’est lui, accusent-ils, le seul responsable de cette débâcle qui humilie le pays. Jean reste attentif aux situations militaires et politiques qui évoluent d’heure en heure. À la maison, l’oncle Louis commente les batailles dont il découvre les comptes rendus dans la presse. Ses analyses sévères, acerbes, tranchantes, sont vérifiées par les défaites.
Impuissants, les soldats de l’empereur ne sont que les spectateurs de l’invasion de l’Alsace. Mais un malheur ne vient jamais seul, ils sont les premiers témoins de l’annexion de la Lorraine. Pourtant, d’importants combats sont livrés autour de Metz. Partout en France, on répète que la ville résiste au siège des Prussiens. Sur place, Achille Bazaine, l’officier à la tête des régiments, qui a déjà servi au Mexique, a la confiance des Français. Ce héros est un militaire valeureux. Il ne livrera pas la ville aux ennemis. Il est, pense-t-on, de ces grands hommes sur lequel l’Empire peut s’appuyer. Qui sait si, à lui seul, il ne serait pas capable de reprendre tous les territoires cédés aux forces de Bismarck ? Il faut lui fournir des hommes. Pourtant, à Metz, la situation est désastreuse. Des milliers de blessés sont soignés grossièrement. Les habitants sont découragés. La faim tue les plus faibles.
Jean a bientôt onze ans lorsque les Prussiens encerclent Sedan dans les Ardennes françaises. Après avoir tenté de marcher sur Metz pour y soutenir Bazaine, les régiments nationaux sont contraints de se replier. L’empereur, venu encourager son armée, assiste à sa reddition. 75 000 hommes sont faits prisonniers dont 2 700 officiers parmi lesquels on dénombre 39 généraux. Plus qu’une cuisante défaite, c’est une infamie pour tous les patriotes. Amputée de ses meilleurs éléments, comment l’armée peut-elle poursuivre une guerre qui, de déroute en déroute, se transforme en désastre ? Parmi les captifs de Sedan, les Prussiens sont fiers de compter Napoléon III en personne.
Voulant épargner l’Empire fragilisé par l’arrestation de l’empereur, Palikao, le chef du cabinet – équivalent du Premier ministre aujourd’hui – dissimule aux parlementaires les événements de Sedan. Mentir aux représentants du peuple, c’est mentir au peuple lui-même. C’est insulter la représentation législative, c’est mépriser la population française. Malgré ce mensonge par omission des plus hautes autorités du pays, la nouvelle de la déroute militaire ardennaise circule en France. Elle parvient aux oreilles de Jean et des siens. On affirme sans preuve que l’empereur aurait été amené en Allemagne. Napoléon III y serait prisonnier parmi ses soldats. D’autres rumeurs courent, on murmure qu’il serait mort. On prétend que Bismarck et ses hommes se prépareraient à marcher sur Paris. Bismarck aurait même l’intention de fusiller tous les habitants de la capitale. Ici ou là, on explique encore qu’à Paris, Eugénie, l’impératrice, aurait quitté le palais des Tuileries avec ses enfants. Ils se seraient réfugiés à Tours. D’autres ajoutent qu’ils auraient rejoint l’Angleterre.
Dans cetimbrogliod’informations contradictoires, les députés se réunissent au palais Bourbon. Ils veulent trouver un remède à la crise politique. Un homme apparaît comme le sauveur : Adolphe Thiers. Ce royaliste septuagénaire n’a-t-il pas été le seul député à voter contre la déclaration de la guerre ? C’est donc un homme lucide. Toutefois, il refuse le pouvoir qu’on lui propose. Il estime la situation bien trop explosive.
À Paris, on apprend que la République vient d’être proclamée à Lyon. Sur les marches du palais Bourbon, un député républicain harangue la foule d’où fusent des « Vive Gambetta ! » En s’adressant aux Parisiens, il comprend l’opportunité pour les républicains de parvenir à leurs fins : rétablir la république que l’empereur, autrefois élu président, leur a ravie. Il convient d’être efficace. De retour à son siège, Léon Gambetta rédige un billet. Quelque temps après, d’un pas assuré, il gravit les degrés qui mènent à la tribune. Devant les représentants du peuple, il lit posément : « Citoyens, attendu que la patrie est en danger ; attendu que tout le temps nécessaire a été donné à la représentation nationale pour prononcer la déchéance ; attendu que nous sommes et que nous constituons le pouvoir régulier issu du suffrage universel libre, nous déclarons que Louis Napoléon Bonaparte et sa dynastie ont à jamais cessé de régner sur la France. »
Avec la chute de l’Empire, une page importante de l’Histoire de France se tourne.
La marche de la IIIe République
Puisque les Prussiens sont en guerre contre l’Empire tout juste destitué, chez les Jaurès et chez les Barbaza, on est persuadé que la fin du régime signe la fin du conflit. Les espérances sont déçues. Non seulement les hostilités continuent, mais de surcroît une défaite entraîne d’autres défaites. Rapidement les Prussiens assiègent Paris. Un Paris désarmé et sans pouvoir.
La chute de l’Empire a rendu caduc le corps législatif. Les députés élus en 1867 ont donc perdu leur légitimité. En février 1871 se tiennent des élections législatives organisées dans la précipitation pour ratifier au plus vite l’armistice. Elles se déroulent dans un climat exceptionnel.Quarante départements sont occupés et l’on dénombre quatre cent mille prisonniers de guerre.Jean découvre dans les journaux les résultats : sur 476 députés élus, 225 sont nobles, avec une forte proportion de monarchistes issus des listes « Pour la paix ». L’assemblée élue est composée majoritairement de royalistes, divisés en deux groupes : les légitimistes soutenant le comte de Chambord, partisans d’une royauté de droit divin, et les orléanistes, favorables au duc d’Aumale, partisans d’une monarchie parlementaire à l’anglaise, les plus nombreux. Parmi les nouveaux représentants, on compte également une trentaine de bonapartistes, fidèles à Napoléon III. La plus grande partie des élus de Paris est composée de républicains des listes « Pour la guerre », souvent extrémistes. En effet, le peuple parisien pense s’être correctement défendu et ne s’estime pas vaincu. Les républicains sont environ 150. Parmi eux un élu du Tarn : Benjamin Constant Jaurès.
Élus, les candidats qui ont brigué les suffrages dans plusieurs départements doivent choisir la circonscription qu’ils représenteront. Il reste ainsi de nombreux sièges libres, ils ne seront pourvus qu’en juillet. Entre-temps, Jean déchiffre assidûment la presse : il soupèse les arguments de chacun, aiguisant son esprit critique.
La guerre de 1870 a profondément marqué Paris qui a subi un siège très dur et dont la population a souffert de la faim. La capitale est une ville ouvrière tiraillée d’une part par l’agitation socialiste et d’autre part par la propagande républicaine. La défaite met en évidence le fossé entre ces deux familles de l’opposition au Second Empire. L’armistice de janvier 1871 paraît insupportable aux Parisiens qui ont résisté à l’ennemi pendant près de quatre mois. Ils refusent l’autorité des signataires. De surcroît, l’attitude du gouvernement désormais dirigé par Adolphe Thiers n’est pas conciliante à leur endroit, notamment lorsqu’il nomme trois bonapartistes aux postes de préfet de police, de chef de la garde nationale et de gouverneur de la ville de Paris. Ces nominations sont vécues comme une provocation par les républicains parisiens. Le 9 mars 1871, le préfet de police interdit les principaux journaux d’extrême-gauche, dontLe Cri du peuplede Jules Vallès. L’attitude de l’Assemblée, royaliste et pacifiste, qualifiée d’« assemblée de ruraux » par les Parisiens, contribue à l’exacerbation des tensions. Le 10 mars 1871, la Chambre des députés transfère son siège de Paris à Versailles, voyant dans Paris « le chef-lieu de la révolution organisée, la capitale de l’idée révolutionnaire ». Par une loi du même jour, elle met fin au moratoire sur les effets de commerce, acculant à la faillite des milliers d’artisans et de commerçants, et supprime la solde d’un franc cinquante par jour payée aux gardes nationaux. Autrefois Thiers, alors ministre de Louis-Philippe, avait commandé la construction des fortifications qui entouraient Paris. Il avait conçu cette enceinte pour défendre la ville contre des ennemis, mais avait aussi déjà calculé à l’époque que, pour mettre un terme aux insurrections populaires, il suffisait d’enfermer les insurgés dans la ville, puis de les réprimer. Durant la révolution de 1848, Thiers avait vainement proposé ce plan à Louis-Philippe pour briser la révolution parisienne. Le 17 mars 1871, Thiers et ses ministres envoient au cours de la nuit la troupe sous le commandement du général Vinoy s’emparer des canons de la butte Montmartre. Ce même jour, Thiers organise l’arrestation de Blanqui, révolutionnaire socialiste franc-maçon, partisan du suffrage universel, qui, malade, se repose chez un ami médecin dans le Lot. Là, il le fait transférer en Bretagne, sous surveillance militaire, avec ordre de tirer en cas de tentative d’évasion. Quand le gouvernement décide de désarmer les Parisiens, ceux-ci se sentent directement menacés. Ils considèrent comme leur propriété ces canons qu’ils ont eux-mêmes payés par souscription lors de la guerre contre la Prusse. Ils se voient sans défense vis-à-vis d’éventuelles attaques des troupes gouvernementales, comme en juin 1848. Cependant ils disposent de près de 500 000 fusils.
C’est l’épisode de la Commune, sévèrement réprimé par les forces d’Adolphe Thiers, chef du pouvoir exécutif. Plus de 300 communards sont condamnés à mort, de nombreux autres sont envoyés au bagne ou exilés. Ils ne seront amnistiés qu’au milieu des années 1870. Ni l’écho des cris d’espoir des rebelles, ni celui des larmes et des armes n’arrivent aux oreilles de Jean.
Les 2 et 9 juillet, des élections législatives complémentaires se déroulent dans quarante-six départements. La destinée nationale est en jeu. Du fait de l’influence française, c’est aussi l’avenir des autres pays européens qui se dessine. Pour la première fois de l’histoire nationale, les électeurs expriment leur préférence sur la nature du régime. Les républicains mènent campagne avec Léon Gambetta, député de Belleville originaire du Lot, choisi en raison de ses propos modérés et fédérateurs. Ils enlèvent 99 sièges sur les 114 à pourvoir.
Ne parvenant jamais à s’accorder sur celui qui devrait devenir roi en cas de retour de la monarchie, les royalistes ont fait le lit des républicains. Ceux-ci sont d’ailleurs réconfortés en janvier 1873 par la mort de Napoléon III à Londres où il était en exil. La disparition de l’ancien empereur voit les dernières velléités bonapartistes s’estomper.
Pendant ce temps-là, Jean Jaurès est élève au collège de Castres.
Les prix et les honneurs scolaires
Allégeant les dépenses inhérentes à la scolarité des fils Jaurès, l’un des cousins de la famille obtient de l’État la division entre Jean et Louis du montant d’une bourse que l’aîné a brillamment obtenue après un concours.
Le dimanche, Jean va à la messe où il perfectionne son latin, qu’il lit déjà aussi couramment que le français. C’est un adolescent aussi pieux que sa mère. Au collège, à la distribution des prix, il est distingué dans toutes les matières. Un collégien doit parler une langue étrangère ? Jean apprend l’allemand. Là encore, ses facultés impressionnent. Germa, son professeur de rhétorique, conserve le souvenir d’un « élève modèle, très docile, très appliqué, très équilibré, doué de pénétration et de finesse ». La maturité de Jean surprend. Aussi certains de ses professeurs lui prêtent des livres, s’entretiennent avec lui de sujets qui n’ont rien de scolaire et qui divisent républicains, bonapartistes et monarchistes. D’autres pourtant supplient le député Benjamin Constant Jaurès d’exercer son autorité morale auprès de Jean. Il faut lui faire comprendre qu’il doit étudier ce qu’on lui enseigne. Il n’a pas à s’immiscer dans ces débats.
Au collège, on prétend que Jean est toujours en train de lire. Toujours ? Pas vraiment. L’adolescent, qui a bien grandi, aime encore s’entretenir avec les agriculteurs. « J’aime entendre notre langue et j’aime à la parler »,écrira-t-il dansLa Dépêche de Toulouse.Son frère ou Mérotte le surprennent parfois perdu dans ses rêveries rythmées par le chant des grillons, sur lesquels il écrira en 1880 : « Ils sont si heureux, qu’ils font une musique à n’en plus finir ; et pourtant, chose curieuse, le rythme de leur chanson a une tournure mélancolique. » Le soir, une fois couché, il garde ses livres fermés. Il en apprécie les idées comme, après un repas, il conserve en bouche les saveurs d’un bon plat.
Le 30 janvier 1875, à la Chambre des députés, l’amendement Wallon est discuté : « Le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages par le Sénat et la Chambre des députés réunis en Assemblée nationale. Il est nommé pour sept ans ; il est rééligible. » Il est ajouté à ce qui deviendra la loi constitutionnelle du 25 février 1875. Le texte, violemment débattu, est adopté par une voix de majorité. Au-delà de cette question de pure procédure, c’est en réalité la nature du régime que l’amendement Wallon définit. Au lieu de la formulation d’Édouard Lefebvre de Laboulaye, député de Paris soutenu parl’Union de la presse parisienne :« Le gouvernement de la République se compose », l’amendement Wallon se contente de :« Le président de la République est élu ». Si la formule est modeste, son vote par les députés, en tant qu’amendement au projet constitutionnel, montre que le régime républicain a dépassé le stade du provisoire pour devenir le régime politique de la France, ce qui fait d’Henri Wallon le « père de la République ».
Le nouveau régime est doté de trois fondements législatifs. On les explique à Jean. Le premier est relatif à l’organisation du Sénat. Le suivant organise les pouvoirs publics. Le dernier précise les rapports des pouvoirs publics entre eux. Ces trois textes consacrent « ce régime qui divise le moins » comme le définit Thiers. Pragmatique, après avoir constaté que les monarchistes ne parviendraient jamais à trouver un accord, celui-ci s’est rallié aux républicains qu’il a pourtant combattus et ceci au grand dam de ceux qui l’ont porté au pouvoir.
En mai 1876, le sous-préfet du Tarn visite le collège de Castres. Cette présence marque l’intérêt que le gouvernement accorde à l’Instruction publique. Il convient de savoir l’accueillir. Comment agir ? Doit-on confier la mission à l’un des enseignants ? Ce serait à coup sûr l’objet de querelles entre eux. L’idée est abandonnée. On choisit parmi les élèves un représentant qui prononcera un discours. Il n’y a pas à réfléchir : Jean est désigné. Il a dix-sept ans et possède une exceptionnelle facilité d’élocution. En s’adressant au fonctionnaire, il s’adressera à la République qui encourage ses plus brillants citoyens, ceux qui bâtiront la France de demain.
Jean s’avance, une feuille à la main, son apparence est gauche. Mais, d’un style soutenu, ses propos sont adroits et affûtés. Ses paroles sont loin des idées communes. « Monsieur le Préfet, laissant aux fonctionnaires supérieurs de l’Université le soin de mesurer nos progrès scientifiques ou littéraires, vous avez voulu par votre présence dans cette enceinte, où, tous, nous vous accueillons avec respect, nous donner un gage de la sollicitude profonde du gouvernement que vous représentez pour l’éducation morale de la jeunesse française. Sans cette éducation, en effet, celui-ci serait impuissant à raffermir l’édifice ébranlé naguère de notre grandeur nationale. » Des années plus tard, Pierre Chabert, ancien condisciple de Jaurès, témoigne : « Sa voix sourde, métallique, fut d’abord rocailleuse. Quelques phrases suffirent à l’éclaircir, disciplinant aussi le tic nerveux d’une paupière lourde, le geste maladroit, l’attitude comme nouée. »
Jean dit au haut fonctionnaire l’adhésion du collège à l’action gouvernementale. Il s’enthousiasme pour l’éducation morale recherchée par la République. Il se désole des contrecoups néfastes de la guerre. Le conflit de 1870 a ruiné et amputé la France. Dans son discours, Jean manifeste le goût du travail « à la restauration de notre gloire, de notre puissance écroulée. » Évoquant l’instruction publique comme un service de l’État, Jean emploie un registre fort : « un besoin absolu » du pays devant avant tout être « éclairé, volontaire, ayant pour principe l’amour du pays et des institutions. »
Jean a fini son allocution, les cent cinquante élèves l’acclament. Il les salue les paupières fermées, son sourire intimidé souligne sa modestie doublée de reconnaissance. Il se retourne ensuite vers l’hôte de choix et vers le corps enseignant. Descendant les degrés, le jeune orateur replie le papier de son discours. Le sous-préfet est stupéfait, Jean n’a pas eu besoin de le lire. Il lui a suffi de le rédiger pour le connaître.