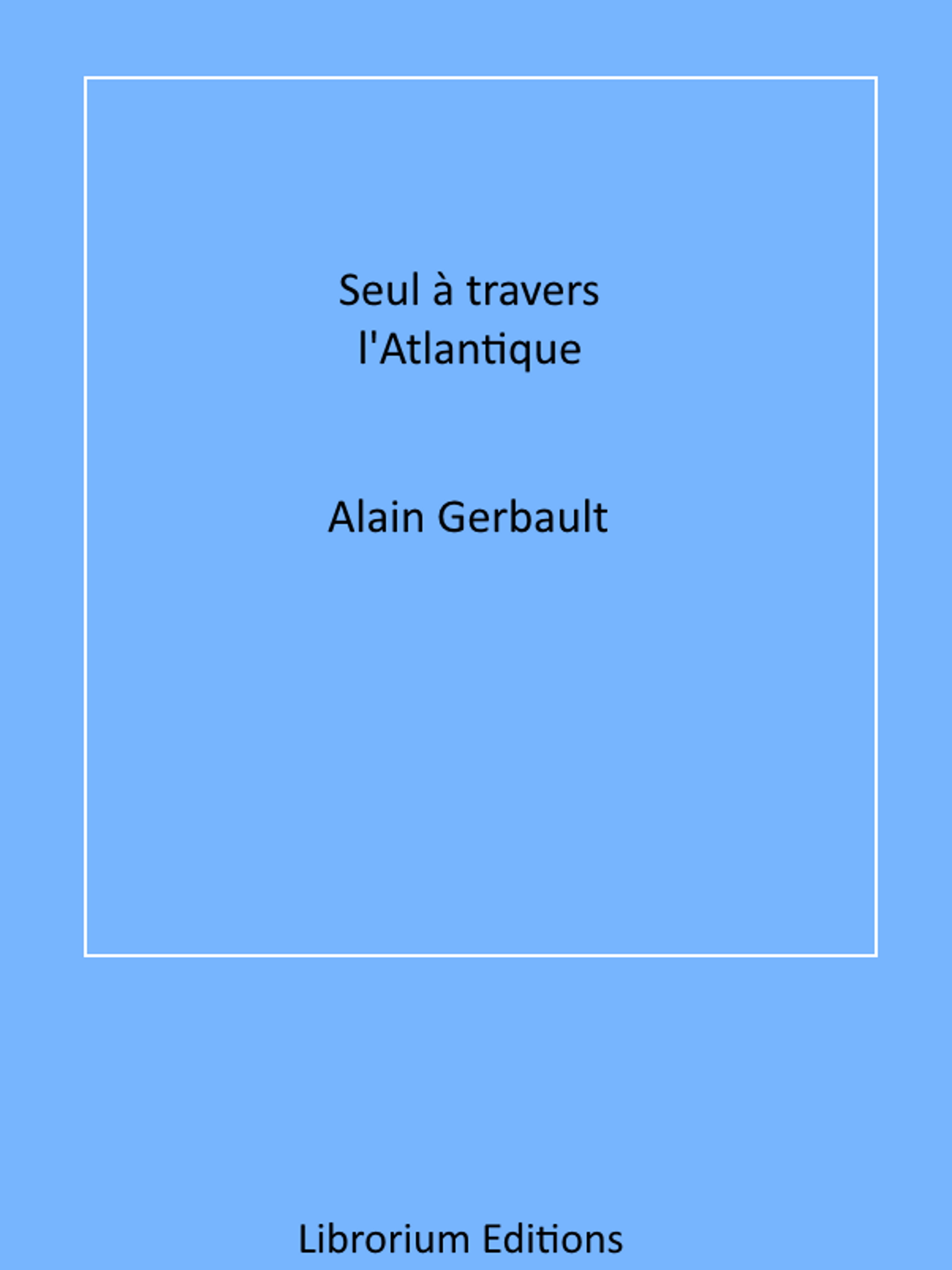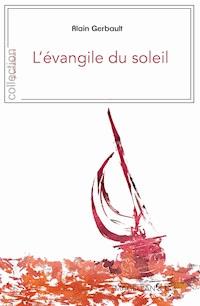Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: CLAAE
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
A la poursuite de la liberté
Après une première traversée de l’Atlantique en solitaire en 1923, attiré par le Pacifique et la Polynésie, Alain Gerbault quitte New York en 1924. Il rentre en France en 1929 après avoir navigué autour du monde au gré de son humeur et de ses escales avec le
Firecrest : Bermudes, Panama, Galápagos, Gambier, Marquises, Tahiti, Wallis, Fidji, Nouvelle-Guinée, Maurice, Cap-Vert, et bien d’autres, et c’est ce qu’il nous raconte dans cet ouvrage préfacé par Jean- Baptiste Charcot.
Ce navigateur solitaire est un artiste et un poète sans être un rêveur ; il tire bénéfice pratiquement de ce qu’il voit et ressent – la navigation est d’ailleurs un art, la mer une poésie sans limites. Il sait tout ce que les bons matelots du temps de la voile doivent savoir, il possède à fond le bagage d’un navigateur avisé. Comment a-t-il acquis ces connaissances ? Je l’ignore, mais je sais qu’il a travaillé et travaille toujours, et dans sa volonté de renverser les obstacles, il a improvisé ce que les livres n’ont pu lui donner. Il a apprivoisé et dressé son bateau, ils ne font plus qu’un, et après tout ne sont jamais seuls, car ils ont asservi la mer. - Jean-Baptiste Charcot -
Laissant derrière lui un destin d'ingénieur tout tracé, Alain Gerbault voyage et nous fait voyager avec lui.
EXTRAIT
Après deux mois d’un travail incessant, le Firecrest est prêt et le départ proche. J’ai confiance, car il est maintenant en bonne condition. Le mât neuf est en pin d’Oregon, d’une longueur totale de quatorze mètres. Un nouveau beaupré, en pin d’Oregon lui aussi, remplace celui qui fut brisé dans un ouragan. Le gréement dormant en fil d’acier galvanisé peut supporter un effort de dix tonnes sans se rompre.
Les voiles sont neuves et cousues d’une manière spéciale. Un nouveau réservoir d’eau claire de deux cents litres conservera l’eau, mieux que les barils de chêne. La sous-barbe de beaupré et le rouleau pour le gui, qui s’étaient brisés pendant ma traversée, sont remplacés par une sous-barbe de bronze et un rouleau en fer galvanisé beaucoup plus solide. La nouvelle grand-voile triangulaire et le gui creux rendront la manœuvre beaucoup plus aisée.
Le Firecrest est prêt et le départ est proche. Depuis plus d’un an, je suis à terre. Toutes les difficultés ont été surmontées et je vais bientôt pouvoir repartir.
À PROPOS DE L’AUTEUR
L’auteur Alain Gerbault (1893 – 1941) est né dans une famille d’industriels installée à Laval. Il se fait remarquer par son goût pour la compétition et le sport. Il deviendra un excellent joueur de tennis classé. Durant la Première Guerre mondiale, il abandonne ses études d’ingénieur pour s’engager dans l’aviation. En 1921, il décide de changer de vie et achète un voilier en Angleterre : le
Firecrest. Après plusieurs navigations en Méditerranée, il part seul traverser l’Atlantique d’est en ouest en 1923. C’est un succès aux USA. Il part en 1924 pour la Polynésie et rentrera une dernière fois en France en 1929. Il disparaît dans l’île de Timor en 1941 après avoir tenté à de multiples reprises d’échapper à la Seconde Guerre mondiale.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 355
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Alain Gerbault
Journal de bord
New York – Tahiti – Le Havre
Préface de Jean-Baptiste Charcot
À la poursuite du soleil
et
Sur la route du retour
CLAAE
2014
Cartes, illustrations © Alain GerbaultPhotos © Droits réservés
© CLAAE 2014
Tous droits réservés. Le Code de la propriété intellectuelle interdit les copies ou reproductions destinées à une utilisation collective. Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite par quelque procédé que ce soit, sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit, est illicite et constitue une contrefaçon sanctionnée par les articles L.335-2 et suivants du Code de la propriété intellectuelle.
9782379110313 (ebook)
CLAAEFrance
Alain Gerbault
L’auteur Alain Gerbault (1893 – 1941) est né dans une famille d’industriels installée à Laval. Il se fait remarquer par son goût pour la compétition et le sport. Il deviendra un excellent joueur de tennis classé. Durant la Première Guerre mondiale, il abandonne ses études d’ingénieur pour s’engager dans l’aviation. En 1921, il décide de changer de vie et achète un voilier en Angleterre : le Firecrest. Après plusieurs navigations en Méditerranée, il part seul traverser l’Atlantique d’est en ouest en 1923. C’est un succès aux USA. Il part en 1924 pour la Polynésie et rentrera une dernière fois en France en 1929. Il disparaît dans l’île de Timor en 1941 après avoir tenté à de multiples reprises d’échapper à la Seconde Guerre mondiale.
Firecrest
Le voyage autour du monde
PRÉFACE
Le Journal de bord du Firecrest ne comporte pas de préface et son auteur n’a pas à être présenté.
Alain Gerbault à bord d’un yacht de huit tonneaux uniquement à voiles, sans compagnon, sans aide d’aucune sorte, est parti de France et est revenu en France ayant effectué le tour du monde. Cet exploit extraordinaire est à peine croyable, mais reste un fait indiscutable. Les commentaires sont inutiles.
Cependant il n’est pas défendu aux gens de bien d’espérer honneurs de leurs vertueux faits, a écrit Amyot. Alain Gerbault est un modeste doublé d’un philosophe qui n’espère pas honneurs ; il devra les subir et je ne veux pas me dérober au devoir flatteur qui m’appelle à célébrer ses vertueux faits.
Dans toutes les nations, les vrais marins ne ménageront pas leur admiration et le public, même non-initié aux choses de la mer, applaudira à son succès.
L’inévitable irritation des jaloux et les critiques des déboulonneurs de gloire consacreront son œuvre, il aurait pu faire ceci, diront les premiers ; il aurait dû faire cela, s’écrieront les seconds ; il tournera le dos à tous deux. Mais d’ores et déjà je répondrai pour lui : il a fait ce qu’il a fait, mieux encore, d’avance il a dit ce qu’il ferait.
Il a eu de la chance, soupireront les dénigreurs en oubliant que cette maîtresse capricieuse ne sourit qu’à ceux qui osent l’affronter.
J’admets toutefois qu’il constitue une exception ; je le regrette d’ailleurs, car je voudrais que la France possédât beaucoup d’hommes de son genre, aussi physiquement et moralement doués, qui aussi bien que lui peuvent ce qu’ils veulent.
D’autres, deux, je crois, un Américain le capitaine Slocum et un Anglais, ont accompli jadis ce tour de force ; ils méritent de semblables éloges ; notre navigateur les leur prodigue largement, mais les conditions ne sont pas les mêmes et le singularisent.
La simplicité des moyens employés ne rend son exploit que plus remarquable ; il a choisi un bateau déjà existant, comportant au moins deux matelots ; il n’a pas fait appel à des procédés spéciaux et à des inventions ; conscient de son endurance, de son adresse, de sa science et de son initiative, sachant ce qu’il pouvait attendre des unes et des autres, sans hésitation il est parti seul ; il est revenu seul, prouvant qu’il valait un équipage complet.
Alain Gerbault est un problème ; je ne chercherai pas à le résoudre, mais lui a trouvé sa solution et a su l’appliquer. Quelques-unes des données méritent d’être soulignées. Ingénieur instruit et cultivé, aviateur remarqué pendant la guerre, toujours sportsman consommé, observateur de toutes choses, amant de la nature, il n’avait jamais exercé une profession se rapportant à la mer. Le sens marin, qualité aux origines inconnues, est en lui ; il s’en rendit compte en mettant le pied sur un bateau, attiré par l’amour de la liberté, enivré par le désir de lutter contre les difficultés. Son apprentissage se fit sur son navire, sous ses propres ordres, en traversant l’Atlantique. Pour continuer à s’instruire, il recherche l’expérience des gens de mer, mais n’a confiance qu’en lui-même ; il a raison, car sa confiance est bien placée ; elle ne l’empêche pas d’apprécier les autres et de leur rendre justice, mais, tout comme il ne gaspille pas ses forces, il ménage ses éloges et ses amitiés. Misanthrope ? certes non, son livre le prouve, mais la vie qu’il a choisie lui permet de s’écarter avec dédain de ce qu’il juge méprisable.
Le lecteur du Journal de bord du Firecrest verra que ce navigateur solitaire est un artiste et un poète sans être un rêveur ; il tire bénéfice pratiquement de ce qu’il voit et ressent ; – la navigation est d’ailleurs un art, la mer une poésie sans limites. Il sait tout ce que les bons matelots du temps de la voile doivent savoir, il possède à fond le bagage d’un navigateur avisé. Comment a-t-il acquis ces connaissances ? je l’ignore, mais je sais qu’il a travaillé et travaille toujours, et dans sa volonté de renverser les obstacles, il a improvisé ce que les livres n’ont pu lui donner. Il a apprivoisé et dressé son bateau, ils ne font plus qu’un, et après tout ne sont jamais seuls, car ils ont asservi la mer.
Alain Gerbault est un phénomène qui concentre toutes les qualités des marins complets, des marins de notre race qui regardent et qui sentent tout en agissant. C’est une force, une volonté, un exemple.
Quels sont les résultats de son magnifique effort ? Des leçons multiples dans l’ensemble et les détails, mais deux déjà me suffiraient largement ; il a attiré l’attention de nos compatriotes sur la mer ; en révélant aux étrangers ce dont un Français est capable, il a bien servi la France et sa marine ; je voudrais que celle-ci, modifiant les armes conférées jadis par le roi d’Espagne à Sébastian el Cano, lui donna un globe ceinturé de la mince flamme tricolore portant cette inscription : Solus unus circumdedisti me.
Jean-Baptiste CHARCOT.
PREMIÈRE PARTIE
—
À LA POURSUITE DU SOLEIL
Journal de bordde New York à Tahiti.
Dans le dédale des îles polynésiennes
CHAPITRE PREMIER
Préparatifs de départ.La remise en état duFirecrest.
À bord du Firecrest,
City Island, 8 octobre 1924.
D’une lettre à son ami P. A.
Lorsque je débarquai du Paris, le 16 août 1924, je me rendis immédiatement à City Island pour revoir le Firecrest. Je le trouvai se balançant à l’ancre, devant le chantier de construction navale, où je l’avais laissé huit mois avant. Privé de tout gréement, il apparaissait plus petit encore et la peinture de sa coque abîmée par les intempéries avait un aspect lamentable. La joie que j’éprouvai à le revoir fit aussitôt place à l’appréhension du travail énorme qu’il me faudrait fournir avant de pouvoir reprendre la mer.
D’abord commencèrent pour moi quinze jours de démarches pour pouvoir passer à la douane le matériel que j’apportais. Je prétendais obtenir le bénéfice du transit, mais malgré l’appui du directeur de la Compagnie transatlantique, je me heurtai à des règlements inflexibles. Et lorsqu’un haut fonctionnaire des douanes me dit que j’aurais aussi bien pu acheter en Amérique tout le matériel nécessaire à ma croisière, je compris et payai. Je payai des droits de douane même pour les chronomètres de bord et les livres anglais destinés à la bibliothèque du Firecrest, mais enfin je pus prendre possession du mât de flèche creux et du gui que j’avais amenés.
J’entrepris alors divers travaux : dessiner et calculer le plan de la voilure et du gréement, commander le nouveau mât, les haubans en fil d’acier, les voiles, surveiller tous les travaux et faire remplacer les pièces dont la résistance n’était pas suffisante. New York n’est certes pas le port idéal pour s’équiper en vue d’une longue croisière. Les chantiers ne sont pas habitués à construire pour le mauvais temps et la haute mer, car les yachts croisent en général dans le détroit abrité de Long Island, et certainement un port de pêche tel que Boston ou Gloucester aurait été préférable. Il me fallait constamment signer des chèques et je n’osais pas songer aux milliers de dollars qu’allait me coûter la mise en état de mon navire.
Souvent, un peu découragé, je laissais tous travaux et allais me promener le long des quais du port. Le plus grand du monde par le tonnage, le port de New York, avec ses innombrables navires, pourrait charmer les yeux d’un amoureux de la mer. Hélas ! de nombreux édifices numérotés cachent les navires et les jetées, et les quais ressemblent à la façade d’une immense gare de chemin de fer.
Mes préférences, certes, allaient aux ports plus petits où l’on peut encore admirer des navires à voiles, à Saint-Malo et ses terre-neuvas, au port de La Rochelle et même au Ladie’s dock de Londres où, il y a quelques années, on voyait encore quelquefois de vieux clippers aux voiles blanches.
Il était cependant, à Battery Place, près de l’Aquarium, un coin charmant d’où l’on apercevait le New Jersey et l’embouchure de la rivière. Assis sur un banc, je regardais avec envie les navires qui descendaient l’Hudson et passaient près de la statue de la Liberté, pour gagner le large. Parfois aussi j’avais le grand plaisir d’apercevoir des goélettes à trois ou quatre mâts qui sont peut-être ce que la construction américaine a produit de plus gracieux.
Un jour même je me découvris dans un petit bassin, près de l’Aquarium, un rival. Là, de nombreux curieux contemplaient un canot ponté nommé Carcharias (requin, en grec), que son propriétaire en uniforme doré exhibait moyennant rétribution, et sur lequel il se proposait de gagner Le Pirée et de faire seul le tour du monde. Un simple coup d’œil me suffit. L’énorme rouf construit sur l’embarcation et son gréement démontraient l’inexpérience totale que son propriétaire avait des choses de la mer, et je ne fus pas surpris d’apprendre qu’il abandonna son projet quinze jours après son départ.
Cet été, d’ailleurs, n’a pas favorisé les audacieux yachtmen. Le ketch Shanghaï, qui s’était illustré par un voyage de Chine au Danemark, a fait naufrage sur les côtes de Nouvelle-Écosse, après avoir traversé l’océan Atlantique Nord avec son nouveau propriétaire américain et trois hommes d’équipage.
Hélas aussi, je suis sans nouvelles de mon ami William Nutting. Quatre ans auparavant, sur un yacht de vingt tonneaux, il avait traversé l’Atlantique de Nouvelle-Écosse à Cowes en vingt-deux jours, ce qui constituait un record pour une embarcation de ce tonnage. La même année, il avait effectué le plus difficile voyage de retour de l’est vers l’ouest en soixante-dix jours, malgré une violente tempête dans laquelle un des hommes du bord était tombé à la mer.
À mon arrivée à New York, il y a un an, Bill m’avait accueilli comme un frère, et nous étions devenus de grands amis. J’admirais sa bravoure, j’aimais sa nature franche et loyale et son enthousiasme pour les yachts successifs qu’il avait possédés.
Parti de Bergen en juin précédent avec trois amis sur un bateau-pilote norvégien, il avait projeté de suivre l’ancienne route des Vikings, celle de Leif Erickson, fils d’Éric le Rouge, qui le premier aurait abordé au Labrador et dont il avait donné le nom à son nouveau navire.
Depuis son départ de Reykjavik en Islande, le 9 août, on en est sans nouvelles, et malgré ma grande confiance en lui je suis fort inquiet. C’est pour moi un grand désappointement de partir de New York sans le revoir.
*
Après deux mois d’un travail incessant, le Firecrest est prêt et le départ proche. J’ai confiance, car il est maintenant en bonne condition. Le mât neuf est en pin d’Oregon, d’une longueur totale de quatorze mètres. Un nouveau beaupré, en pin d’Oregon lui aussi, remplace celui qui fut brisé dans un ouragan. Le gréement dormant en fil d’acier galvanisé peut supporter un effort de dix tonnes sans se rompre.
Les voiles sont neuves et cousues d’une manière spéciale. Un nouveau réservoir d’eau claire de deux cents litres conservera l’eau, mieux que les barils de chêne. La sous-barbe de beaupré et le rouleau pour le gui, qui s’étaient brisés pendant ma traversée, sont remplacés par une sous-barbe de bronze et un rouleau en fer galvanisé beaucoup plus solide. La nouvelle grand-voile triangulaire et le gui creux rendront la manœuvre beaucoup plus aisée.
Le Firecrest est prêt et le départ est proche. Depuis plus d’un an, je suis à terre. Toutes les difficultés ont été surmontées et je vais bientôt pouvoir repartir.
J’écris ces lignes dans la cabine du Firecrest. Le teck et le bois d’érable brillent. Deux cents nouveaux volumes sont sur des rayons. Quelques belles reliures donnent une note d’art. Ce sont : La vie des plus célèbres marins français, édition de 1750, qui me fut offerte par mes amis du Cercle des chemins de fer ; un récit de ma traversée, exemplaire unique sur Japon impérial illustré par Pierre Leconte, et offert par le Yacht Club de France. Il y a aussi tous mes vieux compagnons aux reliures abîmées par l’eau de mer, les Jack London, Loti, Conrad, Stevenson qui ont traversé avec moi l’Atlantique. Huit quarts minuit viennent de sonner à ma pendule marine de bronze poli. Bientôt, j’espère, elle les sonnera pour moi dans les mers du sud.
CHAPITRE 2
Le départ de New York.Une dure traversée.
De Saint-Georges (îles Bermudes).
Extrait du Journal de bord.
Sans avoir eu le temps d’essayer le nouveau gréement, car les voiles avaient été prêtes à la dernière heure, je quittai le chantier de construction et vins jeter l’ancre devant le Morris Yacht Club Pelhom Bay. Le samedi 1er novembre, je remplis tous mes réservoirs d’eau fraîche, puis vins m’amarrer le long de la jetée du Yacht Club pour embarquer toutes mes provisions arrivées seulement la veille. C’étaient des pommes de terre, du riz, du sucre, du savon, du lait condensé, du beurre, de la confiture, du jus de citron contre le scorbut, en tout environ deux mois de vivre, du pétrole pour mes lampes et réchauds.
De nombreux cadeaux avaient aussi été envoyés par des amis et tout cela, avec de nombreux objets commandés par moi à la dernière heure, s’amoncelait sur le pont qui fut vite encombré. Il y avait des couvertures, des carabines, des cartouches, des livres, un arc et des flèches pour la pêche en haute mer, deux kilomètres de film cinématographique en boîtes étanches, d’innombrables cartes et instructions nautiques. Je devais trouver une place en bas pour tout cela, tout en parlant aux nombreux amis venus pour me dire au revoir, et à de nombreux membres de l’Explorers Club et du Cruising Club d’Amérique. Malgré le secret que j’avais essayé de garder sur mon départ, il y avait aussi des photographes et des reporters.
Enfin, arrivait à deux heures de l’après-midi, Mrs Nutting, m’apportant des caisses de biscuit que le fournisseur n’avait pas livré à temps. J’apprenais que le destroyer américain Trenton était parti à la recherche de son mari. Mrs Nutting embarquait à bord du Firecrest avec W. P. Stephens, éditeur du Lloyds Yacht Register et fort connu dans les milieux nautiques anglais et américains.
Presque aussitôt, nous appareillions, car nous voulions profiter de la marée pour descendre East River. Je quittai l’embarcadère, remorqué par Bob Schultz et son yacht à moteur We Two, escorté par une vedette de la police américaine, et par le commodore du Morris Yacht Club dans son yacht à moteur. Le Yacht Club salua mon départ de trois coups de canon, je répondis en amenant le pavillon français. C’était un départ public, cérémonieux, auquel ne manquaient pas les cinémas. Quelle différence avec mes appareillages de Cannes et de Gibraltar, auxquels je songeais avec le mélancolique regret des choses qui ont été et ne peuvent plus être. Et cependant, j’étais tout à la joie du départ, heureux de laisser derrière moi les difficultés de l’existence à terre et de voguer vers les îles lointaines, où ne m’avait précédé aucune publicité. Et je passais bientôt devant Fort Totten, de l’autre côté de Long Island Sound, où j’avais débarqué après ma traversée de l’Atlantique. L’Aventure reprenait là où elle s’était arrêtée…
Extrait de mon livre de bord :
À quinze heures, nous quittons Long Island Sound, pour entrer dans East River, franchissant les dangereux remous d’Hell Gate, la porte de l’Enfer, nous passons sous le pont suspendu de Brooklyn et devant Manhattan et ses gratte-ciel, et ma dernière vision de New York me laisse une impression de ville monstrueuse et titanesque. Le jour tombe comme nous passons près de la statue de la Liberté, et devant Coucy Island, le bateau de police à bord duquel sont montés mes passagers, quitte le Firecrest. Je jette l’ancre à Sheepshead Bay et vais à terre acheter différents ustensiles de ménage qui me manquent. J’occupe une partie de la nuit et de la matinée suivante à arrimer soigneusement toutes mes provisions. À onze heures du matin, je quitte Sheepshead Bay, toujours remorqué par le We Two. Le baromètre a baissé terriblement pendant la nuit et la matinée. Je m’attends à du gros temps. La mer est dure et houleuse, le remorquage pénible. À midi, la remorque casse et le yacht à moteur me quitte fort vite en me saluant, car il désire rentrer avant l’arrivée du grain.
Je suis maintenant seul, absolument seul. Je hisse toute ma toile et fais route au sud-est. La mer est houleuse, la brise fraîche et le baromètre en baisse.
À cinq heures du soir, je suis au sud du bateau-phare Ambrose – Lightship – quand le garde-côtes de Sandy Hook vient près de moi et me signale l’approche du mauvais temps. Le coucher de soleil est d’un gris inquiétant et de gros nuages noirs s’accumulent vers l’occident. Le vent augmente, et à regret, car je sais que cela déformera ma voile neuve, je dois rouler sept tours, amener le foc et la trinquette et prendre la cape pour la nuit.
L’opération est longue, car le gréement est neuf et de nombreux détails ne sont pas au point. Cependant, je constate avec satisfaction que mon nouveau rouleau fonctionne bien. Le vent souffle en tempête, les vagues sont hautes, mais sous la grand-voile réduite le Firecrest tient une cape excellente, et fatigué par les nombreuses opérations de l’appareillage, je dors confortablement jusqu’au petit jour.
Lundi 3 octobre. – Le baromètre remonte légèrement lorsque je reprends ma route vers le sud-est, à six heures trente du matin. Vers treize heures, je hisse la trinquette et le tourmentin et, comme le vent augmente, j’amène la grand-voile et laisse le Firecrest se gouverner seul sous la voilure avant. Je trouve la nouvelle grand-voile triangulaire très facile à amener, mais constate que de nombreux détails ont besoin d’améliorations. Vers onze heures du soir, le vent souffle en tempête du nord-ouest, mais le Firecrest fait seul du chemin vers les Bermudes pendant que je repose.
Mardi 4 octobre. – Le baromètre baisse toujours. Vers huit heures du matin, la tempête augmente encore d’intensité. Les vagues brisent à bord et submergent constamment le pont qui, mal calfaté à New York, laisse pénétrer l’eau dans la cabine.
Il vente très fort, des goélands passent, emportés par la tempête, et essaient vainement de remonter le vent.
Je reste attaché à la barre jusqu’à seize heures, trempé par les embruns sur le pont balayé par les vagues, puis je laisse le Firecrest se gouvernant lui-même fuir devant le temps vers les Bermudes, sous sa voilure avant. Vers le soir, le temps devient meilleur pendant que le baromètre remonte. À midi, je suis à cent vingt milles de New York.
Mercredi 5 octobre. – Vers une heure du matin, je remarque que mon feu rouge de bâbord est éteint. Je descends le fanal dans le poste pour le rallumer, mais je ne me presse nullement, car je n’ai aperçu aucun navire depuis quarante-huit heures. Aussi j’achève tout d’abord les préparatifs d’un repas. Je viens de remplir et d’allumer le fanal lorsque le Firecrest est ébranlé par un choc violent. Je monte sur le pont et aperçois dans la nuit très noire les nombreuses lumières d’un vapeur qui s’éloigne. C’est mon beaupré qui a reçu le choc. La sous-barbe en bronze est tordue. Les bittes ou pièces de bois verticales tenant le beaupré ont été arrachées au ras du pont qui a été soulevé et présente une large brèche. Les étais de foc et de trinquette sont libérés de leurs points d’attache. Le mât n’étant plus maintenu sur l’avant oscille d’une manière inquiétante.
Il est complètement inutile d’essayer d’attirer l’attention du vapeur qui ne m’a probablement pas aperçu dans la nuit noire. D’ailleurs, je n’ai pas de temps à perdre si je veux sauver le mât. Au moyen de palans je roidis les étais et j’amarre le beaupré aussi solidement qu’il est possible sur le pont maintenant rasé à l’avant. Le mât a étalé le coup, maintenant les étais de foc et de trinquette sont raides. Il peut venter... tout est paré. Alors seulement je pense que je l’ai échappé belle.
Au jour, j’inspecte minutieusement les avaries et consolide les réparations provisoires de la nuit. J’obstrue avec du coton et de l’étoupe la brèche que présente le pont. À midi je constate que j’ai fait cinquante milles en vingt-quatre heures. Le vent souffle de l’est, ma route est sud-sud-est. Je hisse ma grand-voile avec deux tours. Je suis par 72° ouest de longitude et 38° 30 de latitude nord.
Jeudi 6 octobre. – La brise vient légère de l’ouest, je hisse toute la grand-voile, mais sur le beaupré mal tenu je ne peux hisser qu’un petit foc. De nombreuses sargasses flottent autour de mon navire.
Vers le soir, j’aperçois un cachalot qui disparaît vers l’ouest. J’amène la grand-voile et laisse le Firecrest se gouverner sous sa voilure avant.
Vendredi 7 octobre. – Mon navire se gouverne lui-même, le ciel est nuageux, à midi je constate que j’ai fait soixante-dix milles en vingt-quatre heures. Les sargasses sont très nombreuses, ce qui ne m’étonne pas, car l’hiver la mer des Sargasses se déplace vers l’ouest.
Samedi 8 octobre. – À sept heures du matin, j’aperçois un vapeur allant vers l’est. Le pont du Firecrest fait eau, je dois pomper constamment. De nombreux poissons s’envolent devant le Firecrest. Mes observations me montrent que le courant du Gulf Stream m’a déporté fortement vers l’est. Le baromètre continue à baisser et je profite de l’occasion pour hisser ma voile de cape que je n’ai pas encore essayée. Le coucher de soleil prend une teinte grise qui ne présage rien de bon. Le vent tourne au nord-est et des grains se succèdent toute la nuit.
Dimanche 9 octobre. – À deux heures du matin, le vent change brusquement. À six heures je suis réveillé par les appels d’une sirène. Je passe ma tête par le panneau et j’aperçois le vapeur Paget, de Portsmouth, qui se maintient sous vitesse réduite à la hauteur du Firecrest qu’il surplombe de son énorme masse. Le capitaine me croyait en détresse et me demande : “ Are you all right ? ”. Je le rassure en lui affirmant que tout va bien à bord et le vapeur reprend sa route vers le nord-est dont il s’était écarté pour s’approcher de moi. Le ciel se couvre de mauvais nuages. La mer est dure, le vent augmente. L’orage arrive du nord-est avec de nombreuses rafales et de la pluie. Les dorades, qui aiment le gros temps, sautent autour du Firecrest qui fait route plein sud.
Les vagues ne sont pas excessivement hautes, mais la mer est très dure, car les vagues viennent de deux directions différentes et déferlent constamment à bord. Le pont prend toujours l’eau, mes livres, mes vêtements et mes couvertures sont inondés.
Vers midi, le vent et la mer augmentent. Je suis mouillé et fatigué, mais je reste à la barre jusqu’à la nuit. Il fait froid, pourtant les vagues du Gulf Stream sont chaudes. La pluie devient torrentielle. Je hisse la voile de cape avec deux ris. Le Firecrest se gouverne ensuite lui-même. Je constate qu’un poisson a mis complètement mon loch hors d’usage d’un coup de dent.
Lundi 10 octobre. – Le vent vire sud-sud-est. Ne voulant pas louvoyer contre un fort vent debout et une mer dure, je mets à la cape. Je dois pomper constamment, l’humidité est partout et je n’ai plus rien de sec à me mettre. Vers treize heures le ciel s’éclaircit et le vent tombe presque subitement, mais je suis inquiet, car le baromètre continue à baisser et je sais que la tempête reprendra plus forte. Je profite du calme pour faire sécher quelques couvertures. Vers huit heures du soir le vent revient de l’est-sud-est et à dix heures souffle en rafales. Je dois de nouveau rouler ma grande voile, l’étrave plonge constamment dans les vagues et l’eau entre toujours par les avaries du pont, m’empêchant même de cuire. Le baromètre baisse encore.
Mardi 11 octobre. – Vers midi, un coup de vent de l’est-sud-est, qui vire bientôt à l’est. J’ai cinq tours dans ma grand-voile et deux ris dans la trinquette. De fortes vagues déferlent à bord, l’eau rentre par les avaries de l’avant. À huit heures du matin les vagues dépassent dix mètres de hauteur. Vers midi le beaupré malgré tous mes amarrages ne tient presque plus, et je décide de mettre à la cape, mais les vagues viennent de deux directions différentes et le Firecrest fatigue beaucoup. Je suis moi-même fatigué, transi et j’ai faim, mais la mer est trop forte pour que je puisse faire cuire quelque chose. J’essaie bien de cuire du porridge sur le réchaud à cadran, mais une vague plus forte envoie le porridge se coller au plafond et aux parois du poste. Je continue à me nourrir presque uniquement de biscuits. L’eau embarque toujours et je dois pomper constamment. Le foc de tempête se déchire, ainsi que la bastaque de tribord, pourtant toute neuve et en fil d’acier de presque un centimètre de diamètre.
Mercredi 12 octobre. – Dans mon demi-sommeil, je pense à ces défectuosités du gréement et du travail fait à New York et à tout ce qu’il faudra réparer aux îles Bermudes, avant de pouvoir continuer ma croisière. Au-dessus de ma couchette est une boussole à carte renversée et, lorsque mon navire se gouverne lui-même et que je me repose, je n’ai qu’à ouvrir les yeux pour savoir la route qu’il suit. L’eau de mer pénètre par le pont et remplit la partie supérieure de la boussole qui, lorsqu’elle est pleine, se retourne et je suis réveillé en sursaut par l’eau qui m’arrive sur la figure.
Vers quatre heures du matin, la tempête se modère. Je trouve un moyen de consolider le beaupré, je hisse la trinquette, abandonne la cape et fais route vers le sud-est.
Vers le soir je remarque que l’étai de foc s’use beaucoup et je me dispose à le réparer lorsqu’un coup de vent arrive si furieux et si sec que l’étai de foc et la bastaque bâbord cèdent en même temps. Je suis en danger de perdre mon mât de flèche, car l’étai de trinquette a pris du mou. Je rentre toutes les voiles et avec de nouveaux palans improvise un étai de fortune. J’ai à peine terminé que l’obscurité arrive avec une pluie torrentielle. Le mât de flèche plie sous l’effort et à sec de toile, le bateau roule terriblement.
Enfin, heureusement la lune se lève et vient m’apporter l’aide de sa clarté. Je peux alors raidir l’étai de trinquette puis l’étai de foc. Je hisse de nouveau la grand-voile et mets à la cape sous voilure réduite. Je dors ensuite malgré mes couvertures trempées, épuisé que je suis par l’effort.
Jeudi 13 octobre. – Le vent souffle furieux un peu plus à l’est, je gouverne dans l’eau toute la journée et dois m’attacher à la barre tant la mer est démontée. De nombreux arcs-en-ciel apparaissent, mais le ciel entre les nuages est d’un bleu trop pâle et je sais que ce n’est pas encore la fin du mauvais temps. La mer grossit toujours et le baromètre baisse. Je suis très fatigué, mais je dois pomper pendant une partie de la nuit.
Vendredi 14 octobre. – Le vent est moins fort, mais la mer toujours grosse, mes observations me placent à cent vingt milles des Bermudes. Le ciel est occupé par un immense arc-en-ciel dont le Firecrest est le centre. Le baromètre est en baisse, mais le ciel s’éclaircit vers le sud où je pressens le beau temps. Vers le soir, le vent tombe et le baromètre remonte légèrement.
Samedi 15 octobre. – Je hisse mon premier foc et toute la voilure, c’est la première journée de beau temps depuis mon départ. À quinze heures, je croise le paquebot Saint-Georges allant des Bermudes à New York, qui me salue avec le pavillon britannique. Je constate avec satisfaction que je suis sur la bonne route. Vers le soir le vent devient debout et très léger. La nuit est très claire et des observations lunaires me placent à cinquante milles des îles Bermudes.
Dimanche 16 octobre. – Tout le jour, je louvoie contre un fort vent debout et je multiplie les observations, car les îles Bermudes sont entourées de récifs de corail qui s’étendent à plus de quinze milles de la côte nord, et sur lesquels maints navires sont venus s’échouer. Vers quinze heures, je découvre la terre devant moi à tribord puis, à la nuit, le phare de Saint-David. Je continue à louvoyer vers la terre une partie de la nuit, puis je mets à la cape car le vent souffle fort et je suis fatigué.
Le lendemain, au petit jour, je n’aperçois plus la terre et mes observations me montrent que j’ai été déporté à trente milles au sud-est. Je tire des bords toute la journée contre une mer très dure. J’embarque toujours beaucoup d’eau et je dois pomper constamment. Vers quatre heures, j’aperçois de nouveau la terre après avoir barré toute la nuit ; je passe au petit jour près d’un destroyer américain et entre dans le port Saint-Georges.
Le docteur Shelley, un descendant du poète, vint à bord et me donne pratique. Il m’apprend que tous les navires se plaignent du mauvais temps et qu’une goélette de deux cents tonneaux a mis quinze jours pour venir de la côte américaine et a subi de fortes avaries.
CHAPITRE 3
Escale aux Bermudes.Réparation duFirecrest.
Àneuf heures du matin, après une dure traversée de seize jours, j’étais à l’ancre dans le port Saint-Georges. À dix heures j’avais déjà trouvé un calfat, un charpentier et un forgeron, et les réparations commençaient. J’obtenais l’autorisation de m’installer le long d’une petite île qui appartenait au gouvernement et sur laquelle j’avais seul le droit de prendre pied. À mon grand plaisir, je constatais que les ouvriers noirs des îles Bermudes travaillaient plus lentement, mais aussi plus soigneusement que ceux d’Amérique. Après quinze jours de travail, le pont était étanche, et les avaries, occasionnées par mon abordage avec un vapeur, réparées.
Mes voiles s’étaient déformées dans les tempêtes d’une manière curieuse. Cependant, à New York, j’avais eu soin de faire couper ma grand-voile près d’un pied trop court dans chaque dimension et maintenant elle était devenue cinquante centimètres trop longue le long du gui et près de soixante-quinze centimètres le long du mât. Je n’en étais pas surpris, car une voile neuve doit être soumise progressivement aux efforts du vent avant de prendre sa forme définitive et, dès ma première sortie, j’avais essuyé de forts coups de vent.
Je fus obligé de les faire recouper complètement. Exposées à la pluie et aux vagues pendant quinze jours, sans avoir le temps de sécher, elles commençaient déjà à être piquées. Je les enduisis d’huile de lin ocrée qui, en les rendant imperméables, les préservait de l’humidité des tropiques et leur communiqua une teinte rouge foncée.
Les Bermudes
La coque du Firecrest prenait un peu l’eau et je décidai de mettre le Firecrest à terre. Très sportivement les frères Darrel, qui avaient pris part par deux fois à la course New York – îles Bermudes à bord de leur yawl Dainty, m’offrirent leur cale de halage pour le mettre au sec.
Je quittai donc le port Saint-Georges pour me rendre à Hamilton, capitale des îles, sur l’île longue, à l’autre extrémité du groupe. Ce fut une navigation fort intéressante, dans les étroits passages entre les dangereux récifs de corail, si redoutés autrefois des navigateurs qu’ils avaient valu aux îles le surnom d’îles du Diable. Quant au véritable nom des îles, son origine n’est pas connue. Oviedo, qui écrivit l’histoire des Indes occidentales, prétend bien que les îles auraient été découvertes par un capitaine espagnol nommé Juan Bermudez, en 1515, mais le nom de Bermuda apparaît déjà sur la carte de la Legatio Babylonica de Pierre Martyr, publiée en 1511.
Vers quatre heures du soir, je jetai l’ancre dans le port Hamilton, au centre d’îles couvertes d’une végétation luxuriante et qui portaient les noms des premiers colons anglais venus de Plymouth au commencement du XVIIe siècle.
Non loin était la grande goélette américaine Zodiac, appartenant à M. Johnson, du New York Yacht Club, qui vint m’inviter à prendre le thé à son bord.
Hamilton était beaucoup plus animé que Saint-Georges. Chaque semaine, des paquebots arrivaient de New York et débarquaient des touristes américains qui venaient se reposer de leurs affaires, à l’abri des lois de la prohibition. La circulation était grande sur les quais constamment envahis de marchandises.
Il y avait souvent, le long des quais, de belles et fines goélettes portant en général le pavillon britannique et qui se livraient à la contrebande de l’alcool. Toutes avaient de belles lignes et étaient taillées pour la course ; elles étaient maniées par d’excellents équipages souvent américains et j’aimais à observer tous les détails de leurs gréements. Peut-être la plus belle était l’Ethel B. Smith, mais il y avait aussi la Marie-Céleste, de Saint-Pierre-et-Miquelon, battant pavillon français et dont la superstructure portait de nombreuses traces de balles, témoins d’une rencontre avec les garde-côtes de la police de prohibition.
Je passai plusieurs semaines agréables à Port Hamilton ; je fus nommé membre d’honneur du Royal Bermuda Yacht Club, où je reçus un excellent accueil. J’assistai aussi à plusieurs courses de chevaux et je pus me remettre à la pratique du tennis sur d’excellents courts en ciment.
Ce fut aussi pendant mon séjour que me fut remise, à bord d’un paquebot anglais, la Blue Water Medal pour 1923, décernée chaque année par le Cruising Club d’Amérique au meilleur exploit maritime amateur.
Une des curieuses et agréables caractéristiques de ces îles fortunées était l’absence d’automobiles, interdites en raison de leur faible superficie et de la rareté des routes. En revanche, le nombre des bicyclettes était extraordinaire.
Je mis le Firecrest à terre à Inverurie et découvris que sa coque prenait l’eau en deux endroits ; après réparation, je retournai, le 2 janvier, vers le port Saint-Georges.
Là je retrouvai le même accueil sympathique de ses habitants, et en particulier des officiers de l’artillerie royale qui y étaient en garnison.
À Saint-Georges, un hôtel possédait une magnifique piscine, où je vis plusieurs fêtes nautiques. Il y avait de bons nageurs et nageuses et deux excellentes équipes de water-polo. J’eus aussi le plaisir d’y admirer miss Gertrude Ederle, Aileen Riggin et Helen Wainwright, qui vinrent faire une démonstration de plongeons et de nages modernes. Au cours de cette fête, je fus présenté au gouverneur des îles, le général sir Enman, qui me parla longuement du Havre où il avait résidé pendant la guerre.
Mais le Firecrest faisait toujours un peu d’eau, et je décidai de le remettre une nouvelle fois à terre et de terminer par où j’aurais dû commencer en enlevant complètement le doublage en cuivre et en refaisant le calfatage de la coque. Ce fut, cette fois, à l’île Saint-David que je mis le Firecrest à terre. C’était, à mon avis, l’île la plus belle du groupe, peut-être aussi parce qu’elle était la moins fréquentée des touristes. Enlever le doublage de cuivre fut une longue opération et nécessita le travail de six ouvriers, car il fallait enlever séparément chaque pointe pour ne pas abîmer le métal.
Lorsque le cuivre fut ôté, la coque fut complètement recalfatée à neuf, mais il était décourageant de penser que j’avais déjà payé pour ce travail qui avait été fait à New York pendant mon séjour en France. Pour le prix total que me coûtait la réfection du Firecrest, j’aurais certes pu me faire construire en France un navire neuf.
Cependant, après trois mois d’escale, j’avais la satisfaction de pouvoir lever l’ancre. Cette fois je savais que mon vieux Firecrest était fort et en excellent état, car j’avais dirigé moi-même tous les travaux.
La population de Saint-David m’intéressait fort par ses mœurs simples et naïves et parlait un curieux patois anglais plein d’expressions maritimes. Mon escale fut cependant attristée par un pénible incident. Un jeune indigène, que j’employais à bord pour me faire la cuisine pendant les travaux de réparation, fut grièvement brûlé en allumant un réchaud à pétrole. Décidément il était préférable d’être toujours seul et d’assumer moi-même tous les risques et toutes les responsabilités.
Enfin je pus appareiller le 27 février, suivi de plusieurs amis qui, dans un canot à moteur, prenaient des photographies de mon départ. En raison de mon retard, j’avais décidé de ne pas faire escale aux Antilles et de chercher à rallier directement l’isthme de Panama. La brise augmentait progressivement pendant que le baromètre baissait, et le 3 mars, tandis que je faisais route sous voilure de cape, un furieux coup de vent coucha le Firecrest complètement sur le côté. La pluie était torrentielle et la mer très dure. Vers le soir, la tempête présentait des caractères cycloniques et je pris la cape, les amures à tribord, pour m’éloigner du centre de la dépression. Malheureusement, mon baromètre ne pouvait me donner aucune indication. Aux Bermudes j’avais oublié de l’enlever de la paroi du salon où il était fixé pendant que l’on recalfatait le pont, et les chocs l’avaient rendu impropre à tout service.
Le 5 mars trouva le Firecrest faisant route au sud sous la voile de cape, le foc et la trinquette, par une forte mer. J’avais, en effet, décidé d’atterrir sur le passage des cinq mille Vierges entre les îles Saint-Thomas et Sainte-Croix et d’éviter les Antilles plus à l’ouest, où j’aurais trouvé un courant contraire, mais, le soir, le coucher de soleil était inquiétant et, vers vingt-deux heures, j’étais obligé de prendre de nouveau la cape. Une pluie torrentielle, des éclairs et des rafales se succédaient toute la nuit. Le lendemain, le ciel s’éclaircissait et je pouvais réparer les dégâts causés par la tempête, mais, le 7 mars au soir, un coup de vent venait du nord-ouest et, le lendemain dimanche, la mer était démontée, la force du vent atteignait 9 Beaufort et je faisais route avec cinq tours roulés de ma grand-voile ; le 9, j’étais encore obligé de prendre la cape et, en vérité, le Firecrest se conduisait si bien que je vins à me demander si je n’étais pas trop prudent. Mais un essai que je fis de reprendre ma route sous tourmentin et voile de cape au plus bas riz me démontra l’effort énorme imposé au gréement et à la coque. Sous cette voilure réduite, le Firecrest atteignait huit nœuds qui était sa vitesse limite.
C’était cependant la fin du mauvais temps et, le 12 mars, par 20° de latitude nord, je rencontrai les vents alizés, je pouvais compter dorénavant sur une plus faible et agréable navigation dans les mers tropicales.
Le vendredi 13 mars, j’aurais dû apercevoir dans la soirée le feu de Sombrero, sur lequel je voulais atterrir et situé sur un roc au milieu du passage des cinq mille Vierges, mais la visibilité était mauvaise et je ne pus rien apercevoir. Je suivis une route en zigzag qui devait me faire éviter tous les dangers. Le surlendemain, une observation solaire et un alignement de l’île Sainte-Croix, qui était en vue dans la matinée, me montrait que mes chronomètres avaient pris une minute de retard sur leur tableau de marche, ce qui m’avait fait passer à quinze milles plus loin que je ne pensais du feu de Sombrero.
Le lendemain, j’apercevais le feu de Toro Point et la pointe sud de Porto Rico. Je mis alors le cap au sud-ouest, sur l’isthme de Panama, et dans la mer des Antilles je faisais une bonne moyenne de marche poussé par les alizés qui soufflaient frais et réguliers du nord-est. C’était une navigation exempte d’incidents et j’avais de nombreux loisirs pour la lecture. J’aimais à relire la vie des flibustiers, les exploits des extraordinaires capitaines et des bons marins qu’étaient Graaf, Grammont et de Lussan, maîtres de ces parages au XVIIe et au XVIIIe siècle, avant que l’entente franco-anglaise mît fin à cette guerre de pillage et de course. Mais, ce que j’aimais par-dessus tout, c’était à me représenter ces îles lorsqu’elles étaient peuplées de ces Caraïbes simples et généreux, qui avaient accueilli à bras ouverts Colón et ses compagnons pour être exterminés ensuite jusqu’au dernier par l’implacable race blanche.
Le 1er avril au soir, la terre était en vue ; à vingt heures j’apercevais le feu de Toro Point et, à une heure du matin, je pénétrais dans le port de Colón. Entre les deux jetées, j’étais ébloui par les nombreuses lumières et j’évitais de justesse un vapeur qui sortait. Derrière la jetée je mouillais mes ancres, ayant couvert, en trente-trois jours, les dix-huit cents milles qui me séparaient des îles Bermudes.
CHAPITRE 4
À Panama.
Yacht Firecrest, île de Taboga, baie de Panama, 3 juin 1925.
C