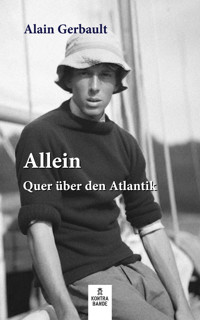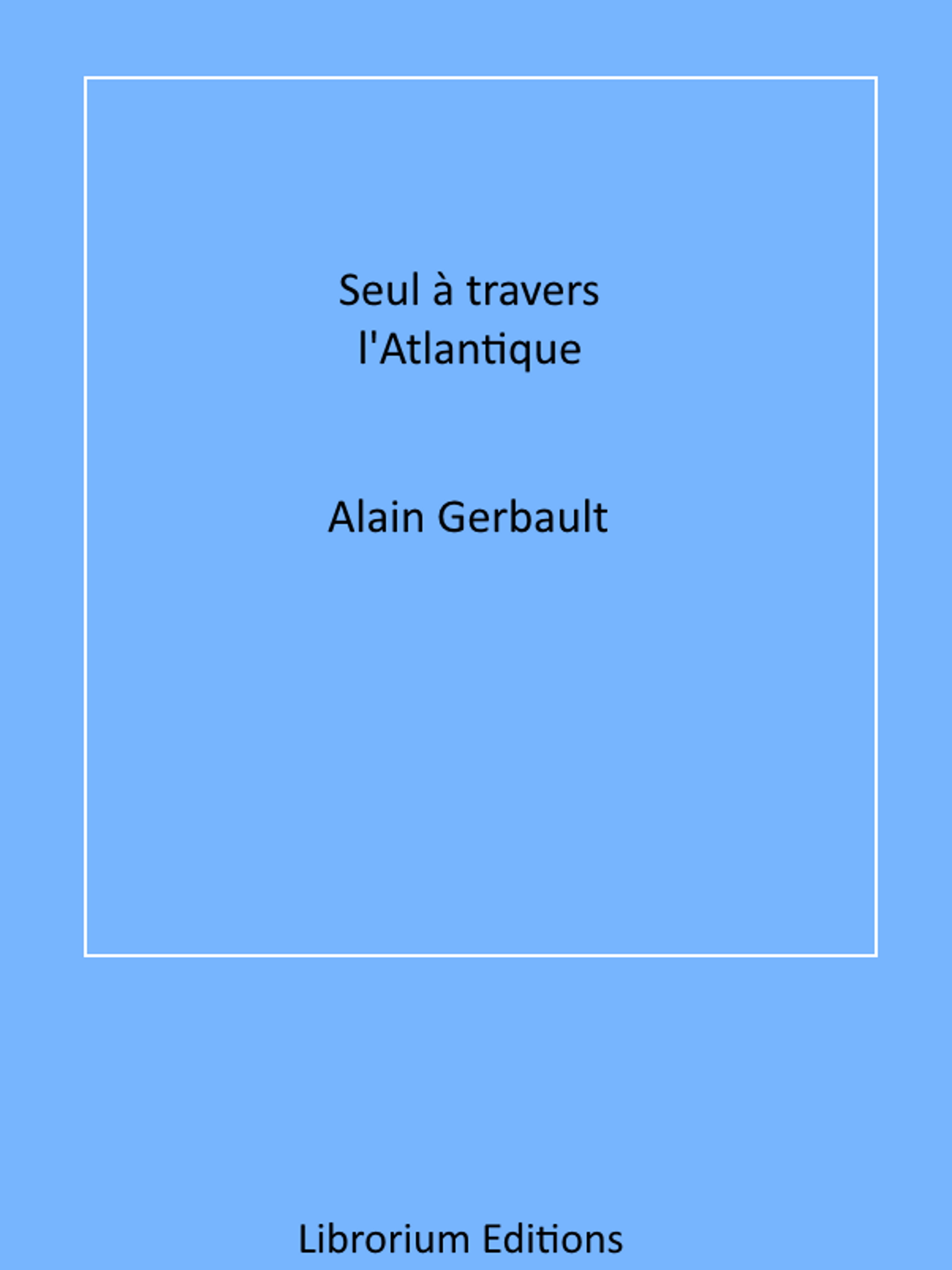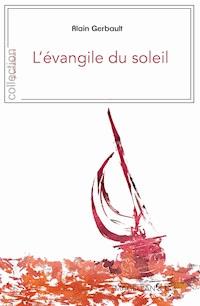
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Magellan & Cie Éditions
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
Les mémoires d'un précurseur...
Je ne recherche ni les dignités ni les honneurs, et, désirant n’être qu’un marin et rien de plus, j’ai pour seule ambition celle de mériter le surnom de Kim, ami de tout le monde.
Cet ouvrage retrace la vie exceptionnelle d'Alain Gerbault et met en lumière son combat pour la défense de la civilisation polynésienne !
EXTRAIT
Je suis de nouveau dans une tempête circulaire. Le Firecrest est à la cape en plein océan, et sous la trinquette seule il gîte et son pont entre dans l’eau jusqu’aux claires-voies. Cramponné au mât et inondé d’embruns, je suis heureux, je ris et je chante. Les Bermudes sont à six cent milles au nord, j’approche de la ligne tropicale où m’attend le beau temps. Je souris, tout en contemplant les abîmes profonds, les efforts vains des éléments déchaînés. Aujourd’hui je suis le plus fort. Le serai-je demain ? Mais, après tout, qu’importe ! La pensée constante de la mort ne fait-elle pas partie intégrante de la vie de l’aviateur et du marin ? Je fus l’un et maintenant je suis l’autre, et je ne veux rien de plus.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Ce livre exceptionnel sonne un peu comme le testament de la fabuleuse existence d’Alain Gerbault. Né en 1893 à Laval et mort le 16 décembre 1941 à Dili (Timor), ce navigateur français est un précurseur. Pilote pendant la Première Guerre mondiale, joueur de tennis de classe internationale, il est le premier à traverser l’Atlantique en solitaire d’Est en Ouest, et le premier Français à achever un tour du monde en solitaire à la voile. Volontairement retiré des agitations du monde, ce grand écrivain signe avec L’Évangile du soleil, paru en 1932, une défense vigoureuse des us et coutumes des Polynésiens, soumis aux prémices de la mondialisation.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 159
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
À MARAO TA’AORA A TATIen souvenir de nos entretiens de Tahiti, avec toutes mespensées d’affection et d’amour pour tout ce qui est tahitien.
Introduction
L’étude et la construction de mon nouveau voilier de haute mer ont différé la publication de ces impressions de voyage, qui n’avaient pas leur place dans mon journal de bord, et que j’avais espéré faire paraître dès mon retour en France.
Bien des amis m’ont déconseillé la publication de certains chapitres, mais le fait que je n’ai rien à y gagner n’est pas pour me retenir. Il existe, en effet, différentes manières de voyager et peu de voyageurs connaissent la vie intérieure d’un pays, mais lorsqu’on a vécu comme moi parmi les indigènes, qu’on a profité de leur générosité et de leur hospitalité, et qu’on est devenu leur ami, on a en retour, envers eux, certains devoirs auxquels je ne saurais sans lâcheté me soustraire.
Ce livre est nécessaire, car je suis obligé de me servir de ma seule réelle influence pour attirer l’attention du public et du gouvernement, pas toujours très bien renseignés sur ce qui se passe dans nos possessions lointaines.
Je ne voudrais pas qu’on y vît une attaque systématique contre la civilisation, la colonisation et la christianisation, qu’il ne faut pas confondre avec l’européanisation dangereuse et néfaste pour les Polynésiens.
Ce ne sont ni les opinions d’un philosophe, ni celles d’un rêveur, mais d’un voyageur qui a vécu et étudié sur place tous ces problèmes. Il me plaît que lorsque ces notes paraîtront, je sois de nouveau reparti seul au péril de la mer, car j’espère qu’on comprendra que je ne recherche ni les dignités ni les honneurs, et que, désirant n’être qu’un marin et rien de plus, j’ai pour seule ambition celle de mériter le surnom de Kim, ami de tout le monde.
.1.Aux Bermudes
Port Saint-Georges, îles Bermudes,décembre 1924
Au port Saint-Georges des Bermudes, j’ai mouillé mes deux ancres après une rude et pénible traversée. Saint-Georges, l’ancienne capitale des îles, est une vieille ville pittoresque aux quais déserts. Elle est aussi calme que New York peut être agité, et ce contraste est pour moi d’une nouveauté charmante. Découvrir à chaque escale des îles toujours différentes par leurs aspects et leurs coutumes, c’est en vérité un des grands charmes de la navigation au long cours.
Les murs et les toits des maisons sont blanchis à la chaux. C’est le milieu du jour et tout semble dormir. Seuls, sur la place, en face de l’îlot, le long duquel s’est amarré le Firecrest, des enfants s’amusent, et de temps en temps leurs sonores éclats de rire viennent troubler le silence, car les enfants des hommes de couleur rient plus bruyamment que les enfants des Blancs, plusieurs siècles de civilisation ne leur ayant pas appris à dissimuler leurs sentiments sous la contrainte du sourire.
Le Firecrest eut besoin de minutieuses réparations. Sa coque, qui avait beaucoup souffert lors des six mois passés à terre, à New York, avait été aussitôt éprouvée par la dure et pénible traversée du Gulf Stream. En ce mois de novembre 1924, il y eut beaucoup de gros temps et de nombreux navires firent relâche aux îles Bermudes pour y réparer les avaries causées par la tempête.
Toutes ces confirmations venant d’autres bâtiments me rassurèrent et me donnèrent confiance en la solidité du Firecrest, car elles me prouvèrent que j’avais réellement rencontré du gros temps. Souvent à terre en effet, en relisant mon journal de bord, je m’étais dit que je m’étais peut-être laissé impressionner et qu’il n’avait pas fait aussi mauvais que j’avais cru.
Et maintenant que je remanie mes notes de voyage pour les publier en livre, je peux les compléter grâce à mes années d’expérience sur les mers autour du monde. Sur le petit bateau, il est presque impossible, sauf en grimpant dans la mâture, d’apprécier la hauteur des vagues1. Tout paraît énorme et démesuré et, dans les cyclones, la mer n’est qu’une surface qui écume et bouillonne de toutes parts. Mais il est cependant une chose qui laisse sur la mémoire une impression inoubliable, c’est la fureur du vent lorsqu’il atteint la force de l’ouragan. C’est un hurlement sinistre qui donne une note invraisemblablement aiguë à travers les câbles d’acier du gréement. On croirait entendre tous les démons de l’enfer déchaînés. Souvent je dus ramper sur le pont à plat ventre pour ne pas être enlevé par le vent, et une fois même, sa violence était telle que j’eus mes vêtements mis en pièces. On ne peut non plus oublier la pluie de l’ouragan, qui arrive horizontalement avec une violence inouïe, vous coupe la peau et vous brûle les yeux.
Pendant ma traversée de New York aux Bermudes, la vitesse du vent n’avait jamais dépassé soixante ou soixante-dix milles à l’heure, mais la mer était fort dure. La direction générale des vagues était de l’arrière, du nord au sud, mais il courait aussi une mer qui venait par le travers, déferlant constamment à bord et m’occasionnant de sérieuses avaries.
Un jour entra dans le port, tirée par un puissant remorqueur, une grande goélette américaine à quatre mâts. Elle présentait un aspect étrange, car son pont était presque submergé. On l’échoua sur la grève et je vis alors que son étrave était complètement sectionnée.
J’appris qu’elle avait été abordée de nuit par un vapeur et que l’équipage, la jugeant perdue, l’avait abandonnée, mais elle n’était chargée que de bois. Délestée, en s’enfonçant, des madriers qu’elle transportait sur le pont, elle avait été maintenue à flot par sa cargaison intérieure. Elle errait, épave flottante, présentant les plus grands dangers pour la navigation, lorsqu’elle fut rencontrée par un navire de guerre et signalée par T.S.F. Une grande compagnie de remorquage avait dépêché un de ses puissants vapeurs pour s’emparer du voilier abandonné.
C’était pour moi, qui venais d’échapper de peu à une collision, un nouvel avertissement du plus grand danger de ma navigation solitaire, auquel un équipage complet et faisant bonne garde n’avait pu se soustraire.
Les deux grandes compagnies de remorquage des îles Bermudes avaient toujours fort à faire par suite du mauvais temps fréquent de ces parages, et la longue grève près du port n’était qu’un vaste cimetière de coques abandonnées, jugées indignes d’être renflouées.
En faisant voile de Saint-Georges à Hamilton, la capitale des îles, située à l’autre extrémité de l’archipel, je passai près d’une ancienne frégate à trois ponts transformée en dépôt flottant de charbon et qui portait le nom de Shah.
J’en connaissais déjà l’histoire. Il était, m’avait-on dit, le seul navire de guerre britannique qui eût jamais fui devant l’ennemi. Ce n’était que son premier engagement, mais il fut ainsi désarmé, jugé indigne de combattre, et ses officiers et son équipage traduits en conseil de guerre.
Tirant un bord pour passer près de son arrière, je pus remarquer l’excellent bois de teck dont il était construit et, sur le château de poupe, des sculptures représentant des dragons et des banderoles aux devises effacées par le temps. De cette vieille coque émanaient la tristesse et la mélancolie. Il semblait que le navire fût conscient lui-même du châtiment et de la déchéance auxquels l’avait condamné la justice des hommes.
L’ÎLE SAINT-DAVIDS
Saint-Davids,février 1925
C’est l’île de l’est des Bermudes. Son rivage très irrégulier, bordé de plages blanches, forme de nombreuses baies. Dans l’une d’elles, qui est presque un bassin circulaire, le Firecrest lévite sur ses ancres au gré des vents. Les collines boisées à l’entour sont couvertes de ce cèdre bermudien, au feuillage vert sombre, si propre à la construction des navires. L’eau est claire et transparente et permet d’apercevoir, sur les bancs de corail du côté du large, les nombreux poissons aux vives couleurs.
Saint-Davids n’est relié que par mer aux autres îles du groupe, qui communiquent entre elles par de longues chaussées, coupées de ponts tournants pour le passage des embarcations. Aussi est-elle heureusement peu fréquentée par les touristes qui font le tour des îles dans des voitures à chevaux, car les automobiles sont interdites.
Sa population est curieuse. Elle descend des colons anglais amenés par Richard Moore en 1612, et de matelots britanniques qui se sont mélangés à des esclaves noirs. C’est pourquoi il n’est pas rare de voir dans la même famille des enfants complètement blancs ayant pour frères des enfants presque noirs.
Vivant un peu isolés du reste du groupe, les habitants sont individualistes et sauvages, et c’est ce qui fait pour moi le charme de cette île. Plusieurs d’entre eux n’ont jamais quitté leur île et ne connaissent même pas Hamilton, la capitale du groupe. Leur chauvinisme local est grand et, lorsqu’on leur demande s’ils sont Bermudiens, ils répondent fièrement: « Nous appartenons à Saint-Davids. » Ils vivent presque tous pieds nus et ne possèdent pas de souliers avant leur mariage. Dans une île aussi petite, ils sont naturellement presque tous parents les uns des autres et, étant pauvres, vivent dans un bon accord perpétuel. Leur langage est fort pittoresque : c’est l’anglais que parlaient jadis les matelots britanniques. Il est plein d’expressions maritimes, et le mot « critter », créature, revient fréquemment pour désigner tout et n’importe quoi.
Je me souviens qu’un jour, à ma grande surprise, un ouvrier calfat noir, qui travaillait sur le Firecrest, m’entretint longuement de Jules Verne, qu’il considérait comme le plus grand écrivain du monde.
Délicieuse île naïve et originale, je me vois encore occupé à des travaux de matelotage sur le pont, pendant que, près de moi, mes petits amis Peck et Cutty, les enfants qui m’apportaient les fleurs que j’aimais, jouaient à se mordre les pieds, jeu charmant et sauvage.
Hélas ! on parle de relier par une chaussée Saint-Davids aux autres îles. Alors Saint-Davids ne sera plus isolé. Les touristes débarqués des paquebots viendront en voiture de Hamilton, la capitale des îles. On y construira un hôtel et un golf.
Et avec les touristes viendra l’argent. Et avec l’argent viendra le Mal…
Et ce jour-là, Saint-Davids ne sera plus Mon île Saint-Davids.
CECIL
C’était un pauvre gosse, qui ne possédait guère que son prénom, « Cecil ». Son autre nom ne lui appartenait même pas, car il était un enfant naturel.
Son père, un homme blanc et riche, avait toujours voulu ignorer son existence ; sa mère, une femme de couleur, l’avait vite abandonné.
Il n’avait jamais eu beaucoup de chance dans la vie. Pendant longtemps la coque renversée d’un vieux bateau de pêche lui avait servi d’habitation. Il avait été aussi en prison pour avoir volé parce qu’il avait faim, et aussi parce qu’il voulait aller au cinéma.
Maintenant, il avait compris qu’il était préférable d’être honnête et de respecter les lois établies par les hommes. Il s’était pris de passion pour la pêche et sortait en mer avec un vieux pêcheur, mais souvent son patron était ivre et ne travaillait pas : alors le pauvre gosse avait faim.
Il était venu un jour, dans un petit canot, le long du Firecrest. Pieds nus, coiffé d’un chapeau pointu de feutre mou, habillé d’un pantalon à bretelles trop long pour lui, il était le vivant portrait de l’Huckleberry Finn de Mark Twain.
Il m’avait tout de suite été sympathique, car il s’était pris, pour mon bateau, d’une vive admiration. Comme je le savais très pauvre, bien que je n’eusse réellement pas besoin de lui, j’avais toujours pour lui quelque travail à bord.
Et, pour la première fois dans sa vie, le pauvre gosse était vraiment heureux et faisait retentir le voilier des éclats de sa joie bruyante pendant que j’accomplissais mon travail de matelot, content de créer autour de moi un peu de bonheur.
L’accident survint brutal et inattendu, pendant que l’on calfatait la coque du Firecrest, tiré à terre. Une distraction, en approchant un bidon d’alcool d’un
réchaud à pétrole qu’il voulait allumer, amena une explosion. L’enfant sortit du panneau du poste en criant et environné de flammes. J’arrivai vite sur le pont et éteindre la torche vivante avec de vieilles toiles ne me prit qu’un instant, mais, peut-être parce qu’il avait pensé à sauver mon bateau avant de se sauver lui-même, le pauvre gosse était grièvement brûlé.
J’allais le voir à l’hôpital le lendemain matin. Il n’avait pas voulu recevoir sa mère, mais il fut heureux de me voir car j’étais peut-être son seul ami. Je restai longtemps près de lui, pendant qu’il me tenait la main en me regardant tristement.
J’avais formé le projet de lui acheter une petite barque de pêche qui lui aurait permis de vivre libre et indépendant, mais, hélas ! le pauvre gosse mourut le surlendemain.
Et celui qui n’avait rien dans la vie eut de belles funérailles que j’escortai tristement parmi les hommes noirs qui étaient sa famille.
Une petite fille de douze ans qui, déjà, était son amie, suivait, insouciante et curieuse, bondissant parmi les rocs pour raccourcir le sentier qui montait le long de la colline au bord de la mer.
Et les gens haut placés du village furent surpris d’une tristesse qu’ils ne pouvaient comprendre ; mais qui sait si le pauvre petit vagabond n’est pas, aux yeux du Christ, plus grand et plus noble qu’eux ?
Et je suis comme un navire désemparé car, n’ayant pas la foi, dédaignant l’espérance et ne croyant qu’en la charité, je ne pouvais éprouver de plus grande désillusion que de produire le mal en voulant faire le bien. Et aussi mon navire que j’aimais tant, souillé par ce drame atroce, m’apparaît maintenant comme un être néfaste et cruel.
Et c’est pourquoi j’ai hâte de reprendre la mer et je voudrais qu’il vente car seule la lutte incessante contre les tempêtes peut rendre moins pénible le souvenir de la vie infortunée et de la fin tragique de Cecil, le pauvre gosse qui mourut parce que j’avais voulu le faire vivre heureux et repose maintenant dans une tombe aux flancs d’une colline au bord de la mer.
AU PÉRIL DE LA MER
Des îles Bermudes à Panama,mars 1925
Je suis de nouveau dans une tempête circulaire. Le Firecrest est à la cape en plein océan, et sous la trinquette seule il gîte et son pont entre dans l’eau jusqu’aux claires-voies. Cramponné au mât et inondé d’embruns, je suis heureux, je ris et je chante. Les Bermudes sont à six cent milles au nord, j’approche de la ligne tropicale où m’attend le beau temps. Je souris, tout en contemplant les abîmes profonds, les efforts vains des éléments déchaînés. Aujourd’hui je suis le plus fort. Le serai-je demain ? Mais, après tout, qu’importe ! La pensée constante de la mort ne fait-elle pas partie intégrante de la vie de l’aviateur et du marin ? Je fus l’un et maintenant je suis l’autre, et je ne veux rien de plus.
1. On pourrait aussi l’apprécier avec un baromètre extrêmement sensible. (N.d.A.)
.2.L’isthme de Panama
COLON
avril 1925
Lorsque je débarque, mon petit canot pliant de toile est, comme partout, l’objet d’une grande curiosité. Quand je mets pied à terre, le groupe qui s’est formé sur le rivage me laisse un passage et, bien que fuyant très vite pour ne pas être importuné, je peux entendre quelques réflexions.
Aux îles Bermudes, c’était presque toujours :
« All alone not even a cat or a dog… » Ici, c’est avec une sorte de terreur respectueuse qu’on murmure : « El hombre solo2 », surnom que la presse espagnole m’a décerné ; et beaucoup s’éloignent en se touchant le front et en disant : « Poco loco3. »
Ainsi, bien des gens ne peuvent comprendre qu’on puisse avoir un idéal différent du leur.
Panama,avril-mai 1925
À Panama, parmi la foule d’individus de toutes races et de toutes couleurs qui circule dans les rues, les Indiens San Blas, de fort petite taille, courts et trapus, au torse énorme, à la longue chevelure, attirent particulièrement l’attention. Ayant conservé leurs anciennes coutumes et religion, protégés par la forêt tropicale, ils sont rebelles à toute pénétration et ne descendent que fort rarement à Panama. Le problème de leurs origines a intrigué tous les savants. Le « toulé », leur langue harmonieuse, contiendrait une trentaine de mots qui sont de l’ancien normand tel qu’il était parlé au moment de la bataille d’Hastings4.
Certains de leurs enfants aussi ont les yeux bleus, les cheveux blonds et la peau claire, ce qui fait croire à une origine nordique. Descendraient-ils des Vikings, de Leif, fils d’Erik le Rouge, qui, avant l’an mille, aurait poussé vers les terres américaines sa longue barque à la proue en forme de dragon ? Descendraient-ils au contraire des Gallois de ce Madoc, fils du prince de Gwynedd qui, avec son vaillant équipage, parti des collines de Snowdon, serait arrivé en Amérique au XIIe siècle ? Les savants n’ont-ils pas découvert des mots cymriques dans le vieux langage mexicain, et Montezuma ne prétendait-il pas descendre d’étrangers arrivés en vaisseaux de l’est ?
Devons-nous croire au contraire les travaux du professeur Wiener du Harvard Institute, qui semblent prouver que les langues indiennes seraient d’origine sémitique et que les Arabes auraient, bien avant le XIIIe siècle, amené en Amérique des esclaves africains ?
Peut-être au contraire les Indiens San Blas descendraient-ils simplement des flibustiers anglais ou normands qui, après avoir incendié leurs vaisseaux et pillé les riches villes aux noms sonores : Porto Bello, la Vera Cruz, Madre de Dios, se fixaient parmi les tribus indiennes pour y finir leurs jours.
EN FUMANT LE MARIGUANA
Panama,mai 1925
Dans Panama, la cité sur le grand Océan, est, non loin de la mer, un jardin où l’on vient s’asseoir sur les bancs pendant les chaudes nuits tropicales.