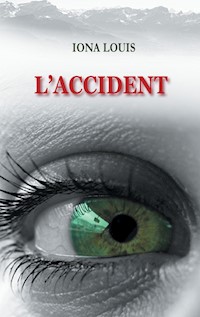
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
Julien Fontayne, auteur à succès, soudainement propulsé sur le devant de la scène par les médias, est emporté dans les remous de la célébrité. Il se replie sur lui-même. Céline en subit le contrecoup et rompt leur relation sans explication. Julien décide de donner une "récréation" à sa vie et se réfugie dans son chalet en montagne. Mais son isolement tourne à l'introspection jusqu'au moment où Stéphane, son ami de toujours, vient remettre en cause ses convictions. Céline réapparaît brutalement par un biais inattendu et fulgurant. La vie de Julien bascule...
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 139
Veröffentlichungsjahr: 2017
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
« Chaque homme sur Terre a un trésor qui l'attend, lui dit son cœur. Nous, les cœurs, en parlons rarement, car les hommes ne veulent plus trouver ces trésors. Nous n'en parlons qu'aux petits enfants. Ensuite, nous laissons la vie se charger de conduire chacun vers son destin. Malheureusement, peu d'hommes suivent le chemin qui leur est tracé, et qui est le chemin de la Légende Personnelle et de la félicité. La plupart voient le monde comme quelque chose de menaçant et, pour cette raison même, le monde devient en effet une chose menaçante. Alors, nous les cœurs, commençons à parler de plus en plus bas, mais nous ne nous taisons jamais. Et nous faisons des vœux pour que nos paroles ne soient pas entendues : nous ne voulons pas que les hommes souffrent pour n'avoir pas suivi la voie que nous leur avions indiquée.
– Pourquoi les cœurs ne disent-ils pas aux hommes qu'ils doivent poursuivre leurs rêves ? demande le jeune homme à l'Alchimiste.
– Parce que, dans ce cas, c'est le cœur qui souffre le plus. Et les cœurs n'aiment pas souffrir. »
[ Extrait de L'Alchimiste de Paulo Coelho – 1994 ]
TABLE DES MATIERES
Le chalet
Stéphane
L’accident
Céline
Renaissance
1
LE CHALET
Il a beaucoup neigé cette nuit. Hier encore, on pouvait apercevoir les touffes d’herbes épaisses et jaunies par le gel. Mais aujourd’hui, les skis sont devenus nécessaires, car c’est le seul moyen à notre disposition pour se déplacer et pour communiquer avec les chalets voisins. En fait, je n’ai pas de voisins. Le plus proche chalet se situe à deux kilomètres à vol d’oiseau, ce qui représente quatre à cinq kilomètres par la route. Les chemins sont si étroits et le passage si rare, que la commune ne s’est pas endettée par l’acquisition d’un chasse-neige. Les gens d’ici vivent au rythme du temps et des saisons. Ils se moquent éperdument de tous les progrès qu’offre notre siècle. D’ailleurs, je pense qu’ils ne sont prêts à accepter la moindre forme de transformation.
Le feu dans la cheminée crépite là, à côté de moi. Je l’apprécie. On dirait qu’il est content. Il est beau, nuancé de rouge, bleu et d’oranger. Et ce silence ! Il y avait bien longtemps que je ne m’étais pas plongé dedans.
J’avais décidé de ne plus écrire, du moins pour un certain temps. Mais cette feuille, décidément m’attire, m’appelle. Je ressens un besoin grandissant de coucher mes sensations et mes impulsions au retour à la vie première et essentielle, les effets de mon exil volontaire de cette ville asphyxiée de bruits, de carbone et de gens au regard vide.
La bûche de châtaigner craque, elle se déchire dans un cri, exprimant toute sa douleur à l’emprise du feu, se tait soudain, se soumettant au pouvoir des flammes dévorantes. Puis, la bûche casse et s’écrase sur les braises rougeoyantes.
J’irais faire une promenade tout à l’heure si le Soleil veut bien se montrer. La beauté d’une montagne enneigée, caressée par un doux soleil, fait ainsi scintiller les mille et un cristaux bleutés qui se sont posés là, au grès du vent, n’a pas son pareil. C’est comme une caresse. J’avais raison ! Voilà le Soleil qui se dévoile m’envoyant ses pâles rayons sur ma plume. La pendule sonne dix heures. L’air s’est réchauffé, je vais chausser mes skis.
Épatant ! J’ai aperçu des traces de lapins au bord du ruisseau. Il a gelé lui aussi cette nuit. Et l’eau en dépit de la glace s’est frayé un chemin, faisant des cabrioles insensées. La lourdeur du silence m’enivra d’une gaieté peu exprimable avec des mots, je sursautais à chaque crissement de skis sur cette neige toute fraîche. Alors, j’ai laissé se perdre mon regard dans l’immensité blanche entrecoupée de quelques points verts que sont les sapins. Tout est si beau ! Il y avait si longtemps que je n’avais pas revu cette montagne, qu’un moment j’ai perdu la notion du temps. C’est la fraîcheur de l’ombre qui me délogea de mes rêveries. Octobre qui commence semble déjà bien rude.
Pour une fois, je prends le temps de vivre. Savez-vous depuis quand je n’ai pas pris le temps ? Dans cette montagne, j’ai presque oublié ce temps, même s’il m’en reste un écho par les dongs lourds et graves de cette vieille pendule. Pourquoi l’ai-je remontée ? Je ne sais pas. Sans doute pour savoir si elle fonctionnait toujours. Je trouve qu’elle s'accorde bien à cette montagne. J’ai oublié la raison de sa présence et plus encore d’où elle vient. Elle est là, c’est tout.
Je n’étais pas revenu ici depuis le début de ma carrière, depuis mon explosion, depuis le début de ma notoriété. Cela fait huit ans. Huit ans de vie passée à trois cents kilomètres à l’heure. Huit ans durant lesquels j’étais coincé entre les nuits blanches sur mes feuilles grimées, les rendez-vous d’affaires insensés, les interviews, la télévision et les autres obligations nécessaires à mon travail, les trains, les avions et Céline.
Je ne m’explique pas pourquoi, lorsque je commence une ébauche de récit, j’ai la fringale. Mais bien sûr ! Il est quatorze heures. J’ai déniché de quoi me rassasier dans le réfrigérateur. L’odeur du steak qui cuit me ravit et me fait savourer d’avance, la simplicité de ce repas. J’oublie de ranger et, à l’instant, j’ai quelques difficultés à me trouver une petite place entre les bouquins, les vieux journaux, les papiers chiffonnés, éparpillés un peu partout sur la table et sur le canapé. Mais le tableau ne serait pas complet si le sol n’en était pas jonché. Je me rappelle pourtant ma mère me seriner quotidiennement sur l’état désastreux de mon domaine.
Depuis mon arrivée, ma vie est concentrée dans cette pièce meublée d’une immense table montagnarde dont j’ai du mal actuellement à apercevoir un carré de son plateau verni. Il y a aussi une commode que je n’ai pas rouverte depuis des lustres. Allez savoir ce qu'il y a dedans ! Je n'en ai plus aucune idée. De l'autre côté, un canapé toujours de travers inondé de lumière par l'immense baie orientée plein sud. La pièce est toujours claire, même par temps sombre. Elle m’offre une vue impressionnante sur les pics et la vallée avec la forêt alourdie de neige. Je ne distingue le village que grâce aux fumées s’échappant des cheminées et au gris foncé des venelles que les habitants ont dégagées. Où que je pose le regard, tout est habillé de blanc.
Soudain, mon attention est attirée de côté, tout près. Deux bergeronnettes se battent les quelques miettes de pain que je viens de jeter. Apparemment, elles se régalent. Mon repas fut un festin.
Je suis venu là pour faire un break de quelques semaines. Me forcer au repos, non plutôt m’offrir des vacances totales, histoire de faire le point, et d’écrire autre chose. Ah ! Pour ça, je n’ai pas besoin de stimulant. Je n’ai jamais compris cette facilité et ce besoin. Ma tête est toujours pleine d’idées. Elle usine à une vitesse que je n’ose décrire, et je n’ai jamais trouvé, ma foi, que l’écriture comme issue de secours pour exprimer ce que je suis, ce que je ressens, ce que je désire. Je n’ai trouvé qu’un interlocuteur compréhensif, vous, ma chère feuille. J’aimerais bien dire aux personnes que j’aime, des choses qui font chaud au cœur, mais cela reste coincé quelque part dans la gorge. J’ouvre la bouche, mais aucun son n’en sort. Je déteste ce genre de situation. Je me sens pataud, ridicule. Alors, mon malaise est tellement grand que je vais pleurer mes mots sur le papier et soudain, ma tristesse se transforme en jouissance tant j’aime à dessiner les mots que je ne peux dire, qui au fil des lignes sont comme un croquis, puis un dessin que je peaufine encore et encore, pour enfin donner à mon étonnement, une toile fidèle à mes pensées.
Mais, ma grande surprise reste le public. Je m’en suis toujours étonné, et malheureusement, cela m’a toujours pris d’une peur panique. Une angoisse étouffante. Mais ce qui est plus fort encore, c’est que je n’ai jamais voulu faire imprimer mes écrits ni rechercher le best-seller. J’écris tout, comme ça me vient au gré de mes pensées, et pour mon premier roman, vous pouvez remercier Céline.
Oh zut ! Je n’ai plus de cigarettes. Je vais devoir sortir de mon terrier et descendre au village.
C’est un petit village avec une seule rue principale et les quelques commerces indispensables, mais ne se faisant aucune concurrence. Il y a bien sûr, la boulangerie, l’épicerie, la boucherie-charcuterie, le quincaillier bricoleur à l’occasion forgeron, la boutique bureau de tabac journaux, librairie et bureau de poste. Je crois même que la gentille dame, dont je ne sais toujours pas son nom, se charge de petites transactions bancaires pour quelques personnes âgées qui refusent obstinément d’aller à la ville, même accompagnées. Puis, il y a encore, l’école et la Mairie qui paraissent minuscules, flanquées contre l’église d’art gothique, construits là, par on ne sait quel hasard. En fait, tout cela me fait penser à une boutade de Prévert, ou à un coup de baguette magique d’un magicien. Merlin sans doute, qui fatigué d’avoir fait tant de grandes choses, a tout réduit petit-petit.
L’école vit encore. Elle gazouille d’une dizaine d’enfants, et à l’heure de sortie, lorsque je me trouve là, j’aime les voir courir et se rassembler sur la petite place autour de la fontaine qui coule même l’hiver, attendant en jouant, la voiture qui les ramera chez eux. Les générations passent, mais les jeux ne changent pas. Je souris et me revois, dans la cour de mon école, jouant comme ces enfants à chat perché.
Les gens ne m’avaient pas oublié. Qu’elle fut ma surprise d’entendre la gentille dame du bureau de tabac, m’accueillir chaleureusement, heureuse d’avoir une personnalité dans son village et de savoir enfin que le chalet n’était pas à l’abandon. J’ai fait quelques autres rencontres qui m’ont tout aussi gentiment salué, et ont continué à parler entre elles en patois. J’ai essayé d’imaginer leur conversation, mais sans succès. Je les ai regardées, leur ai souri à mon tour. Puis, je me suis aperçu qu’elles étaient comme moi, un peu plus marquées par le temps. J’ai rechaussé mes skis et me suis empressé de remonter le coteau pour retrouver la chaleur de mon nid, ma solitude. Je me rends compte que je ne suis pas encore apte à rencontrer les gens.
Eh bien ! J’avais perdu l’habitude des remontées lentes et à pied. J’ai senti le poids des bons repas et des cigarettes. Je me suis effondré sur le canapé, un café brûlant à la main. Je suis lessivé, mais heureux. Je me surprends à sourire. Mon Dieu, mais depuis quand n’ai-je pas souri ? Je me sens pris d’une telle liberté soudaine, que l’envie de faire des bonds me prend. Mais encore une fois, tout se passe en moi, ne laissant presque rien paraître à l’extérieur, et j’exprime ma fougue sur le papier. Je semble calme alors que tout bout à l’intérieur. Absorbé par mes pensées et le crissement de ma plume sur le papier, j’oublie le monde extérieur.
Céline n’aimait pas cette torpeur qui me prend de temps en temps et mon métier l’exaspérait. Tiens donc ! Et pourquoi Céline me vient-elle à l’esprit ? Le courant d’air ou le cloîtré enfumé que je pouvais être la déconcertait, l’usait même, je crois. Si bien qu’un matin, elle a disparu, ne me laissant que quelques mots griffonnés sur un bout de papier :
Salut et bonne chance.
Je me souviens d’avoir lu et relu ce morceau de papier déchiré d'un carnet probablement, sans comprendre. En fait, je regardais la missive coincée entre mes doigts. Je voyais les mots, mais ils n’avaient aucun effet sur mon cerveau, aucune résonance. Ils ne s’imprimaient pas. Je n’arrivais pas à coller à l’évidence que dictait le message. Je me disais que j’allais sortir de ce mauvais rêve, que ce n’était qu’une illusion, un mirage à moins que ce message ne me fut nullement destiné. Incapable de réfléchir, je naviguais dans l'appartement comme un bateau ivre, le papier griffonné entre mes doigts que je posais de temps en temps pour une cigarette ou un verre de whisky. Je l'attendais. Il m’a fallu pratiquement toute la nuit pour réagir. Le non sens qui m'avait tout d'abord frappé se transforma en une sorte de panneau indicateur sur lequel chaque lettre crayonnée y était gravée comme celles sur les tables de la loi1. Puis, petit à petit, à la clarté du jour qui se lève, je me suis rendu compte que je ne rêvais pas. Elle ne signait de son initiale que pour nos messages intimes et sur cette brève déclaration, je ne pouvais nier qu'il en fut autrement. Alors, la tristesse m’a envahi, surgissant à la vitesse et à la force d'un cyclone. Mes yeux se troublèrent, mais les sanglots ne vinrent pas. J’ai simplement allumé une cigarette et je suis retourné à mon bureau comme un automate.
Plus tard, j’ai réfléchi longtemps à ce bout de papier. Sans doute a-t-elle voulu se dispenser d’une conversation où elle aurait craint quelques éclats ? Ou bien mon calme l’aurait une fois de plus mise dans un tel état de rage contenue, qu’épuisée, elle aurait fini comme à son habitude, par s’asseoir, me scruter et me dire :
– Mais enfin, vas-tu parler ? J’existe moi. Qu’y a-t-il dans ce bureau pour que tu ne sortes plus des heures durant ? Je brûlerai bien tout ça. Tu pourrais vivre au moins !
L’énervement la faisait pleurer, doucement, sans bruit. J’aurais bien voulu la consoler, lui dire que sa colère n’avait pas de sens pour moi, mais je ne faisais que m’approcher d’elle, lui ôtant ses longs cheveux roux de son visage ovale, puis je l’embrassais doucement sur le front et sans autre mot, désemparé par la situation, je m’enfuyais dans mon fouillis de papier, poursuivre ma passion.
C’est drôle comme la violence d’une situation fait naître en moi un bouillonnement de mots, de tableaux comme on dit au théâtre, que le seul impératif qui soit pour moi à cet instant soit l’écriture. J’ai comme des démangeaisons très désagréables, un genre d’urticaire au bout des doigts et dans le cerveau. J’ai vu des gens accros à l’alcool ou à la cocaïne, moi c’est du papier. J'ai besoin de son odeur, de sa texture. Et quand la plume gratte la surface immaculée, je ressens chaque griffure où aussitôt l'encre se glisse dans cet interstice minuscule. L'odeur change. Lorsque mon délire se répand ainsi sur une feuille de papier, je perds la notion du temps. Je deviens immortel, ou du moins le temps semble s’arrêter. Puis cela se calme lentement. Je suis épuisé, mais satisfait. Repu et rompu, je m’extirpe alors de ce cagibi-bureau pour passer à nouveau dans l’autre monde.
Des souvenirs me reviennent. Je devais au sortir de mon antre, réfléchir un moment pour savoir, à la lecture de la pendulette du salon, à quel moment du jour on se situait. Bien souvent, le silence m’enveloppait et je comprenais que Céline était sortie, je ne sais où, perdue avec une bande bruyante de copains et de copines. Je l’attendais.
Puis, je regardais à nouveau l’heure à ma montre comme pour me rassurer. Trois heures. Peut-être allais-je dormir un peu ? Je me laissais tomber sur le divan allumant dans ma chute lente, la stéréo ou une cigarette. Lorsque c’était le cas, j’aspirais avec délice, à petites bouffées cette cigarette blonde. Quand je travaille, j’use les cigarettes comme j’use ma plume, sans m’en rendre compte. Ma concentration est telle que je suis hypnotisé par le filet d’encre qui coure sur la page, je ne tire aucun plaisir ni souvenir des cigarettes consommées. C'est mécanique, un tic probablement !
La porte s’est refermée brusquement me sortant de mes rêveries. Je ne sais plus depuis combien de temps, j’étais là, je remarquais simplement l’aube et Céline, les yeux un peu cernés, mais toujours





























