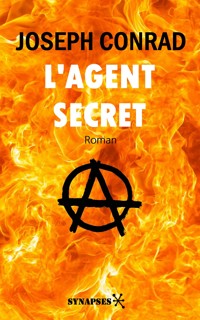
2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Éditions Synapses
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
À la fin du XIXe siècle, Verloc, agent secret d'une puissance étrangère, infiltre les anarchistes et terroristes de son pays réfugiés à Londres. Il doit mener de front sa vie d'agent secret et sa vie familiale, avec sa femme, accompagnée de sa mère vieille et malade et de son frère, handicapé mental. Sommé par sa hiérarchie de se secouer et de réveiller les Anglais, il va s'impliquer dans un plan visant à poser une bombe à l'observatoire de Greenwich...
Conrad nous fait un beau portrait, très détaillé, du monde qui gravite autour de notre héros, et de la destruction de cette misérable famille.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Joseph Conrad
L’AGENT SECRET
Traduction de Henry Durand-Davray
© 2019 Éditions Synapses
ISBN : 9788834178065
Par Joseph Conrad pour Synapses:
Au cœur des ténèbres
Jeunesse
L’agent secret
Sous les yeux d'Occident
Lord Jim
CHAPITRE PREMIER
Quand il s’absentait le matin, M. Verloc laissait la boutique aux soins de son beau-frère, ce qui n’offrait pas d’inconvénients, car les affaires, en tous moments assez calmes, étaient relativement nulles jusque vers le soir. M. Verloc s’inquiétait peu, d’ailleurs, de cette partie ostensible de ses occupations… En outre, sa femme était là pour surveiller son beau-frère.
L’étroite boutique occupait le peu de largeur de la maison, une hideuse maison de brique comme il en existait beaucoup avant que l’on eût commencé à reconstruire les vieux quartiers de Londres, et cette sorte de boîte carrée avait une façade divisée en petits panneaux vitrés. Pendant le jour, la porte restait fermée ; le soir elle s’entrouvrait discrètement.
Derrière le vitrage, s’étalaient des photographies de danseuses plus ou moins déshabillées ; des paquets indéfinissables, emballés comme des spécialités médicales ; des enveloppes en papier jaune très mince, cachetées et étiquetées 2 shillings et 6 pence en larges chiffres noirs. Accrochées à une corde, comme pour sécher, pendaient quelques publications comiques françaises de dates reculées. Il y avait aussi une grande tasse de porcelaine bleu foncé, une cassette en bois noirâtre, des fioles d’encre à marquer et des timbres en caoutchouc ; des livres au titre suggestif ; de vieux numéros de journaux inconnus, mal imprimés, aux dénominations ronflantes : la Torche, le Gong. Et les deux becs de gaz, soit par économie, soit pour le gré de la clientèle, étaient toujours baissés.
Cette clientèle se composait tantôt de tout jeunes gens qui hésitaient un moment devant la montre avant de se faufiler brusquement à l’intérieur ; tantôt d’hommes d’un âge plus mûr et d’aspect plutôt minable. Ceux-ci portaient généralement le col de leur pardessus relevé jusqu’à la moustache, le feutre rabattu sur les yeux ; des traces de boue maculaient le bas de leur pantalon, vêtement de camelote élimé par un trop long usage et recouvrant des jambes qui ne paraissaient pas valoir mieux. Les mains enfoncées dans les poches, ils entraient de biais, l’épaule la première, comme s’ils avaient espéré, par cette tactique, empêcher la sonnette de se mettre en branle ; mais bien qu’irrémédiablement fêlée, cette sonnette suspendue à un ressort en spirale ne manquait jamais, à la moindre provocation, de retentir derrière le dos du client avec une impudente malignité.
À ce signal, du fond de l’arrière-boutique, M. Verloc arrivait à pas pesants ; franchissant une crasseuse porte vitrée, située derrière le comptoir de bois peint, il se présentait, les yeux lourds, avec la mine d’un homme qui a passé la journée couché, tout habillé, sur un lit défait. Tout autre à sa place aurait pris soin de corriger un peu sa mise et sa physionomie, dans le commerce de détail, une bonne part du succès dépendant de la tournure aimable et engageante du vendeur. Mais M. Verloc connaissait son affaire, et n’entretenait pas la moindre inquiétude au sujet de l’impression esthétique qu’il pouvait produire sur sa clientèle. Avec un aplomb imperturbable et un regard décidé, qui semblait toujours retenir la menace de quelque machination inquiétante, il tendait à l’acheteur, par-dessus le comptoir, un objet qui, selon toute évidence, était loin de valoir le prix scandaleux qu’il en recevait ; par exemple, une petite boîte de carton qui paraissait ne rien contenir, ou l’une de ces minces enveloppes jaunes soigneusement cachetées ; ou bien un livre à la couverture sale, étalant un titre plein de promesses. De temps en temps, il arrivait que l’une des danseuses jaunies trouvait preneur, tout comme si elle avait été vivante.
Parfois, c’était Mme Verloc qui répondait à l’appel de la sonnette fêlée. Winnie Verloc était une femme jeune, la poitrine forte sanglée dans un corsage ajusté, et les hanches larges. Le regard assuré et calme, comme celui de son mari, elle gardait, derrière le rempart du comptoir, la plus impénétrable indifférence. Il arrivait qu’un client de hasard, déconcerté à sa vue, demandait en balbutiant une bouteille d’encre dont il n’avait nul besoin, et qu’il jetait subrepticement dans le ruisseau, une fois dehors, après l’avoir payée trois fois sa valeur.
Les visiteurs nocturnes – ceux aux collets relevés et aux feutres rabattus – faisaient un petit salut familier à Mme Verloc, accompagné de quelques brèves paroles de politesse, et, soulevant le battant situé à l’extrémité du comptoir, passaient immédiatement dans le salon. Car la porte de la boutique était l’unique entrée de la maison où M. Verloc se livrait à son négoce interlope, où il exerçait sa vocation de protecteur de la société et cultivait ses vertus domestiques. M. Verloc pouvait passer essentiellement pour un homme d’intérieur : aucun de ses besoins, d’ordre spirituel, moral ou physique, n’étant de nature à l’attirer beaucoup au-dehors, il goûtait à la maison le bien-être matériel et la paix de l’âme, en même temps que les attentions conjugales de Mme Verloc et les égards déférents de sa belle-mère.
La mère de Winnie, respectable dame, corpulente et poussive, au large visage tanné, apparaissait toujours ornée d’une perruque noire que surmontait un bonnet blanc. Ses jambes enflées la rendaient inactive. Elle se prétendait d’origine française, ce qui pouvait bien être vrai. Veuve d’un restaurateur qui la laissa fort démunie, elle s’était créé des ressources en sous-louant sa maison en appartements meublés pour célibataires ; cette maison, située dans le voisinage d’une longue rue déchue de sa splendeur première, était comprise administrativement dans l’aristocratique quartier de Belgravia, répartition topographique qui présentait un incontestable avantage pour la rédaction des annonces captieuses destinées à amorcer les chalands. Néanmoins, les clients de la digne veuve n’étaient pas précisément de la catégorie la plus distinguée. Quels qu’ils fussent, d’ailleurs, Winnie aidait sa mère à assurer leur confort. En elle aussi on pouvait reconnaître des indices de la descendance française dont se targuait la vieille dame ; par exemple, dans l’art qu’elle apportait à disposer son abondante chevelure ou à ajuster ses vêtements. Winnie joignait à ces talents d’autres charmes : sa jeunesse, son teint clair, ses formes généreuses et son impénétrable réserve qui agissait sur les locataires comme une provocation, et n’allait pas jusqu’à lui interdire des dialogues menés d’une part avec entrain, et d’autre part (la sienne) avec une sereine amabilité.
M. Verloc, en tout cas, ne demeura pas insensible à ces attraits. Client intermittent de la logeuse, il arrivait, puis repartait, sans aucun motif apparent. D’ordinaire, il débarquait à Londres, venant du continent, comme la grippe ; seulement, la presse ne trompettait pas son arrivée, à lui. Ses visites étaient dénuées de tout apparat ; il déjeunait dans son lit où il se prélassait jusqu’à midi – et parfois même plus tard encore. S’il quittait la place Belgravia pour quelque mystérieuse affaire, il en partait tard et y rentrait de bonne heure – aux environs de trois ou quatre heures du matin – et, à suivre les détours qu’il faisait pour revenir, on aurait cru qu’il éprouvait de singulières difficultés à retrouver le chemin de son logis temporaire. À son réveil, vers les dix heures, lorsque Winnie lui apportait son déjeuner, il lui adressait ses civilités sur un ton badin, avec la voix enrouée et épuisée d’un homme qui aurait parlé sans discontinuer pendant plusieurs heures. Ses gros yeux lourds, chargés de regards amoureux et languissants, s’attachaient à chacun des gestes de la belle fille, et ses lèvres épaisses distillaient de mielleuses flatteries.
La mère de Winnie professait une très haute estime pour M. Verloc. De l’expérience qu’elle avait pu acquérir« dans les affaires », la brave femme s’était fait un idéal des bonnes manières d’après celles des habitués de comptoir et M. Verloc approchait de cet idéal, il l’atteignait même.
– Naturellement, mère, nous vous garderons avec nous, vous et vos meubles, – avait déclaré Winnie quand le mariage fut décidé.
Car on abandonnait la maison meublée, M. Verloc ayant opiné d’un ton d’oracle « que pour ses occupations » cela valait mieux ainsi.
En quoi consistaient ces occupations ? Il ne le révéla jamais ; toutefois, peu de temps avant le mariage, il s’avança jusqu’à confier à Winnie qu’elles touchaient à la politique ; même il l’avertit qu’elle aurait à se montrer aimable envers ses amis. Ce à quoi elle répondit, avec son regard direct et impénétrable, que c’était bien naturel. Et la belle-mère ne put jamais découvrir s’il avait plus tard mieux renseigné sa femme.
Dès que les fiançailles furent officielles, M. Verloc prit la peine de se lever avant midi. Pour se concilier la sympathie de l’invalide qui ne quittait guère son siège, dans la salle à manger du sous-sol, M. Verloc descendait prendre son petit déjeuner en bas ; il caressait le chat, tisonnait le feu, et il manifestait une évidente répugnance à quitter le confort un peu fétide du sous-sol ; néanmoins, il passait toutes ses soirées dehors et ne rentrait que très avant dans la nuit, sans jamais offrir à Winnie de la mener au théâtre, comme un monsieur aussi gentil que lui aurait dû le faire.
Les nouveaux époux se chargèrent donc de la logeuse et son mobilier, comme il avait été convenu, et la belle-mère éprouva quelque déception devant l’aspect sordide de la boutique. Le séjour, dans cette étroite rue, fut d’ailleurs funeste pour les jambes de la vieille dame, qui prirent d’énormes proportions. Mais, d’autre part, elle se trouvait débarrassée de tout souci matériel : c’était bien quelque chose. La nature pondérée de son gendre lui inspirait un sentiment de parfaite sécurité ; incontestablement, l’avenir de sa fille paraissait assuré, et peut-être celui de son fils Stevie ne l’était pas moins, par suite de cet heureux mariage. Il avait toujours été une cause de soucis, ce cher Stevie ; mais maintenant, elle commençait à espérer que le « pauvre garçon » serait à l’abri des tracas de ce monde. Et au fond de son cœur, elle ne fut peut-être pas fâchée de constater, d’année en année, que les Verloc restaient sans enfant. Comme cette circonstance semblait laisser M. Verloc parfaitement indifférent, et qu’au surplus Winnie dispensait à son frère une affection quasi maternelle, c’était peut-être ce qui pouvait arriver de mieux pour ledit Stevie.
Fort difficile à caser, en effet, ce garçon. Faible de santé, on eût pu lui trouver une assez jolie figure, malgré son aspect chétif, n’eût été sa lèvre inférieure qu’il laissait toujours pendre lamentablement. Grâce à notre excellent système d’instruction obligatoire, il avait tout de même appris à lire et à écrire. Mais placé dans une maison de commerce où il fut affecté au département des courses, il se montra peu brillant dans cette carrière. Il oubliait ses messages, facilement détourné du droit chemin par le spectacle des chats et des chiens errants, qu’il suivait le long des ruelles étroites jusque dans les impasses les plus nauséabondes ; par les comédies de la rue, qu’il contemplait la bouche ouverte, au grand dommage des intérêts de son patron, ou par les drames des chevaux tombés, drames poignants qui lui arrachaient parfois des cris aigus, au grand déplaisir des curieux, lesquels n’aimaient pas être dérangés par ces accents de détresse dans l’agréable contemplation d’un spectacle national. Il arrivait aussi que, lorsqu’un policeman grave et protecteur voulait le reconduire, Stevie perdait totalement, pour quelque temps du moins, la mémoire de sa propre adresse ; une question un peu brusque le faisait bégayer jusqu’à la suffocation, et si quelque chose le tourmentait, il se mettait à loucher d’une façon horrible.
Pourtant – c’était encourageant – il n’eut jamais de crises nerveuses caractérisées. Aux jours de son enfance, devant les mouvements d’impatience du brutal restaurateur, il se contentait de se réfugier derrière les jupes courtes de sa sœur. Par contre, on eût pu le soupçonner de dissimuler un fond de perversité maligne. Lorsqu’il eut quatorze ans, un ami de feu son père, représentant d’une fabrique étrangère de lait concentré, lui avait attribué un emploi dans ses bureaux ; mais, certain après-midi de brouillard, en l’absence de son patron, on l’avait surpris en train d’allumer un feu d’artifice dans l’escalier. Les majestueuses fusées, les soleils furieux, les pétards assourdissants détonaient en succession rapide, et l’affaire aurait pu devenir grave. Une panique s’empara de la maison. Des commis, l’œil égaré, suffoqués, se bousculaient dans les couloirs pleins de fumée ; des chapeaux hauts de forme et de vieux messieurs déboulaient les uns derrière les autres, franchissant plusieurs marches à chaque saut. Il fut difficile de découvrir quels motifs avaient poussé Stevie à cet accès d’originalité. Ce n’est que plus tard que Winnie put lui arracher une vague confession, où elle crut démêler que deux de ses jeunes collègues, ayant travaillé son imagination par quelque histoire de torture ou de cruauté, il avait cru faire acte de justicier en mettant le feu à la maison. Quant au patron, jugeant Stevie dangereux autant qu’inutile, il le congédia sur-le-champ.
Après cet exploit altruiste, Stevie fut relégué au sous-sol de la maison de Belgravia, où il aida à laver la vaisselle ; on le préposa en outre au nettoyage des chaussures de messieurs les locataires, qui lui donnaient de temps à autre un shilling, et M. Verloc était au nombre des plus généreux. Mais ces largesses ne formaient pas un total bien considérable, et les intérêts composés de ce capital ne permettraient jamais au bénéficiaire de vivre de ses rentes ; si bien que lorsque les fiançailles de Winnie furent décidées, la mère ne put se retenir de soupirer et de se demander, en jetant un regard vers le sous-sol, ce que deviendrait maintenant le pauvre Stevie.
Heureusement, M. Verloc parut disposé à l’héberger, comme sa future belle-mère, et au même titre que le mobilier de la famille, – le plus clair de leur fortune. Toute la maisonnée émigra donc vers la nouvelle demeure. Les meubles furent distribués pour le mieux dans la maison : la mère et le fils furent confinés dans les deux pièces de derrière, au premier étage : entre-temps, Stevie, avec une soumission aveugle et tendre, aidait Winnie aux travaux du ménage. Un fin duvet, comme une brume d’or, adoucissait à présent la ligne dure de sa mâchoire inférieure, et M. Verloc se disait parfois qu’on devrait bien songer à placer cet adolescent. Stevie occupait ses loisirs à décrire des circonférences sur du papier avec un crayon et un compas, et il y mettait toute son application, les coudes aplatis sur la table de la cuisine, tandis que, du fond de la boutique, par la porte restée ouverte, sa sœur le surveillait avec une vigilance toute maternelle.
CHAPITRE II
Tels étaient la maison, le ménage et le commerce que laissait derrière lui M. Verloc, ce matin-là, sur la pointe de dix heures et demie. Il sortait rarement de si bon matin et toute sa personne exhalait comme une fraîcheur de rosée.
Il avait endossé sans le boutonner son pardessus de drap bleu ; ses chaussures reluisaient, ses joues rasées de frais avaient un éclat de neuf ; jusqu’à ses yeux qui malgré les lourdes paupières, grâce aux bienfaisants effets d’une paisible nuit de repos, lançaient des regards plus vifs.
À travers les grilles de Hyde Park, il regardait complaisamment le défilé des cavaliers ; des couples passaient, harmonieux, au petit galop de leurs montures ; d’autres s’avançaient posément, au pas de promenade ; des groupes de trois ou quatre flânaient ; des cavaliers se détachaient, solitaires, l’air rébarbatif ; et des amazones, seules aussi, étaient suivies à distance par un groom portant une cocarde à son chapeau et une ceinture de cuir sur sa tunique ajustée. Des attelages fuyaient, rapides, coupés à deux chevaux pour la plupart ; çà et là, une victoria, une coiffure féminine émergeant d’une fourrure de bête sauvage au-dessus de la capote repliée.
Et sur cette scène, le soleil si particulier de Londres, – auquel on ne pouvait rien reprocher sinon de paraître injecté de sang, – semblait monter la garde, ponctuel et bienveillant, à peine au-dessus de Hyde Park Corner. Le sol, sous les pieds de M. Verloc, avait une teinte vieil or, – dans cette lumière diffuse, où ni mur, ni arbre, ni homme, ni bête, ne portaient ombre. M. Verloc cheminait vers l’ouest, à travers une ville sans ombres, dans une atmosphère poudrée d’or. Des rayons rouges, cuivrés, dessinaient les toits des maisons, les angles des murs, les panneaux des voitures, jusqu’aux robes lustrées des chevaux et au dos vaste du pardessus de M. Verloc, et laissaient partout comme un terne reflet de rouille.
Mais M. Verloc n’avait pas la moindre conscience de cette oxydation de sa personne. Il suivait d’un œil approbateur, à travers les barreaux de la grille, les témoignages du luxe et de l’opulence de la grande ville. Il fallait protéger tous ces gens-là ; la protection est le premier besoin des privilégiés. Il fallait les protéger ; et aussi leurs chevaux, leurs voitures, leurs maisons, leurs serviteurs ; et il fallait protéger la source de leurs richesses au cœur de la cité et au cœur du pays ; il fallait protéger tout l’ordre social favorable à leur hygiénique oisiveté, contre l’inepte envie de ceux qui peinent à des tâches malsaines.
M. Verloc se serait frotté les mains de plaisir s’il n’avait été, par tempérament, ennemi de tout effort superflu. L’oisiveté n’était point chez lui commandée par l’hygiène ; mais elle lui seyait parfaitement. Il lui vouait une sorte de fanatisme inerte, ou, si l’on veut, d’inertie fanatique. Né de parents besogneux, pour une vie laborieuse, il avait choisi l’indolence, poussé par un instinct aussi profond et aussi impérieux que celui qui guide la préférence d’un homme dans le choix d’une femme entre mille. Il était trop paresseux pour faire même un démagogue, un orateur ouvrier, un meneur de grèves. C’eût été là trop de tourment. Il lui fallait une forme plus parfaite de bien-être, ou peut-être était-il la victime d’un doute philosophique quant à l’heureux aboutissement de tout effort humain. Une telle espèce d’indolence requiert et implique une certaine somme d’intelligence. M. Verloc n’était pas dénué d’intelligence, et à l’idée d’un ordre social menacé il aurait eu, sans doute, à sa propre adresse, un clignement d’œil, s’il n’avait pas fallu un effort pour produire cette marque de scepticisme. Ses gros yeux proéminents ne se seraient guère adaptés à cet exercice ; ils appartenaient plutôt à cette espèce d’yeux qui se ferment solennellement pour de majestueuses somnolences.
M. Verloc, aussi imposant et peu démonstratif qu’un animal gras, poursuivait son chemin sans se frotter les mains de satisfaction, ni sans clins d’œil sceptiques à ses pensées. Foulant les pavés sous le poids de ses bottes bien cirées, il avait les dehors d’un artisan prospère, travaillant pour son compte, quelque chose entre un encadreur et un serrurier, un petit patron occupant quelques apprentis. Mais il y avait aussi dans son air quelque chose d’indéfinissable, qu’un artisan n’aurait pu acquérir dans la pratique même malhonnête de son métier, l’air qu’ont tous les gens qui vivent des vices, des folies ou des basses couardises du genre humain ; l’air de nullité morale commun aux tenanciers de tripots, aux agents de renseignements et de police privée, aux débitants de boissons, je dirais même aux marchands de ceintures électriques pour rendre la vigueur aux affaiblis et aux inventeurs de prétendues spécialités médicales ; bien que, pour ces derniers, je ne puisse parler avec une entière certitude, n’ayant pas poussé à fond mes investigations dans ce sens. Pour autant que je sache, si leur physionomie avait quelque chose de parfaitement diabolique, je n’en serais aucunement surpris. Ce que je tiens surtout à affirmer, c’est que la physionomie de M. Verloc n’avait absolument rien de diabolique.
Avant d’arriver à Knightsbridge, M. Verloc tourna à gauche, abandonnant la grande artère pleine de gens affairés, le tumulte des omnibus cahotants et des voitures de livraisons, pour s’engager dans une rue calme que dérangeait seule la fuite rapide et presque silencieuse des « hansoms ». Sous son chapeau, qu’il portait légèrement en arrière, ses cheveux étaient soigneusement brossés, lissés à souhait, car il se rendait à une ambassade. Et M. Verloc, ferme comme un roc, – un roc d’espèce molle, – suivait maintenant une voie qui selon toute apparence paraissait être une propriété privée. Par sa largeur, par sa libre étendue, elle avait la majesté de la nature inorganique, de la matière qui ne périt jamais. Le seul représentant de l’élément mortel était le coupé d’un médecin, rangé le long du trottoir dans une auguste solitude.
Les marteaux polis des portes étincelaient à perte de vue, et les vitres bien frottées brillaient d’un éclat opaque et sombre. Tout était silencieux : une voiture de laitier traversa bruyamment la perspective lointaine, et un garçon boucher, conduisant avec la noble insouciance d’un automédon aux Jeux Olympiques, tourna le coin de la rue, haut perché sur une paire de roues peintes en rouge.
Un chat surgi d’entre les pierres s’enfuit, l’air pris en faute, à l’approche de M. Verloc, puis disparut dans un soupirail. Et un gros policeman, sorti apparemment de quelque réverbère, surgit à son tour. Figure impassible, il semblait lui aussi faire partie du décor inorganique, et ne prêta pas la moindre attention au passant solitaire.
Prenant encore à gauche, M. Verloc s’engagea dans une rue étroite bordée d’un mur jaune, qui – sans qu’on sût bien pourquoi – portait en lettres noires l’inscription : N° 1, Chesham Square ; or Chesham Square était au moins à soixante mètres de là. Mais M. Verloc, assez cosmopolite pour ne pas se laisser prendre aux chinoiseries de la topographie londonienne, passa tranquillement sans ombre de surprise ou d’indignation.
Grâce à sa persistance, il atteignit enfin le Square qu’il traversa obliquement, afin de parvenir au n° 10. C’était le numéro d’une importante porte cochère qui s’ouvrait dans une autre muraille bien entretenue, entre deux ailes d’habitation ; l’une de ces ailes portait, avec raison d’ailleurs, le n° 9, tandis que l’autre était numérotée 37 ; mais on avait pris soin d’annoncer qu’elle appartenait à Porthill Street, – rue bien connue du voisinage, – au moyen d’une inscription placée au-dessus des fenêtres du rez-de-chaussée par quelqu’une de ces autorités hautement compétentes à qui est confié le soin de conserver la trace des maisons égarées de Londres.
M. Verloc ne s’inquiéta pas de ces incohérences, sa mission étant de protéger le mécanisme social et non de le perfectionner ou même de le critiquer.
L’heure était si matinale que le portier de l’ambassade sortit précipitamment de sa loge, en se débattant encore pour enfiler la manche gauche de sa livrée ; il portait un gilet rouge et des culottes courtes et paraissait légèrement ahuri. M. Verloc, qui s’attendait à cette attaque de flanc, la repoussa en exhibant simplement une enveloppe au sceau de l’ambassade. Le même talisman fit s’incliner le valet de pied qui ouvrit la porte du vestibule, et qui s’effaça pour livrer passage.
Un feu clair flambait dans la haute cheminée, devant laquelle, lui tournant le dos, un personnage d’âge respectable, en habit, une chaîne autour du cou, la figure calme et grave, tenait à deux mains un journal grand ouvert ; il leva les yeux sans changer d’attitude. Un autre valet, en livrée, à culottes brunes et frac à basques pointues, bordées d’un mince galon jaune, s’approcha ; au murmure du nom du visiteur, il pivota sur ses talons et s’éloigna en silence. M. Verloc le suivit, par un couloir du rez-de-chaussée, qui filait à gauche du grand escalier garni de tapis, jusqu’à un petit cabinet, meublé d’une lourde table et de quelques chaises, où on le laissa seul.
Il resta debout, son chapeau et sa canne d’une main, et de l’autre caressant ses cheveux, tandis qu’il regardait autour de lui.
Une porte s’ouvrit sans bruit. M. Verloc, immobilisant son regard dans cette direction, ne vit tout d’abord qu’un costume noir, un crâne chauve et des favoris gris retombant de part et d’autre derrière deux mains ridées. Le nouveau venu tenait devant ses yeux une poignée de paperasses, et il s’avançait vers la table, à petits pas, sans cesser de tourner et de retourner ses papiers ; le conseiller privé Wurmt, chancelier d’ambassade, était très myope. Ce fonctionnaire, déposant ses papiers sur la table, découvrit une face bouffie, d’une laideur mélancolique, encadrée de longs et fins poils gris et barrée d’épais sourcils. Il chaussa d’un lorgnon à monture d’écaille son nez court et uniforme, et sembla tout à coup s’apercevoir de la présence de M. Verloc. Derrière les énormes sourcils, les yeux usés clignotèrent d’une manière pathétique ; mais le personnage ne donna aucun signe de bienvenue. M. Verloc, qui certainement savait se conduire, ne bougea pas davantage ; il modifia seulement la ligne générale de ses épaules et de son dos, jusqu’à laisser deviner une subtile incurvation de l’échine sous la vaste surface de son pardessus, ce qui lui donna le maintien de la plus modeste déférence.
La voix du fonctionnaire s’éleva douce et basse contre toute attente :
– J’ai là quelques-uns de vos rapports, – dit-il, en appuyant fortement le bout de son doigt sur le tas de papiers.
Il se tut, et M. Verloc, qui avait très bien reconnu sa propre écriture, attendit dans le plus profond silence.
– Nous ne sommes pas très satisfaits de l’attitude de la police ici, – continua le fonctionnaire, avec toute l’apparence d’une grande fatigue intellectuelle.
Les épaules de M. Verloc, sans bouger réellement, esquissèrent un léger haussement. Et pour la première fois, ce matin, depuis qu’il était sorti de chez lui, ses lèvres s’ouvrirent.
– Chaque pays a sa police, – formula-t-il philosophiquement.
Mais sur un clignement plus direct du secrétaire à son adresse, il s’empressa d’ajouter :
– Permettez-moi de remarquer que je n’ai aucun moyen d’action sur la police, ici.
– Ce que nous désirons, c’est la manifestation d’un fait précis qui stimulerait sa vigilance. C’est de votre ressort, n’est-ce pas ?
M. Verloc n’eut d’autre réponse qu’un soupir qui s’exhala malgré lui, car au même instant il s’appliquait à conserver une physionomie enjouée.
Le fonctionnaire cligna de plus belle, comme affecté par l’obscurité de la pièce, et avec l’air de répéter une leçon, il reprit :
– L’indulgence coutumière à la magistrature de ce pays et l’absence totale de mesures répressives, tout cela est un scandale pour l’Europe. Ce que nous voulons, c’est que l’élément révolutionnaire qui fermente en certains milieux soit rendu manifeste pour les plus aveugles… Vous ne me direz pas, j’imagine, que cette fermentation n’existe pas… ?
– Elle existe, elle existe, – attesta M. Verloc, révélant soudain les sonorités d’une belle voix de basse contrastant si fort avec le ton de ses premières paroles, que son interlocuteur s’arrêta tout surpris. – Elle existe à un degré dangereux même. Mes rapports des douze derniers mois l’indiquent assez nettement.
– Vos rapports des douze derniers mois, – reprit le conseiller d’État Wurmt du même ton impassible, – je les ai lus. J’en suis encore à me demander pourquoi vous les avez rédigés.
Un silence glacial régna pendant quelque temps. M. Verloc semblait avoir avalé sa langue. Le conseiller regardait fixement les papiers posés sur la table ; puis, les repoussant légèrement :
– La situation que vous exposez là n’est que la cause première de votre utilité. Il nous faut à présent autre chose que des grimoires : la réalisation d’un fait distinct, significatif ; je dirais presque d’un fait alarmant.
– Je n’ai pas besoin d’affirmer que tous mes efforts tendront vers ce but, – commença M. Verloc, avec, dans sa voix rauque, des modulations qui exprimaient un acquiescement.
Mais il eut la sensation déconcertante d’être dévisagé de l’autre côté de la table par un œil perspicace, quoique myope, et il s’arrêta court, avec un geste d’absolue soumission. Le conseiller Wurmt semblait être sous l’impression de quelque fâcheuse découverte.
– Vous êtes bien corpulent, – déclara-t-il enfin.
Cette observation, inspirée par une réelle perspicacité psychologique et jetée d’une voix hésitante, avec la modestie qui convient au fonctionnaire familier avec la paperasserie, plus qu’avec les tracas de la vie active, piqua M. Verloc comme un reproche personnel désobligeant.
Il fit un pas en arrière, et d’une voix lourde de vexation :
– Pardon ? Vous dites ?
Le chancelier que l’on avait chargé de cette entrevue eut soudain l’air de trouver la tâche au-dessus de ses moyens.
– Je pense, – dit-il, – que vous feriez mieux de voir M. Vladimir. Oui, décidément, il faut que vous voyiez M. Vladimir. Veuillez attendre un instant…
À ces mots, il disparut à petits pas, comme il était entré.
M. Verloc se passa la main sur les cheveux. Quelques gouttes de sueur perlèrent à son front, et il laissa échapper sa respiration entre ses lèvres pincées, comme un homme qui souffle sur une cuillerée de soupe trop chaude. Mais quand parut à la porte le silencieux valet à livrée brune, M. Verloc n’avait pas bougé d’un pouce ; il était resté figé à sa place comme s’il se fût senti entouré de pièges.
Il suivit un couloir qu’éclairait un bec de gaz solitaire, gravit un escalier en spirale, et déboucha dans un corridor vitré, clair et gai, au premier étage. Le valet de pied qui le conduisait ouvrit une porte et s’effaça.
C’était une large pièce à trois fenêtres. M. Verloc sentit sous ses pieds une moelleuse carpette. Assis dans un fauteuil spacieux, devant un énorme bureau d’acajou, un homme jeune, la figure pleine et rasée, disait en français au conseiller qui se retirait, les papiers à la main :
– Vous avez parfaitement raison, mon cher ! Il est gras… l’animal !
M. Vladimir, premier secrétaire, avait une réputation de causeur agréable, et il était fort recherché dans les milieux mondains. Son genre d’esprit consistait à découvrir des rapports comiques entre des idées disparates et quand il était lancé dans cette voie, il s’asseyait sur le bord de son siège, la main gauche levée comme s’il tenait entre le pouce et l’index la figuration des plaisanteries qu’il débitait, cependant que son visage tout rond, tout rose et imberbe exprimait une perplexité enjouée.
Mais il n’y avait aucune trace d’enjouement ni de perplexité dans la façon dont il considéra M. Verloc. Renversé au fond de son fauteuil, les coudes appuyés sur les bras du meuble, une jambe croisée sur un de ses genoux, il aurait fait penser, avec ses joues fraîches et potelées, à quelque bébé anormal qui ne s’en laisserait imposer par personne.
– Vous comprenez le français, je suppose ?
M. Verloc fit une brève affirmation qu’il accompagna d’une inclinaison en avant de toute la masse de sa personne. Il s’arrêta au milieu du tapis, la canne et le chapeau d’une main, l’autre inerte à son côté, murmurant confusément, au fond de son gosier, quelque chose à propos de son service militaire fait en France, dans l’artillerie. Sur quoi M. Vladimir, avec une insouciance dédaigneuse, changea de langue et se mit à s’exprimer dans l’anglais le plus pur, sans la moindre trace d’accent étranger :
– Ah ! oui, c’est vrai ! Voyons, combien vous a rapporté la communication du dessin figurant le verrou de culasse perfectionné de leur nouvelle pièce de campagne ?
– Cinq ans de réclusion ! – riposta inopinément M. Verloc, sans manifester la moindre gêne.
– Vous vous en êtes tiré à bon compte ! Et en tout cas vous les aviez bien mérités pour vous être laissé pincer ! Qu’est-ce qui vous a poussé dans ce genre d’entreprises, hein ?
M. Verloc, de sa voix sourde, parla de jeunesse, d’une inclination fatale pour une indigne…
– Ah ! ah ! cherchez la femme, – daigna interrompre M. Vladimir, moins sec, mais sans affabilité ; il y avait même un accent de blâme dans sa condescendance. – Depuis quand êtes-vous au service de l’ambassade ?
– J’y suis arrivé en même temps que feu le baron Stott-Wartenheim, – répondit M. Verloc, prenant un air de circonstance pour déplorer la perte du défunt diplomate.
Ce jeu de physionomie ne fut pas perdu pour le premier secrétaire.
– Ah ! avec le baron… Bien ! Et qu’avez-vous à arguer pour votre défense ?
M. Verloc répliqua, non sans surprise, qu’il ne venait point pour se défendre. Il avait été convoqué par lettre… et il plongea une main empressée dans la poche de côté de son pardessus ; mais devant le regard railleur fixé sur lui, il jugea inutile de produire le papier.
– Voyons ! – reprit M. Vladimir impitoyable, – à quoi pensez-vous de vous relâcher pareillement ? Vous n’avez certes pas le physique de l’emploi ! Vous, un membre affamé du prolétariat ? Jamais ! Vous, un socialiste à tous crins… un anarchiste ? Lequel des deux ?
– Anarchiste ! – articula d’une voix faible M. Verloc.
– Pure blague ! – prononça M. Vladimir, sans élever le ton. – Le père Wurmt lui-même s’en aperçoit. Cela saute aux yeux ! Pour moi, je trouve vos services piteux ! Vous êtes donc entré en relations avec nous en subtilisant les dessins du canon français… et vous vous êtes fait prendre ! C’est cela qui a dû être agréable pour notre gouvernement ! Vous ne paraissez guère adroit !
M. Verloc essaya de se disculper :
– Comme j’ai eu l’occasion de le mentionner tout à l’heure, une malheureuse inclination…
– Ah ! oui ! la femme fatale !…
M. Vladimir éleva une main blanche et potelée.
– Elle a empoché l’argent, puis elle vous a dénoncé… hein ?
La mine dolente de M. Verloc et un abandon subit de toute sa personne confessèrent que telle était la triste vérité.
M. Vladimir, un pied en travers de son genou, saisit d’une main sa cheville laissant voir une fine chaussette en soie bleu foncé.
– Vous voyez ! maladresse sur maladresse. Seriez-vous susceptible, par hasard ?
M. Verloc donna à entendre, en un murmure guttural et voilé, qu’il avait cessé d’être jeune.
– Oh ! la susceptibilité est un défaut que l’âge ne guérit pas, – opina M. Vladimir avec une familiarité de mauvais augure. – Mais non ! vous êtes beaucoup trop gros pour être sentimental. La vérité toute nue, je vais vous la dire : vous êtes un paresseux ! Depuis combien de temps émargez-vous donc à l’ambassade ?
– Depuis onze ans, – répondit M. Verloc, après une hésitation maussade. – J’ai été chargé de plusieurs missions à Londres du temps où Son Excellence le baron de Stott-Wartenheim était encore ambassadeur à Paris. Plus tard, suivant les instructions de Son Excellence, je m’établis à Londres. Je suis anglais.
– Vous êtes anglais ! Vraiment ? Comment cela ?
– Sujet britannique, né en Angleterre. Mais mon père était français ; c’est pourquoi…
– Inutile de vous expliquer. Je vois que vous auriez pu être légalement maréchal de France et membre du Parlement anglais… auquel cas vous auriez vraiment pu rendre quelques services à notre ambassade.
Cette facétie amena comme un vague sourire sur les lèvres de M. Verloc. M. Vladimir, lui, garda la plus imperturbable gravité.
– Malheureusement, je le répète, vous êtes un paresseux ; vous ne savez pas profiter des circonstances. Du temps du baron Stott-Wartenheim, il y avait à l’ambassade un tas d’écervelés ; ce sont eux qui furent la cause de l’opinion fausse que se firent les gens de votre sorte sur le caractère du service secret. Il est de mon devoir de corriger cette erreur en vous exposant ce que le service secret n’est pas, et il n’est pas une institution philanthropique. Si je vous ai convoqué ici, c’est à dessein de vous en informer.
M. Vladimir observa sur les traits de M. Verloc une feinte expression d’étonnement ; il eut un sourire sarcastique.
– Je vois que vous me comprenez parfaitement… Vous avez, je l’admets, assez d’intelligence pour faire votre besogne. Mais ce que nous voulons maintenant, c’est de l’activité… de l’activité, vous m’entendez ?…
M. Vladimir souligna ce dernier mot en allongeant, sur le bord de son bureau, le long index de sa main blanche.
Toute trace d’enrouement disparut de la voix de M. Verloc. Sa grosse nuque devint cramoisie au-dessus du collet de velours de son pardessus. Ses lèvres se crispèrent, puis s’ouvrirent toutes grandes, livrant passage aux accents oratoires de sa basse profonde et claire.
– Si vous voulez avoir la bonté de jeter les yeux sur mon rapport, vous y verrez qu’il y a de cela trois mois, à l’occasion du voyage que fit à Paris le grand-duc Romuald, j’ai fourni un avertissement qui fut télégraphié d’ici à la police française, et…
– Ta, ta, ta, – interrompit M. Vladimir, en fronçant le sourcil. – La police française n’eut que faire de votre avertissement. Ne braillez pas ainsi. Je ne suis pas sourd.
Subitement, très humble, M. Verloc protesta d’un oubli. Sa voix, également fameuse dans les réunions en plein air et dans les assemblées que tenaient les travailleurs sous de vastes coupoles, avait contribué à établir sa réputation de compagnon convaincu ; elle inspirait confiance en ses principes. Dans les situations critiques, c’est toujours à lui que les meneurs donnaient la parole, ajouta-t-il ; il n’y avait pas de tapage que ses éclats de voix ne pussent surmonter. Et il se mit en devoir de démontrer la vérité de cette assertion.
– Permettez-moi !
Le front baissé, sans lever les yeux, il traversa la pièce de son pas rapide et pesant ; arrivé près de l’une des fenêtres à espagnolette, comme cédant à une impulsion subite, il l’entrouvrit.
Saisi d’étonnement, M. Vladimir bondit du fond de son fauteuil, et, regardant par-dessus son épaule, il aperçut au-dehors, au-delà de la cour de l’ambassade et à bonne distance de la grande porte, le large dos d’un policeman qui contemplait paresseusement un bébé qu’on promenait dans une luxueuse petite voiture par les allées du square.
– Constable ! – prononça M. Verloc, sans plus d’effort que s’il chuchotait.
Et M. Vladimir éclata de rire en voyant le policeman tournoyer comme s’il avait été piqué par un instrument aigu.
M. Verloc referma tranquillement la fenêtre et revint au milieu de la pièce.
– Avec une voix pareille, – dit-il, reprenant son ton enroué, – il est tout naturel que j’inspire confiance. De plus, je sais m’en servir.
M. Vladimir, tout en rajustant sa cravate, l’observait dans la glace de la cheminée.
– Je ne conteste pas que vous connaissiez par cœur le jargon révolutionnaire. Vox et… Vous n’avez jamais appris le latin ?
– Non, – grogna M. Verloc. – Vous n’allez pas exiger que je le sache. J’appartiens à l’innombrable classe des ignorants. Qui est-ce qui sait le latin ? Une malheureuse centaine d’imbéciles qui ne sont pas fichus de se tirer d’affaire tout seuls.
Pendant une demi-minute, M. Vladimir étudia dans la glace le profil charnu du ventripotent personnage auquel il tournait le dos. Cette position lui offrait l’avantage de voir en même temps sa propre figure, ronde et frais rasée, avec des lèvres minces et sinueuses, bien faites pour l’émission de ces spirituelles saillies qui lui avaient valu ses succès mondains.
Son examen fini, il se leva et s’avança d’un pas si délibéré que les bouts de son nœud de cravate à l’ancienne mode semblèrent se hérisser, menaçants. Le geste fut si impétueux que M. Verloc, lui lançant un regard oblique, se replia sur lui-même.
– Ah ! ah ! vous vous permettez d’être impudent, – gronda M. Vladimir, avec une intonation gutturale bizarre, qui n’était ni anglaise, ni même européenne, et qui surprit même M. Verloc, pourtant un familier des bouges cosmopolites.
– Vous osez ! Eh bien, je m’en vais vous parler en bon anglais. La voix ne suffit pas. Nous n’avons que faire de votre voix. Ce n’est pas une voix qu’il nous faut. Ce sont des actes ! des actes ! des actes !
Il décochait ses paroles, avec une sorte de retenue féroce, en pleine figure de son interlocuteur.
– Inutile d’essayer avec moi vos grands airs d’intimidation pour moujiks, – se rebiffa M. Verloc, les yeux fixés sur le tapis.
À quoi le premier secrétaire, avec un sourire moqueur au-dessus des bouts hérissés de sa cravate, reprit en français :
– Vous vous donnez comme agent provocateur. Le propre d’un agent provocateur est de provoquer. Autant que je puis en juger par le dossier que j’ai là, vous n’avez rien fait durant trois années pour gagner votre argent.
– Rien ? – s’écria M. Verloc sans bouger, sans même lever les yeux, mais d’un ton qui montrait qu’il se sentait atteint. – J’ai à diverses reprises prévenu ce qui aurait pu…
– Oui !… Je sais… Il court par ici un proverbe qui dit qu’il vaut mieux prévenir que guérir, – interrompit M. Vladimir, se carrant de nouveau dans son fauteuil. – D’une manière générale, c’est stupide ; on n’en finit jamais de prévenir, mais c’est caractéristique. On n’aime pas le définitif dans ce pays-ci. Ne soyez pas trop anglais ; et dans le cas présent, ne soyez pas absurde. Le mal existe déjà. Nous ne voulons pas prévenir, nous voulons guérir.
Il s’arrêta, et se tournant vers son bureau, se mit à feuilleter des papiers qui s’y trouvaient ; sa voix prit une autre intonation, celle d’une discussion d’affaires. Sans regarder M. Verloc, il reprit :
– Vous êtes sans doute au courant de ce qui se passe à la conférence internationale assemblée à Milan ?
M. Verloc insinua d’un accent piqué qu’il avait l’habitude de lire les journaux. À une nouvelle question, il répondit qu’il se flattait de comprendre ce qu’il lisait. À quoi M. Vladimir, adressant un léger sourire aux documents qu’il compulsait, observa :
– Et tant que ce n’est pas du latin, je suppose ?
– Ou du chinois ! – renchérit M. Verloc.
– Hum ! certaines élucubrations de vos amis les révolutionnaires sont écrites en un charabia tout aussi incompréhensible que du chinois !
Et M. Vladimir lui jeta dédaigneusement un texte imprimé sur du papier grisâtre.
– Qu’est-ce que c’est que tous ces torchons marqués de l’entête A. P. avec un marteau, une plume et une torche entrelacés ? Qu’est-ce que ça veut dire A. P. ?
M. Verloc s’approcha du bureau.
– L’Avenir du Prolétariat. C’est le titre d’une société, – expliqua-t-il, lourdement planté à côté du fauteuil ; – une société non anarchiste en principe, mais ouverte à toutes les formes de l’idée révolutionnaire.
– En faites-vous partie ?
– Je suis l’un des vice-présidents.
Le premier secrétaire leva les yeux vers lui.
– Alors vous devriez avoir honte de vous-même, – déclara-t-il, incisif. – Votre société n’est donc pas capable d’autre chose que d’imprimer ces bourdes prophétiques en caractères fatigués sur du papier malpropre… hein ? Pourquoi ne faites-vous rien ? Écoutez ! c’est moi qui prends désormais la direction du service, et je vous dirai nettement qu’il faut que vous méritiez le salaire que vous touchez. Le bon vieux temps de Stott-Wartenheim n’est plus. Pas de travail, pas d’argent !
M. Verloc sentit ses jambes se dérober sous lui. Il recula d’un pas et se moucha bruyamment.
Il était véritablement très alarmé.
Le soleil, couleur de rouille, sortant vainqueur de la lutte contre la brume de l’atmosphère londonienne, risquait un tiède rayon dans le cabinet du premier secrétaire. Le silence qui régnait dans la pièce permit à M. Verloc d’entendre le léger bourdonnement d’une mouche contre la vitre d’une fenêtre – la première mouche de l’année, – annonçant mieux qu’un vol d’hirondelles l’approche du printemps.
L’affairement inutile de cette minuscule énergie agaça ce gros homme dont on menaçait les habitudes indolentes.
Pendant cet intervalle, M. Vladimir formula dans son esprit une série de remarques peu avantageuses sur la physionomie et l’aspect de M. Verloc. Le gaillard lui parut vulgaire, massif et inintelligent à l’excès ; il ressemblait extraordinairement à un entrepreneur de plomberie venu pour présenter son mémoire. De ses excursions occasionnelles dans le domaine de l’humour américain, le premier secrétaire avait rapporté une opinion très spéciale sur cette classe d’artisans qui personnifiaient à ses yeux la mauvaise foi, la paresse et l’incompétence.
C’était donc là l’homme de confiance, le fameux agent secret, si secret qu’on ne le désignait jamais autrement que par le symbole ∆ dans la correspondance officielle, semi-officielle et confidentielle du feu baron Stott-Wartenheim ; le célèbre agent ∆ dont les avis avaient le pouvoir de changer le programme et la date des tournées royales, impériales et grand-ducales, parfois même de les ajourner tout à fait !
M. Vladimir s’abandonna en dedans de lui-même à un accès de folle hilarité, aux dépens de sa propre surprise qu’il trouvait naïve, mais surtout aux dépens du baron Stott-Wartenheim, de regrettée mémoire. Feu Son Excellence, que la faveur de son impérial maître avait maintenu ambassadeur contre le gré de plusieurs ministres des affaires étrangères, avait joui, de son vivant, d’une réputation de crédulité apeurée. Le baron était hanté par le fantôme de la révolution sociale. Il s’imaginait être un diplomate choisi par une dispensation spéciale pour assister à l’écroulement de la diplomatie, dans un effroyable bouleversement démocratique, qui, à son estime, ne pouvait que précéder de fort près la fin du monde. Ses dépêches éplorées et prophétiques avaient été, pendant de longues années, la joie des chancelleries étrangères. On raconte que, recevant à son lit de mort son impérial ami et maître, il s’était écrié : « Malheureuse Europe, tu périras par la démence morale de tes enfants. » Un tel homme devait être la victime toute désignée du premier intrigant venu ; et M. Vladimir, à cette pensée, sourit vaguement à M. Verloc.
– Vous devez vénérer la mémoire du baron Stott-Wartenheim !
La physionomie de M. Verloc revêtit l’expression de la plus vive contrariété.
– Permettez-moi de vous faire remarquer, – dit-il, – que je suis ici par ordre péremptoire. Je n’y étais venu que deux fois depuis onze ans, et jamais certainement à onze heures du matin. Il n’est guère prudent de me mander de la sorte. Je cours le risque d’être vu, ce qui ne serait pas amusant pour moi.
M. Vladimir haussa les épaules.
– Cela pourrait être préjudiciable à l’utilité de mes services, – continua Verloc s’échauffant.
– Ça, c’est votre affaire ! – fit l’autre cyniquement. – Quand vous ne nous serez plus utile…
M. Vladimir s’interrompit, cherchant une expression suffisamment colorée pour peindre exactement sa pensée, et, l’ayant trouvée presque aussitôt, il reprit, avec une féroce grimace de ses dents blanches :
– … Nous vous ficherons à la porte !
Cette fois encore, M. Verloc eut besoin de toutes ses forces pour réagir contre cette sensation d’affaissement qui lui courut au long des jambes et qui jadis inspira cette trouvaille à certain pauvre diable : « Je sentis mon cœur descendre jusque dans mes bottes. » Mais, conscient de cette défaillance, il releva bravement la tête.
M. Vladimir soutint, avec une parfaite sérénité, le regard interrogateur de M. Verloc.
– Nous voulons administrer un tonique à la conférence de Milan, – expliqua-t-il allègrement. – Ses délibérations à propos d’une action internationale, tendant à la suppression des crimes politiques, sont ineptes. L’Angleterre a besoin, elle aussi, d’un coup de fouet. Ce pays est absurde avec ses idées sentimentales sur la liberté individuelle. Il est intolérable de penser que vos amis n’ont qu’à se réfugier ici pour être à l’abri de…
– Comme cela, je les ai tous sous ma surveillance directe, – objecta le timbre enroué de M. Verloc.
– Il serait plus sûr de les tenir tous sous clef ! Il faut que l’Angleterre se rende compte de cette nécessité. Sa bourgeoisie imbécile se fait elle-même complice de ceux qui ne visent qu’à la chasser de ses demeures et la faire crever de faim dans le fossé. Elle détient encore le pouvoir politique ; il lui faut le bon sens de s’en servir pour sa conservation. Vous êtes aussi de cet avis, je suppose, que les classes moyennes sont stupides ?
M. Verloc en convint, d’une rauque approbation.
– Elles n’ont pas d’imagination. Une vanité idiote les aveugle. Ce qu’il leur faudrait maintenant, c’est une bonne petite frayeur. C’est le vrai moment de mettre vos amis à l’œuvre. Et je vous ai mandé pour vous exposer mon idée à ce propos.
M. Vladimir, en effet, exposa son plan avec une condescendance dédaigneuse, tout en faisant preuve d’une telle ignorance des visées, de l’esprit et des moyens du parti révolutionnaire, que son interlocuteur qui l’écoutait en silence en restait atterré. Plus qu’il n’était permis, il confondait les causes et les effets, les plus distingués propagandistes avec les impulsifs jeteurs de bombes ; il présumait une organisation, là où, par la nature même des choses, il n’en pouvait pas exister ; tantôt, il parlait du parti socialiste révolutionnaire comme d’une armée parfaitement disciplinée où les chefs donnent des ordres suprêmes, et tantôt comme de la plus indocile troupe de brigands qui ait jamais campé dans une gorge de montagnes.
M. Verloc essaya bien de protester, mais à peine ouvrait-il la bouche qu’une main blanche aux contours délicats s’élevait pour lui imposer silence. Bientôt même son ahurissement paralysa en lui toute tentative de protestation ; et l’effroi qui l’immobilisait lui prêtait l’apparence de l’attention la plus soutenue.
– Une série d’attentats, – discourait tranquillement M. Vladimir, – non pas seulement conçus, mais exécutés, ici, non pas ailleurs, voilà ce qu’il faudrait. Vos amis pourraient mettre le feu à la moitié du continent que cela n’influencerait pas l’opinion publique anglaise en faveur d’une législation universelle pour la répression de la propagande par le fait. Ici, ils ne veulent pas voir au-delà des murs de leur jardin.
M. Verloc toussa comme s’il allait parler, mais le cœur lui manqua, et il ne dit rien.
– Il n’est pas indispensable que ces attentats soient sanguinaires, – continua M. Vladimir, comme s’il allouait cette concession au préjugé, – mais il faut qu’ils soient suffisamment démonstratifs ; qu’ils soient dirigés contre les édifices, par exemple. Quel est le fétiche du moment pour toute la bourgeoisie ?
M. Verloc écarta les bras en levant les épaules.
– Vous êtes trop paresseux pour prendre la peine de réfléchir, n’est-ce pas ? – ricana M. Vladimir, pour commenter ce geste. – Suivez-moi alors ! Le fétiche du jour n’est ni la royauté ni la religion. Il faut donc laisser en paix le palais et l’église. Comprenez-vous ?
La stupéfaction et la colère poussèrent M. Verloc à se risquer jusqu’au badinage.
– Parfaitement. Que penseriez-vous des ambassades ? D’une série d’attentats contre les diverses ambassades, par exemple ?
– Vous savez être facétieux, à ce que je vois ! – articula le premier secrétaire d’un ton de glacial dédain. – Mais ce n’est ni l’heure ni l’endroit ! Il serait infiniment plus sage à vous de me suivre avec attention, et, comme on exige de vous de produire des faits et non des racontars à dormir debout, vous feriez beaucoup mieux de tâcher de tirer profit de ce que je prends la peine de vous démontrer. Je continue. Le sacro-saint fétiche du jour, c’est la science ! Pourquoi ne pousseriez-vous pas quelqu’un de vos amis à marcher contre cette idole à figure de bois ? Ne fait-elle donc pas partie de ces institutions qui doivent disparaître avant que puisse se réaliser l’A. P. ?
M. Verloc ne dit mot ; il évitait d’ouvrir la bouche, de peur qu’un gémissement ne lui échappât.





























