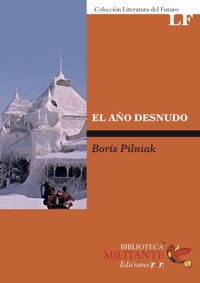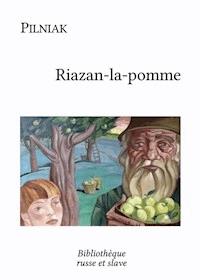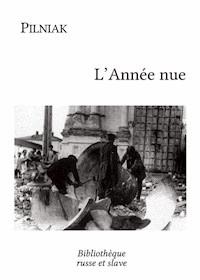
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Bibliothèque russe et slave
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L'Année nue, c'est l'année 1919, année de misère où le vent terrible de la Révolution souffle sur la Russie et arrache l'ordre ancien, année où l'on dénude les églises de leurs icônes et de leur sacré.
Boris Pilniak fut le premier à décrire, en une suite de tableaux éclatés, lyriques, surréalistes, mouvants comme les trains dans lesquels s'entassent les déshérités en fuite, la réalité tragique de son temps. Son livre, adulé et décrié, le mit à sa parution en 1922 au premier rang de la nouvelle génération des écrivains russes.
Traduction de L. Bernstein et L. Desormonts, 1926, révisée, annotée et postfacée par Dany Savelli, 1998.
EXTRAIT
En ville, à la ville comme à la ville.
L’ancienne ville est morte. La ville a mille ans.
Le ciel ardent de juillet verse sa chaleur ardente, et le crépuscule jaune, ce soir, se prolongera... Le ciel ardent se tend de bleu et d’infini ; les chapelles, le couvent, les maisons, la terre flambent. On rêve tout éveillé. Dans le silence profond, les cloches de la cathédrale ont des résonances de cristal ; toutes les cinq minutes, elles font : don ! don ! don !... En ces jours-là, on rêve tout éveillé...
Au-dessus de la grand’porte du couvent, une enseigne avec une étoile rouge :
« Sûreté du peuple du sovdiep d’Ordynine. »
À PROPOS DE L'AUTEUR
Boris Andreïevitch Pilniak (Mojaïsk, 11 octobre 1894 - Moscou, 21 avril 1938) est un écrivain russe. Auteur critique à l'égard de la mécanisation et de l'urbanisation de l'URSS, il a écrit plusieurs romans dont le cadre est la Révolution de 1917. Cet esprit critique, comme la richesse et la complexité de son écriture, lui ont valu d'être progressivement mis au ban des écrivains soviétiques et, pour finir, d'être victime des Grandes Purges de 1937.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 329
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
BIBLIOTHÈQUE RUSSE ET SLAVE
— LITTÉRATURE RUSSE —
Boris Pilniak
Пильняк Борис Андреевич
1894-1938
L’ANNÉE NUE
Голый год
1922
Traduction de L. Desormonts et L. Bernstein, 1926 révisée et complétée avec une postface et des notes par Dany Savelli, 1998.
© La Bibliothèque russe et slave, 2015
© Louise Desormonts et Léon Bernstein, 1926 ; Dany Savelli, 1998, 2016
Couverture : La destruction des cloches de l’Église de Mojaïsk en 1929.
Note au lecteur
On dénombre sept éditions de L’Année nue parues du vivant de Boris Pilniak. Il convient d’y ajouter un recueil de nouvelles parues sous le titre Les Chemins oubliés en 1920, ainsi que trois nouvelles parues en 1921 et 1922 contenant toutes de nombreux passages repris dans L’Année nue.
L’édition Gallimard de 1926, qui est la base de notre édition, faisait abstraction du dernier chapitre, de la conclusion et de divers passages concernant notamment le Kitaï-Gorod et le tchékiste Laïtiss.
Sans proposer une édition académique présentant de façon exhaustive les versions successives du texte, nous avons souhaité, à partir de la traduction de L. Bernstein et de L. Desormonts, restituer un texte plus complet.
Dans l’ouvrage L’Existence réfléchie ou Coup d’œil moral sur le prix de la vie, on lit : « Chaque moment jure au destin de garder sur notre sort un profond silence, jusqu’à ce qu’il vienne se mêler au cours de notre vie ; et tandis que l’avenir se tait sur notre destinée, chaque moment qui passe peut commencer l’éternité1. »
1. Citation extraite de Plaintes ou pensées nocturnes sur la vie, la mort et l’immortalité de l’écrivain anglais Edward Young (1681-1765). En citant un passage de ce long poème plus connu sous le titre Les Nuits, Pilniak reprend en fait une traduction russe publiée à Moscou en 1787 qui, elle-même, fut établie à partir de l’adaptation française — très libre — de Le Tourneur parue pour la première fois en 1769. Nous redonnons ici le texte français.
Ceux qui sont nés aux mornes époques
Ne se souviennent pas de leur route.
Nous autres, enfants des années terribles de Russie,
Nous ne pouvons rien oublier.
A. BLOK2
2. Cette épigraphe extraite d’un célèbre poème écrit par Blok en 1914 et dédié à Zinaïda Gippius figurait en tête de l’ouvrage des éditions de 1922, 1923 et 1924. Ce n’est qu’à partir de l’édition de 1927 qu’elle fut placée après l’épigraphe extraite des Nuits de Young.
La ville d’Ordynine
La porte du Kremlin de la ville portait l’inscription suivante (aujourd’hui effacée) :
GARDE CETTE VILLE SEIGNEUR !
ET SES HABITANTS !
ET BÉNIS CEUX
QUI FRANCHISSENT CETTE PORTE !
Et voici un extrait des annales du Conseil des curateurs d’Ordynine :
1794, lundi 17 janvier. Se sont réunis à midi, au Conseil des curateurs, les sieurs ci-après nommés :
Démenty Ratchine, maire de cette ville ;
Les conseillers Sémione Toulinov et Stépane Illine ; Stépane Ziabrov, conseiller et staroste de cette ville.
Qui, après délibération, ont statué : remercier l’éminent et probe Démenty Ratchine, maire de cette ville, et lui rendre hommage.
Ont signé...
La séance étant levée à deux heures de l’après-midi, les susnommés se rendirent à la cathédrale pour le Te Deum.
Cette résolution, inscrite juste un siècle avant la naissance de Donat Ratchine, fut découverte par lui lorsqu’il saccagea les archives d’Ordynine. Elle était écrite sur papier bleuté, avec une plume d’oie, et en lettres agrémentées d’amusantes fioritures.
L’importante maison des marchands Ratchine comptait deux siècles d’existence. D’abord employés des gabelles, puis marchands de farines et de bestiaux pendant deux cents ans (bisaïeul, aïeul, père, fils, petit-fils, arrière-petit-fils), ils n’avaient pas bougé de derrière leur comptoir, sur la place du Marché (aujourd’hui place Rouge), dans la halle au sel (aujourd’hui démolie). Chaque jour, immuables, ils faisaient claquer les billes de leur boulier, jouaient aux dames, buvaient du thé à même la théière (afin de bien en asperger le sol), recevaient les clients, et terrorisaient leurs commis...
Un jour, il y a quarante ans de cela, Ivan Ratchine, jeune homme aux cheveux bouclés, petit-fils de Démenty et père de Donat, vint prendre sa place au comptoir des aïeux. Puis, bien des choses changèrent ; il se dessécha, devint chauve, porta des lunettes, ne quitta plus ni sa canne, ni sa redingote fourrée, ni sa casquette ouatée. Il avait vu le jour en ce lieu même de Zariadié3, dans la maison familiale à deux étages, adossée à la boutique, et dont deux molosses gardaient l’entrée. Il y était né, il y avait amené sa femme, il en avait fait emporter le cercueil de son père, il y était le maître.
Dans le Kremlin se dressaient des églises et des bâtiments publics ; au-dessous du Kremlin, au bas du ravin, coulait la Vologa ; de l’autre côté de la rivière s’étendaient des prairies ; puis venaient le faubourg de la Yama et le couvent de Redenev — quant au chemin de fer, à cette époque, il passait à cent verstes de là. Toute la journée et toute la nuit, de cinq en cinq minutes, l’horloge de la cathédrale sonnait : don ! don ! don !
Et au Kremlin (les rues étant pavées, on n’y gardait pas de cochons), les oies étaient les premières à s’éveiller, mais bientôt après paraissaient les ivrognes, les mendiants, les dévots, puis les agents de police qui se rendaient à l’Administration avec des tables sur la tête. (Le gouverneur de la ville ayant donné ordre aux brigadiers de police de faire des rondes de nuit et de signer à cet effet des registres cloués aux tables des postes, les brigadiers, pour observer l’ordre et signer, se faisaient apporter ces tables le matin, à leur bureau.) La nuit, on ne laissait pas volontiers les gens circuler, et lorsqu’un agent à demi assoupi vous demandait : « Qui va là ? », il s’agissait de répondre vivement : « Habitant ! »
Selon la coutume établie, les gens amenés au poste de police étaient roués de coups, avec cruauté, avec raffinement, surtout les pochards. Le brigadier Babotchkine s’y était même spécialisé. Les ivrognes se réunissaient dès le petit jour devant le débit du Monopole, s’asseyaient dans l’herbe et attendaient patiemment l’ouverture. Les marchands qui passaient devant eux se signaient.
Venant de la rivière avec ses cannes à pêche, le père Levkoïev, pêcheur acharné, passait bientôt lui aussi ; il allait à pas pressés ouvrir à l’heure fixée la boutique diocésaine. Cet homme respecté n’avait qu’un défaut qui tenait à sa passion pour la pêche : c’était de laisser en été les vers de terre s’échapper de ses poches (ce qui lui valut d’être dénoncé à l’évêque par le poète et délateur Varyguine). L’ivrogne Ogoniok le Classique criait sur ses talons :
— Très honoré monsieur ! Vous comprenez ?
Mais le père Levkoïev poursuivait sa route sans répondre. Aussitôt après, le professeur Blanmanjov, portant sarrau de toile, parapluie et caoutchoucs, sortait par la porte de son jardin pour suivre le père Levkoïev dans sa boutique, où ils prenaient le thé et conversaient ensemble. Ogoniok le Classique d’un pas assuré s’avançait et lui disait :
— Généreux monsieur ! Vous comprenez ?4 Ogoniok le Classique vous parle !...
Blanmanjov lui tendait quelque menue monnaie. Blanmanjov était célèbre par ses connaissances géographiques et par sa femme qui, pour se rendre à l’église, mettait un diadème, et chez elle, en été comme en automne, se tenait en chemise à la fenêtre de sa maison pour y vendre les fruits de son jardin.
Le lutteur Trouscov venait aussi boire ses deux fioles de vodka au débit du Monopole. Des camelots, des colporteurs y entraient aussi avant d’aller s’installer au marché. Après avoir acheté leurs infâmes saucissons, les pochards se dispersaient et allaient vaquer à leurs affaires. Des cochers, perchés sur leur haut siège, faisaient une halte et, à demi endormis, réclamaient :
— S’il vous... ! S’il vous... !
Le soleil se levait sur la ville, toujours resplendissant, toujours merveilleux. Les printemps, les automnes, les hivers splendides et merveilleux passaient sur la terre et sur la ville...
Au printemps, les vieilles femmes fêtaient la semaine de Nicolas Radovanetz5 et, pour la fête de Notre-Dame-de-Kazan6, elles partaient en pèlerinage, elles écoutaient les alouettes et se lamentaient sur le temps passé. Chaque automne, les garçonnets lançaient des cerfs-volants, pourvus de crécelles. Chaque automne, chaque hiver, jusqu’au grand carême et ensuite après Pâques, les marieuses se démenaient pour fournir des fiancées aux jeunes gens, et des femmes de soldats, des veuves, des vierges aux marchands. Au cours des réceptions chez les parents, les employés de poste s’entretenaient de littérature et de géographie avec les fiancées ; la jeune fille disait ses préférences pour le poète Lajetchnikov7 et son prétendant déclarait son goût pour l’écrivain Nadson8. La conversation sur la littérature se trouvant de ce chef épuisée, on passait à la géographie ; la fiancée disait être allée au cimetière durant la semaine de Nicolas Radovanetz, et le fiancé donnait des renseignements sur Varsovie ou Louban, où il avait fait son service militaire.
À la Saint-Nicolas du printemps, à la Saint-Pierre et pendant la semaine du mardi gras se tenaient des foires. Les joueurs d’orgue de Barbarie, les prestidigitateurs, les acrobates affluaient et montaient des baraques ; les artistes distribuaient eux-mêmes leurs programmes. Et la foire finie, les marchands allaient en cachette consulter le docteur Eléazaritch. Durant l’hiver, le samedi, on allait à l’établissement de bains ; le propriétaire avait fait construire un couloir abrité menant à la rivière, jusqu’au trou ménagé dans la glace, où les marchands, après leur bain de vapeur, couraient tout nus faire un ou deux plongeons.
Le dimanche, on organisait des pugilats ; on se battait avec ceux de la Yama et de Redenev ; les gamins ouvraient d’abord la lutte en poussant des « vas-y ! vas-y ! », puis les hommes adultes se jetaient à leur tour dans la mêlée. Mais tout cela n’empêchait pas les marchands d’aller le soir au faubourg de la Yama festoyer chez les tziganes et y faire proliférer les petits tziganes à taches de rousseurs, puis de s’en retourner en renversant quelques réverbères au passage.
La veille de Noël, on ne dînait pas avant l’apparition des étoiles dans le ciel ; le jour de Noël on chantait les louanges du Christ et on se contait des histoires ; le soir du jour des Rois, on traçait à la craie des croix sur toutes les portes.
Les événements étaient rares, et ceux qui se produisaient étaient du genre que voici :
Michka Tsvélev, fils du serrurier, et Hippolitka, fils de l’employé de l’accise, s’amusaient avec une souris qu’ils tenaient par la queue, lorsque le fou Yermil le Borgne, passant par là, se mit à lancer des pierres dans les vitres. Isvély, le serrurier, un couperet à la main, se précipita sur lui ; le fou lui arracha le couperet qu’il brandit contre des pompiers qui passaient par là ; ceux-ci s’enfuirent ; mais le brigadier Babotchkine parvint à maîtriser le fou. Pendant les trois jours qui suivirent, Michka fut abondamment rossé...
De tels événements alimentaient les conversations pendant six mois. Une fois tous les deux ans, les détenus s’évadaient de la prison, et on leur donnait la chasse à travers les rues.
Dans la halle au sel, sur la place du Marché, près de la boutique du diocèse, s’élevait la baraque de l’unique librairie de la ville ; elle portait cette enseigne :
ACHAT ET VENTE
de livres d’écoles, d’encre, plumes, porte-plumes
ET AUTres éditions périodiques, et de fourniture.
A. V. VARYGUINE
La boutique diocésaine se nichait sous l’icône des quarante martyrs devant laquelle les marchands, le jour de la fête de leur patron, venaient faire donner une prière. Dans cette boutique les icônes ne s’achetaient pas, elles s’échangeaient : le client se procurait une casquette neuve, y jetait quelques pièces d’argent, et troquait cette casquette contre l’icône choisie.
Les casquettes étaient destinées au séminaire. Le père Levkoïev, gérant de la boutique, rêvait de fonder, à l’exemple de Jésus-Christ, une « fraternelle » de pêcheurs ; et il se voyait à la réunion générale résolvant le problème qu’il se posait depuis longtemps, à savoir comment il fallait immobiliser les bateaux à la pêche : avec une pierre, à l’ancre ou à l’amarre ? On jouait aux dames dans sa boutique ; elle servait de centre de réunion aux intellectuels : le professeur Blanmanjov et le libraire Varyguine.
Le club du commerce se trouvait chez le marchand de savon Ziabrov, grand amateur d’incendies ; là se tenaient en permanence les « ablocats » et les bonnes langues : les premiers rédigeant requêtes ou dénonciations, les seconds témoignant de tout ce qu’on voulait.
À travers les halles rôdaient des mendiants et des pauvres d’esprit, objets de distraction pour Ziabrov ; en hiver, il collait avec de la salive une pièce de monnaie sur les dalles et obligeait ceux qui voulaient en profiter à arracher cette pièce avec leurs dents ; en été, il offrait dix kopecks à celui qui avalerait un plein seau d’eau (Tiga-goga le Simple y parvenait), ou bien il organisait des courses comme on en voit lors des parades de pompiers.
Ziabrov aimait aussi à faire des farces aux passants : il laissait traîner hors de sa boutique une montre attachée à un fil, ou déposait dans la rue une boîte à bonbons contenant tantôt des cafards, tantôt un rat crevé.
Les halles étaient sombres, humides, elles sentaient le rat, les peaux moisies, le hareng pourri.
Ivan Emélianovitch Ratchine, grand vieillard maigre, coiffé d’une casquette ouatée, arrivait dans sa boutique à sept heures moins cinq, faisait sonner ses clefs, et initiait commis et apprentis aux secrets du métier, aux paroles à prononcer en présence des clients :
non pas « on sert », mais « on balance »,
non pas « céder », mais « fourrer »,
non pas « vend », mais « épingle »,
non pas « marchande », mais « prête serment »,
non pas 150 roubles 50 kopecks, mais artsi-ji-on kon ije-on-koun,
non pas 90, mais du dur-rrr.
Ouvrir la porte aux clients, la refermer derrière eux : vendre, c’est duper. Ivan Emélianovitch Ratchine se retirait dans son bureau, calculait sur son boulier, lisait la Bible à voix haute et appelait ses commis pris en faute — pour les apprentis, il n’y avait pas besoin de motif — ; sous la veilleuse immuable, il administrait les punitions, selon leur degré d’importance, tantôt avec un fouet à double lanière, tantôt avec un fouet à lanières multiples. À midi, heure du boulanger, il distribuait aux commis cinq kopecks et aux apprentis trois, puis il allait chez le père Levkoïev jouer aux dames à dix kopecks la partie, et gagnait sans vergogne toutes les parties. Ratchine ne se souciait guère des commérages, ne parlait qu’à ses acheteurs en gros, et encore d’un ton très bourru.
La fermeture des halles avait lieu à sept heures et demie, et à huit les chiens seuls y rôdaient. À neuf, dans la ville endormie, à la question : « Qui va là ? », il fallait, pour ne pas être conduit au poste, répondre vivement : « Habitant ! »
Dans la maison d’Ivan Ratchine, derrière les portes gardées par des molosses, le silence était de rigueur. Cependant, le soir, du sous-sol où logeaient commis et apprentis s’élevaient des psaumes et des cantiques. Ivan Emélianovitch lui-même dirigeait le chœur, armé de l’archine dont il se servait dans la journée pour corriger son monde. Dès leur rentrée, on enlevait aux commis vestons et bottines, et aux apprentis leur culotte, pour les empêcher de sortir la nuit. Le sous-sol avait des fenêtres grillées ; et la veilleuse devant l’icône en était l’unique éclairage. Le soir, à table, Ivan Emélianovitch coupait le lard dans le plat de choux commun, y puisait le premier, donnait un coup de sa cuillère en bois sur le front de ceux qui rêvassaient, et personne n’avait le droit de toucher au lard avant qu’il n’ait dit :
— À toi de manger.
On n’appelait jamais Ivan Emélianovitch autrement que le papa ou bien lui, et on vivait en observant le dicton : « Le papa va venir et il mettra de l’ordre9. » Ivan Emélianovitch avait une femme épaisse qui lisait l’avenir dans le marc de café ; mais il ne couchait pas avec elle, il couchait avec Machoukha, la femme de charge.
Avant de se mettre au lit, Ivan Emélianovitch lisait les psaumes, priait longuement pour son commerce et ses enfants, pour les trépassés, pour ceux qui voyagent et qui sont en mer. Il dormait peu, et d’un sommeil léger, comme tous les vieillards. Levé le premier, avant l’aurore, il priait de nouveau, prenait du thé, donnait des ordres et se rendait à sa boutique. Sans lui, on se sentait plus à l’aise dans la maison, peut-être aussi parce qu’il faisait jour. De tous les recoins sortaient de vieilles dévotes hébergées par madame Ratchine. Chaque samedi, après les vêpres, Ivan Emélianovitch fouettait son fils Donat. À Noël et à Pâques on recevait les parents. Le 24 juin (après la nuit d’ivresse de la Saint-Jean), jour de fête d’Ivan Emélianovitch, on offrait un repas aux mendiants dans la cour. Le dimanche de la Passion, commis et apprentis venaient s’incliner très bas devant le maître qui leur disait à chacun : « Ouvre la bouche, souffle ! » pour sentir s’ils avaient bu de la vodka.
Ainsi s’écoulèrent quarante ans : entre la maison et la boutique, entre la Bible et les coups, entre l’épouse et Machoukha. Chaque jour, modelé sur le précédent, avait façonné, quarante années durant, la vie de Ratchine ; tout s’y était introduit sans bruit : la femme, les enfants, la mort du père, la vieillesse...
Donat, son fils, venu au monde beau et fort, eut une enfance comblée ; il eut des osselets, des pistolets, des cerfs-volants garnis de crécelles, des pigeons, des pièges à chardonnerets, on lui permit les baignades dans la rivière, les glissades sur la glace, la vente et l’achat de fers à cheval, le pugilat — tout cela durant les années où Donat était encore trop petit pour qu’on fît attention à lui. L’ayant remarqué un jour, vers ses quinze ans, son père lui fit faire des bottes neuves, un pantalon, une casquette, lui interdit de sortir de la maison sauf pour se rendre à l’école et à l’église, surveilla son écriture, qu’il voulait régulière, et lui donna le fouet tous les samedis.
Donat était devenu un grand jeune homme aux cheveux blonds bouclés, au cœur aimant. À l’école, le professeur Blanmanjov l’obligeait, ainsi que tous ses élèves, à voyager sur la carte jusqu’à Jérusalem, jusqu’à Tokyo (par eau et par terre), Buenos Aires, New York (indiquer les rivières, les distances ; décrire les villes, les gens, la flore, la faune). À l’école on ne s’occupait que de géographie, et moins de géographie que de voyages. Blanmanjov ordonnait d’apprendre pour le lendemain comment se rendre au Yorkshire. Ce fut alors que fleurit le premier amour de Donat, amour ravissant et merveilleux, comme tout premier amour. Donat s’éprit de la jeune servante Nastia, douce fille aux yeux noirs. Le soir venu, il entrait à la cuisine pour y lire à haute voix et avec une pieuse dévotion la Vie des saints ; et Nastia, assise en face de lui, la tête appuyée sur ses mains, un fichu noir sur les cheveux, écoutait. Et qu’importe qu’elle fût la seule à écouter ! Donat lisait avec ferveur et son âme irradiait de bonheur.
D’ordinaire on ne pouvait pas sortir de la maison ; c’était carême ; on jeûnait ; et le soir on allait à l’église. Avril était transparent, les rigoles bruissaient, les oiseaux s’affairaient autour de leurs nids, le crépuscule tombait avec lenteur, les cloches mariaient leurs sons — et se tenant par la main, Donat et Nastia passaient d’une église dans l’autre (il y avait à Ordynine vingt-sept églises), sans se parler, tout entiers à leur unique, à leur immense joie. Mais le professeur Blanmanjov qui se rendait aussi chaque soir à l’église, remarqua Donat et Nastia, raconta la chose au père Levkoïev, qui avertit Ivan Emélianovitch. Ivan Emélianovitch appela Donat et Nastia. Relevant la jupe de Nastia, il ordonna au commis principal (devant Donat) de fouetter le corps nu de Nastia avec un fouet à lanières ; ensuite (devant Nastia), il rabattit la culotte de Donat et le fustigea de ses propres mains. Le même soir, il chassait Nastia, la renvoyant à son village, et la nuit venue, il envoya Machoukha à Donat. Le lendemain, le professeur Blanmanjov obligea Donat à voyager à travers le Tibet, jusque chez le Dalaï-Lama, et lui mit un zéro vu qu’on ne permet pas aux Européens de pénétrer jusque chez le Dalaï-Lama. Ce carême, avec ses crépuscules, ses cloches, les yeux doux de Nastia, devait rester pour toujours le plus beau de ceux que connut le fils Ratchine.
Bientôt les commis apprirent à Donat à se faufiler la nuit à travers le vasistas et la grille sciée, puis à sauter par-dessus la clôture, pour courir au faubourg de la Yama et chercher de la vodka à la taverne Europe. Il dut aussi suivre son père à la boutique. Les jours de fête, il se faisait beau et allait se promener dans la rue Bolchaïa Moskovskaïa. Il se prit d’amitié pour un moine officiant, le père Pimen, du couvent de Beloborsk. En été, de grand matin, par la rosée, il allait se baigner avec lui dans l’étang du couvent ou bien errait dans le parc ; rentrés dans la cellule du moine, garnie de croix et d’icônes, d’un ficus en pot et d’une cage à canaris, ils buvaient ensemble de la liqueur de cassis. Le père Pimen parlait des dévotes qui venaient chez lui en pèlerinage, et lisait à Donat des vers de son cru, qui sonnaient comme suit :
O fille ! beau lys de paradis,
Je t’en supplie, je t’en prie,
Regarde-moi pieusement,
Et je t’aimerai passionnément10.
Parfois aussi, avec d’autres moines, Donat allait dans un endroit bien caché, le beffroi de Marina ; alors on envoyait des gamins chercher de la vodka, on buvait et chantait la chanson de Copernic11 et celle de Sachka-canaill’ka en modulant le refrain selon un air de requiem.
Certains jours, une fois le soleil couché, le père Pimen revêtait une tunique d’étudiant pour accompagner Donat au cirque. Le couvent était ancien, avec des églises profondément enracinées dans le sol, des murs mornes, de vieux clochers ; le père Pimen aimait à raconter à Donat les vieilles légendes de la ville d’Ordynine. Il lui fit aussi connaître la belle Ouryvaiev.
Durant les nuits de juin, escaladant la clôture, une bouteille de vodka sous le bras, Donat venait rejoindre cette belle femme, veuve d’un usurier millionnaire. Il frappait au carreau, enjambait la fenêtre, entrait dans sa chambre à coucher, la retrouvait dans son grand lit à deux places. Ils s’aimaient passionnément, causaient, se haïssaient, se maudissaient. L’usurier Ouryvaiev avait épousé à soixante-dix ans les dix-sept printemps d’Olenka pour la pervertir lors d’orgies au monastère. Il avait extirpé chez elle tout naturel, et fait d’elle, par testament, une mineure. La belle Ouryvaiev était devenue une ivrognesse, une hystérique ; la ville se mit à la sermonner, à la « catéchiser ». Ce dernier amour de Donat fut aussi de courte durée. Cette fois, ce fut en vers que le poète délateur Varyguine composa sa dénonciation.
Qui sait ?
Qui sait ce que serait devenu Donat ?
En 1914, en juin et juillet, les herbes et les forêts flambaient dans la pourpre des incendies, le soleil se levait et se couchait comme un disque rouge, et les hommes suffoquaient, les hommes languissaient effroyablement.
En 1914 la guerre s’alluma, et après elle, en 1917, la révolution.
Dans la vieille cité d’Ordynine, on rassembla les hommes, on leur apprit le métier de tuer et on les envoya dans les marais de Bélovièje, dans la Galicie, dans les Carpathes. Tuer et mourir ! Donat fut expédié dans les Carpathes. Les soldats partaient, accompagnés par les gens de la ville jusqu’au faubourg de la Yama.
Le premier qui périt fut Ogoniok le Classique, l’honnête ivrogne, ancien étudiant, qui se pendit en laissant le billet suivant :
Je meurs, ne pouvant vivre sans vodka. Citoyens et camarades de la nouvelle aurore ! quand une classe s’épuise, il ne lui reste qu’à mourir, et mieux vaut alors qu’elle s’en aille de son plein gré.
Je meurs à l’aube d’une ère nouvelle.
Ogoniok le Classique disparut avant l’aube.
En 1916, on fit passer non loin d’Ordynine, droit vers l’usine de Taïegevo, une ligne de chemin de fer. Une dernière fois, les marchands, les « pères de la ville », usèrent de ruse : ils donnèrent leur assentiment aux ingénieurs qui demandaient un pot-de-vin, mais fixèrent une somme si dérisoire que ceux-ci établirent aussitôt la station à dix verstes de la ville, près de l’usine. Les trains filaient devant Ordynine comme des possédés. Cependant, les habitants fêtèrent le passage du premier train ; ils allèrent tous jusqu’à la Vologa pour le voir ; les gamins, pour être mieux placés, grimpèrent sur les saules et sur les toits.
Le premier train qui s’arrêta devant la ville même d’Ordynine fut le train révolutionnaire qui ramenait Donat débordant des souvenirs (de triste mémoire) de son enfance, débordant aussi de haine et d’énergie. Donat ignorait l’avenir mais connaissait trop bien le passé haïssable qu’il voulait détruire. Donat, qui arrivait pour créer, n’alla pas dans la maison de son père.
Dans la vieille ville, dans le Kremlin mort, on manifestait avec des drapeaux, on chantait des chansons rouges, on chantait et on manifestait en foule à travers cette ville de marchands où, naguère encore, le sommeil était profond... À travers cette ville ancienne et pieuse, avec ses couvents, ses églises, ses beffrois, ses rues pavées, où naguère la vie ne palpitait que derrière de hautes murailles, et des portes gardées par des molosses... Autour d’Ordynine s’étendaient des forêts — et dans ces forêts flambaient les maisons ancestrales des nobles. Les moujiks arrivaient des forêts chargés de sacs de provisions et de blé.
La maison du marchand Ratchine fut réquisitionnée pour la garde rouge. Donat alla se loger dans celle du professeur Blanmanjov ; il ne sortait plus sans son fusil : ses cheveux restaient bouclés, mais ses yeux pétillaient de passion et de haine... La halle au sel fut rasée. Des milliers de rats s’enfuirent de dessous les planchers ; du lard fut découvert dans les caves ; des crânes et des ossements humains dans les fondations... On détruisit, on rasa la halle au sel et, par ordre de Donat, on construisit sur son emplacement une Maison du Peuple.
Ce serait tout.
Mais il y a encore ceci — allez vérifier vous-même, si l’envie vous en prend ! —, chaque jour à sept heures moins cinq, devant la Maison du Peuple en construction, juste sur l’emplacement où se trouvait la boutique Ratchine et Fils, arrive un vieillard tout cassé, portant des lunettes rondes et une casquette ouatée ; il s’avance, courbé sur son bâton ; il vient s’asseoir sur une borne, et demeure là toute la journée, jusqu’à sept heures et demie du soir. C’est Ivan Emélianovitch Ratchine, petit-fils de Démenty.
En ville, c’est la famine, l’affliction et la joie, les larmes et les rires. Les printemps, les automnes, les hivers passent sur la ville. Et le long de la nouvelle voie ferrée rampent des hommes chargés de sacs, et la variole, et le typhus.
Au-dessus de la porte du Kremlin, la vieille inscription ne se voit plus :
GARDE CETTE VILLE SEIGNEUR !
ET SES HABITANTS !
ET BÉNIS CEUX
QUI FRANCHISSENT CETTE PORTE !
D’ailleurs, à part ses marchands, la ville d’Ordynine possédait aussi ses nobles, ses artisans, ses intellectuels de toute provenance. Elle se dressait au-delà de la Kama, à mille lieues de toute autre ville, parmi les forêts, et les blancs y firent leur entrée.
Dans ses chroniques, un historien obscur a parlé de ses terres en ces termes :
« Ordynine est une ville de pierre ; ses terres sont riches en pierre qui brûle, et en aimant qui attire le fer. »
C’est pourquoi derrière la ville se dresse une usine métallurgique. Jusqu’à l’horizon lointain se succèdent vallées, ravins, étangs, lacs, forêts, clairières, marais, champs, ciel doux, chemins de traverse. La voûte du ciel, parfois, est triste, couverte de nuées gris-bleu. La forêt, parfois, se lamente et gémit, et parfois aussi, l’été, elle flambe ; les chemins de traverse se traînent et serpentent sans commencement ni fin, on s’ennuie à les suivre : on croit prendre un raccourci, on s’écarte, on s’égare, et voilà qu’on est revenu à son point de départ !... Deux ornières, du plantain, le sentier battu, et tout autour, c’est le blé, ou la neige, ou la forêt, sans commencement, sans fin... On suit les ornières en chantonnant et, pour plus d’un, ces chansons sont tout aussi mélancoliques que le chemin lui-même. Ordynine est née de ces chansons et de ces chemins, avec eux, par eux et en eux.
Dans sa chronique La Grande Russie, la Religion et la Révolution, Sylvestre, archevêque d’Ordynine, a ainsi évoqué les habitants de cette contrée :
Ils vivaient dans les forêts, comme des bêtes ; ils se nourrissaient de choses impures ; ils juraient devant leur père et devant leur bru ; ils ignoraient le mariage, mais durant les fêtes qui réunissaient les bourgades, durant les jeux, les danses, les ébats démoniaques, ils enlevaient des filles, et ensuite s’arrangeaient avec elles ; ils avaient deux à trois femmes chacun ; quand l’un d’eux venait à mourir, ils honoraient sa mémoire par une ripaille, préparaient un grand bûcher, y déposaient le mort et le brûlaient ; ils recueillaient ensuite ses ossements dans un petit récipient qu’ils déposaient sur une borne le long d’un chemin. Toutes choses qu’ils font encore à ce jour12.
Et la chanson d’aujourd’hui au cœur de la tourmente :
— Tourmente. Sapins. Clairière. Angoisses.
— Chooïaïa, chooïaïa, choooïaïaïa...
— Gvi-i-ouou, gua-a-ou, gvi-i-i-ou-ou-ou, gvi-i-i-i-iou-ououou, gua-a-a-ouou.
Et :
— Gla-vboumm !
— Gla-vboumm !
— Gou-vouz ! Gou-ou-vououz !
— Choooï, gvi-i-ou-ou, gua-a-a-ououou...
— Gla-vboummm13 !
Et :
Le Kitaï-Gorod14
Et extrait d’une de ses errances, une des errances de la Chine... Pour commencer... à Moscou, dans le Kitaï-Gorod derrière la muraille chinoise, dans les impasses et les arrière-cours, à la lueur des réverbères à gaz : un désert de pierre. De jour, le Kitaï-Gorod, derrière le mur chinois, s’affaire par millions de personnes et par millions de vies humaines (en chapeaux melons, chapeaux de feutre et caftans), lui-même en chapeau melon et muni d’une serviette d’obligations, d’actions, de billets à ordre, de factures, de documents boursiers — bourses d’icônes, de peaux, de produits manufacturés, de raisins secs, d’or, de platine, de Martianitch —, coiffé d’un chapeau melon, l’Europe exactement. Mais, la nuit, les chapeaux melons disparaissent des arrière-cours et des ruelles aux maisons en pierre, le vide et le silence se font, des chiens à l’affût errent, les réverbères répandent une lumière blafarde sur les pierres, et, aussi rares que les chiens, les gens, en casquettes, vont et viennent dans le Zariadié uniquement. Et alors, dans ce désert, elle sort en rampant des arrière-cours et de par-dessous les portes cochères, elle, la Chine, sans chapeau melon, l’Empire céleste, qui s’étend quelque part en Orient au-delà la steppe, au-delà la grande muraille, et qui regarde le monde de ses yeux bridés, semblables à des boutons de capotes de soldats russes15. Cela, c’est un des Kitaï-Gorod.
Et le second Kitaï-Gorod. À Nijni-Novgorod16, à Kanavino, après Saint-Macaire où l’Iliinka17 diurne de Moscou a casé son gros postérieur, en novembre, après septembre et ses millions de pouds, de tonneaux, d’affaires, d’archines18 et de quarts de marchandises échangés contre des roubles, des francs, des marks, des livres, des dollars, des lires, etc., etc. (après la débauche finale d’octobre, débauche de vins, de caviars, de « Venise », de marchandises « européennes », « tatares », « perses », « chinoises » déversés par la Volga et des litres de spermatozoïdes), en novembre, sous la neige, à Kanavino, des boutiques condamnées, des échoppes barricadées, de tous ces lieux désertés, elle regarde avec ses boutons d’uniforme à la place des yeux, celle-là, moscovite et nocturne, dissimulée derrière la grande muraille de pierre : la Chine. Pas un bruit. Énigme. Sans chapeau melon. Des boutons d’uniforme à la place des yeux.
Celle-là, moscovite, de nuit, du soir au matin. Celle-ci, en hiver, de novembre à mars. En mars les eaux de la Volga inonderont Kanavino et emporteront la Chine dans la Caspienne.
Extrait d’une de ses errances.
Et le troisième Kitaï-Gorod.
Voici : un val, des sapins, la neige, là-bas, plus loin, des montagnes rocailleuses, un ciel de plomb, un vent de même. La neige s’est amollie, les sapins sur les versants sont mouillés et trois jours que le vent souffle : le vent appelle la neige, dit le dicton. Mars. Entouré de sapins, le faubourg, derrière les collines, la ville, dans le vallon, l’usine. Les cheminées ne fument pas, le haut fourneau se tait, les ateliers se taisent, envahis par la neige et la rouille. Silence d’acier. Et là, des ateliers noircis par la fumée, des fraiseuses et des étireuses, des aplatissoirs et des grues, du haut fourneau, du laminoir et des brames fouillées, elle regarde, elle, la Chine, les boutons d’uniforme souriant malicieusement... comme ils peuvent sourire !
Là-bas, mille verstes plus loin, à Moscou, l’énorme meule de la révolution a broyé l’Iliinka, et de l’Iliinka la Chine est sortie en rampant, elle a rampé...
— Où donc ?!
— Jusqu’à Taïegevo ?!
— Menteur ! Menteur ! Menteur ! Le haut fourneau refonctionnera, les laminoirs lamineront encore, les étireuses et les fraiseuses s’agiteront encore.
— Menteu-rrr ! Menteu-rrrr !
Ce n’est pas sur un ton hystérique mais plutôt, semble-t-il, sur un ton de froide colère, les mâchoires bien serrées. C’est Arkhip Arkhipov.
Note indispensable
Les blancs sont partis au mois de mars et, pour l’usine, cela a lieu en mars. Pour la ville (la ville d’Ordynine), c’est en juillet, et pour les villages et hameaux, toute l’année. D’ailleurs, pour chacun, tout cela c’est à travers ses propres yeux, c’est son instrumentation et son mois. La ville d’Ordynine et l’usine de Taïegevo sont voisines, toutes deux à mille verstes de tout. Donat Ratchine a été tué par les blancs. Sur lui, ce sera tout.
3. « Zariadié » désigne couramment dans les villes russes le quartier qui se situe « au-delà du quartier marchand ».
4. En français dans le texte.
5. La fête appelée Nicolas Radovanetz ou encore Radovnitsa avait lieu suivant la tradition russe durant la première semaine après Pâques. Pendant toute cette semaine, il était de tradition pour les fiancés de se promener dans les cimetières.
6. En été, la fête de Notre-Dame-de-Kazan a lieu le 21 juillet, en hiver le 4 novembre.
7. Ivan Lajetchnikov (1792-1869) : auteur de romans historiques et de drames. En 1918, Pilniak lui consacra un article intitulé « Dans la patrie de Lajetchnikov » où il évoquait la ville natale de l’écrivain, Kolomna (au sud-est de Moscou), que lui-même habita de 1915 à 1924.
8. Sémione Nadson (1862-1887) : poète très populaire en Russie au tournant des XIXe et XXe siècles.
9. Le dicton entier s’énonce ainsi : « Ce n’est point nos affaires, a dit la maman, le papa va venir et il mettra de l’ordre » (Note de l’auteur).
10. Voici la suite du poème : « L’humble novice / De toi est très amoureux / Il en a oublié ses vœux / (Ne le dis à âme qui vive) / Mais il n’y a pas de gêne / À ce qu’au pauvre pécheur Pimen / Tu accordes un saint baiser / Samedi, je t’attendrai / Aux portes du monastère / Après... pornographie » (Note de l’auteur).
11. « Copernic a travaillé toute sa vie... » (Note de l’auteur).
12. À quelques mots près, tout ce passage est une citation de la Chronique des temps passés, texte du XIIe siècle écrit par un moine répondant au nom de Sylvestre.
13. Onomatopées intraduisibles liées à des sigles et acronymes très en vogue aussitôt après la révolution. Ainsi « glavboum » renvoie-t-il à « Glavnaïa boumaga » (« Papier général »), qui désigna à partir de 1919 le département chargé de réguler la pénurie de papier et de contrôler le papier vendu aux maisons d’édition.
14. Kitaï-Gorod : nom de quartier dans les villes russes anciennes traditionnellement situé entre le Kremlin (citadelle) et la seconde fortification. Gorod signifie « ville » en russe, et kitaï est un mot d’origine tatare qui signifie soit « milieu » soit « fortification » et qui désigne aussi la Chine en russe. Le Kitaï-Gorod de Moscou (qui inclut la place Rouge) constitue l’ancien quartier marchand de la ville. Il est délimité par une muraille construite au XVIe siècle qui subsiste en partie aujourd’hui.
15. Le thème du Kitaï-Gorod qui épie derrière des boutiques barricadées semble être directement repris au roman de Piotr Boborikine (1836-1921) intitulé précisément Kitaï-Gorod et publié en 1883. Dans ce livre qui retrace la vie de marchands moscovites, l’auteur décrit les ruelles du Kitaï-Gorod de Moscou et évoque « la Horde d’Or, Byzance et la Russie moscovite et cupide qui épient là à travers chacune des fentes ».
16. Nijni-Novgorod, située au confluent de l’Oka et de la Volga — où Pilniak habita de l’été 1912 à l’été 1913 —, était renommée pour la foire qui, depuis 1817, s’y déroulait du 28 juillet au 7 septembre. Celle-ci avait lieu sur la rive gauche de l’Oka dans le quartier Saint-Macaire — une rue et une église portaient ce même nom — délimité au sud par le faubourg de Kounavino (et non Kanavino, comme l’écrit Pilniak). Le 23 septembre, toutes les halles devaient impérativement être fermées jusqu’à l’été suivant ; et au printemps, ce quartier déserté, véritable ville dans la ville, avec sa mosquée et ses quartiers chinois, perse, brésilien, etc., était inondé. La foire accueillait des marchands de toute la Russie et, au début du XXe siècle, jusqu’à 400 000 visiteurs étrangers venant jusque parfois des Indes et de Chine.
17. Iliinka : nom de rue fréquent dans les villes russes. À Moscou, l’Iliinka, située dans le Kitaï-Gorod, était, avant la révolution, habité exclusivement par des commerçants. La bourse notamment s’y trouvait. À Nijni-Novgorod, l’Iliinka est située sur la rive droite de l’Oka.
18. Le poud et l’archine sont d’anciennes unités de mesure russes. Le poud correspond à un poids de 16,38 kg et l’archine équivaut à une longueur de 0,71 m.
Chapitre 1
« Ici on vend des tamates »
En ville, à la ville comme à la ville.
L’ancienne ville est morte. La ville a mille ans.
Le ciel ardent de juillet verse sa chaleur ardente, et le crépuscule jaune, ce soir, se prolongera... Le ciel ardent se tend de bleu et d’infini ; les chapelles, le couvent, les maisons, la terre flambent. On rêve tout éveillé. Dans le silence profond, les cloches de la cathédrale ont des résonances de cristal ; toutes les cinq minutes, elles font : don ! don ! don !... En ces jours-là, on rêve tout éveillé...
Au-dessus de la grand’porte du couvent, une enseigne avec une étoile rouge :
« Sûreté du peuple du sovdiep d’Ordynine. »