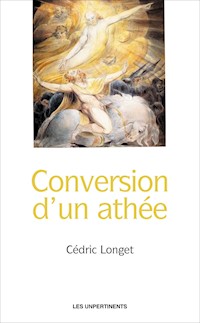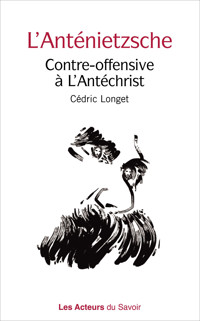
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Les acteurs du savoir
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Französisch
En 1888, quatre mois avant de sombrer définitivement dans le silence, Nietzsche écrivit une assez courte mais célèbre torpille contre les chrétiens et le christianisme : L'Antéchrist. Dans L'Anténietzsche, l'auteur s'emploie à démontrer que toutes les attaques menées par Nietzsche dans ce brûlot sont profondément injustes et de mauvaise foi, reposant essentiellement sur une conviction athée et sur une haine pathologique du christianisme, avec occultation délibérée des saints héroïques que la religion de Jésus produisit pendant deux mille ans.
D'autre part, l'auteur propose que le « nihilisme » proviendrait non d'un reniement de la vie à travers une foi dans un au-delà, mais d'un engourdissement généralisé de la foi en tant que puissance de vie, dans les structures gréco-romaines – mondaines - de la civilisation occidentale.
Ainsi, aphorisme après aphorisme, nombre de thématiques sont abordées : la volonté de puissance, la Modernité, le courage, la réduction de la théologie à la philosophie, la morale, l'hypocrisie, la figure de Jésus, celle de saint Paul, etc. Ce livre est une guerre, une réaction, et à ce titre il est encore... un peu...nietzschéen.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Cédric Longet est né en 1980 et est titulaire d'une maîtrise en philosophie dont le mémoire portait sur Nietzsche. En 2014, il vit une effusion de l'Esprit Saint qui va changer sa vie et entraîner sa conversion au catholicisme en 2018. Il est correcteur de manuscrits et dirige la collection philosophie chez Les Acteurs du savoir.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 461
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Cédric Longet
L’Anténietzsche
Contre-offensive à L’Antéchrist
Les Acteurs du Savoir
Du même auteur
Conversion d’un athée, Les Unpertinents, 2022
Dédicace
À Christophe Michellod qui, un matin de mai en ma dix-septième année, ouvrit ses grands yeux sur moi et me demanda si j’avais déjà lu Frédéric Nietzsche.
Citations
« Ceux d’entre eux qui proclament avec le plus d’insistance qu’ils n’ont jamais eu d’autre souci que celui de la vérité ne sont pas nécessairement ceux dont c’était le plus vrai. »
Jacques Bouveresse, Les Foudres de Nietzsche, 2
« Mais je suis en guerre : je comprends que l’on soit en guerre avec moi. »
Lettre de Nietzsche à Carl Spitteler, 25 juillet 1888
« Il n’est pas permis, il n’est pas décent de faire l’aveugle n’importe où. Monte un peu plus haut avant de fermer les yeux. La lumière seule a le droit de t’aveugler »
Gustave Thibon, L’Échelle de Jacob
Introduction
Dieu vit, est vie, est bien vivant. Il n’est pas « mort », contrairement à ce qu’a affirmé Frédéric Nietzsche (1844-19001) à l’aphorisme 125 de son livre Le Gai savoir, écrit au cœur du chemin d’apostasie2 de la Modernité occidentale3. Cette apostasie des xviiie, xixe, xxe et xxie siècles, matérialistes et nihilistes, qui chassèrent progressivement l’Église hors du « monde », correspondent, pour le croyant catholique, au chemin providentiel de la fin des temps, c’est-à-dire à l’« ultime Pâque [de l’Église] où elle suivra son Seigneur dans sa mort et sa résurrection »4, Pâque lors de laquelle doit régner « une imposture religieuse apportant aux hommes une solution apparente à leurs problèmes au prix de l’apostasie de la vérité (…) un pseudo-messianisme où l’homme se glorifie lui-même à la place de Dieu ».
Pour l’incroyant, la Modernité est en revanche un chemin de libération intellectuelle dévoilant progressivement un néant en place de Dieu, et ce néant comme vérité ultime – qui impose néanmoins à l’humanité de produire d’elle-même son sens. C’est dans ce chemin d’apostasie en quête d’un sens renouvelé que se situe la pensée de Frédéric Nietzsche, héraut du « pseudo-messianisme » sus-mentionné, via les idées de volonté de puissance et de surhomme.
La parole « Dieu est mort » – qu’il faut entendre comme un signe des temps le plus profond – reformule pour nous ce moment du Christ en Croix priant : « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? », moment qui exprime l’anéantissement de la communication avec Dieu, la solitude extrême, mais alors aussi, paradoxalement, l’occasion de la plus intime communion avec Lui. La parole « Dieu est mort » reformule ce moment mais vécu par l’un des soldats romains qui, au pied de la Croix, se partagent les habits du Christ – « nous, les meurtriers des meurtriers »5.
Si le croyant sait que Jésus ressuscite, en revanche, pour l’incroyant « Dieu est mort » et il « reste mort ! »6 ; le Dieu judéo-chrétien ne fut qu’une illusion. C’est à travers La Généalogie de la morale puis L’Antéchrist, que Nietzsche va déployer tout un arsenal d’hypothèses vouées à expliquer la production, la « création », de cette « illusion » au cours des trois millénaires judéo-chrétiens et des temps précédents.
La Généalogie de la morale fut publiée en 1887. Il s’agit du premier essai psychanalytique : une psychanalyse pré-psychanalytique (pré-freudienne et non freudienne) de l’humanité sous son rapport au bien et au mal, dans laquelle toutes les valeurs et notions judéo-chrétiennes sont ramenées à un principe de ressentiment des faibles à l’égard des forts. L’Antéchrist, qui devait probablement servir d’introduction au projet d’une œuvre majeure : La Volonté de puissance, est pour sa part écrit un an plus tard, durant l’été 18887, peu de mois avant que Nietzsche ne sombre dans le silence, et repose sur les présupposés de La Généalogie de la morale tout en proposant de nouvelles hypothèses.
Comme l’écrit Peter Pütz dans la notice introductive à mon édition8, L’Antéchrist ne fait pas comparaître le christianisme « devant le tribunal de la raison critique, comme cela fut le cas au xviiie siècle (…). Nietzsche ne cherche pas non plus (…) à réfuter les dogmes de la foi par des faits, des raisonnements et des preuves. Le christianisme n’est plus pour Nietzsche la cible d’une argumentation et d’une critique rationnelles », mais, poursuit-il, « l’objet d’une analyse psychologique » – ce qui est toutefois beaucoup dire, comme nous le verrons, dans le cas précis de L’Antéchrist, s’il doit être question de « logique » dans le « psychologique », c’est-à-dire d’ordre, de rigueur, de justice, de rationalité même en une moindre mesure. Peter Pütz nous donne alors l’une des clés de l’ouvrage : Nietzsche ne parvient plus à entendre le christianisme autrement que comme une religion du mensonge, il « ne voit plus en lui un interlocuteur de bonne foi dans un débat d’idées », et de cette mauvaise foi, de cette interprétation de la parole judéo-chrétienne comme mensonge, Nietzsche va faire son propre outil dialectique, et le déchaîner contre l’Église du Christ.
Au début de cette année 2022, je discutais philosophie avec un prêtre qui en vint à évoquer la figure de saint Thomas d’Aquin, penseur dont, lui dis-je alors avec le ton de l’exagération, « tout prêtre possède évidemment chez soi les œuvres complètes ». Or ce prêtre s’exclama : « Mon pauvre ami, détrompez-vous ! Peu de prêtres connaissent saint Thomas d’Aquin ! » Mon étonnement fut complet. Certes, j’imaginais bien que tous les prêtres ne possédaient pas les œuvres complètes de saint Thomas d’Aquin, mais je croyais en revanche qu’une bonne part des sept années de formation au séminaire consistait précisément en l’apprentissage de l’éminent docteur angélique. Le prêtre avec qui je conversais ajouta même qu’à l’époque de son séminaire, il avait fallu que les élèves intervinssent eux-mêmes et avec insistance pour recevoir un minimum d’enseignement sur la doctrine du grand théologien, suite à quoi ils n’obtinrent que deux heures de cours sur le sujet ! J’interrogeai alors ce prêtre pour lui demander si lui et ses confrères avaient peut-être plutôt étudié l’autre éminence de l’Église, saint Augustin : « Non ! Rien du tout sur saint Augustin ! » me répondit-il. Je lui demandai : « Mais qui diable vous enseignait-on comme figures philosophiques au séminaire ? » Sa réponse fusa comme l’éclair : « Lacan et Freud, Marx, Nietzsche ». Voilà à quoi préparait donc le séminaire dans les années 70 : à l’étude respectueuse des penseurs qui avaient le plus radicalement chassé Dieu. Tout une génération de prêtres fut ainsi formée – pour le dire vite – loin de Dieu. Ainsi en trouve-t-on de nos jours qui haussent les épaules quand on leur demande de bénir par exemple un chapelet9. Le prêtre avec qui je discutais avait pour son compte échappé à ce sacrifice, comme d’ailleurs tous les prêtres que j’ai eu la chance de rencontrer sur ma route depuis six ans10.
D’autre part, syndrome théologique de Stockholm : tous les chrétiens rencontrés depuis ma conversion, qui connaissaient Nietzsche, m’en parlaient presque avec déférence, au moins avec respect voire affection, disant en gros que Nietzsche avait bien fait de botter un peu les fesses du christianisme, beaucoup trop sec et autoritaire à son époque. Bien. Sauf que 1. Nietzsche ne fait pas que botter des fesses, il veut annihiler le christianisme, l’éradiquer de la surface de la Terre, et le remplacer par une espèce d’aristocratisme féroce ; 2. ce n’est certainement pas l’autoritarisme de l’Église qui gênât jamais Nietzsche, qui a toujours appelé à ce que les pouvoirs exercent impitoyablement leur puissance ; ce qui gênait Nietzsche dans le christianisme c’était la bonté, l’universalité et la paix – à bon entendeur.
Bref, je me suis demandé si je ne pouvais pas faire quelque chose. M’est venue l’idée d’une riposte à L’Antéchrist. Ainsi ce livre se compose-t-il de cinquante contre-attaques aux cinquante premières sections de L’Antéchrist, suivies d’un tour rapide des douze dernières.
J’admets ma chance d’avoir eu à m’occuper du livre sans doute le moins bon parmi tous ceux de Nietzsche ; le moins fin, le moins riche. Il est assez facile d’attaquer le contenu d’une œuvre finalement assez anémique, seulement fardée d’un maquillage certes vif mais grossier – c’est un livre pour acteur, une comédie – a fortiori lorsqu’on sait que presque tout n’y est que faux-monnayage, sur le fondement d’une immense erreur ; ça facilite les choses, ça allège le travail, tout devient dansant. Nietzsche est le terrible soldat d’une volonté de changement du paradigme judéo-chrétien, mais dont l’artillerie n’est que rhétorique, brillamment : travail de faussaire pour ce qui touche au point névralgique de l’existence de Dieu. Nietzsche est maître en subterfuges d’écriture, et ses livres sont un spectaculaire laboratoire révolutionnaire qui pour bonne partie ne repose que sur les fumées d’un feu d’artifices – quand bien même les préparatifs sembleraient des plus intelligents, comme la connaissance aiguë en biologie du jeune professeur de Bâle. A contrario de ce que Nietzsche avance, ce qui compte chez lui n’est pas la vérité mais la conviction et la transmission de cette conviction ; non pas la vérité mais le sortilège.
Je m’autorise ici une courte mise au point concernant la « vérité » nietzschéenne. Nietzsche ne cesse dans ses ouvrages de tirer à boulets rouges sur la « conviction », lui opposant la méfiance ou circonspection scientifique11. S’en prenant à la conviction, Nietzsche s’en prend bien sûr à la foi – « l’aveugle ou myope “conviction” (comme l’appellent les hommes : – chez les femmes, elle se nomme “foi”) »12 – une foi que Nietzsche ne peut entendre comme authentique vérité (l’athée étant sincèrement convaincu de son postulat sur l’inexistence de Dieu) mais donc comme la conséquence de tout un système de persuasion, non de démonstration ; de rhétorique, non d’analyse. De là, Nietzsche veut partout en finir avec la vérité comme conviction pour en finir avec la foi et toutes les « ombres » de la foi. Or, ce cas de la conviction révèle un clivage flagrant chez Nietzsche entre ce que l’auteur peut déclarer et ce qu’il fait et est. Car qu’est-ce qui caractérise selon Nietzsche la vérité comme conviction ? Il écrit : « Avec les images et les comparaisons on persuade, mais on ne démontre pas. C’est pourquoi, dans le domaine de la science, on a une telle terreur des images et des comparaisons ; car ici l’on ne veut précisément pas ce qui convainc et rend vraisemblable, on provoque, au contraire, la plus froide méfiance, rien que par la façon de s’exprimer et la nudité des murs, parce que la méfiance est la pierre de touche pour l’or de la certitude. »13 Or qu’est-ce qui caractérise le style de Nietzsche ? Est-ce la « nudité des murs » ? Précisément non : Nietzsche est sans doute le philosophe pour lequel on peut le moins parler de « nudité des murs », le philosophe doué du plus vaste emploi de vocabulaire et d’images qui soit. N’est-il pas au moins cocasse que l’auteur d’Ainsi parlait Zarathoustra pointe d’un doigt réprobateur l’emploi de l’image dans l’accession à la vérité ? Nietzsche n’étaie quasiment jamais ce qu’il dit par des démonstrations scientifiques, il est l’inverse d’un « esprit scientifique », il assène, affirme, enrobe, détourne, émerveille, raconte, fascine, fait forte impression, il produit de l’effet – de la « puissance » – il nous envoûte à travers les cercles successifs et quasi infinis de ses hypothèses, mais il ne démontre quasi rien, il ne fait que persuader, c’est un rhéteur, c’est un comédien, plein d’attitudes, d’épices et de couleurs, car lui-même n’est que convaincu – il n’a pas la foi. Nietzsche croyait en lui-même d’une façon telle qu’elle l’exemptait la plupart du temps d’avoir à s’expliquer sur les idées qu’il avançait ; il faut lui faire confiance, faire confiance à son « flaire » si exceptionnel, c’est le pari nietzschéen. Nietzsche aurait pu étendre à quasi toute son œuvre cette parole de La Généalogie de la morale14 : « Dans cette dissertation, on le voit, je pars d’une hypothèse que, pour des lecteurs tels que ceux dont j’ai besoin, il est inutile de démontrer. » Je me permettrai donc fréquemment de dire de Nietzsche qu’il ne cherche pas la vérité mais seulement à persuader son lecteur de ce dont il est lui-même seulement convaincu.
Revenons maintenant à nos moutons, si je puis dire. L’objectif de ce travail n’est nullement de prétendre « dépasser » Nietzsche. Nietzsche est sans doute indépassable dans son genre. L’objectif ici est plutôt de l’annuler dans sa bataille contre le Dieu judéo-chrétien. Nietzsche ne sera dépassé que lorsque Jésus reviendra. Je n’ai donc pas non plus cherché, dans le livre que j’introduis ici, à démontrer que « Nietzsche », toute la pensée de Nietzsche serait fausse, ce serait d’ailleurs absurde et fou tant est vaste l’étendue des sujets qu’il affronte, tant sont profondes beaucoup de ses enquêtes et pertinentes nombre de ses critiques, intuitions et formules. Mon objet est limité, si je puis dire, au christianisme : il s’agit de persuader et de démontrer que pour le cas du christianisme, Nietzsche fut au moins dans l’erreur. Le fond de ses attaques partait avant tout de son « aujourd’hui », du spécimen chrétien hypocrite qu’il observait chez l’Européen Allemand de son époque ; aussi son véritable objet d’offensive aurait-il dû être cantonné, il me semble, à la Modernité, tout particulièrement à la Modernité comme matérialisme et athéisme et à sa source dans l’intellectualisme grec, c’était là je pense le véritable défi que le Seigneur lui avait peut-être soufflé de relever au moment de sa création, être un grand héraut de Dieu contre le cadavre civilisationnel du matérialisme moderne, tout en maintenant une recherche vigoureuse et joyeuse des remèdes : ré-insuffler à l’Europe un cœur d’enfant courageux, malgré la solitude la plus totale.
Ancien nietzschéen passionné, je garderai toujours une forme d’admiration pour quelques parts de ce penseur : sa vitalité, sa prose, son agilité, son inventivité, son courage, sa présence dans les pages, son dialogue avec le lecteur, sa philosophie des perspectives, l’excitation de la pensée, La Naissance de la tragédie. Mais la contre-attaque que je propose est légitime ; Nietzsche l’eût d’ailleurs peut-être honorée (par de cinglantes contre-offensives). Certes j’attaque un mort, ce n’est pas très digne, mais n’a-t-il pas lui-même attaqué « Dieu » ? Depuis ma conversion au catholicisme et la fin de ma paralysie mentale, mon désaccord avec Nietzsche est donc devenu des plus profonds, mais je sais ce que je dois au professeur. Il eût été un véritable ennemi s’il avait menti au sujet de la « mort de Dieu », or il fut authentiquement « naïf » quant à sa non-existence15 : il goba tout entier le désert tragique de l’univers schopenhaurien, tira de la théorie de l’évolution les conséquences qui lui semblaient s’imposer, et crut en définitive les conclusions du balourd matérialisme de la modernité (nonobstant sa lucidité à ce sujet16). Il crut sincèrement et presque parfois amèrement17que Dieu n’existait pas, de quoi découleront la plupart de ses erreurs, de ses sophismes18, de son énorme trafic - toute sa puissance. D’autre part, il releva factuellement l’absence de Dieu en tant que puissance de Vie joyeuse chez les chrétiens pratiquants de la bonne société européenne du xixe siècle, orgueilleux, nationalistes, militaristes, avares, mesquins, bref : tout sauf ce dont parlent les Évangiles, de quoi on pouvait bien en venir à songer que, en plus de ce qui se déduisait des divers arguments présentés par les matérialismes à travers l’Histoire, Dieu devait bel et bien « être mort », et que, à tout le moins, le christianisme avait quelque chose d’une formidable hypocrisie.
Mon désaccord avec Nietzsche est donc toutefois devenu des plus profonds, ainsi le présent livre ne s’intitule pas seulement L’Anténietzsche parce qu’il est une riposte pied à pied, section après section, à cette sorte de grosse insulte qu’est finalement L’Antéchrist ; il ne s’appelle pas non plus L’Anténietzsche seulement parce qu’à l’Église des mauvais pécheurs dont Nietzsche se sert pour en induire l’essence du christianisme, j’oppose l’Église des saints (lâchement passée par-dessus bord par Nietzsche) ; il s’appelle aussi L’Anténietzsche parce que j’y propose un renversement de la thèse nietzschéenne sur ledit nihilisme judéo-chrétien. La thèse qui court en effet à travers toutes les pages de ce livre consiste à soutenir que ce n’est pas le christianisme qui a ruiné la « vie » en Europe mais bien au contraire un manque de foi chrétienne, étouffée dans un excès de matérialisme gréco-romain19 : un christianisme content du vestige gréco-romain.
Je dois bien préciser que ce livre, L’Anténietzsche, est encore nietzschéen dans sa forme, non pas chrétien. Je veux dire que la disposition guerrière qu’on y trouve est bien guerrière, non pacifique : il ne s’agit pas d’un dialogue, ou d’une explication. J’espère qu’on ne prendra pas cette guerre pour une marque de colère : je réponds à Nietzsche par Nietzsche, je fais du « Nietzsche à Nietzsche », et donne par là quelques armes contre-nietzschéennes aux chrétiens. J’espère alors ne pas me risquer au péril dont nous avertit le prophète : « Ne fréquente pas le coléreux, n’approche pas l’homme irascible ; sinon, tu prendras leurs manières, tu seras pris au piège. »20 La disposition guerrière de ce livre tient toutefois sans doute plus à une foncière inquiétude, d’une part de la santé digestive de l’Église, peut-être trop prompte à écarter la franche contre-attaque de l’adversaire à la faveur d’une absorption des critiques utiles qu’on pourrait lui reconnaître, quitte à risquer l’intoxication – ce qui avec Nietzsche me semble pour partie avoir été le cas. J’aspire à transmettre une excitation au combat, par armes nobles. Jésus n’était pas passif face aux démons. J’aspire à ce que tout chrétien se redresse, chausse ses sandales, revête sa tunique ; non sous le coup d’un réveil belliqueux, mais sous le coup de l’amour. Que tout chrétien fasse ce qu’il peut mais qu’il fasse. Quitte à mal faire, quitte à se tromper, mais qu’il fasse.
D’autre part et plus généralement, c’est un livre inquiet de l’omniprésence absolue, en occident et ô combien en France, des adversaires du Christ à tous les niveaux de la société et à la tête de presque tous les caps. Or même si de toute manière tout est confié au Seigneur et si la mascarade ne durera qu’un temps, on ne peut rester parfaitement calme, inerte face à l’indécence des matérialistes alpha – dominants – à la pollution mentale qu’ils infusent de fond en comble sur toute la planète, et au désastre parfaitement inouï qu’ils entraînent et préparent (car ce n’est qu’un début) aussi bien sur le plan terrestre que sur le plan surnaturel. Tous ces démolisseurs de la nature humaine et de toute nature, de toute essence, de toute vérité et de toute vie, tous ces déséquilibrés ontologiques, dont je fus, sont, délibérément ou non, soutenus en profondeur par la « mort de Dieu » et par la pensée nietzschéenne dans sa totalité, pensée qui au xxe siècle fut la plus impactante avec celles de Marx, Freud, Wittgenstein et Heidegger – tous fanatiques du néant21. L’objet de ce livre consiste donc aussi, plus en profondeur, en une tentative de contrevenir à la dissolution de l’humanité dans la puissance immanentiste athée ; à enfreindre la loi du monde qui, dans sa folie, se régale comme d’une panacée de tous les prophètes du chaos ; à froisser l’abîme désert des eaux primordiales où siffle l’antique serpent ailé, dont l’ossature recouvre déjà le monde et dont la chair, porteuse des lumières fascinantes, du métal rutilant, décore déjà les cœurs d’une aube pleine de prodiges. À chacun sa contribution contre les antéchrists.
1. Le 3 janvier 1889, Nietzsche s’accroche en sanglotant au coup d’un cheval battu par un cocher, et sombre dans la folie (un mutisme total jusqu’à sa mort).
2. Reniement de la foi.
3. Le Gai savoir est rédigé en 1881 et publié l’année suivante.
4. Catéchisme de l’Église catholique, 675-677.
5. Extrait de l’aphorisme 125 du Gai savoir.
6. Extrait de l’aphorisme 125 du Gai savoir. « Dieu est mort ! Dieu reste mort ! Et c’est nous qui l’avons tué ! »
7. Il sera encore modifié durant l’automne et jusqu’à « l’effondrement » de l’auteur, mais ne sera finalement publié qu’en 1894 ou 1895.
8. Friedrich Nietzsche, Œuvres, T. 2, Robert Laffont, Bouquins, 1998, p. 1031-1103.
9. Témoignage d’une amie.
10. Pour mon parcours de conversion, voir mon précédent ouvrage Conversion d’un athée, Les Unpertinents.
11. Voir par exemple dans L’Antéchrist, § 54 – « Les convictions sont des prisons ».
12. Nietzsche, Humain, trop humain, I, § 636. Ou bien dans L’Antéchrist § 54 : « la conviction, la « foi » ».
13. Nietzsche, Humain, trop humain, II, § 145.
14. III, 16.
15. Au mieux, Dieu fut pour Nietzsche une ancestrale puissance créancière à qui sacrifier. Voir La Généalogie de la morale, II, 19.
16. Nietzsche parle de « la balourdise mécaniste actuellement en faveur » – Nietzsche, Par-delà bien et mal, § 21. L’ouvrage de Friedrich A. Lange, Histoire du matérialisme et critique de son importance à notre époque, eut un impact considérable sur l’esprit de Nietzsche, peut-être comparable à celui de Schopenhauer. L’athéisme de Nietzsche, singulièrement anti-chrétien, ne repose pas sur les sciences matérialistes modernes, mais, d’une part, disons sur un sentiment mystérique schopenhauerien de désert universel et d’absurdité, qui deviendra chez lui dionysisme ; d’autre part sur la révolution apportée durant son adolescence par la théorie darwinienne de l’évolution (dont Nietzsche divergera toutefois en pensant celle-ci et notamment la sélection sous le rapport primordial de la volonté de puissance), ensuite sur un problème historio-critique quant à la valeur de vérité des documents rapportant des événements d’ordre surnaturel à travers tout le judéo-christianisme, sur une idée psychanalytique de la dette (développée dans La Généalogie de la morale), puis sur une passion pour la libération intellectuelle en général qui avait cours depuis quelques siècles à travers l’Europe, aussi sur l’idée que « Dieu » a toujours été différent selon les territoires et les époques, qu’il n’y a donc pas « un » « vrai » Dieu mais que Dieu est une invention des peuples, une création, ou encore sur le fait qu’un Dieu – Dieu tout-puissant, Dieu créateur – devrait au moins être tout, or l’existence du mal mettrait justement à mal la suprématie du Dieu chrétien (« seulement » bon). Néanmoins, Nietzsche se réjouit des conclusions athées du matérialisme scientifique moderne, ainsi non seulement il l’adoube par-là même, mais s’y fie (tout en disant le contraire). De tout cela, Nietzsche tire qu’il peut postuler l’inexistence d’un Dieu transcendant, vivant, conscient, etc. Cette inexistence n’est pas démontrée, elle est postulée.
17. Voir Le Gai savoir, § 125 : « Qu’avons-nous fait lorsque nous avons détaché cette terre de la chaîne de son soleil ? Où la conduisent maintenant ses mouvements ? Où la conduisent nos mouvements ? Loin de tous les soleils ? Ne tombons-nous pas sans cesse ? En avant, en arrière, de côté, de tous les côtés ? Y a-t-il encore un en-haut et un en-bas ? N’errons-nous pas comme à travers un néant infini ? Le vide ne nous poursuit-il pas de son haleine ? Ne fait-il pas plus froid ? Ne voyez-vous pas sans cesse venir la nuit, plus de nuit ? »
18. Le « sophisme » est un syllogisme erroné. Un syllogisme est un type de raisonnement logique établi par Aristote. On appelle « sophisme » un raisonnement logique erroné, en référence à l’école des sophistes, qui détournaient l’esprit logique dans un but purement rhétorique pour pouvoir dire une chose et son contraire, et faire passer n’importe quelle proposition pour vraie ou fausse.
19. Un appendice se trouve à la fin de ce livre où j’expose les raisons pour lesquelles je qualifie la Grèce et Rome de matérialistes. Voir aussi à ce sujet le commentaire du § 61 ainsi que la conclusion.
20. Proverbes 22, 24-25.
21. Cf. ici § 7.
§ 1. Le christianisme occulterait le mal
La première section de L’Antéchrist offre à Nietzsche l’occasion de distinguer son monde de celui des chrétiens. Il écrit : « Par-delà le Nord, les glaces et la mort – notre vie, notre bonheur… » Or n’est-ce pas d’emblée une vision chrétienne que l’auteur dépose ici ? En effet, le Christ ne nous dit-il pas : par-delà les souffrances, les épreuves, la mort, il y a la vie et le bonheur ? Nietzsche attaque alors sans doute le bourgeois de son temps, confortablement dissimulé à la vie comme épreuve, mais certainement pas le chrétien, qui lui, comme le Christ qui est son modèle, accepte les épreuves, cueille la grâce de chaque instant et fuit les conforts.
Nietzsche écrit plus loin, parlant du christianisme : « Cette tolérance et cette largeur du cœur, qui “pardonne” tout, puisqu’elle “comprend” tout, est pour nous quelque chose comme un sirocco. » Nietzsche reproche en somme au christianisme d’avoir été un violent déferlement d’idéalisation sur le monde. Or le christianisme est tout sauf une religion qui idéaliserait dans le sens d’une négation du mal, du froid, des glaces ; c’est une religion qui y répond par le bien mais qui ne nie pas du tout l’existence du mal ; je rappelle ici que le sens d’une vie chrétienne est de participer à la rédemption du monde, d’un monde qui est sous la puissance du mal, lesquels hommes soumis au mal sont rachetés par les souffrances des chrétiens : ni le mal ni la souffrance ne sont niés, on ouvre au contraire en gros les yeux dessus, mais avec en arrière-plan la vue du cœur, pour apporter la solution, libérer, sauver.
« Nous avions soif d’éclairs et d’actions », écrit Nietzsche, ce fragile ermite semi-aveugle qui errait d’auberge en auberge, osait à peine s’adresser aux jeunes femmes qu’il croisait ni froisser ses amis. Il est alors bien regrettable pour Nietzsche qu’il ne se soit abonné au destin d’une vie de saint missionnaire, il aurait non seulement goutté « éclairs » et « actions » mais aussi soleils, tempêtes, glaces, prairies, gouffres, extases, vertiges en tous genres ; car certes, le bourgeois allemand du xixe siècle n’avait en soi assurément rien d’un saint missionnaire typique, et l’on devrait alors se poser la question de savoir dans quelle mesure il fut à proprement parler « chrétien » – le baptême suffit-il absolument pour être chrétien ? Sans aller jusqu’à dire qu’il faille nécessairement être l’un des milliers de milliers de saints missionnaires pour être chrétien : qu’est-ce qui fait que Jésus se détourne ou non de soi ?22 Est-ce que le baptême et la messe suffisent ? Mais on ne peut pas dire du chrétien authentique qu’il ne soit absolument pas un être de vertiges, d’élan, d’enthousiasme, frappé d’éclairs et pleinement acteur.
« Je trébuche parmi l’inclémence de l’espace ouvert. Me voici : du froid, de la boue, des ténèbres et l’angoisse de l’atome abandonné. Et l’épine lointaine du souvenir, l’image suavement vénéneuse des bonheurs ensevelis. Allons ! Les temps du nid sont révolus, la nostalgie du nid est mirage et trahison. L’étendue t’appelle : le vide est la patrie des ailes. »23
22. Il semble que ce soit de n’avoir pas confiance en son Amour. Cf. les « Colloques » de Marcel Van.
23. Gustave Thibon, L’Échelle de Jacob, Fayard, Poitiers/Ligugé, 1984, p. 61-62.
§ 2. Le bonheur chrétien serait un bonheur de faibles car un bonheur sans combat
Nietzsche s’en prend ici à ceux pour qui le bonheur ne serait pas une résistance surmontée, car un bonheur sans résistance surmontée serait un bonheur de « ratés » et de « faibles » : en un mot, pour Nietzsche, un bonheur « chrétien ». Rappelons rapidement ici que, selon Nietzsche, le christianisme serait en quelque sorte, par « l’invention » du péché, la patiente et sournoise réponse des lièvres aux lions d’Antisthène24. Le christianisme est pour Nietzsche la religion des faibles au pouvoir, la religion qui appellerait tous les brisés de la vie à voler leur pouvoir aux forts dont ils jalouseraient atrocement la nature robuste, heureuse, fière, bien-portante, bonne en ce sens. Ne pouvant rivaliser physiquement, les faibles passeraient ainsi leur temps à empoisonner la vie des forts par le moyen cruel et sournois de la mauvaise conscience, dont le prêtre détiendrait tous les secrets parmi lesquels celui du péché originel (invention politique destinée à asseoir la domination sacerdotale sur les « malades » et à asservir les forts) ; jusqu’à faire de cet empoisonnement un projet de civilisation. Le christianisme, pour Nietzsche, plus exactement les 3 000 ans de judéo-christianisme, furent le déploiement de cette hypocrite et méthodique dépossession des vigoureux de leur bien, c’est-à-dire leur joie à se sentir forts, au cours de quoi la faiblesse, c’est-à-dire l’état des faibles, devint le bien, l’état supérieur, tandis que la force devint le mal, l’état inférieur. Le christianisme, et particulièrement la Modernité, seraient les sommets de cette « inversion des valeurs », les sommets d’un bonheur d’impuissants, sans résistance surmontée, qui fait semblant, hypocrite. Or pour quel chrétien à proprement parler, être chrétien n’est-ce pas chaque jour vaincre une, dix, cent résistances les plus diverses ? Toutes les faiblesses à surmonter, tous les péchés à contourner ! C’est toute la vie chrétienne ! – de résistances vaincues avec vigueur, avec panache, avec élan et courage – avec noblesse, j’ose le dire ! et dans la joie de le faire pour le bonheur de Jésus ! Quant à la fierté, le chrétien n’en a même pas besoin, il lui préfère la lucidité, le fait accompli ou non – l’humilité. Ainsi, détournant les paroles de Nietzsche, j’affirme que le christianisme, continuelle victoire sur soi-même, c’est « Non le contentement, mais davantage de puissance, non la paix avant tout, mais la guerre ; non la vertu, mais la valeur », une valeur énergique acquise par l’épée qu’on s’applique de soi à soi par l’entremise de Dieu, et sur quoi fleurissent un instant de contentement, une plume de paix, une branche de vertu, vers toujours plus de paix, vers toujours plus de puissance (d’obéissance et de commandement) face au harcèlement continuel des épreuves, par une organisation hiérarchique des instincts la plus claire25. Pas de chrétienté sans cette continuelle victoire sur soi-même dont le Christ sur la croix est le grand emblème. « L’homme libre » c’est le chrétien. Voilà qui départit pour nous ceux qui se livrent aux épreuves de ceux qui se contentent d’être, les « forts » des « faibles », s’il faut encore employer cette terminologie prétentieuse. Toutefois, nous, n’appelons pas, comme Nietzsche dans cette section et dans bien d’autres, à ce que les « faibles » « périssent »26. Notre victoire est sur nous-mêmes. Voici l’exemple, dit le chrétien, voici l’enseignement, puis à chacun sa liberté.
24. Réponse des lions aux lièvres, qui demandaient que l’égalité régnât parmi tous les animaux : « Il faudrait pouvoir défendre votre prétention. » Employé par Aristote dans sa Politique (III, VIII, 1284 a). Mentionné par Jacques Chevalier dans Histoire de la pensée, T. 1, « Aristote », 9, 3.
25. Au sommet : la simplicité nue de l’état de béatitude, pour l’humilité, et la compassion, pour la charité. – Cf. Humain, trop humain, avt-pr. § 7 : « C’est le problème de la hiérarchie dont nous avons le droit de parler, (…) c’est notre problème. »
26. « Périssent les faibles et les ratés ».
§ 3. Le chrétien serait un type humain sans avenir et non voulu
Dans la section 3, Nietzsche nous apprend au détour d’une équivalence que « le plus digne de vivre » est ce qui est « le plus certain d’un avenir ». La question qu’un chrétien devrait alors se poser à cet endroit me paraît la suivante : le chrétien est-il le plus certain d’un avenir ? Car enfin, s’il l’est, alors il est le type humain que l’humanité se devrait d’élever (« quel type d’homme doit-on élever, (…) quel type aura la plus grande valeur, sera le plus digne de vivre, le plus certain d’un avenir ? »). La question, et sa réponse, sont donc décisives.
Posé que Dieu existe et que le christianisme est religion du salut, pour une vie de joie éternelle, la chrétienté est de fait le type d’humanité qui propose le plus certainement un avenir (disons un avenir riche, joyeux, puisqu’il faut le distinguer de l’enfer qui, aussi, assure un avenir éternel). Mais ne jouons pas aux plus fins : Nietzsche parle évidemment d’un avenir terrestre. Je suis surpris par le fait que notre penseur, pourtant dressé comme peu au sens de l’Histoire, ne considère pas ici l’exceptionnel avenir qu’eut la civilisation chrétienne depuis son avènement27, un avenir dont la puissance et l’extension – chrétiennes – eussent fait rougir de honte toutes les civilisations préalables, assurément écrasées au moins en termes d’extension : le christianisme fut à la fois une civilisation sur le temps long et la première civilisation mondiale. Dès lors, comment ne pas s’accorder sur le fait que le chrétien, porté par la puissance de sa longue et forte civilisation, est certainement l’un des types humains les plus assurés d’un avenir ; l’Histoire le prouve ! Glorieuse Histoire de la temporalité chrétienne ! Même si elle dû déplaire à Jésus, puisque Jésus n’a jamais réclamé de conquêtes terrestres mais seulement spirituelles ; néanmoins quelles victoires, quelle ténacité, quelles ruses, quelle force et quelle bravoure !
Mais Nietzsche oppose alors, à tout type « certain d’un avenir » ayant préalablement existé, qu’il n’existât que par hasard, « jamais comme type voulu ». Quoi donc ? Le chrétien ne fut jamais un type voulu ? Mais Dieu en Personne est descendu sur Terre pour produire ce type ! N’est-ce pas suffisant pour dire que le type chrétien fût assurément un type voulu ? Et non seulement Dieu le Père impulsa la marche, par Jésus, mais il accompagna son type voulu par l’Esprit Saint, et des tombereaux de saints moururent volontairement pour cette volonté. Alors évidemment, à l’oreille d’un athée ces arguments vont sonner creux ; sauf que ça devient gênant pour comprendre l’histoire de la vie de « l’Église de Jean »28 sur deux mille ans, et pour comprendre les deux mille ans de « l’Église de Pierre », insufflée par l’Esprit ; bref : pour comprendre ce qui a historiquement eu lieu – l’athéisme empêche massivement de comprendre le réel.
Au fond, Nietzsche craint donc les forts, c’est-à-dire les chrétiens, et, tout son troupeau d’immoralistes courbés au pied de la statue du Maître, eux aussi craignent cet incompréhensible inconnu qui, par passion pour la vie, se laisse néanmoins tailler en pièces pour dresser, très haut, sa table des valeurs29 : le chrétien, le type d’être humain que l’humanité devrait élever. Le nietzschéen n’y comprend strictement rien, noyé dans le non possumus30 non seulement de son raisonnement mais de sa perception, il crie au masochisme, et ricane comme on plante un drapeau sur un sommet, puis pleure enfin sur les limites de sable de sa réalité.
27. Voir ici entre autres § 17 et 19.
28. Église des saints et des mystiques, qui avance main dans la main avec « l’Église de Pierre », Église des dogmes et des clercs.
29. Toute la philosophie de Nietzsche consiste à inciter les « hommes forts » à inventer et imposer une nouvelle table des valeurs, « par-delà le bien et le mal », c’est-à-dire par-delà le judéo-christianisme.
30. Référence à l’impossibilité d’atteindre Dieu chez Pascal.
§ 4. La Modernité procéderait d’un déclin dont le christianisme serait responsable
Dans la quatrième section, Nietzsche nous brosse en à peine quinze lignes sa conception de l’Histoire : quelque chose de fort s’est développé en Europe, éminemment avec la Renaissance31, puis le « progrès » moderne fut un déclin. Enfin il existerait toutefois des types d’hommes supérieurs qui surgiraient ici et là comme des « coups heureux », écrit Nietzsche (pour un chrétien il n’y a pas de « coups heureux », il n’y a que des « coups » nécessaires au salut).
Évidemment, si le progrès moderne est un déclin c’est, selon Nietzsche, parce que la Modernité est le sommet d’un « mal » souterrain qui vient de beaucoup plus loin, du judaïsme comme « soulèvement des esclaves dans la morale : ce soulèvement qui traîne à sa suite une histoire longue de vingt siècles et que nous ne perdons aujourd’hui de vue que – parce qu’il a été victorieux »32. Ce déclin moderne vient donc plus encore du christianisme, puisque le christianisme est pour Nietzsche le sommet du judaïsme33 et que les idées modernes seraient spécifiquement chrétiennes ; j’ajoute : spécifiquement chrétiennes mais « accessoirement » agrémentées de l’apostasie de la transcendance, et cette précision n’est pas des moindres : dans quelle mesure peut-on en effet dire d’une doctrine (Modernité) qui nie le fondement (Dieu) d’une autre doctrine (christianisme) qu’elle est la représentante réalisée de cette dernière, en quelque sorte son accomplissement ? Car en effet, les idées modernes (universalité, liberté, égalité, fraternité, etc.) n’auraient jamais existé s’il n’y avait eu leur préparation chrétienne sur de longs siècles (Nietzsche parle généralement de « domestication », d’« uniformisation »). Pour autant : le bébé naît en tuant le père puis en confirmant et instituant ce meurtre tout du long de sa vie, allant jusqu’à reconfigurer tout son univers sur un projet non seulement nouveau mais inverse à celui du père (tout centrer sur la Terre et non plus sur le Ciel – qui n’existe plus). La vie de cet enfant parricide, son intronisation et son renversement du fondement sont la Modernité. L’enfant n’est donc pas le même que le père, la Modernité n’est pas le christianisme, pour autant qu’elle en provienne.
Nietzsche écrit : « Le “progrès” n’est qu’une idée moderne, c’est-à-dire une idée fausse. Dans sa valeur l’Européen d’aujourd’hui reste bien loin au-dessous de l’Européen de la Renaissance. » Pour éclairer cette parole, posons-nous la question de savoir ce qu’est, à notre sens, la « Modernité ».
La Modernité c’est le retrait de Dieu : « Comment avons-nous pu vider la mer ? », s’écrie Nietzsche dans son aphorisme sur la « mort de Dieu »34. – La Modernité c’est une période qui s’ouvre au début du xviie siècle et se poursuit jusqu’à maintenant35. Il y eut d’abord le schisme protestant en 1517, puis les guerres de religion, qui traumatisèrent en profondeur tous les esprits du monde chrétien, puis il y eut une réponse philosophico-politique à ce traumatisme, qui consista à tout repenser en se passant désormais franchement de la religion : ce fut le début de la Modernité.
Au sein du catholicisme, deux courants majeurs s’opposèrent alors au cours du xviie siècle : une ligne disons plutôt humaniste, des bonnes œuvres, bienveillante et laissant sa place à la volonté humaine, la lignée des jésuites, née de saint Ignace de Loyola (1491-1556) ; et une autre ligne, elle théocentriste, exigeante et intérieure, qui, réagissant aux bouleversements produits par la Réforme protestante, va entrer en conflit avec la doctrine des jésuites en recherchant un christianisme authentique via un retour aux Pères de l’Église, dont principalement saint Augustin : ledit jansénisme, de l’évêque d’Ypres Cornelius Jansen (1585-163836). Dans cette rivalité doctrinale, les jésuites l’emportèrent d’emblée. Pour autant, le jansénisme reçut me semble-t-il l’intuition profonde de l’essence moderne, non seulement par sa conception d’un monde humain submergé par le péché, mais plus encore dans son idée corrélative d’un tragique retrait de Dieu : le « Dieu caché » (« Deus absconditus37 ») ; d’un autre côté, ce retrait de Dieu prit la forme positive de l’essor de la volonté humaine, essentiellement à travers la recherche du commencement de l’humain en lui-même et lui seul (cogito cartésien38), corrélative d’une extension de l’esprit rationnel à la totalité du monde et son contenu (cartésianisme), qui aboutira à la Révolution française, puis à l’athéisme occidental (retrait effectif de Dieu). En résumé : Dieu est bouté loin après la limite de l’univers, l’Intellect prend sa place et l’être humain cherche à se fonder tout seul (cogito cartésien + empirisme).
Mais par l’autonomisation prétendue du sujet humain, la Modernité n’exprima pas une version égarée de l’ancien Homme qui, dorénavant privé du Sens du sens, aurait été dans l’errance. Se libérant de l’ordre divin, l’être humain se trouva derechef non seulement engagé dans un nouveau sens mais enferré, d’une manière totalement inédite, dans un ordre métaphysique tout autrement contraignant que n’était celui du monde soumis à Dieu, un ordre qui, momentanément, offrit à l’humain une nouvelle réalité dont il pouvait se réjouir, mais qui l’emprisonna en même temps de la tête aux pieds, âme incluse : l’ordre mathématique absolu, la construction « naturaliste » du monde, le déterminisme scientifique radical, ce que Nietzsche appela non pas le libre-arbitre mais son envers, le « “serf-arbitre” qui conduit à abuser des notions de cause et effet »39 et à leur soumettre absolument tout, la nature ontologique de l’humain elle-même, dans une structure « simplificatrice » et « mutilante » (Edgar Morin) n’ayant d’autre horizon que le néant et la machine.
La Modernité fut un progrès scientifique, certes, aussi un progrès juridique (conquis par les luttes) et un progrès des conditions de vie, elle apporta bien évidemment aussi de nombreux faisceaux lumineux jaillis du christianisme, qui, au milieu de l’ivraie, irradièrent notamment la Modernité récente de bienfaits inédits et ô combien attendus (le dialogue entre les peuples, le sort des femmes, le droits des plus faibles, l’assistance aux malades, etc.), mais elle fut pourtant, dans le même temps, d’abord et aujourd’hui encore, une régression des plus terribles pour ce qui touche à l’essence humaine, dont la science sonna le glas car la personne humaine lui est inaccessible, exactement comme Dieu lui est inaccessible : ils ne sont pas positifs40. En conférant tout le pouvoir à la science c’est l’humain qu’on enterra. La Modernité fut alors un printanier chemin de mort conduit par des squelettes aux yeux de feu, habillés d’une noble armure de bronze, ou bien de plumes de chouette, ou bien d’un doux pelage d’agneau : Newton, Voltaire, Sade, Robespierre, Napoléon, Marx, Nietzsche, Freud, Lénine, Staline, Heidegger, Hitler, Sartre, Mao, Derrida, Tony Blair : la condamnation radicale de la liberté humaine – « Ta nature divine n’existe pas ! Tu n’es qu’un objet ! Une machine ! Un nombre algébrique ! Un tas de structures ! Un champ ! Un amas de cellules ! De la poussière d’étoiles ! Un projet ! Tu es malléable à souhait ! Tu ne vaux pas plus qu’une pierre ! Tu n’es personne ! » et mille simulacres pour nous faire accroire tout le contraire. En égarant Dieu, l’humain a égaré la nature de l’humain (le xixe siècle sera la conscience de cette perte et donc la conscience de l’humain).
Le sujet humain ne s’est pas « auto-fondé », il s’est au contraire tout entier anéanti dans l’identification ontologique idéaliste à l’Être rationnel pur, comme on le voit tout particulièrement chez Descartes et Hegel. Libéré de Dieu il fut prisonnier comme jamais, de l’esprit rationnel absolu, du matérialisme (l’appréhension de tout sous l’angle exclusif de la matière, au moyen des mathématiques et de la mécanique). L’être humain devint une horloge (qui allait plus récemment évoluer en horloge quantique) où le vide seul allait offrir une pseudo-liberté, ce qui pour autant, deuxièmement, destina l’être humain à une autre illusion, celle d’une plénitude du sens : il n’avait plus qu’à approfondir et suivre sa connaissance de la Nature (de la Raison) pour atteindre à la pleine connaissance de son propre sens et de son destin, à savoir : s’égarer à l’infini dans son double, dans son alter egotechnologique, et adhérer jusqu’au fond à la fatalité de sa propre nullité ontologique en cédant sur le long cours la place au robot.
La Modernité en tant que telle c’est l’affirmation indubitable du naturalisme, l’aliénation à la Nature – aux mathématiques – à côté de quoi se mit à planer une humeur inquiète, celle de la perte de notre liberté d’enfants de Dieu, la liberté de se transfigurer en servant Dieu, au lieu de quoi l’époque, ayant pris le temps de préciser sa nature, offre pour le moment cette alternative aussi fallacieuse qu’apparemment indépassable : plaisirs matériels ou néant, dans l’attente de l’humain-robot comme Parousie.
L’autonomie du sujet nous a rendus esclaves de la matière, nous a dépouillés avec acharnement de tout ce que l’humain avait été, et a réduit notre substance relationnelle à des comportements de surface, extérieurs et stéréotypés, négateurs de ce qui dé-range et moribonds – mathématisés, c’est-à-dire naturalisés, c’est-à-dire immanentisés. La Modernité c’est cette affirmation que nous sommes dorénavant en tous points esclaves de l’Être et de la Nature, et du néant absolu au bord. Le xxe siècle fut l’enfer déchaîné de cet esclavage, la destruction de l’ancien monde pour laisser place à l’ultime épiphanie luciférienne, sournoise, « agnelisée », que nous vivons de nos jours41, celle qui met tout en œuvre pour nous attacher au Cosmos, pour nous détourner de l’Au-delà.
Ce n’est donc pas le christianisme qui est la cause de la « fausseté » du « progrès », c’est-à-dire du « déclin » de la Modernité comme « voie détournée vers le néant »42, ni l’égalité chrétienne, ni l’universalité chrétienne, ni la bonté, ni la douceur, ni la générosité, mais l’absence du Dieu vivant, de l’océan de Vie, et l’exaltation des restes : le rationalisme fanatique – tout le fascisme patriarcal du cerveau démiurgique inincarné et insensible – et la matière – tout le fascisme matriarcal des tripes utérines du monde. L’être humain dépérit de n’être rien de plus qu’un rouage insignifiant de la grande machine immanente, il dépérit de s’immortaliser dans la pseudo-éternité de la « Nature », il dépérit de sa peur absolue de mourir, il dépérit d’avoir complètement perdu de vue la vie éternelle de l’Autre Monde, il dépérit d’avoir été coupé, par lui-même, de l’océan de Vie. Mais la Vie revient ! Car notre Dieu ressuscite.
31. Pour la Renaissance particulièrement, voir dans ce livre le commentaire de la section 61.
32. Généalogie de la morale, I, § 7.
33. Ici § 44.
34. Nietzsche, Le Gai savoir, § 125 (« L’insensé »).
35. Même si l’on parle désormais de « post-modernité » pour l’époque qui commence après-guerre.
36. 1640 : publication de l’Augustinus par Jansenius.
37. Terme janséniste, pessimiste, qui se répandit à travers l’œuvre de Pascal pour désigner la conception de Dieu comme obscur.
38. 1637 : publication du Discours de la méthode. 1641 : publication des Méditations métaphysiques.
39. Nietzsche, Par-delà bien et mal, § 21.
40. Positif renvoie au positivisme, à savoir la pensée scientiste qui a culminé au xixe siècle, pour laquelle n’est que ce qui se révèle (au sens photographique) à travers les critères de la science moderne.
41. Mais tout une foule recommence à penser par elle-même, ce qui est le signe décisif d’une tendance révolutionnaire. Reste à savoir si ce mouvement ne fera, comme toujours avec la Modernité, que répéter et amplifier le mouvement de fond, à savoir le rejet de Jésus, et empirer les choses. Le problème de l’être humain moderne, c’est de croire que la solution est dans la liberté au sens moderne – c’est là son piège, son impasse, son auto-condamnation.
42. La Généalogie de la morale, II, § 11.
§ 5. Le christianisme : religion de faibles, et de soumis (Pascal)
Dans la section 5, le christianisme est accusé par Nietzsche d’avoir « mené une guerre à mort » contre les instincts fondamentaux du « type supérieur », d’avoir « distillé de ces instincts le mal, le méchant ». De cela, Nietzsche conclut un peu partout ailleurs que le christianisme aurait produit une civilisation, en gros, de « femmelettes »43. Or Jésus ne nous donne-t-il pas, au contraire, l’exemple d’un courage proprement extrême ? La « femmelette » ne se serait-elle pas enfuie face à la terrible épreuve ? Or, le vrai christianisme, celui extraordinairement courageux d’une sainte Blandine torturée, livrée aux bêtes, flagellée, grillée, livrée à un taureau et finalement égorgée, d’une sainte Jeanne d’Arc ou d’un saint Maximilien Kolbe (qui n’avait nul goût pour l’auto-torture mais celui du surpassement total de soi : abandon à Dieu), non pas le « christianisme » gêné aux entournures qui règne depuis que l’humanisme athée gouverne le monde, le vrai christianisme c’est celui qui marche dans les pas du Christ, qui marche dans les pas du courage absolu.
Enfin : le christianisme s’est efforcé de chasser les instincts du mal, eh bien j’en suis fort aise, d’autant que quoiqu’en dise Nietzsche (ou plutôt quoiqu’il se passe de dire), la civilisation chrétienne n’en fut pas du tout une malade, faible, peureuse, débile, mais grandiose, vigoureuse, puissante, géniale, prodigieuse, spectaculaire, capable d’absorber toute la Grèce, tout Rome, et même une antinomie telle que l’âme orientale, devenue « exotisme », tout en développant contre ses propres pulsions de destruction des Œuvres de paix et de charité sans égales en nulle autre civilisation. Sa maladie, la civilisation chrétienne l’a contractée lorsqu’elle mit Dieu de côté – vers le début du xviiie siècle, avec pour racine le xviie ; et qu’elle se retrouva alors, oui, tout à fait seule avec sa conscience, ce qui la plongea sans doute dans un terrible sentiment de responsabilité et de détresse44. Là elle commença à faiblir, là elle commença à devenir peureuse. Puis ses sommités pensantes s’installèrent au xixe siècle dans la mollesse d’un confort physiologique qui leur fit perdre le Sens du sens. Là, elle devint l’humanité que Nietzsche se donna pour tâche d’attaquer en s’en prenant, « maladroitement », au christianisme, alors que c’est précisément la mise au ban de celui-ci qui alita mortellement sa civilisation. Là elle devint malade, fébrile et convulsa, emportant des dizaines de millions des siens dans les délires monstrueux de sa fièvre. Alléluia au christianisme ! Qui fit une humanité forte, vivante, curieuse, généreuse, savante – glorieuse, tandis que son effacement ne laissa qu’un cadavre, un golem, un jouet pour les artifices de Lucifer entre les mains duquel nous sommes encore, le « méchant », celui qui précisément revient quand on écarte le christianisme – tous les athées ou mystico-bizarres abominables du xxe siècle : Mussolini, Lénine, Staline, Hitler, Hirohito, Mao, Pol Pot – qui, les préfère au christianisme ? Quel fou, quel insensé, quel psychopathe les préfère au christianisme ?
Enfin, pour ce qui est de Pascal, réduit ici à un « lamentable exemple »45 et critiqué pour sa vision de la raison comme corrompue par la péché originel, Nietzsche l’attaque en tenant le christianisme pour responsable de cette « corruption », c’est-à-dire, sous-entendu, de cette invention (à visée politique) du péché, invention dans laquelle Pascal, un homme pourtant on ne peut moins sot, serait néanmoins naïvement tombé les deux pieds en plein dedans. Mais Nietzsche nous détourne, comme si souvent, de la vérité, ouvre une voie de dérivation et nous y engage mine de rien, car, à la différence de ce que notre professeur en mensonge suggère dans cette section, Pascal n’a pas simplement adhéré au dogme catholique du péché originel parce que c’était un dogme et qu’il faut (bêtement) se soumettre au dogme, il a surtout et d’abord fait une expérience mystique – l’illumination par la « nuit de feu » du fameux « Mémorial »46 – qui l’a conduit à croire fermement en la vérité constituée dans le dogme catholique. Nietzsche attaque Pascal alors qu’il n’a précisément pas accès à ce qui conduisit Pascal à abolir la raison ; comme un homme ayant toujours vécu cloîtré dans une prison sans fenêtre (la raison seule) moquerait un fabricant de télescope (la charité), et donc imagine, invente, fabrique, vite fait, un autre motif peu flatteur et le plus facile à cette abolition : Pascal se serait juste bêtement soumis. Faute nietzschéenne encore – puissance : une idée simple mais nourrie d’art (d’effet, de falsification) ne suffit pas à déguiser la faute en génie.
43. Terme employé dans La Généalogie de la morale, II, § 7.
44. Cf. La Généalogie de la morale, II, § 16.
45. « Le plus lamentable exemple, c’est la corruption de Pascal qui croyait à la corruption de sa raison par le péché originel, tandis qu’elle n’était corrompue que par son christianisme ! »
46. « Depuis environ dix heures et demie du soir jusques environ minuit et demi. Feu. Dieu d’Abraham, Dieu d’Isaac, Dieu de Jacob, non des philosophes et des savants. Certitude, certitude, sentiment, joie, paix. Dieu de Jésus-Christ. Deum meum et Deum vestrum. Ton Dieu sera mon Dieu. Oubli du monde et de tout hormis Dieu. Il ne se trouve que par les voies enseignées dans l’Évangile. Grandeur de l’âme humaine. Père juste, le monde ne t’a point connu, mais je t’ai connu. Joie, joie, joie, pleurs de joie. Je m’en suis séparé. – Dereliquerunt me fontem aquae vivae. Mon Dieu, me quitterez-vous – que je n’en sois pas séparé éternellement. C’est la vie éternelle, qu’ils te connaissent seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé J.-C. Jésus-Christ. Jésus-Christ. – je l’ai fui, renoncé, crucifié. Je m’en suis séparé, – Que je n’en sois jamais séparé ! – Il ne se conserve que par les voies enseignées dans l’Évangile. Renonciation totale et douce. »
§ 6. Les valeurs nihilistes viendraient du règne du Dieu judéo-chrétien
La section n° 6 est importante, je veux dire proprement nietzschéenne. Nietzsche y dépose une thèse fondamentale à toute sa philosophie : « Je prétends que toutes les valeurs qui servent aujourd’hui aux hommes à résumer leurs plus hauts désirs sont des valeurs de décadence. » Il est important de souligner le mot « aujourd’hui » : Nietzsche regarde autour de lui, hume l’air du temps qui s’offre à ses narines et constate que les valeurs qui y planent sont décadentes. Il écrit : « La vie elle-même est pour moi l’instinct de croissance, de durée, d’accumulation des forces, l’instinct de puissance : où la volonté de puissance fait défaut, il y a déclin » ; or justement, l’humain contemporain de Nietzsche est un « déclin », il « choisit et préfère ce qui lui est désavantageux ». Donc, les valeurs de la fin du xixe siècle européen manqueraient de volonté de puissance, contreviendraient à l’instinct de croissance, de durée, d’accumulation des forces. Quelles sont les valeurs de la fin du xixe siècle ? Selon Nietzsche : le progrès, la démocratie, le socialisme – valeurs du troupeau chrétien qui, suffisamment domestiqué au fil des siècles, suffisamment prévisible et par-là inoffensif, put alors, selon notre professeur, se passer de pasteur divin. Or cette déperdition de force ne s’est-elle pas installée en Europe précisément depuis que le matérialisme y chassa la religion chrétienne de sa place centrale ? Car en effet : qu’est-ce qui caractérise le mieux et de façon générale l’« aujourd’hui » dont parle Nietzsche, à savoir l’intellectuel européen de la fin du xixe siècle, sinon la pensée positive47 ? Le positivisme est d’ailleurs consubstantiel aux idées de progrès (scientisme) et de socialisme (universalisme scientifique) ; en résumé, ce qui caractérise le mieux et de façon générale l’« aujourd’hui » dont parle Nietzsche c’est le matérialisme exclusif, soit l’ennemi du religieux, non pas le religieux.
La critique de Nietzsche serait légitime s’il circonscrivait la décadence qu’il perçoit à cet « aujourd’hui », elle ne l’est plus quand il sous-entend que « Dieu » y serait – en présence – pour quelque chose, ce que laisse entendre la toute fin de la section : « Des valeurs de déclin, des valeurs nihilistes, règnent sous les noms les plus sacrés » – évidemment, quel nom plus sacré que celui de Dieu. Or comment soutenir que les valeurs sacrées de la civilisation chrétienne, à commencer par la Valeur des valeurs qu’est son Dieu, auraient favorisé en Europe tout ce qu’il y avait de désavantageux alors même qu’elles engagèrent sur Terre l’une des civilisations les plus puissantes et qui, même après l’apostasie meurtrière de son Dieu, de son tronc, de son axe, continua à planer et à s’étendre ? César Borgia, tant loué par Nietzsche, est un produit de cette civilisation chrétienne (il est carrément fils de Pape et fut en personne cardinal-diacre) ; n’aurait-il pas, toutefois, été plus fécond et n’aurait-il pas plus duré