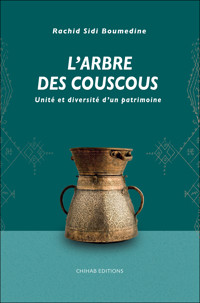
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
Rachid Sidi Boumedine, qui a déjà signé un ouvrage sur les cuisines, revisite les mille et une manières de nommer, de préparer le couscous, en rapport avec les moments, les lieux, les motifs et les circonstances de sa consommation en cercle plus ou moins intime, dans une commensalité ordinaire ou solennelle.
Pour secouer nos mémoires afin de les arracher à la somnolence qu’engendrent le familier et les fausses évidences, Rachid Sidi Boumedine nous plonge dans l’histoire longue pour nous convaincre de l’ancestralité de ce mets. En suivant les traces du couscous, on découvre le pointillé des voies et des chemins que l’écume des siècles a recouvert. On se résout à admettre, avec l’auteur, que « l’approche par les rites et consommations alimentaires est susceptible de montrer que là où on nous propose coupure, nous pourrons reconstruire des continuités ». Pas à pas, il retisse la toile, reconstruit les liens et, pour reprendre ses mots, suture les coupures imposées par les idéologies et les aléas de l’histoire. Le couscous, concentré de codes, de signes et de manières de vivre, se révèle alors comme une sorte de condensé de l’histoire sociale, politique et culturelle. Avec cette leçon magistrale, l’auteur a réussi son pari et relevé ledéfi de nous convaincre de la nécessité de résister au piège dela familiarisation que les sociologues appellent « l’illusion de la transparence ». On en sort avec cette conviction : la connaissance requiert, au préalable, de ne pas se fier aux idées reçues et de s’appliquer à mettre à distance les consensus superficiels. En adoptant ce programme, l’auteur a beaucoup appris sur le couscous et a fini par nous proposer un ouvrage aussi riche qu’agréable à lire. En refermant le livre, le lecteur ne mangera plus le couscous avec la même désinvolture qu’avant. Il le goûtera désormais par tous ses sens.
À PROPOS DE L'AUTEUR
Sociologue et urbaniste,
Rachid Sidi Boumediene a enseigné et dirigé plusieurs organismes publics d›étude et de recherche, et travaillé comme expert auprès d’institutions nationales et internationales. Il s’est également consacré à l’écriture, notamment sur les villes et le patrimoine.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 369
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’ARBRE DES COUSCOUS
Unité et diversité d’un patrimoine
Rachid SIDI BOUMEDINE
L’ARBRE DES COUSCOUS
Unité et diversité d’un patrimoine
CHIHAB EDITIONS
******
© Éditions Chihab, 2023.
www.chihab.com
Tél. : 021 97 54 53 / Fax : 021 97 51 91
ISBN : 978-9947-39-687-2
Dépôt légal : mars 2023.
Préface
En réagissant à l’inscription du couscous au patrimoine de l’humanité, Rachid Sidi Boumedine, qui a déjà signé un ouvrage sur les cuisines, exprime un certain dépit. Non pas pour contester cette patrimonialisation qu’il trouve justifiée et méritée, mais pour déplorer l’indigence de l’argumentation du dossier. Il décide alors de le rouvrir à nouveaux frais avec l’objectif d’aller au-delà des arguments piégés par les évidences et plus loin que les propos convenus consacrant le consensus entre pays que met en avant l’UNESCO. Il s’attache alors à mettre en relief les multiples facettes et toutes les dimensions qui, à ses yeux, auraient mérité d’être mises en avant à cette occasion. Pour ce faire, il revisite les mille et une manières de nommer, de préparer ce plat, en rapport avec les moments, les lieux, les motifs et les circonstances de sa consommation en cercle plus ou moins intime, dans une commensalité ordinaire ou solennelle.
En suivant l’auteur dans sa quête effrénée des pratiques et des usages, factuels et symboliques, relatifs à ce plat, le lecteur voyage dans le temps, traverse des déserts, franchit des frontières, des mers et des océans. Au fil de cette odyssée, son bagage s’alourdit et il se retrouve enseveli sous les données historiques, économiques, sociologiques et anthropologiques. Car, pour saisir le monde du couscous, l’auteur ne lésine sur rien et ne néglige aucun domaine.
En chercheur avisé, le sociologue Rachid Sidi Boumedine aborde son objet en élargissant la focale. Le couscous est appréhendé à la fois comme matière nourricière, mais aussi comme une modalité de se nourrir et d’être, requérant une approche non pas pluridisciplinaire, mais transdisciplinaire. Pour questionner l’acte de se nourrir, l’auteur mobilise concurremment l’histoire (longue et immédiate), la géographie mais aussi la sociologie, l’anthropologie, la philologie et n’hésite pas à faire des incursions en ethnolinguistique pour décoder mots, dictons et autres proverbes.
Après avoir posé le cadre et évité les quiproquos, après avoir montré la richesse des appellations et des manières de l’apprêter, Rachid Sidi Boumedine s’intéresse à la dimension anthropologique et symbolique de la commensalité au travers des rituels associés aux moments ordinaires et cérémoniels de la consommation de ce plat.
Au fil de la lecture et à la lumière des données qui s’accumulent, le couscous s’impose comme un « fait social total » (M. Mauss) qui concerne la totalité de la société et de ses institutions. Il est tout à la fois nourriture hygiène, diététique et soin. Sa préparation et sa consommation interpellent à la fois « les manières de table », le goût, le raffinement ; mais aussi les compétences et les statuts.
S’élevant au-dessus des données ethnographiques touffues et cherchant à rendre la lecture de son ouvrage aussi digeste et goûteuse que l’objet dont il est question, Rachid Sidi Boumedine divise le livre en deux grandes parties. Il consacre la première à régler la question patrimoniale du couscous, entre l’ancien et le nouveau. Le lecteur, même le plus initié, se trouvera surpris par la variété des noms du couscous en Algérie, dans la région du Maghreb et ailleurs, à commencer par le monde berbère où le générique couscous est une appellation se déclinant en plusieurs phonétiques : kuskusi, saksou, kusksu, kousksi. Le berbère possède aussi un autre mot : aberbouch ou berboucha (arabisé).
Parallèlement à ces dénominations berbères, le couscous possède d’autres noms en arabe. Il se dit na’ma, ’aysh et t’aam, trois vocables renvoyant tous au même connotatif : la vie. Le couscous est plus qu’un plat qui nourrit (t’aam) et fait exister (’aysh), il est une grâce (na’ma).
Si la racine kuskus est la plus fréquente pour désigner ce met, un peu partout dans les contrées où on le rencontre, il porte quelquefois d’autres noms. Au Moyen-Orient, il est désigné par l’appellation moghrabieh, en référence au Maghreb, sa région matricielle, et quelquefois par le mot maftûl (roulé), du verbe ftal qui veut dire rouler ou enrouler. En dehors du monde arabe et berbère, à l’exemple de la région du Sahel, des noms puisés dans les idiomes locaux désignent ce plat et constituent des sortes d’indicateurs, voire de buttes, témoins de l’étendue d’une aire culturelle.
Toutefois et malgré leur nombre, les appellations génériques du couscous restent limitées. En revanche, les dénominations locales des plats sont innombrables. La région, les ingrédients, le type de céréale, la grosseur du grain, les façons de le faire cuire sont autant de facteurs qui concourent à distinguer un couscous d’un autre. Les nombreuses manières de les associer et de les croiser démultiplient encore davantage les variantes et types de couscous et partant, les noms qui les désignent.
Tout en se régalant de précieux détails sur les manières de préparer ou de consommer, le lecteur se nourrit d’une érudition foisonnante qui déborde de ces mots savamment agencés et élargit l’horizon. On découvre le monde raffiné du savant et musicien Ziryab, les goûts culinaires du grand médecin persan Avicenne. On apprend que le grand scientifique perse, ar-Râzi, tout comme le célèbre philosophe et médecin cordouan, Averroès, se sont intéressés à la diététique et ont laissé des traités sur les aliments.
La seconde partie est une véritable anthologie des couscous, soutenue par des données historiques et éclairée par des percées anthropologiques. Nous saurons tout sur les différents couscous, secs ou arrosés, sucrés ou salés, avec ou sans viande, au poisson, assortis de fruits secs ou frais.
Pour distinguer le couscous ordinaire du couscous festif, Rachid Sidi Boumedine commence par évoquer les multiples variétés de pâtes (fdaouch, chakhchoukha,thrida, rechta et autres) qui s’en rapprochent plus ou moins. Comme tous ces plats, le couscous est consommé dans les temporalités ordinaires mais se caractérise, tout de même, par un point essentiel. Il demeure le seul plat dédié à la célébration collective, ponctuant les moments d’allégresse et les épisodes d’affliction.
Ne se contentant pas de mettre en évidence cette singularité sur le plan du symbolique, Rachid Sidi Boumedine réprime difficilement l’envie de nous parler encore et davantage de tous ces plats et sous tous les angles. Il finit par compatir, évitant au lecteur le risque de s’égarer en perdant le fil de l’écheveau.
Il poursuit alors sur sa problématique principale, celle de la singularité du couscous au regard des autres mets. Plat du dedans et du dehors, de l’intime et du public, il est consommé ordinairement à la maison mais aussi en offrande à l’extérieur. Il est servi lors des manifestations festives et dans les cérémonies les plus solennelles. Le traitement et l’analyse des données recueillies par l’observation et l’enquête documentaire établissent la centralité du couscous dans l’échange, le don et le contre don. Il apparaît clairement que le couscous sert d’abord à (re) construire le lien social et autorise à soutenir qu’il est à la fois signe et signifiant.
Pour secouer nos mémoires afin de les arracher à la somnolence qu’engendrent le familier et les fausses évidences, Rachid Sidi Boumedine nous plonge dans l’histoire longue pour nous convaincre de l’ancestralité de ce mets berbère attesté depuis la nuit des temps. Marqueur de l’identité berbère et traceur de son aire d’influence, le couscous est présent bien au-delà du nord de l’Afrique, sa terre d’origine où il est signalé depuis les époques romaine et phénicienne. Certaines sources le font remonter « au règne du roi berbère Massinissa, c’est-à-dire entre 238 et 149 avant Jésus-Christ », nous dit l’auteur.
Signe d’une certaine profondeur historique qui l’enracine dans ces terres du nord de l’Afrique, le couscous montre également l’étendue de l’influence géographique de cette région, aussi bien en direction de l’est (au Moyen-Orient) et de l’ouest (péninsule Ibérique) que vers le sud (Sahel et au-delà).
Né dans ces contrées berbères, le couscous va voyager au gré des conquêtes et des expéditions. Il parvient en Orient et dans la péninsule Ibérique (Espagne, Portugal) à l’époque almohade, au XIIIe siècle. Il semble avoir voyagé jusqu’en Perse par le biais des Ottomans, présents au Maghreb du début du XVIe siècle jusqu’à la conquête d’Alger par la France. Cette dernière va, à son tour, l’intégrer à son art culinaire confirmant ainsi le couscous comme lieu de croisement et de métissage. Il est un point de jonction entre l’Orient et l’Occident, le Moyen-Orient et l’Andalousie, l’Afrique du Nord et l’Afrique subsaharienne.
En suivant les traces du couscous, on découvre le pointillé des voies et des chemins que l’écume des siècles a recouvert. On se résout à admettre, avec l’auteur, que « l’approche par les rites et consommations alimentaires est susceptible de montrer que là où on nous propose coupure, nous pourrons reconstruire des continuités ». Pas à pas, il retisse la toile, reconstruit les liens et, pour reprendre ses mots, suture les coupures imposées par les idéologies et les aléas de l’histoire. Le couscous, concentré de codes, de signes et de manières de vivre, se révèle alors comme une sorte de condensé de l’histoire sociale, politique et culturelle.
Avec cette leçon magistrale, l’auteur a réussi son pari et relevé le défi de nous convaincre de la nécessité de résister au piège de la familiarisation que les sociologues appellent « l’illusion de la transparence ». On en sort avec cette conviction : la connaissance requiert, au préalable, de ne pas se fier aux idées reçues et de s’appliquer à mettre à distance les consensus superficiels. En adoptant ce programme, l’auteur a beaucoup appris sur le couscous et a fini par nous proposer un ouvrage aussi riche qu’agréable à lire. En refermant le livre, le lecteur ne mangera plus le couscous avec la même désinvolture qu’avant. Il le goûtera désormais par tous ses sens.
Moussaoui Abderrahmane
Professeur en anthropologie
Université Lyon 2
Avertissement :Un lecteur averti en vaut deux
Pourquoi avertir le lecteur pour un sujet qui, non seulement semble ne présenter aucune difficulté de lecture mais, plus que cela, est un terrain fréquenté par chacun de nous depuis sa plus tendre enfance ! Nous en avons tous une telle expérience que cela semble superflu, à la limite du ridicule, de prévenir quelqu’un que l’on va lui parler d’une question qu’il (pense maîtriser) maîtrise parfaitement.
Justement, le piège est dans la familiarité. Pas dans le fait de savoir mais dans l’illusion de savoir que crée cette familiarité de tous les jours. Il faut dire que l’illusion de connaissance repose surtout sur notre expérience gustative des couscous, parfois même sur notre art de leur confection, mais elle ne porte pas sur le pourquoi ni le comment des façons de le consommer et qui ont fait de ce plat, très varié dans sa diversité, un patrimoine immatériel partagé.
Ce n’est donc pas le fait de parler du couscous comme met qui présente un problème mais le fait de tenter, comme ici, d’établir et d’illustrer comment et en quoi il est un patrimoine immatériel. C’est-à-dire de quelque chose que chacun considère comme sien, comme une propriété personnelle et collective.
Et c’est là que commencent les problèmes, chacun disant ou pouvant dire « chez nous, on fait comme ceci ou comme cela ». Il n’y a qu’un pas qui nous sépare d’un absolu du genre « c’est comme ceci qu’on fait le couscous ». Ce genre d’affirmations, chacun peut les faire tant en ce qui concerne les recettes (de couscous qu’on mange seulement à la maison ou à l’occasion de fêtes) que les circonstances qui font qu’on mange plutôt telle sorte de couscous que telle autre.
Et nous avons donc, si nous nous en tenons aux discours des uns et des autres, autant de manières de faire qu’il y a de régions, de villes, de villages… presque de familles. Il faut donc, pour y voir plus clair dans ce qui est un patrimoine partagé, trier les manières de faire et les circonstances/conditions où on consomme ces variétés, les classer et en tirer des régularités, du sens à travers le pourquoi et le comment.
J’ai donc créé une façon de classer les sortes de couscous en fonction de ce double point de vue (critère) : celui de la manière de préparer les différentes variétés, leurs principaux ingrédients, d’un côté, et, de l’autre, celui des circonstances de la consommation (pour la famille, pour les invités, à destination d’étrangers).
C’est de ce double classement objectif, à travers toute l’Algérie, que nous pouvons faire surgir ce que nous avons tous en commun, dans les manières de faire et dans les manières de consommer, et ce que nous avons, tous, comme originalité.
Je ne consacrerai aucune place aux « outils » : les keskes, gassaa, djefna et autres s’han, tous ces vastes plats où il se roule, se refroidit, se déguste aussi parfois, pour me consacrer à un objet central, celui des manières dont nous pratiquons les couscous et ce que cela recouvre comme système de pratiques et de valeurs sociales.
Cette façon de procéder m’a permis aussi de mettre en lumière certaines préparations particulières qui font parfois la spécificité et la fierté de leur région. Mais c’est aussi en raison des capacités d’innovation des familles dans chaque région, en profitant de toutes les ressources locales, qu’il est vain de prétendre faire un inventaire complet des couscous tant les variantes abondent.
Il en résulte des nuances infinies dans les recettes, les dosages ou les listes d’ingrédients, les modes de cuisson, et qui font que les « frontières » entre régions et sous-cultures resteront floues.
D’autant plus floues que les facteurs démographiques – les mariages et les migrations qui se sont amplifiés et accélérés depuis l’Indépendance notamment - ont engendré de telles influences réciproques qu’il est absurde de vouloir prétendre à des « modèles » purs.
Je demande au lecteur le même genre d’efforts que j’ai été obligé de faire : suivre le fil conducteur, même s’il prend des formes sinueuses, sans se laisser distraire par ses certitudes anciennes, de ce qui donne à nos couscous ce caractère de patrimoine immatériel.
Il m’importe en effet que le message que je tente de délivrer dans le présent ouvrage suive son chemin et, pour cela, j’ai besoin que le lecteur soit averti des embûches que j’ai rencontrées dans sa rédaction car il va les retrouver dans sa lecture.
Dénominations et généralités
L’inscription du couscous sur la liste du patrimoine immatériel de l’humanité a suscité un vaste consensus. Mais cette reconnaissance globale d’un jeune homme de plus de trois mille ans, si plein de vitalité que chacun réclame haut et fort, le voulant pour soi, me semble quelque peu dérisoire.
De plus, cette reconnaissance n’en recèle pas moins un risque plus subtil lié à la globalisation qu’implique l’usage du terme générique « le couscous ».
Reconnaître par conséquent aux couscous leur diversité comme vecteurs du patrimoine immatériel exige de faire ressortir et décrypter les facettes des systèmes de pratiques matérielles (la confection et les conditions de consommation des couscous) et des valeurs (qui sous-tendent des pratiques socialement ancrées).
Mettre en lumière l’unité et la diversité des pratiques matérielles d’un côté et sociales de l’autre est susceptible en effet, quelles que soient les nuances apportées par les différentes communautés aux modes de confection (les recettes), de marquer encore plus l’ancrage des couscous dans la vie des populations du Maghreb, et spécifiquement celles de l’Algérie que nous traitons ici.
Pour le montrer, nous partirons de la définition officielle et consen-suelle de ce qu’est un patrimoine immatériel de l’humanité telle que retenue par la Convention de l’UNESCO1.
Sur cette base, notre travail devrait se focaliser autant sur les savoir-faire (les recettes) que sur les pratiques sociales associées, pour montrer en quoi et comment les couscous (leur diversité) constituent un patrimoine immatériel. Nous utiliserons cependant le singulier, terme générique, chaque fois que nous voudrons énoncer une règle générale.
Il nous faut prendre acte aussi de la dimension symbolique de ce patrimoine aux yeux du peuple algérien qui, tout comme ses voisins nord-africains, a sacralisé le couscous en lui donnant, non seulement, des noms à ses différentes variantes, et elles sont nombreuses, mais surtout le nom de « nourriture fondamentale ».
Pour beaucoup, en effet, il s’appelle t’aam (la nourriture par excellence) si ce n’est na’ma (le bienfait de Dieu). Il partage parfois avec berkoukes, son faux jumeau, le titre de aïch (la vie).
Par ailleurs, sa pénétration de longue date – dix siècles au moins – au sud du Sahara et au Sahel par le biais d’échanges soutenus a ouvert la porte à la consommation du blé dans des pays où domine l’usage du mil et du sorgho2, et créé les conditions pour que leurs peuples en revendiquent le partage symbolique.
Partout, chaque consommateur de couscous concourt, en l’accom-modant selon son goût et les moyens dont il dispose, la circonstance qui le lui fait préparer, à l’entretenir comme fait vivant en l’inscrivant dans sa vie de tous les jours.
Et bien que nourriture par excellence, inscrit de « tout temps » comme un fait vivant, immuable, il n’en subit pas moins les effets de l’adaptation de ses consommateurs/adeptes à des conditions de vie qui changent, à travers les migrations vers les villes ou vers l’étranger, de statut économique et social, de mode de vie.
Ce patrimoine, résultat d’une appropriation, est alors soumis aux relectures, combinaison de nostalgie reconstruite et d’innovation, par ceux qui, tout à la fois évoluent et le font évoluer tout en se prétendant – toujours – absolument respectueux des caractères d’un couscous « traditionnel ».
Le résultat est que, dans chaque région et pour chaque type de couscous il y a un risque patent de rencontrer des décalages entre les versions des différents acteurs, déclarées par ailleurs toutes plus « authentiques » les unes que les autres, et entre les discours et les pratiques.
Mais le couscous millénaire « absorbera », sans se dénaturer, ces nouveaux apports comme il a absorbé en leur temps la tomate puis la pomme de terre, ce qui nous vaut des « sauces blanches » et des « sauces rouges » sans que personne y trouve de l’hétérodoxie3.
Après les premiers habitants de l’Algérie, puis tous ceux qui sont venus ensuite, jusqu’aux « immigrés » européens, entrés de force, il n’est pas qui ne s’en soient finalement emparés pour fabriquer et réexporter, en repartant, de nouvelles variantes au prix de certaines innovations culinaires aussi bien qu’intellectuelles/culturelles.
Et il faudra leur pardonner leur « audace », pleine d’ironie au demeurant, puisqu’elle va jusqu’à dénommer « Royal4 » ce plat populaire par essence et souvent par composition, ou lui ajouter des merguez, lui qui ne s’accommode que des ingrédients doux ou sucrés, parce qu’ils auront péché par amour.
Si cette réappropriation reste compréhensible, à défaut d’être orthodoxe, elle n’en témoigne pas moins de la volonté de (ou d’une partie) cette communauté de concentrer en un plat« tous les parfums du Maghreb »,de s’y reconnaître en en faisant son emblème. Plus que cela d’ailleurs puisque plusieurs enquêtes ont révélé que le couscous est le plat préféré des Français.
Préambule : les noms du couscous5
Le terme couscous a pour mission paradoxale de désigner dans le même temps, par son usage du singulier et dans sa généralité, un plat qui apparaît sous la forme d’une infinité de variantes. C’est, chaque fois, le contexte qui nous dit, parmi ces couscous pluriels, de quel couscous il s’agit. Chacun, celui qui parle et celui qui écoute, sait de quoi il retourne comme souvent dans le cas des polysémies ou des expressions ambivalentes.
Ici, puisqu’il s’agit pour nous, de « parler de couscous » à des personnes dont certaines n’appartiennent pas à notre groupe d’interconnaissance, ni même peut-être à notre pays ou à notre culture, il nous faudra prendre quelques précautions pour que chacun sache dans quelle acception nous entendons utiliser le terme.
Le terme couscous (terme convenu en langue française) est, pour commencer, variable dans son orthographe selon la région ou la langue dans laquelle il est énoncé.
De nombreuses recensions en ont été faites, sans doute depuis qu’il dispose de lettres de noblesse officielles mais surtout depuis que les sites électroniques ouverts à l’initiative de membres de la diaspora en ont consacré de multiples recettes toutes plus « authentiques » les unes que les autres. Il ne paraît guère utile de tenter d’en ajouter une autre à celle, consensuelle, de Wikipédia, résultat d’apports croisés, en la recoupant avec d’autres sources.
Dénominations convenues
Le terme couscous, dans ses différentes variantes (en berbère il s’écrit : ⵙⴽⵙⵓseksu ou ⴽⵙⴽⵙⵓ keskesu, et en arabe maghrébin الطعام، كسكسي، كسكس، سكسو,seksu, kuskus, kusksi, kesksu, t’aam) désigne en même temps, d’une part, la semoule de blé dur dont on fait les grains, et, d’autre part, son accompagnement culinaire sec ou en sauce, à base de légumes, d’épices, d’huile d’olive et de viande (rouge ou de volaille) ou de poisson.
Le mot seksu existe dans tous les parlers berbères de l’Afrique du Nord suivant les régions amazighophones, sous les formes keskesu et seksu, kuskus, kuskusūn en arabe.
Un autre terme qui dérive, selon certains auteurs, de la même racine berbère que seksu est le verbe berkukes, de kukes, « rouler la semoule », et de ber qui signifie « redoubler le travail dans le but d’agrandir les grains ». Le mot taseksut ou tasaksiouth désigne la passoire dans laquelle on fait cuire le couscous.
Le verbe seksek est utilisé par les Touaregs dans le sens de « passer au crible », rappelant l’usage du tamis dans la préparation, alors que ce dernier porte le nom de gharbal (agahrvâl en berbère) dans le Nord.
Autres appellations
On dit kusksi ou kusuksi (كسكسي) en Tunisie et dans l’est de l’Algérie (prononcé parfois coussi), et seksu et kesksou en Kabylie et à Alger, où on utilise aussi le terme t’aam, de même que dans l’Oranie et même t’aam meftul, (طعام مَفْتُول) où le concept de nourriture se substitue au mot couscous, tandis qu’en général, on dit saksu/suksu (سكسو) ou k’s’ksu/kusuksu (كسكسو) dans la majeure partie de l’Algérie et le Maroc, chez les arabophones et les berbérophones.
Dans le Constantinois, il y a une concurrence entre l’usage de la désignation aberbouch, terme berbère (zenète), dit berboucha dans la version arabe qui renvoie à la grosseur du grain, et t’aam (bienfait) qui renvoie au caractère essentiel du plat.
En effet et dans les Aurès où se situe l’origine du mot, ainsi que dans l’est de l’Algérie, on le nomme aberbuc (prononciation aberbouch) ou seksu en berbère chaoui, et barboucha en arabe. Dans le nord-Constantinois, on dit invariablement cousksi(kouski) et barbucha, dérivé du berbère aberbuc signifiant « gros grains », sinon na’maنعمة, terme pouvant être traduit par « bénédiction ».
Je dois profiter de ces énoncés géographiques pour apporter des précisions que me recommande d’ailleurs mon ami Khelfaoui Farouk, et qui préconise le recours à la notion de « terroir », thème sur lequel je reviendrai plus loin au chapitre opportun.
Dans le M’zab, on nomme le couscous uccu (prononciation ouchou), terme issu de la même racine berbère que pour le mot « ecc », manger, et qui est l’équivalent du terme arabe t’aam (nourriture) . C’est donc le même concept qui circule.
Dans d’autres pays de la région
Au Maroc, il s’appelle seksu dans toutes les régions à peuplement berbérophone : Moyen Atlas et sud-est marocain, le Rif où on le nomme seksu ou seysu, dans le Haut Atlas, l’Anti-Atlas et le Souss. Sinon, dans la plupart des régions, on le nomme kesksou ou seksou, tandis qu’à Doukkala et Chaouia on trouve aussi le terme t’aam.
En Tunisie, on dit cosksi (kosksi) comme dans l’Est algérien, tandis qu’en Libyec’est l’expression t’aam qui est la plus usitée.
S’il est kuskus en Mauritanie6 et dans l’Azawad, en Égypte il est appelé seksu en tamazight de Siwa, كسكسيkuskusi en arabe égyptien. Son nom copte est pour l’instant inconnu.
Ailleurs
En Europe du Sud, on l’appelle cùscus en sicilien, cascà ou cascò en ligure, cuscus en sarde, kusksu en maltais, cuscús en espagnol, cuscuz en portugais, κουσκούςkuskús ou κουσκούσιkuskúsi en grec, kiskas en albanais.
Au Levant, il est appelé moghrabieh (moghrabié) ou maftul (maftoul) en arabe levantin.
Pour clôturer ce bel apport, M. Chastanet7 recense les nombreuses appellations du couscous au sud du Sahara selon le peuplement comme suit :
« Les noms du couscous (sont) en wolof, cere, en peul, lacciri, en sérère sadj, attieke pour la Côte d’Ivoire, en soninké, futo, en mandinka, fùtu, en bambara, basi, enfin chez les Maures, kuskus, ngemu et basi. Il s’agit là des noms utilisés à l’heure actuelle ; j’évoquerai plus loin les noms du couscous dans les sources écrites. Il faut signaler cependant le nom du couscous en berbère zénaga, « oufti », relevé par Faidherbe (…) En pays dogon, le couscous est d’introduction récente, comme le montre son appellation, lasiri, empruntée au peul, et ne fait pas partie des recettes « traditionnelles ». On consomme aussi le couscous au Niger, chez les Kanouris, les Zarmas-Songhays, et les Haoussas de l’Ader : il s’appelle burabusko chez les premiers et dambuailleurs. En milieu songhay, J. Rouch distingue le couscous de mil, hauru, et le couscous de blé, kouskousu ».
Ajoutons qu’en Afrique centrale, il est appelé wasa en toubou, et kuskus en haoussa, kusikusi en soussou, sadj en sérère, dambu en zarma, wasa wasa au Bénin et au Togo, acheke en Côte d’Ivoire.
PARTIE I : LE COUSCOUS PATRIMOINE IMMATÉRIEL
Les fondamentaux des cuisines traditionnelles en Algérie
Vouloir traiter du couscous seul, en l’isolant des cuisines traditionnelles en Algérie, sous le prétexte que c’est de lui seul que nous parlons en tant que patrimoine, serait mutilant, car il escamoterait tout un pan de l’ensemble des pratiques qui entourent l’acte de se nourrir et, notamment, de se nourrir en commun. On laisserait, ce faisant, échapper ainsi une partie des explications.
Les Maghrébins en général et les Algériens en particulier con-somment, comme tous les autres peuples, différentes catégories de plats selon leur bon plaisir. Mais lorsqu’ils partagent leur repas avec des invités pour telle ou telle circonstance, ils procèdent à une sélection au sein de la palette des mets dont ils disposent et cela obéit, comme nous le verrons, à des choix socialement codifiés.
En effet, le fait de choisir de servir, dans une circonstance déterminée du couscous et non tel ou tel autre plat, ou telle ou telle gamme de plats, n’est pas fortuit. Il est sous tendu par des considérations non culinaires qui éclairent sur les relations entre invitant (celui qui apprête le plat) et invité(s) (celui ou ceux qui consomme(nt) ce plat).
Il me semble donc indispensable de dresser un panorama, aussi sommaire soit-il, de ces cuisines traditionnelles même sous la forme de catégories, pour mieux marquer la place du couscous dans ce dispositif, sans aller pourtant jusqu’à établir une liste des plats et des pratiques culturelles qui les entourent et les accompagnent.
Pour les besoins de notre raisonnement, je vous propose de subdiviser les plats de la cuisine traditionnelle en Algérie en trois grandes catégories : les plats mijotés, communément appelé tajines mais qui portent, dans la pratique, une infinité de noms, ensuite les pâtes, et, enfin, les couscous, sachant qu’autant les céréales utilisées que les modes de préparation distinguent ces derniers d’avec ce que nous aurons regroupé dans le registre « pâtes ».
Les grandes catégories de plats de la cuisine traditionnelle8
Nous n’allons pas épiloguer sur la question de savoir si le couscous est une pâte9 ou non. Contentons-nous de dire que, techniquement, le couscous se distingue des autres pâtes par le fait que ces dernières sont le plus souvent cuites dans leur sauce, y baignent au point parfois de l’absorber presque entièrement, mais que les couscous, cuits à la vapeur, hors sauce10, sont, eux, seulement « arrosés » avec cette dernière, lorsqu’elle figure dans la recette.
De plus, les usages respectifs des tajines, des pâtes et des couscous qui composent la palette des plats dans cette alimentation, ne sont ni indifférenciés ni alternatifs, car ils ne se substituent l’un à l’autre que dans des circonstances précises. En revanche, ils sont gouvernés par des règles qui définissent leur place, chacun remplissant une « niche ».
En effet, au-delà de la simple consommation de la nourriture confectionnée en famille pour s’alimenter, les usages des plats traditionnels obéissent, dès qu’il s’agit de les servir à autrui, groupe familial ou extra-familial, à une série de règles, concernant aussi bien leur recette, les menus et leur déroulement, que les rituels qui les accompagnent.
Il est vrai qu’un certain snobisme consiste, dans certains milieux citadins, à faire remonter sa propre origine et sa cuisine familiale soit à une filiation turque, cette filiation supposant, bien entendu, l’origine noble de la personne, et non pas une descendance de janissaire ou mamlouk, soit à l’Andalousie, à savoir Séville, Cordoue ou Grenade.
Cuisine et diététique : des traditions qui plongent dans l’histoire
Des travaux de chercheurs, avec des thématiques et des préoccupations différentes, conduits sur l’Algérie, le Maroc et la Tunisie, illustrent cette réalité bien connue, à savoir la conjonction centrale de trois traditions : la tradition locale berbère et africaine, dont celle du couscous, la tradition culinaire du Moyen-Orient au Moyen Âge relayée et transformée par le passage en Andalousie11 et, enfin, l’apport ottoman qui a « coloré » une partie de ce patrimoine dans certaines villes du Maghreb.
Lucie Bolens, dans sa présentation de l’ouvrage consacré à la cuisine andalouse du XIe au XIIIe siècles nous apprend que le mot escabèche est purement et simplement issu du persan « sakbâdj » ou « sikbâdj », forme vinaigrée de préparation du poisson, appelée « mukhallal » en Andalousie, ce qui fait remonter la recette très loin dans l’histoire, puisqu’elle aurait influencé la Rome antique.
C’est d’ailleurs grâce à une rencontre providentielle12, que j’ai pu d’abord prendre connaissance d’un article, signé par le professeur Ambrosio Huici Miranda, qui avait obtenu un exemplaire unique d’un ouvrage anonyme en arabe et intitulé Kitâb Attabîkh fi Almaghrib Wa l’Andalus (Le livre de la cuisine dans le Maghreb et l’Andalousie) et qui aurait été publié en 1012 hégirien correspondant à l’an chrétien 160413.
Faute de pouvoir identifier cet auteur, dont il a été établi qu’il avait travaillé en qualité de cuisinier auprès des cours de Cordoue et Séville avant leur chute et qu’il a écrit son livre lors du règne des Almohades à Grenade, on l’a appelé « l’Anonyme ». J’ai également pu accéder à la version en langue arabe reproduite in extenso par la Revue de l’Institut d’Études Islamiques à Madrid.
Tout se passe en effet comme si chaque type de plat portait la trace de ces héritages : par exemple, les plats d’origine ottomane, dont le plus emblématique est la dolma14, reposent sur des sauces blanches à la cannelle (héritage andalou), avec parfois l’addition, avant de les servir, d’œuf et de citron pour en accroître l’onctuosité15, donnant à la sauce un goût légèrement acidulé et cette couleur blanchâtre si caractéristique.
Mais si on ne fait pas, en général et à titre d’exemple, de dolma en sauce rouge, on peut préparer des tomates farcies dans une sauce blanche16 et des dolma de poivrons. Dans cette pratique, le principe de la dolma (végétaux farcis) est respecté mais on se contente d’utiliser de nouveaux légumes, introduits tardivement.
Parfois aussi, le plat est comme un raccourci de l’Histoire : ainsi, la recette de la sfiria contient du fromage à la manière des plats de la cuisine de la période abbasside où on utilisait des moudjabbanate (fromages) dans la kefta (autre apport de l’Orient et de sa cuisine diététique ?). Or, le fromage séché (touklilt en berbère, klila en arabe) existe de longue date en Algérie y compris chez les peuples Touaregs.
On retrouve encore un cas d’extension du langage puisque le terme sfiria serait aussi le nom donné aux beignets à base de pâte d’amande à Tlemcen.
Ainsi, si certains principes centraux de l’art culinaire et des façons de faire nous proviennent nettement de l’Antiquité, pour une part latine, certains d’entre eux, élaborés, à la période abbasside à partir des différents apports, mésopotamiens mais aussi perses ou indiens, ont cours à ce jour dans ces cuisines que nous appelons algériennes.
J’ai, par exemple, été très surpris, en lisant des textes sur la cuisine romaine17, telle qu’elle était au début de l’ère chrétienne, d’y découvrir l’attrait des Romains pour ce qui fait partie chez nous de la base de la dersa, dans le mélange d’ail et de cumin en tant qu’ingrédients principaux pour une bonne partie de leurs sauces, ainsi que de la banalité, chez eux, de la sauce escabèche et de la charmoula18 sans compter le garum, fait à base d’œufs de poisson ?19
Il semblerait même, selon le livre consacré par Jacques André à Apicius, que le « salé/sucré » a été véhiculé dans la Rome ancienne par un plat numide. En effet, à cette époque, la mélasse de dattes servait à préparer ce qui était appelé « le poulet numide », un mets à base de viande de volaille avec une note sucrée faite de dattes et de mélasse de dattes. Cette tradition perdure d’ailleurs de nos jours dans un certain nombre de plats.
Autre lieu, autre temps : de nombreux savants de la période abbasside ont traité de la nourriture, mais dans des ouvrages de prescriptions médicales qui mettaient l’accent sur les effets bénéfiques de tel ou tel ingrédient, produit, mode de préparation, en raison de ses effets sur le corps et la santé.
Ces savants ont ainsi exalté les vertus du miel, du vin, du vinaigre20 et des herbes, tandis que le rôle des viandes dans leur variété et leur mode de préparation est décrit minutieusement, chaque groupe d’ingrédients étant censé avoir des vertus curatives ou préventives sur telle ou telle maladie, fonction, ou partie du corps.
Et c’est comme cela que la diététique et la cuisine procèdent de la même filiation, au moins dans la philosophie abbasside et maintenant en héritage, maghrébine, ce que de nombreux dictons rappellent de nos jours.
Il y a de très fortes traces dans de nombreuses régions d’Algérie, sous la forme des couscous ou des berkoukes aux herbes, qui revendiquent clairement des objectifs thérapeutiques.
Et pour aboutir entre autres à la facilitation de l’absorption des aliments, on en hachait les composants, la viande le plus souvent, ou on en poussait la cuisson à son extrême pour obtenir des produits « fondants » réputés ainsi plus digestes : n’est-ce pas là un caractère central commun à tous les plats au Maghreb ?
Les musulmans en Espagne, arabes ou berbères, ont à cet effet, joué un rôle de relais, de passeurs, en particulier par leur travail de traduction des œuvres de la haute antiquité grecque et latine ensuite, et d’impulsion, bien sûr, de ce qui est devenu la renaissance européenne21.
La diète méditerranéenne et afourou
Mais il y a une autre dimension, et je devrais dire deux dimensions, que peu de personnes chercheront tant elles se dissimulent au point de devenir invisibles soit en raison de certains ostracismes vis-à-vis de la culture algérienne, de sa diversité et de ses composants, soit, en interne, parce qu’elles sont tellement consubstantielles du couscous qu’on ne les voit plus.
Examinons-les successivement.
La diète méditerranéenne
Ce qui a fait la renommée mondiale de ce qui a été appelé la « diète méditerranéenne » ou « régime crétois22 » c’est la réputation des habitants des pays du pourtour de la Méditerranée d’échapper, plus que d’autres, à des maladies « modernes » dont les maladies cardiovasculaires, de Parkinson et d’Alzheimer, etc. Des études, couronnées d’ailleurs par l’inscription de cette « diète » au patrimoine immatériel de l’Humanité de l’UNESCO, menées en Crète ont établi que le régime alimentaire portant ce nom était source d’immunité contre ces maladies graves, en plus de la longévité relative de ses consommateurs.
En quoi consiste ce régime ? Il s’agirait d’une alimentation qui repose sur :
– « L’abondance de produits céréaliers complets ;
– L’abondance de fruits et de légumes ;
– L’abondance d’ail, d’oignon, d’épices et d’aromates ;
– L’utilisation de l’huile d’olive et de colza comme corps gras ;
– La consommation quotidienne de légumineuses, de noix et de graines ;
– La consommation quotidienne de yaourt et de fromage de brebis (mais pas de lait)… ».
On peut remplacer, pour l’Algérie, les termes yaourt et fromage par petit-lait et lait caillé.
Afourou et la cuisine à la vapeur
La deuxième dimension, qui est, du reste, liée à la première, réside dans les modes de cuisson dominants en Algérie. Il s’agit d’une part de la cuisson « mijotée » qui a donné naissance aux tajines et qui consiste à faire cuire à feu doux les légumes dans leur jus. On notera d’autre part que les plats strictement frits, sont rares. Ils sont souvent limités à ce qu’on classe dans les Sqaït (les envies) qui sont les nourritures mangées « sur le pouce » ou faisant partie des cuisines de rue.
Mais concernant le couscous dans toutes ses variantes, la cuisson à la vapeur en est le pivot central. La graine est cuisinée à la vapeur, les sauces sont mijotées, et les accompagnements, légumes ou herbes sont souvent cuits, eux aussi à la vapeur.
Dans la logique de la « diète méditerranéenne », la cuisson à la vapeur est celle qui garantit, par la faiblesse des températures (moins de cent degrés par définition, par opposition aux fritures qui peuvent dépasser les cent cinquante degrés en plus des déshydratations qu’elles provoquent) la conservation des nutriments : sels, oligoéléments, vitamines, etc. Aussi le recours fondamental à la vapeur dans la cuisson des couscous (elle en est la base) peut-il être considéré lui aussi comme une application de la philosophie de cette diète.
Si les archéologues ont tendance à faire remonter cette technique de cuisson à dix mille ans en Chine, la cuisson à la vapeur daterait également, selon certaines sources, dont Wikipedia, du néolithique, et le couscoussier est donc un ustensile de cuisson à la vapeur de la semoule de blé dur au Maghreb (couscous), du mil et du sorgho en Afrique. Présent dans la tombe de Massinissa (238 à 149 avant J.-C.), il est adopté en Afrique de l’ouest à la fin du premier millénaire de notre ère et on le retrouve au Moyen Âge arabo-andalou, fait de deux récipients en céramique.
Quel que soit le nom utilisé pour désigner ces couscous « secs » en Algérie, c’est-à-dire sans sauce, avec parfois leur désignation comme mesfouf, afourou, mfawer, etc., ce qui revient strictement au même, la cuisson des légumes à la vapeur destinés à la consommation familiale essentiellement prend une très grande part.
Il y a donc, en raison des approches étroites utilisées tant dans la désignation des pays et/ou régions concernées par cette diète que dans les modes d’examen des cuisines des pays susceptibles de figurer sur les listes du patrimoine immatériel, une lacune grave car elle exclut de son champ les couscous comme composants fondamentaux de cette diète.
Les couscous aux légumes et aux herbes, comestibles ou aromatiques, très nombreux et variés, sur lesquels nous reviendrons dans le chapitre idoine sont une illustration parfaite de cette appartenance.
L’utilisation des épices
Pour ce qui est de la façon d’accommoder les plats, les épicer, la cuisine suit en général trois voies : une voie cannelle ou safran qui s’accompagne souvent du couple coriandre/menthe et une voie ail/gingembre/cumin, qui s’accommode un peu plus du piment mais qui a facilement ses compagnons consacrés comme le zâatar (thym sauvage), par exemple. Cependant, si l’usage du piment vert23 s’accroît au fur et à mesure qu’on va vers l’Est, il ne va pas jusqu’à brûler les papilles.
Nous retrouvons ici un deuxième caractère central de cette cuisine algérienne, celle de la modération dans le dosage des épices.
D’abord, il est presque toujours fait usage d’un bouquet d’épices qui comprend quatre à six épices pour un plat donné. Ensuite, le dosage de chacune est fait de sorte qu’aucune ne domine trop, évitant ainsi de donner un goût trop marqué.
Plus que ses composants qui diront sa simplicité ou sa richesse, qui diront aussi à quelle occasion il est consommé, ce qui caractérise et distingue le couscous, d’une région à l’autre, d’un milieu à l’autre, d’une circonstance à l’autre, ce sont surtout les dosages des épices qui lui donnent couleur, goût et saveur.
À priori, la nature et le dosage des épices, selon le type de couscous bien entendu, ne font pas mystère et ne présentent pas de caractère particulier. Lorsqu’on procède à l’examen des épices utilisées dans les couscous présentés par F. Z. Bouayed et qu’on la conforte par l’examen des couscous présentés par L. Boukli, on peut constater d’abord que le poivre noir est présent dans toutes les sauces, suivi de la cannelle.
Les interviews que j’ai pu mener dans diverses régions m’ont permis de découvrir des règles, en ce qui concerne cette dernière épice (et dont j’ai décrit une partie dans le chapitre consacré au ras el hanout). Certes, la cannelle est utilisée dans certains couscous à l’Est et au Centre mais les maîtresses de maison préfèrent utiliser ce qu’on appelle le ’oud (bâtonnet) de cannelle pour en tirer les parfums. L’usage de la cannelle en poudre est évité sauf lorsqu’il s’agit de décorer.
En revanche, on notera qu’en dehors du plat spécifique appelé afawi à Constantine, il n’y a usage ni de carvi ni de cumin dans les recettes du couscous, dans tout le pays.
Le paprika, exclu des sauces blanches, est par contre, logiquement, ajouté dans les sauces où figure la tomate.
Le safran ou le gingembre font leur apparition, dans la plupart des régions d’Algérie, dans les couscous à sauce blanche ou destinés à recevoir un apport sucré. Le safran a l’avantage de donner aux plats cet aspect « doré » apprécié des cuisinières qui veulent donner fière allure à leur sauce et qui intervient même d’une certaine manière dans la dénomination d’un plat.
Ce qui est notable, c’est que conformément à la philosophie de cette cuisine qui se veut équilibrée et où ne devrait dominer aucun goût particulier, les doses de chaque épice utilisée sont souvent équivalentes, se mesurant d’abord en cuillerée à café.
Ce sont donc à la fois la modération et les équilibres entre goûts d’un côté et la combinaison plutôt que l’opposition qui sont recherchés.
Nous sommes très loin de l’image d’une « cuisine épicée » qui serait forte et si dure à avaler que l’on recense parfois dans la littérature étrangère, même si cette image de plus en plus désuète tend à s’estomper à la faveur de la découverte par le grand public, grâce à la télévision notamment, des civilisations non européennes.
Si dans les cas les plus simples, on se contente de la « couleur » et le parfum que donnent le poivre noir et le paprika (dit piment rouge), on ajoutera pour des coucous plus riches, la cannelle (pour les sauces blanches notamment), parfois le safran ou le gingembre, plus rarement une pointe de ras el hanout (capital du magasin).
Ce nom qui peut sembler étrange désigne en fait le capital (la diversité) des épices qu’on peut trouver dans le magasin, ce qui indique la complexité de la composition de cette épice composite24, et non sa valeur économique.
En effet, le consensus sur l’appellation dissimule des variations régionales (géographiques) en apparence, pour correspondre en fait aux influences culturelles tout au long de l’histoire, de l’Algérie, de la ville ou du territoire considéré, et de la famille qui confectionne le couscous. Mais il ne faut jamais perdre de vue que chaque maîtresse de maison a son secret qui réside dans la quantité effective de telle ou telle épice incorporée, sinon parfois même, un « surdosage » d’oignon ou l’utilisation de telle ou telle partie du mouton (on parle dans certaines régions du goût que donne le collier alors qu’ailleurs c’est la queue qui le détermine).
Même, et c’est rarement explicité sauf sur insistance de l’interviewer, les « pourquoi ? » et les « comment ? » de l’aspect de la sauce sont aussi un facteur à prendre en considération.
En guise d’illustration, la précaution que l’on prend, selon des règles tacites, à bannir l’usage de la cannelle en poudre dans certains plats (je l’ai noté à Tlemcen, Oran, Mascara, Tiaret, avant de le vérifier lors d’un parcours à l’Est), soit parce qu’elle noircit la sauce, soit parce qu’elle reste au fond de la sauce, gâchant sa limpidité.
On utilisera ainsi le bâtonnet car il assurera le parfum sans contaminer la sauce par une couleur ou un résidu visible et indésirable. Il y a donc tout un savoir et un savoir-faire dans l’usage des épices qui se dissimulent chez les maîtresses de maison mais qui ne se révèlent, comme j’ai pu le constater, que par le truchement d’une interview approfondie.
Il y a cependant quelque chose qui sonne comme une exception à cette règle de la modération dans l’usage des épices. C’est le cas du piment. D’une façon générale, et sauf si le plat est justement destiné à être pimenté – comme certaines façons de préparer le berkoukes ou les légumes secs – le piment fort est une option et seulement une option lors de la consommation des plats. Pas dans tous les plats ni dans leur majorité, comme si, ici aussi, il y avait des règles non écrites.
C’est qu’en effet, le goût du piment est un goût sans compromis. Il passe le plus souvent par le piment vert préparé seul ou avec une tomate, cuit (grillé) en chlita ou hmis. Sous sa forme piment vert ou de piment de « Cayenne » (petits piments rouges très piquants appelés felfel Gnaoua) il est glissé dans la sauce25 et retiré intact par les puristes. Jamais pourtant, et dans la quasi-totalité de la cuisine traditionnelle, sa force ne l’emporte sur les parfums recherchés.
Ziryab et l’invention du menu





























