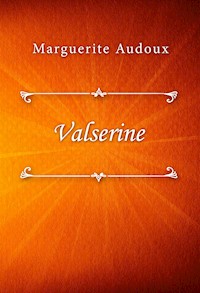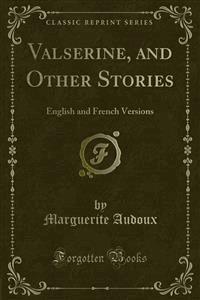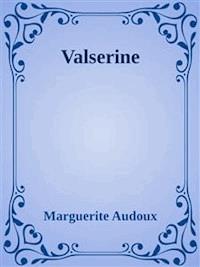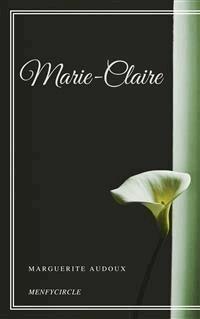1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Raanan Editeur
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Französisch
L’Atelier de Marie-Claire est un roman de Marguerite Audoux publié en 1920.
Résumé
| L’atelier de couture où Marie-Claire a trouvé du travail est dépeint comme une grande famille. Les patrons, M. et Mme Dalignac, et les ouvrières, obligées de s’embaucher en usine lors des périodes de chômage, dépendent de la même façon des clientes, exigeantes et souvent mauvaises payeuses. Ainsi ce roman est à la fois la peinture d’un milieu social et une suite d’anecdotes variées qui, tout en campant avec précision les personnages des ouvrières, permettent au récit de progresser. Après la mort des patrons, on ne sait si Marie-Claire épousera Clément, le neveu de Mme Dalignac, qu’au demeurant elle n’aime pas…|
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
SOMMMAIRE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
MARGUERITE AUDOUX
L'ATELIER DE MARIE-CLAIRE
ROMAN
Eugène Fasquelle, 1921
Raanan Editeur
Livre numérique 627 | édition 2
1
Ce jour-là, comme chaque matin à l’heure du travail, l’avenue du Maine s’encombrait de gens qui marchaient à pas précipités et de tramways surchargés qui roulaient à grande vitesse vers le centre de Paris.
Malgré la foule, j’aperçus tout de suite Sandrine. Elle aussi allongeait le pas et je dus courir pour la rattraper.
C’était un lundi. Notre chômage d’été prenait fin, et nous revenions à l’atelier pour commencer la saison d’hiver.
Bouledogue et la petite Duretour nous attendaient sur le trottoir, et la grande Bergeounette, que l’on voyait arriver d’en face, traversa l’avenue sans s’inquiéter des voitures afin de nous rejoindre plus vite.
Pendant quelques minutes il y eut dans notre groupe un joyeux bavardage. Puis les quatre étages furent montés rapidement. Et tandis que les autres reprenaient leurs places autour de la table, j’allai m’asseoir devant la machine à coudre, tout auprès de la fenêtre. Bouledogue fut la dernière assise. Elle souffla par le nez selon son habitude, et aussitôt l’ouvrage en main, elle dit :
— Maintenant il va falloir travailler dur pour contenter tout le monde.
Le mari de la patronne la regarda de très près en répondant :
— Eh bé… Dites si vous grognez déjà !
C’était toujours lui qui faisait les recommandations ou les reproches. Aussi les ouvrières l’appelaient le patron, tandis qu’elles ne parlaient de la patronne qu’en l’appelant Mme Dalignac.
Bouledogue grognait pour tout et pour rien.
Lorsqu’elle n’était pas contente, elle avait une façon de froncer le nez qui lui relevait la lèvre et découvrait toutes ses dents, qui étaient fortes et blanches.
Il arrivait souvent que le patron se querellait avec elle ; mais Mme Dalignac ramenait toujours la paix en leur disant doucement :
— Voyons… restez tranquilles.
Les colères du patron ne ressemblaient pas du tout à celles de Bouledogue. Elles étaient aussi vite parties que venues. Sans préparation ni avertissement il se précipitait vers l’ouvrière à réprimander, et pendant une minute il criait à s’en étrangler, en supprimant la moitié des mots qu’il avait à dire.
Cette façon de parler agaçait la grande Bergeounette qui se moquait et marmottait tout bas :
— Quel baragouin !
Le patron était le premier à rire de ses emportements, et comme pour s’en excuser, il disait :
— Je suis vif.
Et il ajoutait parfois avec un peu de fierté :
— Moi, je suis des Pyrénées.
C’était lui qui brodait à la machine les manteaux et les robes des clientes. Il était adroit et méticuleux, mais après quelques heures de travail il devenait tout jaune et paraissait écrasé de fatigue.
Sa femme le touchait à l’épaule en lui disant :
— Repose-toi, va.
Il arrêtait alors sa lourde machine, puis il reculait son tabouret, afin de s’appuyer au mur ; et il restait de longs moments sans remuer ni parler.
Il y avait entre les patrons et les ouvrières comme une association amicale. Mme Dalignac ne craignait pas de demander des conseils dans l’atelier, et les ouvrières lui accordaient toute leur confiance.
Quant au patron, s’il criait à tue-tête pour nous donner la moindre explication, il parlait tout autrement à sa femme. Il prenait son avis pour les plus petites choses et ne la contrariait jamais.
Mme Dalignac était un peu plus âgée que son mari. Cela se voyait à ses cheveux qui grisonnaient aux tempes ; mais son visage restait très jeune et son rire était frais comme celui d’une petite fille.
Elle était grande et bien faite aussi, mais il fallait la regarder exprès pour s’en apercevoir, tant elle paraissait toujours effacée et lointaine. Elle parlait doucement et posément ; et s’il arrivait qu’elle fût obligée d’adresser un reproche à quelqu’un, elle rougissait et se troublait comme si elle était elle-même la coupable.
Le patron avait pour sa femme une tendresse pleine d’admiration, et souvent il nous disait :
— Personne n’est comme elle.
Dès qu’elle sortait, il se mettait à la fenêtre pour la voir passer d’un trottoir à l’autre, et si elle tardait à revenir, il la guettait et devenait inquiet.
Dans ces moments-là, les ouvrières savaient bien qu’il ne fallait rien lui demander.
Aujourd’hui l’espoir du travail apportait de la joie dans l’atelier. Il n’était question que d’une nouvelle cliente dont les paiements seraient sûrs, parce qu’elle tenait un commerce important, et qui nous donnerait beaucoup d’ouvrage parce qu’elle avait cinq filles.
Le patron pressait sa femme d’aller chercher les étoffes annoncées :
— Vite, vite, disait-il.
Et il s’agitait si fort, qu’il heurtait les mannequins et les tabourets.
Mme Dalignac riait, et tout le monde en faisait autant.
Le soleil paraissait rire avec nous aussi. Il rayonnait à travers la vitre et cherchait à se poser sur la corbeille à fil et sur la machine à coudre. Sa chaleur était encore très douce et Bergeounette ouvrit toute grande la fenêtre pour qu’il pût entrer à son aise.
De l’autre côté de l’avenue, les murs d’une maison en construction commençaient à sortir de terre. Des bruits de pierres et de bois se confondaient en montant jusqu’à nous, et les ceintures rouges et bleues des maçons se montraient à travers les échafaudages.
À tout instant, des tombereaux de moellons et de sable se déversaient. Les moellons roulaient avec un bruit clair, et le glissement du sable faisait penser au vent d’été dans le feuillage des marronniers. Puis c’était des fardiers chargés de pierres de taille qui arrivaient. On les entendait venir de loin. Les charretiers criaient. Les fouets claquaient, et les chevaux tiraient à plein collier.
Aussitôt que sa femme fut partie, le patron se fit aider par la petite Duretour, pour débarrasser les planches des bouts de chiffons et mettre de l’ordre un peu partout.
La petite Duretour n’était pas très bonne ouvrière malgré ses dix-huit ans, mais Mme Dalignac la gardait à cause de sa grande gaîté. Elle prenait toujours les choses du bon côté, et son entrain nous empêchait souvent de sentir la fatigue.
C’était elle qui faisait les courses et qui ouvrait la porte aux clientes. Sa taille était si menue et ses cheveux si négligés que beaucoup la prenaient pour une apprentie. Cela la vexait un peu et lui faisait dire :
— Lorsque je serai mariée, elles me prendront encore pour une petite fille.
Son fiancé n’était guère plus âgé qu’elle. Chaque soir il venait l’attendre à la sortie et tous deux ne tenaient pas plus de place qu’un seul sur le trottoir.
Maintenant elle vidait les casiers et brossait les planches. De temps en temps, elle lançait un paquet en l’air et le rattrapait comme une balle, ou bien elle s’amusait à déformer les noms des clientes en faisant des révérences aux mannequins. C’étaient surtout Mmes Belauzaud et Pellofy qui recevaient ses compliments. Elle s’inclinait très bas en prenant un air ravi :
— Bonjour, Madame Bel-oiseau.
— Bonjour, Madame Pelle à feu.
Les rires s’échappaient tous ensemble par la fenêtre, et les maçons d’en face levaient la tête pour voir d’où ils sortaient.
J’étais la dernière venue dans la maison.
J’y étais entrée peu de temps avant la morte-saison d’été, et quoique toutes se fussent montrées bonnes camarades pour moi, une timidité m’empêchait de prendre part à leur gaîté. Cependant, depuis que j’étais à Paris, c’était le premier atelier où je me sentais à l’aise. La voix querelleuse du patron ne m’effrayait guère, et la douceur de sa femme me donnait une grande tranquillité.
À mon arrivée, le patron avait tout de suite coupé mon nom en deux. Ses joues s’étaient gonflées pour accentuer la moquerie pendant qu’il disait :
— Marie-Claire ? Deux noms à la fois ? Eh bé… vous êtes épatante, vous.
Et en rejetant son souffle comme s’il éloignait de lui une chose trop compliquée, il avait ajouté d’un ton sérieux :
— On vous appellera Marie. Cela sera bien suffisant.
Mais cela ne fut pas suffisant. Je répondis si mal à ce nom qu’il fallut bien rendre au mien sa première forme.
Mme Dalignac revint plus tôt qu’on ne s’y attendait. Elle rapportait un énorme carton dont le couvercle se soulevait malgré les ficelles qui le retenaient.
Le patron s’empressa de l’ouvrir. Il toucha les tissus avec une petite grimace de contentement.
— De la soie, rien que de la soie, disait-il. Sa femme l’éloigna :
— Laisse… tu vas tout embrouiller.
Puis en s’adressant à nous :
— C’est pour un mariage.
Elle s’assura que le carton reposait tout entier sur la table et elle sortit une à une, les pièces d’étoffes, en désignant leur emploi.
— Une robe noire pour la mère de la mariée… Deux robes bleues pour les grandes sœurs… Des robes roses pour les petites sœurs… Et des dentelles noires, et des dentelles blanches, et des pièces de ruban, et des taffetas pour doublures, et des satins pour jupon…
Elle sortit avec précaution le dernier tissu soigneusement plié dans du papier :
— Et voilà du crêpe de chine pour la robe de la mariée.
Et sans prendre le temps d’enlever son manteau, elle attira un mannequin et prit les étoffes à pleines mains pour les draper autour du buste. Elle dépliait les dentelles et les disposait, elle tournait les rubans en coque sur ses doigts et les piquait d’une épingle. Puis elle rejeta le tout sur la table et ce ne fut bientôt plus qu’un fouillis de toute couleur.
Mes quatre compagnes avaient cessé de coudre et regardaient avec intérêt. Leurs yeux allaient d’une couleur à l’autre et leurs mains s’avançaient pour toucher les dentelles et les tissus soyeux.
Tout à coup la pendule se mit à sonner.
Bouledogue se leva en disant d’un ton bourru :
— Il est midi.
C’était vrai, mais la matinée avait passé si vite que personne ne se doutait qu’il était l’heure d’aller déjeuner.
Les autres déposèrent leur ouvrage et se levèrent lentement comme à regret.
L’après midi fut pleine d’entrain. Duretour, montée sur un tabouret, garnissait les planches d’un papier gris que le patron lui passait, après en avoir coupé les bandes de la grandeur nécessaire.
Quand le patron ne donnait pas les papiers assez vite, Duretour en profitait pour tourner et danser sur son tabouret ; puis elle ouvrait et refermait les bras en criant comme une marchande à la foire :
— Robes et manteaux, robes et manteaux.
Cela nous faisait rire et le patron disait d’un air indulgent :
— S’il n’y avait que vous pour les faire, ma pauvre Duretour.
Les maçons d’en face sifflaient comme des oiseaux libres. Ils avaient fini par découvrir l’atelier et ils faisaient tout leur possible pour attirer notre attention. L’un d’eux appelait tous les noms de jeunes filles qui lui venaient à l’idée, pendant qu’un autre frappait une charpente en fer avec un lourd marteau. Et chaque fois qu’un rire éclatait ou que l’une de nous se montrait un peu à la fenêtre, les appels redoublaient, et la charpente sonnait comme une cloche.
Vers le soir, la sœur du patron entra dans l’atelier. C’était une femme à l’air hardi. Elle était couturière aussi et on l’appelait Mme Doublé.
Elle s’assit sur le tabouret du patron et elle dit d’un ton méprisant :
— Tout le monde travaille déjà ?
Son frère répondit, l’air vexé :
— Je suis sûr que tu n’as pas fini de te reposer, toi !
Elle fit le geste de lancer quelque chose par-dessus son épaule :
— Oh ! moi, je fais comme les clientes, je vais aux bains de mer, et je suis rentrée seulement ce matin.
Le patron lui montra les tissus :
— Nous avons de l’ouvrage, dit-il.
Mme Doublé devint attentive, et ses sourcils se rapprochèrent.
Elle avait des yeux noirs comme ceux de son frère, mais son regard était plein d’audace et de fermeté. Sa bouche aussi faisait penser à celle du patron, mais ses lèvres semblaient faites d’une matière dure qui les empêchait de se distendre pour le sourire. Elle marchait sans grâce, en bombant la poitrine et on eût dit qu’elle portait sur toute sa personne quelque chose de satisfait.
À son entrée le visage de Mme Dalignac avait changé d’expression. Tout en coupant ses taffetas, elle mordillait sa lèvre comme les gens qui ont une préoccupation, et on entendait davantage le bruit sec et grinçant de ses ciseaux.
Mme Doublé reprit :
— C’est égal, tu es fou, Baptiste, d’avoir toutes tes ouvrières au début de la saison.
Elle me désigna du doigt :
— Tu n’avais pas besoin de reprendre celle-là.
Le patron parut gêné. Il répondit sans me regarder :
— Elle a besoin de gagner sa vie comme nous.
Mme Doublé se moqua. Elle avait l’air de chantonner quand elle dit en tapant sur l’épaule de son frère :
— Eh ! oui, pauvre Baptiste ! mais moi, j’aime mieux que l’argent soit dans ma poche que dans celle des autres.
Bouledogue et Sandrine baissaient la tête et cousaient plus vite. La petite Duretour était devenue sérieuse et je ressentais moi-même un malaise, qui me faisait désirer fortement le départ de Mme Doublé. Seule, la grande Bergeounette paraissait ne rien redouter et continuait à s’intéresser aux maçons d’en face, qui menaient grand bruit en quittant le chantier.
Le patron cherchait à parler d’autre chose, mais sa sœur revenait toujours au même sujet. Elle trouvait que Mme Dalignac manquait de fermeté avec ses clientes et de sévérité avec ses ouvrières. Elle demandait des détails précis sur le travail et trouvait à redire à tout.
Le patron finit par montrer de l’agacement :
— Ma femme n’est pas un gendarme comme toi, dit-il.
Et Mme Doublé, qui avait le même accent que son frère, répondit :
— Eh bé… Tant pis, donc.
Et elle se campa debout en regardant tout le monde avec insolence.
— Il est sept heures, Bouledogue… dit tout à coup Mme Dalignac.
C’était peut-être la première fois que Bouledogue oubliait l’heure. Elle se leva vivement et défit son tablier avant d’avoir rangé son ouvrage. Les autres aussi se levèrent en hâte. Elles passèrent la porte sans bruit. Mais à peine sorties, on les entendit dégringoler l’escalier comme si elles fuyaient un danger.
Je les retrouvai en bas, groupées comme le matin devant la porte cochère ; mais leurs visages étaient bien différents. Les jolis yeux de la petite Duretour montraient une vraie colère :
— Elle nous a gâté notre belle journée, disait-elle.
Sandrine affirma en se rapprochant de moi :
— Elle est très dure pour ses ouvrières.
Elle se rapprocha encore en baissant la voix.
— Vous la verrez revenir quand les robes de mariage seront faites. À chaque saison, elle vient prendre nos plus jolis modèles, et elle se vante de les faire payer très cher à ses clientes.
La grande Bergeounette fit entendre un rire drôle, et dit tout en l’air, sans souci d’être écoutée :
— Elle n’a pas sa pareille pour savoir amener l’argent dans son coffre.
Bouledogue grogna en montrant ses dents :
— Je ne travaillerais pas chez elle, même si j’avais grand faim.
L’arrivée du fiancé de Duretour nous obligea de nous séparer et chacune s’en alla en emportant sa rancune.
2
Octobre était venu. Les toilettes de mariage se terminaient les unes après les autres, et il ne resta bientôt plus que la robe blanche qu’on devait faire au dernier moment afin de lui conserver toute sa fraîcheur.
C’étaient Sandrine et Bouledogue qui s’occupaient de ce travail. Mme Dalignac leur donnait des tabliers blancs qui les couvraient jusqu’aux pieds, et elles s’installaient momentanément au bout de la table.
Mme Doublé revint comme l’avait prédit Sandrine. Elle fit tourner d’un coup de pouce les mannequins sur lesquels étaient les robes, et après avoir crayonné des lignes sur un bout de papier, elle sortit de l’atelier comme elle y était entrée, sans dire un mot.
La voix de Bouledogue gronda derrière elle :
— Elle nous prend pour des chiens.
Au même instant Duretour leva le nez au plafond et fit entendre une petite voix flûtée qui disait :
— B’jour, M’dame.
Maintenant, les planches débordaient d’étoffes et les rires des premiers jours avaient cessé. Le soir à la sortie, on ne prenait plus le temps de bavarder sous la porte cochère. Bouledogue filait vite dans la clarté des becs de gaz. Bergeounette, qui se pressait aussi, ne prenait pas toujours la direction de sa demeure, et Duretour, serrée contre son fiancé, l’entraînait rapidement vers la rue de la Gaîté.
Sandrine habitait une rue voisine de la mienne et nous remontions une partie de l’avenue du Maine ensemble. Une fois, elle m’avait quittée pour courir à la rencontre de son Jacques qui venait au-devant d’elle.
J’avais souvent entendu parler du Jacques à Sandrine, ainsi que le nommait Bergeounette. Mais lorsque je le vis il me fit penser à une chose inachevée. Il était beaucoup plus grand que Sandrine. Cependant quand elle lui prit le bras pour l’appuyer sur le sien, il me sembla qu’elle n’aurait eu aucune peine à le porter comme un petit enfant.
Jacques et Sandrine n’étaient pas des fiancés, comme la petite Duretour et son mécanicien. Ils étaient des amoureux qui s’étaient toujours aimés.
La mère de Sandrine les avait nourris ensemble et longtemps ils s’étaient crus frère et sœur. Puis les parents de Jacques avaient repris leur fils, pour le mettre au collège. Mais chaque année ils le renvoyaient passer ses vacances dans le petit village. Aussi, lorsque à vingt ans Sandrine était venue chercher du travail à Paris, elle était déjà mère d’une petite fille.
Elle l’avait avoué sans honte ni crainte à Mme Dalignac. Et tout de suite elle avait demandé à emporter de l’ouvrage le soir pour augmenter le prix de sa journée.
Elle savait son métier à fond. Elle était douce et gaie. Et dès les premiers jours Mme Dalignac l’avait prise en amitié.
Depuis, il lui était venu un autre enfant, un petit garçon qui allait sur ses trois ans et que la grand’mère élevait à la campagne avec la petite fille.
Jacques était caissier dans une grande maison de banque. Il habitait avec sa mère qu’il faisait vivre maintenant que son père était mort, mais il passait toutes ses soirées auprès de Sandrine à faire des colonnes de chiffres qui n’en finissaient plus. La même table et la même lampe leur servait, et tout deux travaillaient courageusement jusqu’à minuit pour gagner de quoi faire vivre leurs petits.
Pour l’instant, il y avait quelque chose de changé dans leur intimité. Jacques ne venait plus au-devant de Sandrine, et il la laissait seule à veiller dans la petite chambre. Sandrine n’en prenait pas souci. Jacques lui avait dit qu’il était obligé de rester auprès de sa mère très souffrante et cette explication lui suffisait. Elle se montrait heureuse et tranquille, comme si elle eût été la femme légitime de Jacques, et elle disait avec un sourire plein de confiance :
— Je sais bien que mon Jacques ne pourra jamais m’épouser, mais je sais bien aussi que rien ne pourra nous séparer.
C’était à elle que je devais mon entrée chez Mme Dalignac. Le hasard nous avait réunies un dimanche sur un banc du boulevard. Nous avions parlé de la couture, et elle m’avait proposé la place de mécanicienne qui était libre dans son atelier.
Moi aussi je l’avais prise en amitié tout de suite. J’ignorais si elle se sentait elle-même attirée vers moi ; car elle paraissait indifférente à tout ce qui n’était pas son Jacques ou ses enfants. Mais lorsqu’elle levait les yeux sur moi, elle avait toujours l’air de m’offrir quelque chose.
Au jour fixé pour le mariage de la jeune cliente, Sandrine mit la robe dans le carton, afin d’aller habiller elle-même la mariée et s’assurer qu’aucun point n’avait été oublié. Elle aimait faire ce travail et Mme Dalignac savait bien qu’elle s’en acquittait parfaitement. Aussi, elle lui indiqua seulement la manière de disposer le voile à la nouvelle mode. Il fallait surtout que la couronne de fleurs d’oranger retînt très en arrière les plis de tulle.
— Tenez, comme ceci.
Et Mme Dalignac drapait une mousseline raide sur les cheveux de Duretour, et elle ramassait au hasard une bande de toile, qu’elle lui enroulait au front, en guise de couronne.
Sandrine ne riait pas comme nous des mines révoltées de Duretour. Elle suivait attentivement les gestes de Mme Dalignac et, quand elle eut elle-même arrondi certain pli sous la bande de toile, elle partit toute légère et pleine d’assurance.
L’activité se relâchait toujours un peu lorsqu’une commande importante était finie. Bouledogue prenait son temps. Le patron se croisait les bras, et Bergeounette regardait plus qu’il ne fallait à travers la vitre.
Bergeounette était la plus ancienne après Sandrine. Elle avait pris sa place devant la fenêtre et n’avait jamais voulu la céder à personne.
Le patron affirmait qu’elle faisait des signes à un manchot qui passait sur le trottoir d’en face, mais Mme Dalignac disait que cela ne l’empêchait pas de coudre très vite et très bien.
Personne ne savait le véritable nom de Bergeounette et personne ne s’en inquiétait.
Le premier jour de son entrée à l’atelier, elle avait refusé de faire le travail à la manière de la maison, prétendant que sa manière à elle était aussi bonne. Le patron qui n’aimait pas à être contredit s’était emporté en lui criant qu’elle était aussi entêtée qu’une Bretonne.
Aussitôt elle s’était redressée pour répondre avec fierté :
— J’en suis une. Je suis une véritable Barzounette.
Le patron s’était moqué :
— Comment dites-vous cela ?
Mais Bergeounette l’avait nargué :
— Je dis comme ça, Monsieur. Et vous ne pourrez pas le répéter, parce que les gens du Midi ne sauront jamais prononcer ce mot-là.
Le patron avait ri au lieu de se fâcher, et il avait cédé à l’entêtée en l’appelant : tête de Bergeounette.
Elle continuait à montrer le même entêtement pour tout ce qui n’était pas son idée.
Les cris furieux du patron ou les douces remontrances de sa femme n’avaient aucune prise sur elle ; et il fallait toujours lui céder à la fin.
En dehors de ce défaut qui amenait souvent des disputes, elle était toujours prête à rendre service aux autres. De plus, elle était d’humeur égale et ne cherchait jamais les querelles. Sa grande joie était d’être écoutée, quand elle parlait de sa Bretagne, elle disait :
— La lande est grise, mais les ajoncs fleuris sont plus jaunes que les genêts.
Elle parlait de la mer comme d’une personne qu’elle aurait aimée tendrement.
— Quand j’étais petite, disait-elle, je courais sur les rochers pour mieux la voir, et lorsqu’elle se mettait à écumer, je croyais qu’elle s’habillait en blanc pour une fête, et que toutes les vagues la suivaient en procession.
Par les jours de grand vent, Bergeounette ressentait une véritable inquiétude et ne manquait jamais de nous dire :
— Il y aura des barques à la côte.
Parfois elle ouvrait la fenêtre et regardait le ciel comme si elle y cherchait les barques en péril. Puis elle fixait longuement les nuages, et souvent, en se rasseyant, elle chantait d’une voix lente et comme lointaine :
D’où viens-tu, beau nuage, Apporté par le vent ? Viens-tu de cette plage, Que je vois en rêvant ?
Notre gaîté s’effaça brusquement au retour de Sandrine. Elle rentrait de chez la cliente avec un visage si bouleversé, que tout le monde pensa qu’un malheur était arrivé à la robe.
Le patron et sa femme n’osaient pas l’interroger. Ils attendaient ce qu’elle allait dire, mais elle passa devant eux sans parler, et au lieu de s’asseoir, elle resta debout près de son tabouret.
Ses épaules étaient comme tassées et ses yeux étaient si élargis qu’ils faisaient mal à voir. Et tout à coup, elle se tourna contre le mur pour y appuyer son front.
Alors le patron n’y tint plus. Il se précipita en lui criant dans les oreilles :
— La robe ? la robe ?
Le regard de Sandrine passa sur lui et sur nous et aussitôt elle parla. Elle parlait avec vivacité ; et ce qu’elle disait était si embrouillé qu’il semblait que personne n’y comprendrait jamais rien. Cependant, quand elle s’arrêta, tout le monde savait que la robe allait bien, que le voile avait été disposé à la nouvelle mode, et que la pauvre Sandrine venait d’apprendre que son Jacques était marié à une jeune fille riche depuis une semaine déjà.
Il y eut comme une épouvante qui sembla commander le silence. Puis le patron baissa la tête et recula jusqu’à son tabouret, pendant que sa femme s’avançait lentement vers Sandrine, comme si elle y était attirée contre sa volonté.
Ce fut Bouledogue qui ramena le bruit en lançant des mots injurieux à l’adresse de Jacques. Bergeounette secoua les épaules comme si elle voulait se débarrasser d’un manteau gênant. La petite Duretour se mit à pleurer tout haut. Et quand enfin je ramenai mon regard sur la machine à coudre, je m’aperçus que je serrais fortement la burette contre ma poitrine, et que l’huile tombait goutte à goutte sur mes vêtements.
C’était chez la mère de Jacques que Sandrine avait appris son malheur. Comme la vieille dame lui avait toujours témoigné de l’amitié, elle n’avait pu résister au désir de monter prendre de ses nouvelles en passant devant sa demeure. Mais là, au lieu d’une malade, elle avait trouvé une personne bien portante et gaie qui lui avait dit tout de suite :
— Jacques a fait un beau mariage.
Et après avoir donné beaucoup de détails sur le bonheur de son fils et la beauté de sa bru, elle avait renvoyé doucement Sandrine en lui disant :
— Allez vite habiller votre jeune mariée.
Tout le jour Sandrine pleura. Elle poussait des cris comme un petit enfant, et sa peine nous paraissait si grande que nous ne trouvions rien à lui dire.
Elle s’arrêtait pour répéter d’un ton plein d’angoisse :
— Pourquoi ? mais, pourquoi ?
Justement, la veille, Jacques avait passé quelques instants dans la petite chambre, et il était parti en emportant une photographie des enfants.
Et le front de Sandrine se plissait, et son regard semblait se retourner en dedans comme pour fouiller sa mémoire :
— Pourquoi ? mais, pourquoi ?
Elle finit par s’endormir contre le mur et le bruit des tabourets ne la réveilla pas, à la sortie des ouvrières.
Je restai pour attendre son réveil afin de l’accompagner chez elle. De son côté, Mme Dalignac parlait de tirer le lit-cage de son coin, pour l’étendre dans l’atelier.
Sandrine se réveilla au bruit que fit la sonnette de la porte.
C’était Jacques qui venait aux nouvelles. Il était comme apeuré, et il n’avait ni chapeau, ni pardessus, malgré le temps humide et froid.
Sandrine trembla de tout son corps en le voyant, et lui, en s’avançant, semblait implorer sa pitié :
— Ma Sandrine !
Et Sandrine en lui tendant les deux mains comme pour le protéger, répondit aussitôt :
— Mon Jacques.
Ils restèrent un long moment à se regarder.
Le visage de Jacques exprimait une tendresse si profonde, qu’il me vint à l’idée qu’il n’y avait rien de changé entre eux. Mais cela s’effaça vite, car tous deux se mirent à pleurer lamentablement.
Sandrine ne fit aucun reproche. Elle dit seulement à travers ses larmes :
— Comment vais-je faire pour élever les enfants ?
Jacques voulut parler aussi, mais les mots qu’il avait à dire sortaient difficilement de sa bouche.
Sa voix restait au fond de sa gorge, et il pressait davantage les mains de son amie, comme si cela suffisait à le faire comprendre. Puis il se mit à tirer sur le dossier d’une chaise dont les pieds se trouvaient retenus par la traverse de la table. Il tirait fortement, et quand il eut réussi à sortir la chaise il respira avec satisfaction comme s’il venait de faire une chose absolument nécessaire. Peu après, il reprit son air craintif, et il regarda vers la porte avec un mouvement qui lui fit tendre le dos.
Sandrine ne chercha pas à le retenir, mais au moment où il la quittait pour aller rejoindre sa nouvelle femme, elle lui lustra du bout des doigts le plastron de sa chemise, dont les plis formaient des cassures.
Le lendemain, personne ne la vit pleurer.
Cependant, elle gardait un tic qui lui tirait durement la bouche. Et à tout instant son regard s’en allait autour de l’atelier comme à la recherche d’un objet perdu.