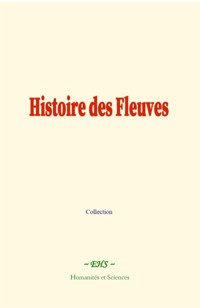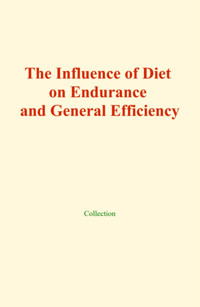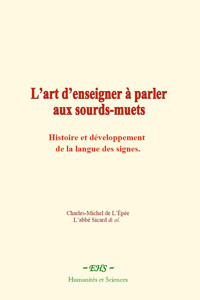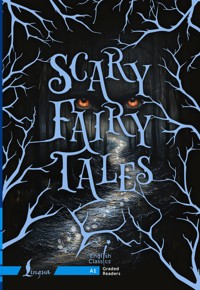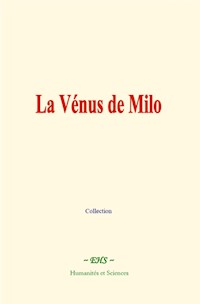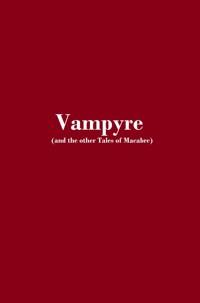Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: EHS
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Französisch
On a beaucoup écrit sur l’Atlantide dont il est déjà question en deux endroits de l’Odyssée d’Homère. Platon fait remonter à neuf mille ans, l’époque où la puissance des Atlantes arrivée à son apogée, devint menaçante pour les pays situés en deçà des Colonnes d’Hercule. Cette puissance, dit-il, fut abîmée par le courage des Athéniens, et plus tard l’île elle-même fut anéantie par un tremblement de terre à l’issue duquel elle disparut sous la mer…
Le grand continent qu’elle désigne a été vu en effigie un certain jour dans les temps héroïques ; mais comme on ne voit pas cette image à toute heure, et que le phénomène optique qui y donne lieu ne se produit que dans des conditions particulières de soleil et d’équilibre atmosphérique, on comprend que le voyageur grec ou égyptien qui voulait voir le pays des Atlantes, ne trouvait plus que de l’eau là où devait être et où il avait pu précédemment apercevoir, une île plus grande que l’Asie et l’Afrique.
En fallait-il davantage pour conclure avec la tradition, que « l’Atlantide disparut sous la mer ».
Ce livre explore, à travers différents récits, l’histoire de l’Atlantide et des Atlantes.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 101
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
L’Atlantide et les continents disparus
L’Atlantide et les continents disparus
Collection
EHS
Humanités et Sciences
L’Atlantide de Platon expliquée scientifiquement{1}
On a beaucoup écrit sur l’Atlantide dont il est déjà question en deux endroits de l’Odyssée d’Homère{2}. Hésiode parle des Atlantes dans sa Théogonie ; Euripide s’en occupe sur le théâtre d’Athènes. Solon a écrit leur histoire d’après la tradition à lui enseignée par un vieux prêtre de Sais.
Ce que Platon en dit vient de la même source, car il le tient de Critias son grand-père, lequel avait puisé ses récits dans les manuscrits de Solon qui se trouvaient alors déposés chez son père, manuscrits que, dit-il, il a beaucoup étudiés dans son enfance. L’initié de qui vient cette tradition, fait remonter, d’après les livres égyptiens, à neuf mille ans, l’époque où la puissance des Atlantes arrivée à son apogée, devint menaçante pour les pays situés en deçà des Colonnes d’Hercule. Cette puissance, dit-il, « fut abîmée par le courage des Athéniens, et plus tard l’île elle-même fut anéantie par un tremblement de terre à l’issue duquel elle disparut sous la mer. »
Aussi, ajoute le narrateur, « depuis ce temps, la mer est-elle devenue inaccessible et a-t-elle cessé d’être navigable, par la grande quantité de limon que l’île abîmée a laissée à sa place ».
Suivant cette tradition, l’Atlantide était placée devant les Colonnes d’Hercule (détroit de Gibraltar) ; elle était plus grande que la Libye et l’Asie. C’était donc un immense continent, dont Bory de Saint-Vincent voit les derniers restes dans les îles du Cap-Vert, l’Archipel des Canaries et celui des Açores.
Cependant Plutarque place ce pays dans la mer Glaciale, l’érudit Suédois, Rudbeck, cherche à prouver par des textes et de nombreuses citations que l’Atlantide devait exister non pas dans l’Océan Atlantique mais bien dans la Baltique, en Suède, son pays à lui.
Dans le volume que Bailly a consacré à cette question, on va plus loin encore ; pour Bailly, les Atlantes sortent du Groenland, du Spitzberg et de la nouvelle Zemble qu’il nous représente comme un des berceaux de l’humanité à une époque sans doute contemporaine des mammouths qu’on trouve gelés sur place dans ces régions polaires.
D’autres, enfin, ont voulu voir dans le récit de Critias, la preuve que les anciens connaissaient l’Amérique.
La géologie contemporaine s’est également occupée de cette tradition ; elle considère comme très probable l’existence de l’Atlantide ainsi que son anéantissement subséquent par voie d’affaissement. Car, en définitive, la configuration du sol qui recouvre le globe terrestre est due, en grande partie, à des phénomènes de l’ordre de ceux qui, au dire des anciens, ont présidé aux destinées du continent des Atlantes et la carte de l’Europe actuelle ne date elle-même que du grand soulèvement qui a donné naissance aux Alpes en même temps qu’il a occasionné la submersion d’une autre partie de la terre ferme.
Pour le moment donc, les géologues, raisonnant par analogie, sont seuls à admettre sans commentaires, la position topographique de l’Atlantide telle que l’indique la tradition. Les érudits qui n’ont à leur disposition ni la théorie des soulèvements ni celle des tremblements de terre, ne s’accordent pas aussi bien : leurs divergences sont même assez fortes pour avoir fait rejeter par beaucoup de penseurs, dans le domaine des chimères, tout ce qui est relatif au récit de Solon et de ses successeurs.
Nous ne serons pas aussi absolu, persuadé que nous sommes que la fable de l’Atlantide est basée sur une donnée certaine. Le souvenir de cette donnée a pu être altéré et plus ou moins modifié au gré des peuples et des narrateurs ; le récit dont elle a été l’occasion peut même — et cela n’est pas douteux — fourmiller d’erreurs et d’anachronismes mais tout en lui ne peut être inventé ; il doit avoir pour point de départ, un fait de nature à justifier cette croyance de l’antiquité, dans l’existence d’un vaste continent placé au devant des Colonnes d’Hercule et qui, par une cause quelconque, a un jour disparu sous les flots de l’Atlantique.
Or, à en juger d’après de récentes observations faites, précisément, sur l’un des points de cet Océan, où les narrateurs de l’antiquité placent ce problématique continent, le petit grain de vérité qui a donné lieu à la tradition de l’Atlantide repose, tout simplement, sur un phénomène de mirage, phénomène qui de nos jours encore, et dans de certaines conditions physiques, parait pouvoir être observé du pic de Ténériffe, lequel, placé aux Canaries, s’élève comme on sait, à près de 2000 mètres au-dessus du niveau de la mer.
Au dire d’un récit récemment publié, c’est, en effet, dans une ascension à la cime de ce volcan que quelques savants portugais virent, non sans surprise, au lever du soleil, des terres se développant sur certains points de l’horizon et formant une masse qui ne pouvait, évidemment, appartenir qu’à un continent. L’Archipel des îles Canaries était pour ainsi dire à leurs pieds, en sorte qu’il n’était pas possible de confondre les terres qui apparaissaient à l’horizon avec les îles du groupe des Canaries quelle que fut la distance qui les séparât.
« C’étaient donc des terres autres que celles des îles Fortunées qui se montraient à leurs regards étonnés, et ce n’étaient, en effet, ni plus ni moins que les montagnes Appalaches de l’Amérique que l’on apercevait du haut de cet observatoire colossal. Le doute n’était plus permis d’après le calcul fait par un des voyageurs qui connaissait cette partie de l’Amérique et tous s’extasièrent devant ce spectacle grandiose qui leur offrait la vue du continent américain à une distance de près de 1000 lieues. »
Le CourrierdesSciences auquel nous empruntons cette observation ajoute ce qui suit:
« Ce spectacle était du à un mirage des plus merveilleux. Les effets de cette réfraction extraordinaire sont produits par le vent humide de l’Ouest-Sud-Ouest qui règne dans cette partie de l’Océan. Le jeu des réfractions terrestres, dont les phénomènes sont d’ailleurs très connus, se révélait là, pour la première fois, peut-être, dans des proportions vraiment extraordinaires et qui paraîtront incroyables quand on saura que de la cime d'une montagne élevée comme le pic de Ténériffe, l’œil ne peut embrasser qu’une surface de 5700 lieues carrées, et que le rayon visuel de l’horizon du pic s’étend à peine à une distance de 50 lieues. Or, apercevoir les Appalaches de l’Amérique situées à 1000 lieues, était assurément le plus émouvant et le plus merveilleux résultat de réfraction qui jamais se fût produit ».
Si cette relation est conforme aux faits, on a raison de considérer comme merveilleux, le phénomène d’optique qu’elle rapporte ; car on n’a pas d’exemple de mirage rendant visible à 4000 kilomètres de distance (environ la neuvième partie de la circonférence du globe terrestre), un objet, fût-ce une immense chaîne de montagnes, et visible au point de pouvoir être reconnu et appelé par son nom. Peut-être, est-ce plutôt par supposition que nos voyageurs anonymes ont attribué aux Aleghanny’s les terres vues à l’horizon. Quoi qu’il en soit, un mirage peut se produire à Ténériffe aussi bien qu’ailleurs, lorsque les conditions sont favorables et pour peu qu’on admette ce fait qui, d’ailleurs, ne saurait être contesté, il est impossible de ne pas songer à ce vaste continent de la tradition, lequel se développant dans l’Atlantique, au delà du détroit de Gibraltar, comprenait ainsi l’Archipel des Canaries, c’est-à-dire les « Hespérides » des anciens.
Sans doute, on voyageait peu au temps de Solon et beaucoup moins encore, au temps antéhistorique dont parle la tradition égyptienne qui nous occupe. Mais — et cela n’a rien d’improbable — que du sommet des Hespérides, un mirage vers le Nord-Ouest ait été remarqué dans l’ancien temps, par un observateur suffisamment autorisé, il n’en fallait pas davantage pour faire naître l’idée d’un continent, placé dans l’Atlantique par delà les Colonnes d’Hercule, continent dont les savants portugais eussent eux-mêmes admis l’existence s’ils avaient fait leur curieuse observation quelques siècles plutôt, c’est-à-dire à une époque antérieure à la découverte de l’Amérique.
La vue d’un, pareil continent devait produire sur l’observateur des temps pharaoniques, l’effet que produisit en 1799 sur l’armée d’Egypte errant dans les sables du désert, la vue des lacs et des palmiers qu’un phénomène de réfraction atmosphérique inconnu d’elle, lui montrait à l’horizon. Brûlé par le soleil et harassé de fatigue, le soldat prenait au sérieux les eaux transparentes et les frais oasis qui se montraient au loin, mais il avait beau marcher vers eux ; il n’arrivait pas à les joindre.
Bien d’autres observations du même ordre ont été faites sur les différents points du globe ; les Fatamorgana qui défrayent les chroniques et les légendes des riverains du golfe de Naples, ne sont dus eux-mêmes qu’à un phénomène de mirage qui se manifeste de temps à autre, dans de certaines conditions atmosphériques.
L’Atlantide de Platon a, selon nous, une origine analogue. Le grand continent qu’elle désigne a été vu en effigie un certain jour dans les temps héroïques ; mais comme on ne voit pas cette image à toute heure, et que le phénomène optique qui y donne lieu ne se produit que dans des conditions particulières de soleil et d’équilibre atmosphérique, on comprend que, venant dans un moment inopportun, le voyageur grec ou égyptien qui voulait voir le pays des Atlantes, ne trouvait plus que de l’eau là où devait être et où il avait pu précédemment apercevoir, « une île plus grande que l’Asie et l’Afrique. »
En fallait-il davantage pour conclure avec la tradition, que « l’Atlantide disparut sous la mer ».
Les observateurs portugais dont nous venons de parler mais dont nous ignorons les noms, ont donc pu voir, dans une séance de peu d’heures, ce qui, selon la tradition, ne s’est accompli que dans une longue suite de siècles, savoir la naissance de l’Atlantide et puis, sa disparition sous les flots.
Ils y retourneront, munis cette fois, du Tymée et du Critias ; car, si les îles Fortunées sont, réellement, le siège d’un mirage périodique, nous ne doutons pas que Ténériffe ne soit tôt ou tard, un but d’excursion pour les zélateurs de plus en plus nombreux, de l’histoire ancienne et dont beaucoup seront curieux d’assister, en moins de quelques heures, au spectacle qui a donné lieu à une des plus belles traditions de l’antiquité.
L’Atlantide et les continents disparus{3}
Beaucoup de personnes très instruites, et même ayant appris avec détails la Géographie, n’ont pas de notion précise sur l’histoire de la répartition des continents et des mers. Plusieurs ne sont pas loin de penser qu’il y a eu, je ne dirai pas de toute éternité, mais presque depuis leur formation initiale, une Europe, une Asie, une Afrique, une Amérique et une Australie.
Lorsque j’étais élève au Lycée, et fort adonné à la Géographie, le premier livre de Géologie qui me tomba sous la main fut LaTerreavantleDéluge, de Louis Figuier. La lecture de cet ouvrage me stupéfia. Comment ! Pendant toute la durée des périodes de l’histoire du Globe, les continents et les mers avaient eu des formes différentes de celles d’aujourd’hui ? Pourquoi aucun de mes professeurs (j’allais dire de Géographie) non, d’Histoire, mais enseignant la Géographie, ne m’avait-il jamais parlé de cela ?
Il est vrai que la Géologie était bien jeune à cette époque cependant peu lointaine. Et le système de cet excellent Louis Figuier était d’une simplicité un peu trop grande.
L’auteur supposait que la mer recouvrait au début toute la surface de la Terre et que, peu à peu, avaient émergé des îlots qui, s’agrandissant par leurs bords, comme par les pièces surajoutées d’un jeu de patience, avaient formé, çà et là, des îles de plus en plus grandes, arrivant à constituer des continents qui, en définitive, dessinaient les terres et les mers actuelles.