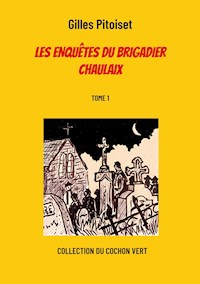Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Collection du cochon vert
- Sprache: Französisch
Divorcé depuis peu, Alexandre Girardot partage son temps entre les voyages et son commerce. Parcourant le Moyen-Orient et l'Asie, il rapporte meubles, bijoux et tapis. Sa rencontre avec une jeune femme Kirghize semble inéluctable. Elle va changer sa vie. Alors que le monde est frappé par une épidémie de grippe aviaire, une course au vaccin miracle se transforme en conflit d'intérêts. Nos deux tourtereaux se trouvent happés dans une lutte sans merci, où sécurité et identité deviennent les défis majeurs d'une nouvelle ère. La technologie biométrique menace la liberté des individus et les dirigeants jouent aux dieux aveugles.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 389
Veröffentlichungsjahr: 2022
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Né en 1959 à Dijon, Gilles Pitoiset raconte, à travers ce premier roman, voyages et rencontres inattendues. Il nous emporte dans ses bagages où se mêlent réalité et fiction. Après avoir lui-même parcouru les pays les plus méconnus, il nous livre une partie de sa propre histoire et celle d’un avenir où la réalité l’emporte sur la fiction.
Celui qui voyage sans rencontrer l’autre ne voyage pas, il se déplace…
Alexandra David-Neel
Sommaire
PREMIERE PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
DEUXIEME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
TROISIEME PARTIE
Chapitre I
Chapitre II
Chapitre III
Chapitre IV
Chapitre V
Chapitre VI
Chapitre VII
Chapitre VIII
Chapitre IX
Chapitre X
Chapitre XI
Chapitre XII
Chapitre XIII
Chapitre XIV
Chapitre XV
Chapitre XVI
Chapitre XVII
Chapitre XVIII
Chapitre XIX
PREMIERE PARTIE
I
Tout allait de travers, à part peut-être l’astre du jour qui, fidèle à sa trajectoire, pointait à l’horizon. Même l’horloge, suspendue au mur de briques, avait perdu sa grande aiguille. Restait la petite qui, dénuée de toute initiative, faisait le boulot pour deux. C’était toutefois ce que l’on se plaisait à croire, mais la réalité voulait qu’elle n’ait rien changé à ses habitudes et que sa coéquipière s’était bel et bien éclipsée. Cela n’empêchait nullement le temps de s’écouler, mais l’on sentait que l’endroit avait perdu en précision. Malgré cela, Gaby, le visage perlé de sueur et inondé de lumière halogène, se penchait à nouveau sur sa patiente avec la même assurance qu’autrefois. Il paraissait très calme malgré une opération qui s’était mal engagée. Il connaissait pourtant bien son affaire et avait connu des situations beaucoup plus périlleuses. Avec une pince, il s’y reprit à deux fois avant de réussir enfin à stopper l’hémorragie. Gaby s’épongea le front sur la manche de sa blouse, qui n’était plus franchement propre. Il était grand temps de faire une pause, maintenant que la situation était à nouveau sous contrôle. Il leva péniblement la tête et aperçut toutes ses patientes qui attendaient leur tour. Il lui semblait que leurs grands yeux transparents l’accablaient de reproches. Certaines étaient là depuis plusieurs jours. Ce n’était encore jamais arrivé, il en était conscient et il lui faudrait faire patienter leurs propriétaires. Étonnamment, tout cela lui parut sans importance. L’huile noire épaisse qui s’échappait paresseusement de la durite s’arrêta de couler dans la bassine.
— Allez ça va aller ma belle, demain t’y penseras plus, et moi non plus.
Il releva la tête de dessous le capot et enleva les gants poisseux qu’il jeta sur l’établi à roulettes qu’il avait confectionné lui-même.
Gaby, c’était pas un savant, mais dans son boulot, il était plutôt un virtuose. À quatorze ans, il avait déjà du cambouis en guise de moustache et des clés à pipe à la place de ses dix doigts. Maintenant, il avait son propre garage qu’il considérait d’ailleurs davantage comme une clinique. Quand il inspectait les voitures qu’il devait opérer – c’est comme ça qu’il disait – on avait l’impression qu’il faisait le tour des lits de ses malades en lisant leurs courbes de température. Ce matin, il avait beaucoup perdu de temps avec cette intervention, et, malgré cela, comme la petite aiguille, il pensait avoir fait le boulot pour deux. Lui aussi avait perdu sa coéquipière. Il aurait bien enfermé le temps sous un globe en verre mais le tic-tac de son cœur meurtri lui martelait chaque seconde. Il fit le tour de la mécanique et lui parla comme pour la rassurer. Il aimait caresser les ailes arrondies de ses patientes métalliques.
— Bon ! C’est élémentaire mon cher klaxon ! Il suffit de changer cette durite à la con et ça va repartir, pas de problème ! Il avait un humour plutôt style mécano-linguistique le Gab’s – comme l’appelaient certains – et souvent, il y allait de bon train… avant !
Mais là, un vrai temps mort s’imposait.
La tasse de thé avait remplacé la clope et la clé de douze la petite cuillère. Avec le temps, les bagnoles avaient pris toute la place dans sa vie. En quarante ans de boulot, mises bout à bout, toutes les belles carrosseries qui lui étaient passées entre les pattes auraient aisément fait le tour du globe.
Je passais souvent le voir dans son atelier qui se trouvait au bout de ma rue.
On s’était côtoyés toute une année dans la salle de sport du quartier, où je me recomposais les abdos après être passé sur le billard – histoire de tuyaux pas très rigolote. Il chahutait les haltères pendant que je faisais le tour de France à vélo sans user les pneus. On s’était très vite liés d’amitié et je lui avais confié ma Vespa. Autant dire, ma vie. Il l’avait remise en état et s’était mis en tête de faire pareil avec mon bide. Il m’avait concocté un p’tit programme au gymnase. Les pompes avaient rapidement vidangé l’antigel qui me restait des opérations. Mais les haltères, rien à faire, ce n’était pas mon truc.
Puis le garage avait rapidement repris le dessus et rappelé le Gaby à sa passion. Il avait rangé les poids, en avait repris un peu, et se donnait tout entier à ses patientes devenues encore plus possessives.
C’est devant sa tasse de thé que je le trouvai ce matin-là. Le brouillard, mêlé aux fumées d’échappement du boulevard qui longeait l’atelier, pénétrait jusqu’à la cage de verre qui lui servait de bureau. Il n’avait pas la pêche.
L’hiver était là, et fallait faire avec.
— Alors, t’as rangé ta Vespa ? me dit-il mécaniquement.
— Tu ne crois pas si bien dire Gab’s, hier soir je m’suis croûté, comme dit mon gamin.
— Comment ça ?
— Ecoute ! Il pleuvait, j’y voyais rien, un gars m’a coupé la route et je suis parti dans le décor. Remarque, je n’ai pas tapé la bagnole, une chance, sinon, j’étais bon pour un nouvel abonnement au gymnase.
— Y’a du mal ? qu’il s’inquiète.
— Ma petite Vespa t’a demandé trois fois !
— Opérable ? qu’il me demande.
— C’est pourquoi je suis là Gaby, elle veut te voir.
Après les blagues d’usage, je pris le bus en direction du centre-ville et laissai mon bon Gaby reprendre sa conversation avec une courroie de distribution récalcitrante.
Dijon l’été, c’est déjà un poème, mais l’hiver, faut être né ici. De ce fait, j’ai vite trouvé à me réchauffer l’âme devant un p’tit noir sur le zinc d’un bistrot bien de chez nous, l’Armstrong !
L’Armstrong concoctait un petit café aussi noir que lui avait les dents blanches. La zizique y était sympa et la serveuse avait un déhanché de saxophone. Il était d’ailleurs fortement déconseillé de jouer avec les touches. La moindre fausse note et le chef d’orchestre te foutait dehors.
Mon Paulo, lui, ce qu’il aimait à l’Armstrong, c’était son petit blanc.
Il était fidèle au poste et avait déjà parcouru toutes les annonces concernant les petits boulots du coin.
— Alors mon Paulo ! Y a plus de boulot dans la moutarde ? que j’lance style boute-en-train « arrière ».
— Pas plus que de blanc-cassis dans le lac Kir, qu’y m’répond du tac au tac.
Paulo, faudrait une encyclopédie pour illustrer tous les vieux démons qui le titillaient et qu’il cherchait à noyer au fond des verres qu’il déglinguait. Le problème, c’est que ses démons nageaient mieux que lui et qu’il fallait souvent aller le repêcher au fond du fond. On se fréquentait depuis que l’on était mômes, et je dois dire que j’avais bien une idée de ses tourments, mais il n’aimait pas particulièrement s’attarder sur le sujet et moi je détestais la plongée en apnée.
Les habitués de l’Armstrong avaient pris leur place respective et déblatéraient sur les nouvelles du jour. Dehors, le brouillard s’était transformé en un petit crachin et les passants marchaient en regardant les pavés. Un journal passait de table en table à mesure que les clients quittaient l’endroit pour se rendre à leurs activités quotidiennes. Il y avait dans ce rituel populo quelque chose qui me nourrissait et qui me dérangeait en même temps. Un besoin de prendre le large pour ne pas coller au parquet, sans doute.
Près du bar, un ancien lisait le canard, qui lui servait de kleenex, épongeant lentement les gouttes qui s’échappaient de son nez. On y parlait de grippe, d’épidémie, de fléau, que sais je encore, de pandémie ! La peur s’installait sournoisement et le regard de l’autre devenait suspect. Si quelqu’un venait simplement à tousser, ou pire encore à éternuer, des nuages noirs se profilaient à l’horizon. L’homme ou la femme en question était mis au banc de la société. La peste noire était de retour et les journaux télévisés en rajoutaient à tel point que les microbes devenaient palpables. Le danger c’était l’autre. Méfiance, disait-on ! Méfiez-vous de votre voisin ! Il n’y a encore pas si longtemps on aurait encouragé la délation. Heureusement pour nous, on nous promettait que notre gentil Gouvernement allait nous sortir de là. Bref, on se marrait bien dans le troquet, jusqu’à ce qu’un Asiatique entre, un masque de tissu lui recouvrant le nez et la bouche. Là, pareils à un nuage de criquets, la plupart des clients s’envolèrent sans autre forme de procès.
— Bah !! ils z’ont qu’à nous distribuer du blanc payé par la Sécu, déblatéra mon Paulo, y’a pas meilleur antibiotique, pouvez m’croire, continua-t-il, fier de sa conclusion. Il devait se sentir immunisé à vie. Bref, il n’était pas dans ses meilleurs jours et je préférai ne pas assister au rituel.
— Y vont bien nous trouver un remède qui va se vendre au prix de l’or, vous allez voir, et qui c’est qui va s’enfiler la note en suppositoire ?... répondit le patron du troquet.
L’ancien, qui était resté collé à sa table, plia le journal, comme on plie un mouchoir humide, et nous lança par défi :
— Rigolez donc les jeunes, vous verrez quand vous serez vieux, hein ! Vous ferez quoi de mieux que nous ? En attendant on fait quoi pour les vieux, hein ? À part nous matraquer pour qu’on les prenne leurs suppositoires ! Dommage, on n’est plus là pour descendre dans la rue, nous ! Ce n’est pas vous avec vos joysticks à la con qu’allez changer ce bordel ! Faites comme vous voulez les p’tits gars, mais moi si j’ai passé la canicule avec la mention « vieil emmerdeur », ce n’est pas pour me mettre leur saloperie dans le cul. Allez, à bon entendeur, salut !
Passant devant le nouveau venu masqué jusqu’aux oreilles, il se bidonna en gueulant que si les Chinois commençaient à s’inquiéter pour leurs semblables, c’est qu’il fallait vraiment faire gaffe.
Dix minutes plus tard, je laissai mon ami Paulo réviser son chinois au comptoir.
Le froid s’était installé et les pavés des ruelles scintillaient sous le gel. Il me fallut peu de temps pour rejoindre mon commerce situé dans une petite rue adjacente. Je tenais cette boutique depuis maintenant quatre ou cinq années. Le quartier était agréable et le boulot plutôt sympa. Avec le temps, j’avais entassé différents meubles, tapis, bijoux, luminaires et toutes sortes de bibelots récoltés lors de mes différents voyages en Asie et en Moyen-Orient. Le tout ressemblait à une caverne d’Ali Baba bobo et je m’y sentais bien. L’ambiance était chaleureuse et la température naturelle qui y régnait m’évitait d’utiliser du chauffage. Pas mal de types dans la dèche passaient régulièrement à la boutique me taper une cigarette ou un billet de dix. C’était presque devenu une taxe, mais je la préférais à celles que l’Etat m’imposait. Finalement, avec le temps, elles allaient finir par avoir raison de mon commerce et de ma patience. Bref, la vie était plutôt douce et les rencontres intéressantes.
J’avais à peine relevé le rideau de fer que l’Inca fit son entrée. De tous les gars un peu barrés qui passaient au magasin pour discuter avec moi, l’Inca était mon préféré. Certains m’exposaient une thèse sur la fin du monde ou l’invasion des extraterrestres, des reptiliens vivant sous notre sol, ou bien encore déliraient sur la théorie des crânes de cristal. C’était pour eux plus qu’une évidence. L’Inca, lui, avait quelque chose de plus. L’homme était toujours très théâtral et ce n’était pas pour me déplaire. Il effrayait pas mal de gens avec ses grandes tirades mystico-politiques. Elles étaient pourtant bien loin d’être dénuées de sens. Il émanait de ce type quelque chose de mystérieux qui le rendait attachant. Mais, comme disait notre regretté Georges : « Les braves gens n’aiment pas que l’on suive une autre route qu’eux... » Bref, l’Inca me révéla que cette fameuse pandémie de grippe n’était qu’une mise en scène savamment orchestrée et que l’on allait tous en prendre pour notre grade. Bon, allez savoir ? Il me taxa d’une petite blonde et sortit comme il était entré. Contrairement aux autres, que je trouvais vraiment déconnectés de la réalité, l’Inca était très impliqué dans les sujets de société et plutôt bien informé. Il ne délirait pas, non, je ne dirais pas ça. Il commentait les événements à sa façon et ses arguments étaient souvent troublants. Je m’étais habitué à sa visite hebdomadaire.
J’entrepris de changer la présentation des bijoux turkmènes et afghans que j’affectionnais tout particulièrement. Un an auparavant, alors que je passais à Istanbul avec ma fille qui adore partir en balade avec moi, nous rencontrâmes Hassan. Il possède une entreprise uniquement familiale. Lui et sa famille avaient bénéficié de la prime que le gouvernement turc offrait aux réfugiés musulmans qui fuyaient l’Afghanistan lors de l’invasion des Soviétiques. Les bijoux qu’ils fabriquaient étaient uniquement composés de pierres semi-précieuses. Fan, ma fille eut vite fait de sélectionner une grande quantité de ces merveilles. Installés en vitrine, ces colliers et bracelets avaient rapidement augmenté la clientèle féminine. Je ne pouvais m’empêcher de repenser à ce voyage, chaque fois que je réorganisais l’étalage. Auparavant, j’avais moi-même acheté quelques bijoux au Pakistan, mais le succès n’avait pas été au rendez-vous. J’étais ravi que ma petite Fée ait su développer, de façon aussi intuitive, cette nouvelle activité enchanteresse au magasin. D’ailleurs, elle adorait passer du temps à la boutique et devint très vite une excellente vendeuse. Elle connaissait tous les tapis, leur origine et même leur histoire. Les clients ne s’y trompaient pas et l’appréciaient beaucoup. Pendant qu’elle s’affairait, je faisais chauffer la théière et préparais le t’chai. Les journées défilaient tranquillement. Noël s’annonçait et j’allais avoir grandement besoin de son aura.
Je pensai à nouveau à l’Inca. Tout de même, il était incroyable… Il voyait des conspirations partout. Ce jour-là, je ruminais ses paroles et me demandais s’il n’y avait pas une part de vérité dans ses propos.
Rentré chez moi tard dans la soirée, , j’allumai à l’aide de la redoutable zapette le téléviseur. Il diffusait un débat sur la fameuse grippe. Quoi d’étonnant ? Audimat garanti ! Ceci dit, les interlocuteurs n’étaient pas des moindres et je me laissai passionner par leur conversation. Ils venaient de détecter, en Norvège, une mutation sur trois virus H1N1 qui était, semblet-il, à l’origine de deux nouveaux décès. Pour autant, cette nouvelle alerte ne semblait pas inquiéter les organismes internationaux de santé. Ils précisaient que cette mutation restait sensible aux médicaments et traitements antiviraux oséltamivir et zanamivir, et que d’autre part des cas semblables avaient été détectés en avril de cette même année au Brésil, en Chine, au Japon, aux États-Unis, en Ukraine et au Mexique. Cette transformation ne semblait donc pas, statistiquement parlant, à l’origine des nouveaux décès. À l’évidence, ils constataient tous que les réseaux d’Euroflux, qui n’étaient autres que ceux de l’OMS pour la surveillance de la grippe en Europe, étaient débordés et manquaient d’effectifs pour faire face à une éventuelle accélération de l’épidémie. Je m’endormis sur ces conclusions, la tête bien calée sur un coussin du canapé. Instantanément, je me retrouvai nu, me débattant au milieu d’un fleuve bondé de corps sans vie, victimes de la grippe. Ils dévalaient le lit de la Seine dans une atmosphère apocalyptique. Réussissant tant bien que mal à m’agripper à une racine, je me hissai sur la berge. Je grelottais de froid et d’épouvante. Au-dessus de ma tête, le ciel était noir et des nuages monstrueux y défilaient à une vitesse vertigineuse. Au loin, des flammes gigantesques dessinaient des ombres sordides qui dansaient et précipitaient d’innombrables corps par-dessus le parapet du pont principal, qui donnait accès au cœur de la cité. Des cris montaient au ciel. Soudain, entouré d’un halo surnaturel et lumineux, l’ange Gabriel creva les cieux… avant.
— Alors ! Tu baignes dans l’huile, me lança le Gab’s auréolé.
Je me réveillai aussitôt, frissonnant et en sueur. J’éteignis le téléviseur, qui diffusait un reportage sur la peste noire au Moyen Âge, et me recroquevillai à nouveau sous la couverture pour me rendormir jusqu’au petit jour.
II
Jamilia Oblomov venait de fêter ses trente-deux ans. Originaire du village de Kara Kache au Kirghizistan, elle vivait maintenant à Paris où elle avait terminé ses études de médecine. Bien des événements s’étaient déroulés depuis qu’elle avait quitté son pays, et jamais elle n’aurait pu s’imaginer qu’elle allait vivre dans un endroit aussi différent de celui de son enfance. Entre la tour Montparnasse et les grands espaces d’Asie centrale, le contraste était de taille. Une nomade des temps modernes, en quelque sorte. Elle était née sous une yourte au bord du lac magique de Song köl. Son père, alors éleveur, l’emmenait chevaucher des journées entières sur les hauts plateaux. Puis, à l’âge de quinze ans, sa famille l’avait précipitée dans le cœur de la capitale du pays, où le changement avait été brutal. Les bouleversements politiques des dernières décennies les avaient contraints à s’installer à Bichkek. Ishen, son frère de dix ans son aîné, venait d’y ouvrir une agence de trekking. Il organisait des randonnées à cheval à travers le pays, ce qui ne manquait pas d’attrait pour les amateurs d’un tourisme vert. Une année plus tard, son père ainsi que Rash, son plus jeune frère, étaient retournés à Kara Kache. Ils avaient rapidement installé plusieurs yourtes sur le terrain familial, pour accueillir les groupes. L’activité était florissante et avait permis d’envoyer Jamilia à l’université Jusup Balasagyn de Bichkek. Elle était fière de la réussite de sa famille et du changement visionnaire que ses frères avaient su opérer. Il leur avait fallu beaucoup d’imagination et d’audace pour faire face à la détresse qui s’était installée dans le pays après le retrait des Russes en 1991. Les salaires qu’ils percevaient régulièrement des coopératives agricoles s’étaient volatilisés du jour au lendemain, et ils avaient dû retrouver une nouvelle source de revenus. Ils n’avaient pu compter que sur eux-mêmes. Beaucoup de personnes s’étaient trouvées démunies, se laissant alors plonger dans les méandres de la vodka frelatée. Jamilia était consciente des sacrifices financiers que représentaient ses études pour sa famille, elle était bien décidée à ne pas les décevoir. Elle parlait naturellement le russe, en plus de sa langue natale, et s’était familiarisée avec l’anglais au contact des étrangers qui fréquentaient l’agence de trekking. Il ne lui fut pas très difficile d’apprendre le français à l’université. Bercée dès la petite enfance par les nuits sous la voûte céleste, les étoiles avaient su lui insuffler les secrets qui unissaient l’infiniment petit à l’infiniment grand. Les constellations lui étaient familières et le monde invisible de l’infiniment petit l’avait rapidement intriguée. C’est ainsi qu’elle se retrouva dans un cursus de recherche biomédicale, qui l’amena, dans un premier temps, à Grenoble. Après plusieurs années d’études parallèles médecine-sciences, elle décrocha un poste d’interne au service de microbiologie de l’hôpital Necker à Paris. Ensuite, sa thèse hospitalo-universitaire la conduisit dans un laboratoire de recherche parisien, à l’Institut Pasteur, où son travail fut validé par des publications internationales. C’est ainsi que Jamilia se retrouva confrontée au virus de la grippe H1N1 de 2009. Le laboratoire Pasteur travaillait alors pour l’Organisation mondiale de la santé (OMS), et était chargé, entre autres, de la surveillance de l’évolution de la grippe en Europe de l’Est. Jamilia s’y plaisait et adorait la vie parisienne.
Elle était concentrée sur l’écriture d’un rapport à propos de la réaction en chaîne de la polymérase, action qui consiste à ajouter un réactif sur une portion d’échantillon prélevé sur un patient, afin de désactiver le virus. Elle ne vit pas entrer sa collègue, qui était accompagnée d’un homme d’une quarantaine d’années.
— Jamie, dit-elle en posant délicatement la main sur l’épaule de Jamilia qui bondit de sa chaise.
— Oh, Lucie, je ne t’ai pas entendue entrer. Je suis désolée, s’excusa-t-elle.
— Non, c’est moi qui suis désolée Jamie, s’esclaffa la douce Lucie. Puis-je te présenter le Pr Youssouf Pamir ? Il vient d’être affecté au sein de notre laboratoire.
— Enchanté, Madame, je suis également confus de vous déranger, s’excusa Pamir en tendant la main.
— Mademoiselle, rectifia Jamilia dans un sourire qui illumina toute la pièce. Bienvenue dans notre unité.
— Merci, s’empressa-t-il de répondre, en lui serrant la main avec beaucoup de délicatesse.
— Le professeur Pamir nous arrive directement d’Istanbul où il a travaillé en collaboration avec le Dr Mitral Akcay Ciblek, continua Lucie, impatiente d’en raconter davantage.
— Le Dr Mitral Akcay Ciblek ! répéta Jamie. Ne dirigeait-elle pas le laboratoire de recherche d’Ankara ?
— Vous êtes bien informée mademoiselle, s’empressa-t-il de répondre avant que Lucie ne reprenne la parole. Elle dirige également le centre de recherche d’Istanbul depuis deux ans. La connaissez-vous ?
— Oh non, pas particulièrement, mais je me souviens avoir lu des articles sur ses travaux. Elle devait alors travailler au Centre américain de prévention et de contrôle des maladies. Le CDC je crois.
— Exactement, je suis très impressionné mademoiselle, répondit le professeur qui semblait déjà sous le charme.
— Je vous en prie, appelez-moi Jamilia.
Lucie, qui sentait la conversation lui échapper, s’interposa entre eux deux, même s’ils ne semblaient plus faire cas de sa présence. Elle se lança :
— Le Pr Pamir…
— Youssouf, intervint-il, mettons de côté le protocole voulez-vous ? Ne sommes-nous pas amenés à travailler ensemble désormais ?
— Bien volontiers, reprirent-elles en cœur.
Ils rirent spontanément.
— Voulez-vous une tasse de thé ? proposa Jamilia en se dirigeant vers la petite table qui faisait office de kitchenette.
— Avec plaisir Jamilia, dit-il en insistant sur le prénom.
— Et toi Lucie, tu es partante ? continua Jamie.
— Seulement s’il reste de l’Earl Grey. Puis elle continua en s’adressant directement à lui : je voulais simplement informer Jamie de votre mission.
— Excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Je manque d’éducation semble-t-il, reprit Youssouf l’air ennuyé.
— Eh bien oui, reprit Jamie sans laisser à Lucie le temps de reprendre sa phrase, que nous vaut cette belle affectation ? Oh, rassurez-vous, je ne faisais pas allusion à votre éducation, plaisanta Jamie.
Il sourit.
— Eh bien, je dois contrôler le dispositif des règles de biosécurité concernant les risques d’infection et de contamination du personnel. Mon rôle est, en quelque sorte, de protéger l’environnement, conformément au règlement sanitaire international.
— Si je comprends bien, vous êtes là pour nous protéger, reprit Lucie avec un air complice.
— Pour mon plus grand plaisir, riposta Youssouf en s’inclinant légèrement, la main gauche sur le cœur dans la plus pure tradition stambouliote.
Lucie remarqua le superbe bracelet en or qu’il portait. Elle sembla troublée et, tout en faisant remarquer la beauté du bijou, s’approcha et le regarda plus attentivement.
— Il est magnifique n’est-ce pas ? Vous aimez ? demanda Youssouf en exhibant son poignet.
— Oui, il est splendide ! En fait il me rappelle une personne… Excusez-moi, je suis ridicule, conclut Lucie dont l’émotion était perceptible.
— Je vous en prie, ne vous excusez pas ! Toutes les jolies femmes aiment l’or, c’est naturel, plaisanta Youssouf.
Tous les trois rirent de bon cœur et trinquèrent en choquant leur récipient rempli d’Earl Grey. Tout en buvant, Jamilia observa le professeur par-dessus sa tasse. Leurs regards se croisèrent. Elle n’était pas insensible à son charme. Elle s’était concentrée sur ses études au détriment de sa vie affective et la proximité de ce beau Turque réveillait en elle des désirs auxquels elle avait laissé peu de place ces derniers temps. Bien sûr, elle avait eu quelques aventures, mais uniquement pour le sexe. Elle ne s’était jamais vraiment engagée et cela lui convenait. Toutes ces pensées la submergèrent instantanément et elle sentit une douce chaleur lui monter le long du corps. Elle eut la sensation, en devinant un léger sourire sur ses lèvres, qu’il lisait dans ses pensées. Elle plongea son regard vers le fond de sa tasse.
III
Le cauchemar de la veille ne s’était pas franchement estompé et me hantait encore par de petits flashs restés très précis. Assis à une table du café du commerce où je me réchauffais en attendant l’heure d’aller ouvrir le mien, je commandai un petit noir serré. J’attirai machinalement vers moi le journal qui trainait sur la table. Comme d’habitude, les nouvelles n’étaient pas du genre à vous donner la pêche, mais plutôt à vous inciter à vous jeter par-dessus le pont le plus proche. D’ailleurs, à la lecture de la deuxième page, un individu, dont l’identité n’était pas révélée, en avait déjà eu l’idée la veille. Plus loin, un titre en gras annonçait l’arrivée de la vidéosurveillance au cœur de notre ville. Mes oreilles se connectèrent instantanément aux conversations qui fusaient au comptoir. Quatre personnes, que je n’avais pas remarquées en entrant, déblatéraient sur le sujet en sirotant de la bière. Vaste programme… Soudain, dans un timing remarquable, leurs regards convergèrent sur la jeune et belle serveuse, qui, une tasse de café à la main – détail, qui de toute évidence, n’était pas leur principal centre d’intérêt – se dirigeait vers moi. Le ballet de pupilles dilatées fit un travelling arrière pour raccompagner la demoiselle à sa place initiale, où elle se retrouva à nouveau aux premières loges et eux… au balcon. Ils ne seraient sans doute pas contre une petite caméra derrière le bar, voire même être membre du bureau d’éthique qui devrait surveiller ceux qui surveillent. Bref, le débat prit lentement de la hauteur, du liquide, du volume et finalement tourna à l’altercation.
— T’es qu’un con Joseph, j’vois pas ce qu’Hitler vient foutre avec les caméras. C’est des idées fachos ça.
— Et alors, t’as un problème avec les fachos, connard ? rétorqua le plus virulent. T’as même pas assez de cerveau pour comprendre le truc.
— Quel truc ?
— Ben qu’avec un système comme ça, il aurait repéré tous les juifs rapidos.
Ça commençait à sentir le soufre et personne n’avait envie de commencer sa journée par ce genre de problème. Certains auraient bien aimé voir des agents sortir d’une petite boite noire, comme dans un roman de Philip K. Dick, et maitriser nos quatre individus. Mais ce ne fut pas le cas. Ça viendrait peut-être disait le journal, mais d’autres allaient certainement y voir une atteinte à leur liberté. Bref, le sujet promettait de faire couler encore beaucoup d’encre. Pour l’instant, l’ambiance était plombée et c’était du sang qui coulait du nez du premier éméché. J’allais avoir du mal à terminer l’article. Et toujours pas de héros pour nous sortir de ce marasme matinal.
— Putain tu m’as cassé le nez, beugla la victime, les deux mains sur le visage.
Ce genre de situation insupportable allait largement convaincre les indécis concernant la protection vidéo et nos quatre lascars, qui se sentaient de plus en plus légitimes, faisaient campagne. La bêtise humaine était à nouveau en route et la filmer n’aurait pas été des meilleurs feuilletons. La jeune fille devait prier le saint patron des cafetiers, quand un fourgon klaxonna devant le bar, un son semblable à celui d’une corne de chasse qui rappelle la meute. À cet appel, et dans la précipitation la plus totale, chaque individu de notre quatuor infernal reprit ses affaires et laissa rouler quelques pièces sur le comptoir. Ils sortirent, puis disparurent dans la camionnette. Celle-ci démarra et s’éloigna pour notre plus grand soulagement. Enfin, un groupe d’étudiants entra bruyamment dans le bar et, tel un coup de gomme, effaça l’épisode précédent. Je restai à méditer sur mon journal, qui promettait une consultation publique avant de statuer sur la question de la vidéo. Ben voyons !!
Il était grand temps d’aller ouvrir la boutique, où m’attendait l’Inca, le sourire aux lèvres.
— Big Brother nous regarde, me dit-il comme s’il lisait dans mes pensées.
— Tant qu’il ne nous juge pas vieux frère.
Il était particulièrement élégant en ce début de journée. Un pantalon de cuir noir, assorti d’une chemise de même couleur, faisait ressortir l’éclat de sa longue chevelure ébène, finement attachée en catogan, qui lui tombait jusqu’en bas du dos. Son visage cuivré rayonnait et l’éclat de son sourire invitait à la bonne humeur.
— Si t’es dans les clous et que tu leur donnes tes sous, t’as pas à t’en faire… me répondit-il, on fait partie d’un vaste plan où tout est déjà écrit, programmé. Tu sais, on te fait croire que tu as ton mot à dire, mais en fait ils savent depuis longtemps ce qu’ils veulent et ce qu’ils attendent de toi. Tout se met en place lentement, inéluctablement. Tu penses avoir le libre arbitre, hein, d’être le maître de ta destinée ? Peut-être… certainement… Mais uniquement dans les actions mineures, celles de ton individu, celles auxquelles tu t’accroches. Sûr ! Mais tu vois, à l’échelle du collectif, on suit un plan bien établi. On suit le courant d’un fleuve dont on ne maitrise pas les contours. Une boule de flipper mon frère ! Extra ball ou tu sors. C’est tout. Eux, y comptent les points et claquent les bonus.
Mais ne t’arrête pas Brother. Continue. Ah ah !! Travaille et donne leur tes sous.
Et le v’là reparti je ne sais où, riant les bras au ciel en s’adressant aux passants qui s’écartent sur son passage. Sacré Inca. Je ne sais pas de quelle planète il vient et qui sont ces « ils », ces « on » et ces « eux », mais j’aime bien ses histoires, elles m’interpellent c’est certain.
La journée continua comme ça, un peu bancale, avec son flot de personnes banales, entre lesquelles aucune communion n’était possible. Ça commença par Madame Je-sais-tout, pour finir par Monsieur J’ai-fait-le-tour-du-monde-et-j’ai-tout-vu. Ou encore : « Vos articles sont trop chers, vous ne les avez pas acheté ce prix-là que je sache ! » Mieux : « Vos meubles ne sont pas authentiques, et je sais de quoi je parle. » Mon préféré peut-être ! Mais je n’étais pas d’humeur. Pas une seule belle âme à l’horizon pour me sortir de ces pensées de meurtre où m’avaient précipité nos quatre fauves du comptoir. Je commençais à étouffer. En fait, j’étais en colère d’avoir été pris à témoin de cette scène lamentable et de n’avoir su réagir. Cette culpabilité me hantait et me plongeait dans l’abîme, voire dans le cœur de la bête. Mes dents s’allongeaient, mes ongles devenaient griffes, l’instinct de chasse se réveillait. L’envie de mordre, de déchiqueter. L’envie de sang, d’étriper. D’étriper quoi d’ailleurs ? Leur bêtise ou ma couardise ?
Impossible dans ces conditions de rester en société, de parler d’évasion, d’Orient, d’Asie et d’inciter la clientèle aux rêves et aux longs voyages. Non ! Le mieux était d’aller prendre l’air.
Ce flot de pensées sombres provoqué par ces quatre abrutis était inattendu et désagréable. Une lame de fond, tel un rouleau chargé de galets qui grondait en moi et qui me rappelait la fois où j’avais manqué me noyer. Il n’y avait ni ciel ni mer, ni sol ni surface. Plus de repère, plus de haut, plus de bas. Je frissonnais. Mon cerveau partait en vrille, l’œuf devenait mollet. Il était grand temps de l’aérer.
Les portes du magasin refermées derrière moi, je levai les narines au petit vent frais. Et là, marchant sur le trottoir, je me sentais lové comme dans un bon fauteuil où l’on se replonge avec délectation dans le bouquin laissé la veille. J’étais bien, je m’écoutais. Cette partie de moi en colère semblait vouloir reprendre sa place et frappait dans mon crâne comme on cogne à une porte. Elle se sentait dépossédée de son habitacle. La sérénité l’avait délogée et la raillait. Je ris intérieurement. Je pensai au Gollum de la trilogie du Seigneur des anneaux : « Mon précieux, il est à moi ! Sméagol est gentil, le Maître est gentil avec Sméagol. Non ! Imbécile ! Il se moque de Toi. » Ce petit incident matinal sans vraiment d’intérêt avait finalement réveillé de vieux fantômes. Ils semblaient avoir pas mal de choses à me dire. « Non ! Tu ne te trompes pas, tu connais cela. Allez vas-y, coupe ! Fends ! Transperce ! Ah ! Ah ! rien n’y fait hein ! Tu sais bien que tout repousse aussitôt, inéluctablement, sans fin. L’un appelle l’autre. Ouvre les yeux ! Ou bien ferme-les pour mieux voir, prends du recul, de la légèreté, je ne sais pas, une certaine hauteur peut-être ! Regarde, n’es-tu point pareil à eux ? Avec ces mêmes zones d’ombre ? Ne vois-tu donc plus cette flamme dans leurs yeux qui n’est autre que le reflet de ton tien Sméagol ? »
— Pardon, vous n’auriez pas du feu s’il vous plaît ?
On venait de m’adresser la parole et j’étais certain que Sméagol ne fumait pas.
— Heu, ouais… enfin je crois… ah si voilà.
— Merci.
— De rien, bonne journée l’Ami.
— Toi aussi, salut !
Une rencontre toute simple, un échange banal, mais un contact qui faisait du bien. Deux fourmis qui, par le jeu de leurs antennes olfactives, s’invitaient à continuer, se reconnaissaient. Comme si elles se disaient : « Va en paix. » Ne laissant pas de place pour autre chose. Le lâcher prise des anciens, lisse, dispo. Pas d’accrocs ni de complaisance, juste de la tolérance et de l’humilité. D’accord, il y avait encore du boulot.
Le serein et le coléreux cohabitaient à nouveau. Le soleil n’a-t-il pas sa part égale d’ombre ? Ouais, ça va ! La ramène pas, tu veux ?
Je ris à nouveau. J’étais ces deux caractères-là, incontestablement, pourtant intuitivement, je me sentais ailleurs, extérieur ou alors encore plus intérieur. J’ouvris à
nouveau les portes du magasin. Deux heures s’étaient écoulées. Bon ! Il fallait certainement bien ça.
Une femme entra et me sourit. J’étais à nouveau à ma place. Je lui offris du thé, elle accepta. Les heures passèrent, les gens aussi. Certains partagèrent notre thé, d’autres notre conversation. On était bien. Je n’avais rien vendu de particulier, mais cela n’avait pas d’importance. Je n’avais plus envie de vendre d’ailleurs. Non, j’avais plutôt besoin de partager mes récits de voyages, d’en parler comme pour mieux les comprendre. Bientôt, je ne serai plus à ma place ici, je le sentais. Dommage, ce n’était que du bonheur.
Je repensais à l’Inca. Tout de même, la prochaine fois, il faudra que je lui demande ce qu’il voulait dire par ce « vaste plan tout établi ». Oui, qu’est-ce que c’était au juste, ce plan ? Voulait-il dire que l’histoire se répète sans cesse ? Que la Nature est cyclique tout autant qu’illusoire ? Que le décor change en permanence, les acteurs aussi, mais que le scénario reste identique, imperturbable ? Ce genre de trucs quoi ! Et le but de tout ça ? Apprendre, explorer, voir, expérimenter la dualité esprit-matière ? S’extirper de la réalité et mesurer la causalité ? Et Dieu, tiens, parlons-en ! Une création arbitraire, une projection de l’homme pour mieux s’appréhender ?
Quoi qu’il en soit, il semblait bien que l’on ait égaré la notice. Et si depuis la nuit des temps, beaucoup s’évertuent à vouloir l’écrire noir sur blanc, sa compréhension nécessitait une notice de la notice. Brancher l’Inca sur ces sujets me semblait dommageable.
Dehors, le temps avait viré au gris foncé, et la pluie tombait tel un rideau infranchissable. Les passants avaient déserté les rues et leurs vitrines de Noël. Tout en fermant le magasin, je repensai au Noël de mon enfance.
IV
Né à Ankara, d’un père turc et d’une mère hollandaise Youssouf Pamir avait fait ses premières armes à l’Institut national pour la santé publique et l’environnement (RIVM) de Bilthoven, aux Pays-Bas, sous la coupe du célèbre virologiste, le Dr Adam Beijer. Cette collaboration, presque paternelle, lui avait très vite donné confiance en lui. Après quatre années sous la tutelle du docteur, et deux années passées sur le terrain, principalement dans des pays d’Afrique centrale, Youssouf partit vivre en France où il travailla pour la Direction générale de la santé (DGS). Après la parution du nouveau Règlement sanitaire international (RSI) sur les maladies émergentes, il se porta volontaire pour aider à mettre en œuvre, de manière anticipée, certaines de ses dispositions, qui étaient considérées comme pertinentes au regard du risque présenté par la grippe aviaire et par une pandémie potentielle de grippe humaine. Depuis son arrivée à Paris, ses nouvelles fonctions au sein du laboratoire lui prenaient tout son temps. Ces deux mois écoulés à s’assurer de la sécurité sanitaire des groupes de travail sur les nouveaux virus, l’avaient rapproché de Jamilia. Ils allaient régulièrement déjeuner ensemble. De temps à autre, Lucie venait se joindre à eux, mais elle avait la sensation de les déranger. Ils avaient beau lui affirmer le contraire, elle se sentait de trop. Youssouf n’avait d’yeux que pour sa collègue et ça la rendait pratiquement jalouse. Il émanait un certain magnétisme de cet homme et elle se serait bien laissé courtiser. Mais c’était peine perdue. Il avait de toute évidence jeté son dévolu sur la belle Jamilia et elle n’y pouvait rien changer.
Un jour, elle avait surpris une conversation téléphonique alors que Youssouf s’était réfugié dans une des arrière-salles du laboratoire que personne n’utilisait jamais. Elle n’avait pas compris grand-chose, mais cela lui avait paru étrange et elle s’était sentie mal à l’aise. Il parlait à voix basse et de façon inhabituelle. Elle s’était dérobée discrètement sans qu’il ne la voie. Depuis ce jour, elle était intriguée. Mais ce côté « mystérieux » le rendait encore plus attirant.
Alors qu’ils déjeunaient tous les trois au café parisien, Jamilia surprit sa collégue.
— Eh bien Lucie, tu ne sembles plus avec nous.
— Je suis désolée, répondit-elle absente, c’est vrai. Ne m’en voulez pas mais je dois vous quitter. J’ai une course à faire.
Elle prit son sac, paya son café et disparut dans la rue après leur avoir fait un dernier signe de la main à travers la vitre de la brasserie.
— Elle est bizarre en ce moment, tu ne trouves pas ? interrogea Jamie.
— Non pas particulièrement, répliqua Youssouf. Pourquoi cette question ?
— Je ne sais pas… je la trouve distante. Elle n’est plus comme d’habitude avec moi. Je dirais bien que c’est depuis ton arrivée, reprit-elle sur le ton de la plaisanterie.
— Quoi ? s’exclama Youssouf soudain piqué au vif, je ne comprends pas. Que veux-tu dire ?
— Ne me dis pas que tu n’as rien remarqué !
— Remarqué quoi ?
— Je crois qu’elle a un faible pour toi et que tu ne fais jamais attention à elle.
— Est-ce ma faute si c’est toi qui captes toute mon attention ? lança-t-il téméraire.
— Qu’est-ce que je suis censée comprendre ? s’étonna Jamilia.
— Ne fais pas l’innocente… tu le sais bien. C’est vrai, jusqu’à présent, je n’ai pas trouvé le courage de te le dire, mais je crois que mes sentiments pour toi sont évidents et je suis désolé s’ils lui font ombrage. Mais je ne vois que toi, je ne pense qu’à toi.
Il posa délicatement sa main sur la sienne. Elle ne se dégagea pas et il y vit un signe favorable.
— C’est certainement inattendu pour toi, reprit-il, et je ne te demande pas de me répondre maintenant. Mais veux-tu bien y réfléchir ?
— T’es trop mignon, répliqua Jamilia légèrement amusée, en prenant garde de ne pas le froisser par une réaction qu’il trouverait trop légère.
Elle sentait bien qu’il prenait sa demande très au sérieux. Elle était touchée mais avait très envie de rire tellement elle le trouvait conventionnel.
— Innocente, moi ! Eh bien oui jeune homme je revendique mon innocence. Je n’ai rien fait semble-t-il pour déclencher de telles ardeurs. Toutefois je suis flattée et désireuse d’en savoir davantage sur vos intentions !
— Tu te moques de moi, dit-il en se prenant au jeu et faisant mine de retirer sa main.
Elle lui bloqua les doigts entre ses deux mains et rapprocha son visage du sien par-dessus la table.
— Je ne me permettrais jamais, professeur, sois en convaincu. Mais l’endroit ne me semble pas idéal pour répondre honnêtement à une telle requête. Sortons, proposa-t-elle. Allons marcher que je te donne une idée de mes sentiments.
Après s’être débarrassés du serveur, ils sortirent dans la rue et firent quelques pas. Aussitôt, elle l’entraina sous un porche et, à l’abri des regards l’embrassa avec passion.
— Que penserais-tu si nous allions chez moi ? lui suggéra-t-elle.
— Eh bien, ça ne me déplairait pas, répondit-il. Mais tu ne crois pas qu’au laboratoire…
Elle l’interrompit en lui posant un doigt sur les lèvres.
— Ils penseront bien ce qu’ils voudront. Quant à Lucie, je trouverai bien quelque chose. Viens.
Ils dévalèrent les marches du métro et montèrent dans la rame qui arrivait au même instant.
Jamilia habitait un petit deux pièces avec terrasse rue Pétrelle, dans le 9e arrondissement. Ils arrivèrent sur le palier du deuxième étage et Jamie ouvrit l’unique porte qui s’y trouvait. Elle le fit entrer en premier et ferma la porte derrière elle. Un petit rayon de soleil hivernal traversait le rideau de la fenêtre de la pièce principale. Youssouf se sentit tout de suite à l’aise. L’appartement était coquet et décoré chaleureusement. À l’évidence, il venait d’être rafraîchi, et les couleurs avaient été choisies avec goût. Un comptoir et deux tabourets hauts séparaient harmonieusement la pièce d’une kitchenette qui semblait ne manquer de rien. Sur la gauche, une porte grande ouverte laissait entrevoir une salle de bain. Sur la droite, le salon, équipé d’un magnifique canapé rouge et d’une table basse, ouvrait sur une autre pièce, plus petite, telle une alcôve où se tenait un grand lit recouvert de plusieurs coussins aux couleurs orientales. Après avoir jeté ses clés sur le canapé, elle retira son manteau et le laissa tomber à même le sol. Elle libéra ses longs cheveux noirs qui ruisselèrent sur ses épaules.
Jamilia lui prit la main en riant et l’attira directement vers le lit. Elle lui enleva son pardessus avec précipitation et se dévêtit complètement, comme par enchantement. Elle était superbe. Il en avait le souffle coupé. Ses cuisses, ses hanches, sa taille, son ventre, sa poitrine, ses mamelons dressés comme la tour de Babel… tout lui plut. Elle se jeta littéralement sur lui, retirant les boutons de sa chemise avec une dextérité incroyable. Il était pétrifié. Tout allait trop vite. Il aurait adoré prendre le temps, la caresser, la sentir, l’embrasser, la dévêtir lentement comme on libère un cadeau trop longtemps attendu. Il avait besoin de sentir son désir et le sien monter progressivement, profiter de chaque instant avec une infinie douceur. Il se sentait assailli par une vague déferlante qui le submergeait et le vidait de toutes ses capacités. Elle ne sentit pas son désarroi et lui arracha le reste de ses vêtements avec une véhémence inattendue. Il se tenait debout, nu comme un vers, déconcerté et ridicule. Elle lui prit le sexe à pleine bouche. Décontenancé, il se sentit incapable d’avoir une érection dans des conditions pareilles. Jamais il n’aurait pu imaginer que cela se déroulerait de la sorte. Non, pas comme ça. Il avait besoin d’amour, d’érotisme, de complicité. Il était stupéfié de la façon dont elle s’y prenait et il sentait la situation lui échapper complètement. Comment le lui dire ? Leurs attentes étaient trop différentes et la magie n’était pas au rendez-vous. Il n’avait même pas la volonté de lutter. Non, elle l’avait désarçonné. Il était à terre et sa virilité plus basse encore. Comment lui faire comprendre ? La suite lui échappa davantage. Elle ne voyait là qu’une incapacité de sa part et cela le transportait à des années-lumière de son désir. Lui qui avait tellement espéré cet instant, qui aimait tant faire l’amour, qui adorait tout contrôler. Quelle déception ! Même la colère l’avait abandonné. Il était vide et il était là, à la regarder tirer énergiquement sur son membre comme si subitement il allait durcir. Elle ne pensait qu’à son plaisir et elle lui faisait mal. Pas seulement physiquement. Il aurait aimé que cela cesse. Mais elle semblait ne pas faire cas de sa défaillance. Puis, elle s’allongea sur le dos, s’offrant complètement à lui. C’était comme une punition divine le privant de ses sens. Pourtant un cul pareil ! Merde !
Youssouf se laissa tomber sur le côté, anéanti. Un silence épais s’installa. Après quelques instants insupportables, il tourna la tête et la vit, la tête posée sur l’oreiller. Il sentait son souffle sur son visage. Ses yeux étaient fermés comme pour mieux l’inonder de reproches. Elle était vraiment belle. Ses lèvres étaient sensuelles et charnues. Sa peau brune et lisse, une véritable invitation à l’amour. C’était trop injuste.
Qu’avait-il donc pu faire pour mériter une telle vexation ? Non, c’était vraiment insupportable. Pourtant il s’entendit s’excuser, qu’il ne comprenait pas ! Que jamais cela ne lui était arrivé auparavant. Chaque mot qui sortait de sa bouche le confondait davantage. Il en était conscient, mais c’était comme un poids qui l’entrainait irrémédiablement vers le fond. Il se sentait une personne extérieure qui défendait quelqu’un qu’il savait indéfectible. Elle ouvrit les yeux et sans rien dire pour le soulager, le prit dans ses bras et lui enfonça le visage entre ses seins. C’était pire que tout ! Il avait dix ans, il avait bobo et elle le berçait comme une pauvre âme en peine. Non vraiment, c’était pire que tout !
— Je suis très sexe, conclut-elle.
Une demi-heure plus tard, il arpentait la rue qui le ramenait chez lui. Le petit rayon de soleil avait disparu derrière les nuages… et de sa vie. Quel gâchis ! Il aurait aimé pouvoir revenir en arrière et changer le cours des choses. Il faisait froid et tout en marchant il la revoyait nue, superbe, devant lui… Il bandait.