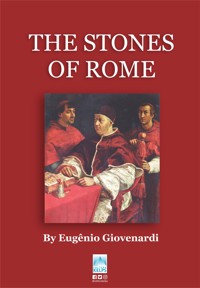Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Editora Kelps
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
L'homme interdit de Eugênio Giovenardi, est le récit romancé d'une période cruciale de la vie de l'auteur. Il raconte les vicissitudes et les péripéties d'un jeune homme en quête de liberté de penser et de désirer sans l'orientation d'une institution. Le destin conduira Juliano au séminaire pour faire de lui un prêtre de l'Église catholique. À l'éducation reçue dans l'enfance, dans une famille pieuse, vint s'ajouter la pratique disciplinée de prières quotidiennes, entrecoupées d'études philosophiques, morales et théologiques. Qui lui donna la force de questionner le fonctionnement et la doctrine d'une institution millénaire ? Formellement convaincu de ses engagements au sein du régime monastique, Juliano, ayant pour pseudonyme Leonardo, se dédia avec ferveur à l'alphabétisation de dockers sur les quais du port, au service social et religieux de la Prison Modèle du Partenon, à l'organisation des paysans Sans-Terre et d'habitants de quartiers abandonnés par le service public. Rébellion, appels à la transgression, doutes sur des vérités dogmatiques, contestation de rites formels, plaintes sur l'amour réprimé, imposition de l'autorité indiscutable, tourmentaient le cœur inquiet de Juliano. Il est sûr de ses doutes et cherche des réponses. En traversant l'océan, de Rio de Janeiro à Lisbonne, sur le transatlantique Eugenio C., il découvre un autre monde. Se joint aux passagers qui pendant six jours se croiseront dans les coursives, fréquenteront le restaurant, les salles de jeux et de jour, le pont ensoleillé. À la proue du navire, Juliano pointe sa boussole vers un port qui s'approche. À Paris, dans les ruelles médiévales de la Rive Gauche, Juliano récupère, au bout de trois ans, la liberté d'être un homme commun, sujet aux incertitudes, à l'instabilité et aux imprévus de l'amour et de la vie.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 381
Veröffentlichungsjahr: 2021
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
EUGÊNIO GIOVENARDI
L’HOMME INTERDIT
Traduction de Nicole Pegeron
Goiânia-Go
Kelps, 2021
Copyright © 2021 by Eugênio Giovenardi
Editora Kelps
Rua 19 nº 100 — St. Marechal Rondon- CEP 74.560-460 — Goiânia — GO
Fone: (62) 3211-1616 - Fax: (62) 3211-1075
E-mail: [email protected] / homepage: www.kelps.com.br
Dessin visuel: Marcos Digues
CIP - Brasil - Catalogação na Fonte
DARTONY DIOCEN T. SANTOS - CRB-1 (1ª Região) 3294
G513 | GIOVENARDI, Eugênio
L’homme interdit. - Eugênio Giovenardi. - Goiânia / Kelps, 2021.
Ebook (epub):
ISBN:978-65-5859-355-3
1. Littérature brésilienne. 2. Roman. 3.Traduction. 4. Français. I Titre.
CDU: 821.133.1-32
DROITS RÉSERVÉS
Le Code de propriété intellectuelle interdit des copies ou reproductions destinées à une utilisation collective, sans l’autorisation de l’auteur. (Loi no. 9.610/98 Brésil).
Imprimé au Brésil
2021
À Hilkka
et
Aino Alexandra
La persuasion par la contrainte et la violence
peuvent détruire la vérité,
mais elles ne pourront jamais la remplacer.
Hannah Arendt – Les origines du totalitarisme
Préface
«Os filhos do cardeal» «Les fils du cardinal», roman publié par Paralelo15 en 1997, paraît maintenant dans sa seconde édition révisée sous le titre original: «O homem proibido» - «l’homme interdit».
Le titre actuel de l’œuvre est apparu en 1968 pendant les évènements de mai en France quand il était «interdit d’interdire».
Le livre a été traduit en espagnol et publié par Arte y Literatura à La Havanne, Cuba en 2000. En 2001 il a été publié en finnois par la maison d’édition Like à Helsinki. En 2019, publié en englais, par la Maison d’édition Kelps, à Goiânia, Brésil.
Le roman autobiographique a été écrit sous forme de journal de bord pendant vingt ans. Des nombreux évènements produits dans l’enfance j’ai raconté plus précisément ceux qui avaient un rapport avec ma trajectoire future. J’ai résumé la routine monotone de l’internat. Je n’ai pas éludé les querelles propres aux hommes enfermés ni les péripéties que traverse un jeune homme peu sûr de lui mais idéaliste scrutant des signaux à l’horizon.
Dans la présente édition j’ai corrigé les dates qui situent les faits dans leur époque sans altérer le contenu ou le climat dans lesquels ils se produisirent.
J’ai amplifié les concepts, éliminé les adjectifs, raccourci les phrases.
«O homem proibido» «L’homme interdit» est une évocation chargée d’amertumes et d’espoirs dont la longue traversée du maquis intérieur a fait l’expérience. Les personnages, Juliano et Leonardo, deux facettes du même homme, se débattent à la recherche de l’identité cachée derrière les rideaux d’institutions sévères pour conquérir la liberté de penser et d’aimer. Ils s’opposent, s’accusent, se combattent dans la course contre le temps, exigeant du débat la réponse apaisante.
Un livre est le témoignage d’une époque bien que celle-ci se modifie avec l’évolution de la pensée et des comportements. Les institutions politiques et religieuses s’adaptent, se libéralisent, mais les faits personnels vécus intensément conservent l’identité de leur contexte originel.
Eugênio Giovenardi
SUMÁRIO
Préface
LA LETTRE
CHARQUEADA – LA FERME DES SALAISONS
L’INTERNAT
L’HOMME NOUVEAU
SOFIA
L’INVASION DES COUVENTs
LA THÉOLOGIE, SCIENCE DE DIEU
HÉMOPTYSIE FULMINANTE
L’ORDRE DE MELCHISEDECH
SUR LES EAUX DE LA MER
LES OS DE L’OFFICE
UN PAS A GAUCHE
COMMISSARIAT EPISCOPAL
LE FETICHISME CATHOLIQUE
GRACIELA
PARIS
DANS LES RUES DE BABYLONE
VEILLES DE L’IMMINENCE
DIASPORA
LETTRE A EGIDIO
L’«EX» LIMEIRA
SUR LE DIVAN
REFUGE DE L’INCERTITUDE
HOMME COMMUN
OEUVRES DE L’AUTEUR
LA LETTRE
A ce moment-là je me sentis l’apostat en personne, en chair et en os. Apostat et libéré de l’Église catholique. Ce sentiment me donna le plaisir de la victoire. Je n’ai pas eu peur de moi ni de l’apostat que j’étais devenu, quasi sur le champ. Je marchais dans les rues de Paris seul et léger. La décision de commencer à être un homme commun fut si renversante et enivrante que j’oubliai de demander pardon au Christ de l’abandonner, pardon à la foi de l’avoir perdue, aux dogmes de ne plus les accepter, à l’Église de la quitter, et à Dieu de ne plus avoir peur de lui. Je venais de renoncer au privilège d’un aller pour le ciel et sautai du train.
Les portes de l’enfer m’apparurent jaunes et accueillantes comme un vieux musée, et ce dieu biblique rubicond, furieux qui me tournait le dos, offensé par le moindre petit péché, disparut dans le silence de l’éternité. Je ne sais si éveillé ou dans mon sommeil, j’en vins à rêver que Lucifer avait été amnistié lors d’un jugement sommaire.
Ce matin-là, je sortis du couvent où j’habitais poussé par une force irrésistible ; La force de l’apostasie définitive. Je traversai le Jardin du Luxembourg, descendis la rue Saint Michel, jetai un regard sur l’abbaye de Cluny comme si cela avait été la première fois et entrai au café de Notre-Dame pour lire un article sur les fondements du droit canonique et du libre-arbitre que le théologien Granner m’avait recommandé. Pourquoi lirais-je ces spéculations juridiques à ce moment? Peut-être cherchais-je pour la dernière fois une justification finale à la décision déjà prise.
J’avais les yeux fixés sur les eaux de la Seine qui descendaient de l’autre côté de la rue, l’esprit perdu dans mes pensées. Il me parut humain de dépendre de la certitude et de la sécurité pour le saut que je venais de faire. J’avais mis plus de mille jours à me débattre dans d’immenses flots de doutes qui refluaient à chaque accalmie. Et poussé par eux j’arrivai comme naufragé sur une côte nouvelle et inconnue. Un cri de mouette me réveilla. Sur la terre ferme je pouvais regarder avec orgueil et respect le risque et le danger. Un lien affectif et nostalgique m’accrochait aux innombrables abîmes où s’était noyé Leonardo, et à la chaleur paisible des sables où je me trouvais. Un soupir long et profond comme le vent d’automne m’oxygéna l’âme , je repliai la copie de l’article ouverte sur la table, posai la salière dessus. Je ne saurai jamais le contenu de ce travail juridique. J’ eus pitié de l’auteur pour son effort, mais la curiosité de le suivre dans le labyrinthe du droit s’arrêta net. Leonardo mourrait là, le 8 décembre 1968.
Dans ce même café Le Notre-Dame je rédigeais, en paragraphes brefs et froids, une lettre officielle où je faisais savoir au supérieur de l’Ordre la mort de Leonardo et mon nouvel état civil. A partir de ce moment-là, je me considérais libre de l’obéissance à l’Ordre religieux auquel j’appartenais et détaché de l’institution ecclésiastique.
Quand l’employée de la poste, distante et revêche, enregistra la lettre, l’insérant machinalement dans l’enregistreuse, je me réveillai dans un autre monde. La lettre pourrait se perdre, pensai-je. Le destinataire ignorerait le message pour toujours. Quelle importance ? Je n’attendais ni désirais de réponse. Je n’en avais aucun besoin. La lettre était postée. Elle commencerait un long voyage, emportant un message court et définitif à un lecteur désormais inutile.
Pleinement serein j’avais tué, de manière consciente et préméditée, Leonardo. Le frère que j’avais été, était mort et ses derniers cris descendirent la Seine emportés par une brise tranquille. Paris était splendide et sensuelle comme un jour de printemps où les femmes du nord montrent au soleil timide leurs jambes blanches et les superbes décolletés que les neiges cachent pendant de longs mois.
Les mots fermes et décisifs de la lettre bourdonnaient à mes oreilles comme les tambours d’une foule déchaînée envahissant les rues, chassant les oiseaux de leurs nids, réveillant les vigiles dans leurs guérites, effrayant les mendiants qui dormaient sur la place.
Sur l’escalier de la poste, je regardais et entendais, stupéfait et absent, le pas pressé d’hommes et de femmes poursuivant dans des directions opposées quelque objet invisible. Mu par un élan automatique comme si j’avais un rendez-vous ou un compromis, je me mis à marcher. Je descendis la rue de la poste d’un pas incertain, les jambes tremblantes. Je tâtai mes poches, portai la main à ma tête, le béret? Le béret y était. Je regardai mes pieds et soudain expérimentai cet état d’innocence dont on jouit en rêve devant sa propre nudité. Instinctivement je retournai au café à la surprise du serveur. Il m’assura que je n’avais rien oublié.
A peine sur le trottoir, de l’autre côté de la rue, je recommençai à me tâter avec la même sensation que la précédente d’avoir perdu quelque chose. Je me vis dans le reflet d’une vitrine, seul et hébété. Je n’avais aucun rendez-vous, personne ne m’attendait pour me rencontrer ni ne réclamait ma présence. Rien ne convoquait mes jambes ni ma conscience. Tous les canons semblaient avoir été enfreints. Les tables de la loi n’existaient plus pour mon âme en état de grâce, et la loi du transit ne valait que pour mes pieds si je voulais traverser la rue. Dans le transit de la conscience il n’y avait pas de feu rouge.
Je restai au coin de la rue et bien que les murs du cinéma Un, les portes du café Saint Michel et quelques garçons en tablier blanc me parussent familiers, je ne reconnus pas tout de suite la rue Monsieur le Prince. Je passai devant l’abbaye de Cluny sans remarquer les ruines de l’ancienne basilique. Je me sentais impondérable et solitaire comme une mouette au-dessus d’une eau infinie. Sensation d’irréalité. Quand je retrouvai mes esprits j’eus la perception physique de mon âme libre. Le corps tressaillit, ma peau se hérissa. La liberté! Que faire de la liberté? Comme lors d’une insurrection victorieuse, j’eus envie de la traîner par les rues, par les couloirs du métro, de la frotter sur le visage de tout le monde. De la brandir contre le tourbillon des canons, des décrets, bulles et encycliques qui m’avaient tourmenté l’esprit pendant plus de mille jours. Je voulais crier, crier à en crever le cri de la liberté et de la victoire. Et je criai! Je voulais embrasser tout le monde, partager ma folie heureuse. J’espérais rencontrer à chaque coin de rue, aux fenêtres des immeubles, aux portes des maisons des connaissances qui me féliciteraient. Je voulais de nouveau rencontrer Avelino sur le boulevard Montparnasse. Lui dire que je n’étais déjà plus ce frère prisonnier des nuits d’insomnie, qui se débattait dans une guerre titanesque et diabolique aux limites du bien et du mal. Je n’étais plus otage de l’incertitude, balançant entre le vrai et le faux, le juste et l’injuste, prisonnier à la frontière de la loi et du droit, où le son du mot apostasie me faisait trembler la peau et les os et me paralysait l’âme.
J’arpentais le boulevard Saint Michel dans un sens et dans l’autre, réveillé parfois par quelque coup de coude aimable de la part d’hommes bien élevés «pardon monsieur» et pressés, la serviette dans la main droite et une demie douzaine de livres coincés sous le bras. Je sifflotais des passages de chansons nostalgiques pour bercer ma solitude métaphysique, unique, ontologique, exclusive. Je me rappelais les petites lunettes de Granner et les yeux bleus et profonds de Clairmont, théologue de chevet. Je me rappelais les nuits blanches, l’enfance perdue dans les brumes de la ferme où l’on séchait la viande. Je me rappelais le séminaire où on me dit que j’étais là pour être prêtre, puis les années d’étude de la philosophie où les choses commencèrent à se compliquer et où il n’y avait pas d’explication pour tout ; puis la théologie où la foi expliquait tout parce qu’elle était inexplicable. Et maintenant j’étais ici, apostat, libre, solitaire, voulant construire un poème qui contiendrait la vie, le désespoir, l’angoisse, la mort, la liberté. Un hymne sans paroles et avec toutes les paroles. Je voulais me déchirer l’âme en mille morceaux et les éparpiller dans les rues et sur les places, une relique du frère apostat.
Je me rappelais avec affection Mafalda Borghetti qui aurait comme moi 34 ans. Je pourrais devant elle maintenant plonger tendrement mon regard dans ses yeux couleur amazone, ouvrir doucement son corsage de dentelles de Cambrai brodé de fleurs et voir ses seins dressés et vigilants comme dans mes rêves à l’internat.
Je devais être ridicule quand je descendais le jardin du Luxembourg. Je saluais les passants sans me contrôler. Les Français dans leur hâte habituelle s’effarouchaient, à l’exception d’une petite vieille qui en plus de répondre à mon geste, poursuivit en murmurant à son chien qui la guidait, sa propre philosophie chenue.
Je me souvins de Egidio à qui j’avais écrit une lettre il y avait longtemps. Où était-il? A quoi l’avaient réduit son intelligence et son humour caustique. J’eus soudain envie de le voir, de le serrer dans mes bras. J’entrai dans la bibliothèque de l’Institut Latino-américain. J’allais écrire à Egidio un poème libre de règles sur la liberté, fort du culot que m’octroyait l’état d’excitation de l’homme libre.
«Peut-être après ces dernières lignes, tu attendais depuis de nombreux mois cette nouvelle. Tu comprends que je n’ai pas abandonné les pierres du temple, l’audace des ogives dessinées par des architectes et ingénieurs, les murs de l’église, les vitraux des basiliques, les marbres des cathédrales ni les accords de la musique grégorienne qu’à ta demande, j’exécutais à l’orgue. Je me libère de cette armée d’envahisseurs qui ont pénétré dans mon âme, dévasté ma liberté, mon identité, mon moi, mon cerveau. Je me sens libéré de ce pouvoir autoritaire qui envahit les consciences, vomit des règles et des dogmes au nom de la Sainte Trinité, encadrant tout dans des théorèmes moraux. Egidio, j’ai commis l’apostasie sur les dogmes, les vérités immuables, les artifices théologiques, les mensonges pieux sur le ciel et l’enfer, sur l’hypocrisie discrète de qui parle au nom de Dieu. Maintenant, je te le dis sereinement, ne me manquent ni les dogmes, ni les saints, ni la virginité de Marie. Dieu ne me manque pas, la sainte Trinité m’indiffère ainsi que l’infaillibilité du pape, je n’ai pas peur de l’autorité des tribunaux du Vatican. Il ne manque qu’un morceau de moi. Un morceau de vie. On m’a volé ma jeunesse.»
Dans une autre lettre je commentai ce qu’a dit le théologien Clairmont : ni moi ni lui ni personne n’existe pour la bureaucratie de l’Église catholique, sauf quand on entre dans la foi en sens interdit, quand la certitude tranquille des membres assoupis de la Curie Romaine s’agace de quelque effronterie théologique.
Je pourrais même dire que j’étais curieux de savoir quels effets pourraient produire sur ma conscience un anathème, un silence canonique, l’excommunication. Quelques années auparavant j’avais fait l’expérience de certaines menaces de silences canoniques venues de Dom Scherer pour avoir prêché la socialisation et la réforme agraire. Mais le théologien Granner m’avait assuré avec autorité que la conscience est le territoire libre de l’homme, le refuge du libre-arbitre.
Poussé par la même force qui m’avait tiré de chez moi tôt ce matin, je revenais à la tombée de la nuit dans la petite rue Boissonnade où j’habitais. La rue était déserte, seules les poubelles montaient la garde le long des trottoirs. Ma petite chambre dans le vieux couvent paraissait changée. Moins de vingt-quatre heures auparavant, l’air était pesant, la lumière opaque et la table de travail m’étouffaient. Le lit, encore imprégné de longues insomnies, me réclamait maintenant. Je dormis des heures d’oubli et de tranquillité. J’en vins à avoir faim et à manger avec plus d’ardeur. Les religieux ressemblaient à des lambeaux de rêve. Les couloirs, les escaliers, l’odeur de la cuisine, les rots de bonne digestion, le désordre avec les barricades du mai parisien paraissaient flotter dans un théâtre de marionnettes. Des jours plus tard, je m’aperçus qu’un trouble léger mais constant, logé dans un coin imaginaire de mon estomac, diagnostiqué par mon médecin comme ballon d’air, avait disparu. Dans l’imprimerie Etoile où je me faisais un peu d’argent en liant par paquet des livres et des revues, j’augmentai le taux de productivité et la valeur ajoutée de l’entreprise avec la rapidité qui les expédiait à Fort-de-France et en Guadeloupe. Les petits yeux noirs d’Annette demandaient à Robert, avec l’air de curiosité qui la rendait plus jolie, quelle transformation s’était opérée en moi, ce mercredi. Le regard timide de Neila qui m’épiait à travers ses longues lettres du Brésil, laissées par le facteur, tous les lundis, comme si elles marquaient un rituel sacré, alluma en moi le désir d’aimer, état d’âme que je m’étais interdit pendant tant d’années.
Le soir je montrai à un couple d’amis la copie de la lettre de libération envoyée aux archives d’un lecteur officiel. A ce moment-là, elle traversait l’océan dans une malle postale. Eva eut un doux sourire d’intense joie et émit un petit cri qui résumait l’inutilité de la parole. Vicente me serra fort dans ses bras, en silence par respect aux fibres ténues de la convalescence spirituelle. Notre repas fut une soupe de lentilles, recette millénaire appropriée à commémorer la liberté et la citoyenneté retrouvée.
Une discrète bougie éclairait nos visages
CHARQUEADA– LA FERME DES SALAISONS
Mon père et moi avions quitté très tôt la ferme où nous habitions à une heure et demie de la ville. Le cheval Moreno tirait avec le même entrain que d’habitude la voiture achetée récemment. Moreno me connaissait. Je lui donnais des bains au bord du ruisseau les après-midis de grosse chaleur et lui apportais du maïs tous les soirs. Nous nous aimions. Je le citais dans mes poèmes de jeunesse.
Sur le quai de la gare, je sentais dans mon for intérieur le regard grave et préoccupé de mon père. A tout moment, le train arriverait, avec un retard d’une heure et demie, de la ville de Mafra. Mon père parlait peu. C’était un silence sévère, autoritaire et méditatif. Il m’avait fait comprendre très tôt que le silence était la grandeur de l’homme. Ses seules paroles furent:
– Ta mère va prier pour toi, Juliano. Obéis à tes supérieurs. Monsieur Afonso t’accompagne jusqu’à Marau.
Et avant de descendre du wagon où il m’avait installé :
– Quand les affaires me laisseront du temps, je te rendrai visite, dit-il sans me donner beaucoup d’espoir.
C’est mon père Antonio qui avait la vocation d’être prêtre. Il parlait de Dieu comme un prophète et avait des sermons différents de ceux des curés médiocres quand il s’agissait de fustiger le péché, l’immoralité, la cupidité et l’arrogance de l’homme. C’était un perfectionniste, personne ne faisait mieux que lui. Expert en viande, ses charcuteries, mortadelles, salamis et saucisses se vendaient très bien. Il avait l’art de l’assaisonnement, il officiera comme cuisinier dans le train qui conduisit Getulio Vargas à São Paulo lors de la révolution de 1930. Avoir un fils prêtre c’était comme étendre son esprit moralisateur sur le monde pour le convertir par la parole. De ses silences il extrayait des maximes, des prophéties eschatologiques, peignait des scénarios menaçants pour le futur de l’humanité. Il a dû souffrir en silence en m’emmenant au petit matin à la gare pour un voyage incertain, mais il ne le montra pas. Il me remettait à Dieu comme garantie d’un investissement futur sur le salut du monde. Quelques visites sporadiques après mes vingt ans, me montrèrent qu’il était doté d’humour et d’ironie. Mais mon enfance avec lui fut marquée par la sévérité. Les punitions fréquentes et les rossées terribles pour des motifs puérils étaient dictées par l’amour paternel, copie de l’amour de Dieu.
Quelques années plus tard, je ne pouvais pas me rappeler ce que ma mère avait dit lors des adieux, ni si elle m’avait serré dans ses bras ou donné un baiser. Un sentiment indéfini de refus de la séparation effaça ce moment de ma mémoire d’enfant. Pour compenser j’imaginais qu’elle versait de temps en temps des larmes silencieuses pour moi, comme le font toutes les mères. Dans la cuisine, occupée à ses casseroles tandis que j’apportais les bûches de bois, elle me regardait avec un vague orgueil mêlé de pitié. Ils allaient mettre un garçon de dix ans dans un train qui se traînerait pendant trois interminables jours sur des rails paresseux par les défilés et forêts de Santa Catarina. Après le train, il serait embarqué par le bouvier Afonso Sá dans un bus qui ressemblait plus à un camion de déménagement, un bahut plein de gens et de valises, gémissant en franchissant les hauteurs le long de la rivière Guaporé et celle des Antas. Le sieur Ficca, propriétaire du bus, confierait ma personne et ma valise le jour suivant à un autre véhicule:
– Ce gamin va à Alfredo Chaves, à la fabrique des curés.
Ils se mirent tous à rire. Et tous paraissaient empreints de zèle pour remettre au destinataire le garçon et la valise.
Si d’aventure je m’étais perdu dans quelque gare, imaginais-je au séminaire, je serais allé frapper à la porte de quelque ferme de São João de Cima et j’aurais grandi sur le dos d’un cheval, m’occupant des travaux des champs. Je voulais être bouvier. J’ai vécu longtemps avec ce rêve, sans avoir la chance de me perdre en chemin. Ma mère, cependant, dans son profond respect de la volonté divine, berçait dans son cœur la certitude que le plus grand orgueil d’une famille est d’avoir un fils prêtre. Les frères répétaient ce refrain périodiquement et je l’acceptais comme l’expression d’un droit de ma mère auquel je ne pouvais pas m’opposer. Sacrifier un fils à Dieu parmi tant d’autres, était garantie de salut, de gratification dans l’autre vie. Une sorte de commerce religieux avec pour hypothèque le fils. Quand j’arrivai au séminaire, nous étions deux cent treize hypothèques de Dieu aux mains des frères.
A cette époque, des missionnaires italiens visitaient les villages et les petites villes en quête de vocations. Ces personnages exotiques sans patrie et sans famille qui répondaient aux noms indéchiffrables de frère Cassiano da Bergamo ou frère Exupéry de la Compotte, vendaient des sièges réservés aux côtés de la Vierge Marie, pour la vie après la mort. La cession d’un fils à Dieu était ensuite compensée par d’autres qui naîtraient des promesses en échange de vœux de bonheur. L’ignorance et la pauvreté accomplissaient ce que les missionnaires répétaient de manière irresponsable: «Croissez et multipliez».
La famille nombreuse, des enfants, beaucoup d’enfants, était un signe de semence abondante, de la femme généreusement offerte, de cette sorte de négligence et irresponsabilité devant le fonctionnement parfait de l’organisation génétique et de la nécessité biologique incontrôlée. Mais curieusement ni les frères ni les sœurs, intransigeants défenseurs de la procréation, n’avaient d’enfant, sauf les nombreuses exceptions dont j’eus connaissance plus tard.
Les missionnaires recrutaient les enfants des autres pour les offrir à Dieu. Abraham selon la Bible, fut sur le point de perpétrer un infanticide insensé pour adoucir le courroux de Jéhovah, immolant son propre fils. «Des célibataires invétérés, ennemis du sexe et de la femme, disait Casanova l’avocat athée, encourageant la procréation des autres et leur promettant en échange le règne invisible des cieux.»
Mal chaussés, vêtus de soutanes crasseuses de poussière et de sueur, ces hommes étaient porteurs d’une joie ingénue, d’une foi indiscutable, de ferveur quasi fanatique, de certitudes absolues, de confiance consolidée par les siècles. Et le garçon marqué du signe invisible de la vocation par les missionnaires, était dans le train. Le train me déchargea dans le bus, le bus me livra avec ma valise au séminaire.
Ma famille hérita de toutes les manifestations culturelles de la religion catholique, du baptême à l’enterrement, de toutes les valeurs doctrinales qui définissent le bien et le mal, qui séparent le paradis de l’enfer, le saint du pécheur. Le village où nous habitions était une espèce d’orchestre religieux dirigé par un chanoine austère dont la baguette morale dansait dans l’air désignant les dangers des dièses et des bémols, menaçant ceux qui dissonaient, d’excommunication ou de privation de sépulture ecclésiastique. Les mères, en général, assumaient la tâche de reproduire les enseignements doctrinaux transmis par le curé sous forme de codes et de maximes du type «pas tuer, pas voler, pas pécher contre la chasteté», de sorte que nous savions tout ce qui était interdit, sans demander pourquoi. Dieu n’aimait pas et ça suffisait.
Les choses correctes se pratiquaient par exclusion. Cela facilitait la comptabilité des actes dont le bilan se clôturait au confessionnal. Là, le prêtre avec une certaine curiosité, aidait à chercher dans la conscience d’autres actes interdits, mauvaises pensées, querelles familiales, regards indiscrets sur les jambes des femmes, baisers entre amoureux, bal pendant le carême et ce péché italien de blasphème que les adultes commettaient quand la récolte était perdue sous la grêle ou les grands vents. Le «porco dio» et la «porca madonna» étaient les pires manifestations d’insubordination contre la nature anarchique et l’insondable volonté divine. Guiseppe Tagliassassi, quand ses affaires allaient mal, descendait quelques bouteilles de vin, sortait jusqu’au milieu de la place, regardait le ciel, appelait quelques saints connus à venir dans son chapeau et les piétinait. Ces péchés exigeaient des années de repentir, beaucoup de jeûne et de pénitence. La mort soudaine d’un proche ou une maladie congénitale prolongeant le calvaire d’une famille, pouvaient être vues comme châtiment de Dieu pour punir les péchés d’orgueil et de chair.
Ces communautés italiennes récemment déracinées de leur patrie, étaient des nids incubateurs de vocations religieuses. Tous les ans, garçons et filles, entre neuf et douze ans, étaient emmenés au pensionnat ou au séminaire, recrutés par des frères ou des prêtres réputés pour leur vie sanctifiée. Ils laissaient des souvenirs aux familles, des images du cœur sacré de Jésus, de Notre Dame du Secours Perpétuel, de Saint Antoine, de Saint François et une bénédiction de Dieu sur le potager, les poulaillers, les porcheries et surtout sur les maisons de bois pour éviter de dramatiques incendies. Le prêtre et la religieuse, éclairés par l’Esprit Saint, identifiaient les garçons et les filles qui portaient le signe de la vocation religieuse. Cette indication, se drapant de la volonté divine, était indiscutable et laissait une promesse de serment pour l’année suivante quand l’envoyé de Dieu venait récolter les recrues.
Penché à la fenêtre du train, en partance pour le séminaire, je remarquai avec amertume que tout était derrière moi, comme un chemin sans retour. J’avais la vague impression que c’était un aller simple. Quand mon père et moi partîmes ce matin-là, mes frères et sœurs, qui étaient pour le moment au nombre de cinq, dormaient encore, je ne leur fis pas mes adieux parce que l’enfance est ainsi faite, d’un espoir intemporel. Le cheval Moreno, les petits poissons de la rivière, les raclées de mon père, la compagnie simple et amicale de monsieur Alcino employé de la ferme avec qui j’arpentais les collines pour rassembler le troupeau, les hirondelles qui s’envolaient en bandes au printemps, tout cela était derrière moi. Je revoyais la cigarette roulée à la main qu’Alcino gardait au coin de la bouche, ses conseils de bouvier soucieux de trouver dans les broussailles sombres la bête égarée; les espiègleries des grands cousins cherchant à lever le mystère des filles de la ferme dans la réserve à maïs, les jours de pluie.
Dans la ferme je m’étais habitué à la réalité du sang et de la mort. Mon père me réveillait vers trois heures et demie du matin pour l’aider à l’abattage. A huit ans je maîtrisais le lasso et menais la bête au billot avec la détermination de l’adulte expérimenté. Le coup du couteau pointé par mon père pour bien viser la carotide faisait jaillir une cataracte de sang. Un animal prostré qui perdait son sang me donnait plus un plaisir de victoire qu’un sentiment de pitié. Cette logique rectiligne entre la vie et la mort me fascinait. Des vies destinées au sacrifice, des vies utiles une fois tuées. La vie et la mort semblaient naître d’une seule racine déterminant les commencements et la fin de faits joués par un destin aveugle et fatal. Au séminaire on parlait du sang du Christ versé pour laver les péchés de l’humanité et que faute de sang il n’y avait pas de rémission. L’accent était lentement mis sur le sang nécessaire aux chrétiens les plus osés soupirant après le martyre, pensée qui nous était inculquée par les prêcheurs de retraite spirituelle. Mort sanglante, croix, cruauté des Juifs, salaisons humaines.
Le train dans des spasmes de fatigue, coupait nonchalant et mou, les liens qui retenaient mes années de vives impressions et en laissait tous les monceaux derrière moi, de manière ordonnée et définitive. La distance étouffait les voix, occultait, mètre après mètre, les images, le visage de ma mère, les rides sévères de mon père, la liberté vécue à la ferme. Afonso Sá ronflait à côté de moi quelques bons bouts de temps tandis que je suivais avec intérêt des bribes d’histoires vraisemblables, presque fantastiques de certains passagers venus de malheureux maquis, dont l’occupation était d’abattre des cannes et acácias du Brésil géants, des palissandres multicentenaires pour les scieries qui dévoraient tout avec une ardeur animale.
J’accompagnai une relation amoureuse entre Afonso Sá et une métisse indienne brune aux grands yeux noirs, aux cheveux longs tombant sur sa poitrine négligée, presque débraillée sans la barrière du soutien-gorge. Cette brunette racolait de son regard sensuel, né de sa nature ingénue, et simulait un sourire absent, observant par la fenêtre du wagon les choses qui passaient loin là-bas au-dehors. La métisse s’occupait d’une femme déjà courbée par l’âge, basanée par le soleil, burinée de rides profondes dues au travail de défrichage de ces forêts. Elle s’appelait Guilhermina, la vieille. Elle marmonnait çà et là quelque plainte et mâchonnait un biscuit imaginaire dans sa bouche édentée.
Afonso Sá était venu à la ferme sur l’invitation de mon père parce que ces champs ouverts et les terres alors quasiment inhospitalières requéraient des bouviers expérimentés. Son habileté au lasso favorisait mon imaginaire de petit garçon. Il était mon héros. Il portait toujours le pantalon bouffant large, orné de huit rangées de boutons sur les côtés, du flanc à la cheville, des bottes en accordéon, des chemises à carreaux et un mouchoir autour du cou, rouge sang. Soigneusement plié sur son épaule, un poncho fin à franges tombant jusqu’aux cuisses pour cacher son revolver «38». La moustache noire, épaisse, taillée chaque jour, révélait la vanité du célibataire têtu et farouche. S’il eut des amours, il ne les montra jamais et cela ne regardait pas les enfants. Il aimait son cheval de race créole, nommé Monseigneur, robe marron, grand, bien fait, agile. Monseigneur accompagnait en tout lieu ce lanceur de lasso nomade et embarquait là-bas à l’arrière d’un wagon de frêt. Afonso me fit connaître cette amitié. Il me confiait le cheval à la tombée de la nuit pour le bain et le fourrage. Quelques mètres sur son dos et j’étais le roi. Plus d’une fois maman observait de loin avec crainte et orgueil ma désinvolture. Je voulais être bouvier comme lui, par amour du cheval.
Lors des premiers jours au séminaire, les travaux à la ferme, le dos de Moreno me manquèrent. Je n’aurais plus à accourir vers mes petits frères et sœurs quand ils pleuraient ni à craindre les raclées du père, mais la privation du plaisir des aurores sur la campagne, pures et silencieuses, s’étalant sur les hauteurs, s’étirant sur les frondaisons des jatobás, des angicos et des cerisiers, réveillées par le mugissement venu des enclos où nichaient les troglodytes, remplissait de nostalgie les couloirs et les cours de l’internat. J’entendais dans ma mémoire les ordres criés par tante Luiza à une petite bande de cousins qui s’agglutinaient contre le poêle à bois dans les matins froids. J’étais privé de cette vie libre en compagnie de monsieur Alcino. Il m’attendait à l’écurie, parlait de choses sérieuses et de la maison qui se construisait au sommet du plateau et qui, grâce à Dieu allait être bientôt terminée. Il pourraient y mettre ses biens. Sa femme aurait un labrador couché dans la cuisine et elle veillerait au bétail dans les champs de monsieur Antonio. Alcino avait un sourire heureux qui n’empêchait pas le mégot de sa cigarette de rester calé au coin de sa bouche.
J’étais le grand garçon de la ferme, docile, obéissant, courageux. Ma mère disait que si on m’ordonnait de mettre la tête dans le feu pour chauffer l’eau, je le ferais. Maintenant qui surveillerait les petits l’après-midi quand les femmes sortaient laver les énormes paquets de linge dans les eaux limpides du ruisseau? Qui ramènerait le bétail à l’étable à la tombée de la nuit? Qui se lèverait avec le père bien avant le soleil pour l’abattage? Dans ces tâches je me sentais pleinement homme à affronter avec courage le sang et la mort. Non seulement j’écoutais avec plaisir les éloges qui venaient des adultes, mais je percevais dans leurs yeux la stupéfaction admirative pour l’habileté avec laquelle je me débrouillais.
Ces images me visitaient constamment et je ne voulais pas les dissocier du séminaire parce que c’était comme enterrer sans appel l’espoir de retourner à ce lieu de départ, mystérieux et obstiné. La ferme ne fut pas, à vrai dire, le lieu de toute mon enfance car écartelée implacablement, des morceaux de moi étaient dans d’autres fermes. Mais c’est là-bas qu’en contact avec la mort, j’y eus les premiers éclairs de conscience de la vie. La famille avait le virus du déménagement dans le sang. Ils traversèrent les océans, défrichèrent les forêts de la colonie italienne dans le sud, commencèrent un monde nouveau. Et les nouvelles terres, la nouvelle maison, les nouveaux amis, les nouveaux enfants stimulaient une routine modérée qui se répétait de temps en temps.
L’INTERNAT
J’ai été transplanté de la famille dans un internat de prêtres qui, eux aussi, n’étaient pas de ce monde. Ils étaient sur le chemin du ciel, disaient-ils, où le bonheur serait éternel. En peu de temps je fus entraîné par le courant du nouveau règlement et les activités de l’internat. Je m’aperçus vite que chaque séminariste devait se défendre comme il pouvait. Les sentiments maternels et les liens du sang plus profonds qui venaient de la famille, ne servaient ici à rien ou peu. On les avait laissés derrière la grande porte.
Mon grand oncle et moi, marchions par des rues poussiéreuses sous un soleil brûlant de la fin janvier. Les feuilles des arbres paraissaient immobiles et la végétation racornie par tant de chaleur. Nous traversâmes un jardin négligé, divisé en plates-bandes de marguerites, de roses et de dahlias. Au pied d’un mur haut et long, quelques pieds de camélias en fleur. Le grand oncle à qui j’avais remis la lettre de mon père, me lâcha la main, s’approcha de la grande porte, tira sur une corde qui pendait du toit, une cloche sonna à l’intérieur.
– C’est l’heure de la sieste, dit-il en regardant vers le troisième étage.
C’était un immense bâtiment de trois étages, d’un blanc délavé, aux innombrables petites fenêtres carrées. Une inscription occupait presque toute la façade: Séminaire Séraphique.
Au bout de longues minutes, un frère à la grande barbe grise, en habit marron et sandales rustiques à deux brides, ouvrit la porte. De la cordelette jaunâtre qui lui tombait sur l’entrejambe, pendait un grand rosaire à grains en bois dur de pin araucaria. Il nous installa au parloir, et entendant mon grand oncle dire que je venais au séminaire, il me serra contre lui, me passa la main sur la tête et dit qu’il allait appeler le Recteur. Je sentis une odeur paternelle et amicale qui imprégnait son habit de coton tâché de graisse. Le Recteur connaissait mon grand oncle. Pendant un certain temps tous deux parlèrent de leurs connaissances, de proches du grand oncle, certains religieux, d’autres religieuses.
Me voyant si petit et menu, le Recteur eut du mal à croire qu’âgé de seulement dix ans, j’avais trouvé mon chemin, de si loin, avec quatre changements de train, puis de bus en bus jusqu’ici. Le grand oncle me donna une bonne accolade, me remit au Recteur, prit congé et sortit.
Derrière lui, derrière les marguerites et les camélias, le frère verrouilla la grande et lourde porte. Je regardai, déconcerté et perdu, le haut plafond du parloir. Je saisis la valise et suivis le Recteur par les couloirs qui ressemblaient à des défilés. Ils étaient étroits et sombres, malgré les quatre heures d’un clair après-midi d’été. Le grand escalier grinçait par endroits sous le poids du Recteur. Étant séminariste, je le suivais en silence comme un petit chien, répondant par monosyllabes au genre de questions habituelles que l’on fait à des étrangers sur le voyage, la famille, le nombre de frères et sœurs, leur âge. Dans le dortoir des mineurs, il me donna un lit sous lequel, rescapée, se réfugia ma petite valise que des cauchemars m’avaient fait perdre plusieurs fois pendant les six jours du voyage.
J’étais arrivé seul dans un endroit inconnu, avais rencontré des étrangers, toujours agrippé à ma petite valise et porteur d’une lettre pour mon grand oncle. Il y avait eu tant de recommandations sur la valise que je la gardais avec moi, jour et nuit, éveillé et en rêve. Nous devions arriver ensemble ou du moins elle ne pouvait pas être perdue. Elle était prisonnière de ma vocation, s’internait avec moi, notre destin était le séminaire.
Je pensais à la ferme de la campagne de São João de Cima, au garçon de ferme Alcino, au cheval Moreno tandis que le Recteur me conduisait à son bureau. Là, il inscrivit mon nom dans un livre épais qui occupait une grande partie de sa table de travail où régnait le désordre. La pièce était encombrée de mille choses. Des rouleaux de fil de fer, je le sus plus tard, se transformeraient en chapelet pour compter les «Ave Maria»; des paquets de papier, des caisses de crayons et beaucoup de livres. Nous étions à peine arrivés dans la cour des mineurs, qu’il en appela quelques uns juste sortis du bain, me confia à leurs soins pour qu’ils me montrent toutes les dépendances et les cours autorisées aux jeunes garçons.
Quelques jours plus tard, quand un frère me demanda d’écrire une lettre à mes parents pour leur dire que j’étais arrivé et étais heureux «parce qu’un jour je serai prêtre», je constatai que je n’avais pas l’adresse de la maison et que je ne savais que le nom de la ville d’où j’étais parti. La lettre pliée dormit, pendant longtemps, dans une enveloppe blanche sans destinataire. Ce fut ma première impression, vague et inconsciente, d’être prisonnier comme un petit oiseau dans un piège. Il me vint à l’esprit que je pouvais être un enfant adopté ou trouvé, comme Lucas le petit noir, abandonné dans une gare, à seulement cinq ans. La peur d’avoir été rejeté me glaça le sang. Et, comme dans l’histoire de Lucas, j’allai à l’autel de la Vierge Marie, dans la chapelle vide, m’agenouillai et la suppliai de devenir ma mère.
En lisant des histoires d’orphelins ou d’enfants abandonnés, je pleurais en secret ou incarnais leurs aventures. J’étais en même temps un orphelin, garçon oublié des rues et petit héros d’un monde tragique, gouverné par des parâtres et des marâtres. Sans père ni mère en vue, sans adresse connue, je commençais à avoir des fantasmes et m’imaginais en prêtre idéal, sans défauts, aimable avec tous, généreux avec les enfants, les vieux et les faibles, donnant l’accolade à tous dans mon habit de coton grossier, marron, au relents de graisse. J’aurais douze ans et deux mois de séminaire quand, entendant des nouvelles de guerre, je m’imaginais sortir d’une cachette, unique survivant d’une immense catastrophe dévastatrice. Alentour, tout était à reconstruire. Je serais le prédestiné à qui on confierait le chantier d’un monde nouveau.
L’internat était un concentré de garçons inachevés. Ils n’avaient pas eu le temps de terminer leur enfance, menés d’une main de fer par des adultes qui avaient grandi sans père ni mère, dédiés à obéir à la loi indiscutable de Dieu. Comme on le sait, sa justice n’admet pas d’exception d’âge, de sexe, de temps ou de circonstances. La sévérité, le châtiment, la dévotion, la peur, la discipline étaient les éléments de la nouvelle culture pour tremper le caractère et échapper au péché. J’eus l’intuition et, des années plus tard je le constatai, dans les manières et les paroles, que pour être prêtre il fallait tuer quelqu’un et l’enterrer. On parlait du vieil homme plein de passions, de vices et de péchés. Le vieil homme était en moi et s’appelait Juliano. L’homme nouveau le substituerait avec le passage du temps. La frayeur initiale devint peu à peu une réalité routinière et rapidement je me consacrais à creuser ma propre tombe.
La routine de l’internat ne tarda pas à s’imposer. Tout y était déterminé par le temps et les activités. Tout était calculé pour faire s’activer plus de deux cent séminaristes dans différentes occupations réglementées. Les ordres valaient pour tous. Tous à l’église, au réfectoire, dans les salles de classe. Tous dans la cour, aux travaux manuels, tous à la confession, aux latrines, tous au lit.
Au séminaire, l’œil de Dieu était partout. A l’église parce que c’était sa maison et on y allait par obligation. Dans les latrines il surveillait le sexe ; au lit contrôlait la masturbation; à table modérait la goinfrerie; dans la salle de classe chassait les mauvaises pensées. Où que le séminariste se tournât, il tombait sur un ange gardien ou se heurtait à un saint. La vie du séminariste était mise à nu par mille esprits curieux qui contrôlaient les désirs et l’imagination. A une hauteur plus discrète, dans une niche, se trouvait Marie la mère de Dieu, ayant des pouvoirs maternels sur Lui et coordonnant les saints protecteurs dans la maison.
Dès les premiers jours apparurent les grandes différences entre la vie libre à la ferme et les mouvements disciplinés dans ce grand bâtiment bondé de garçonnets enterrés vivants. A la place de l’enclos où les animaux attendaient patiemment l’heure de la mort, une immense salle de lecture et d’étude était surveillée par un frère professeur, appelé aussi préfet. Sa présence empêchait la communication à voix basse, décourageait la copie, interceptait quelque dessin étranger aux consignes, surprenait des vers révélateurs de sentiments interdits ou quelque lettre tendre à un compagnon de cette solitude trouble.
Par sa vigilance attentive et permanente, le frère-préfet pouvait détecter les sentiments de l’âme, découvrir de petits larcins, surprendre des indisciplines la main dans le sac et prendre en flagrant délit les situations compromettantes. La surveillance, comme le sait le policier, se nourrit de petits détails, de prises sur le fait inattendues, de faits épars qui s’enchaînant s’accumulent et l’œil clinique du surveillant leur lance un éclair de défiance. Le surveillant et le surveillé établissent des relations actives et passives. L’œil inquisiteur voit et est vu.
Une des défenses du surveillé est de participer à l’œil surveillant, multipliant la capacité de tout voir. Le mouchard fait partie de la filature. Deux garçons qui sortirent de la même porte des toilettes du dortoir, à un moment calme de la journée, furent dénoncés au préfet et convoqués immédiatement au bureau du Recteur. Quelqu’un les avait suivis, vu par dessous la porte leurs habits tombés par terre, en avait déduit que les deux y étaient nus et avaient fait ce que Dieu seul savait. Un des deux confessa dignement tout par respect à lui-même. Ils furent expulsés du séminaire sans commisération. La décision drastique fut réaffirmée par des actes de réparation de la part de la communauté contrite, devant le très saint sacrement et l’autel de la Vierge Marie, pimentés par une harangue du Recteur où il utilisa des mots que je ne comprenais pas: «pédérastie» «morbide» «Sodome et Gomorrhe» qui le firent rougir comme si c’était lui le pécheur. «En raison de ces péchés, Dieu pourrait exterminer le séminaire par le feu», conclut-il.
L’organisation sociale de l’internat exigeait, pour mieux contrôler les élans et initiatives individuelles, que les séminaristes fussent divisés en groupes où ces manifestations pussent être classifiées et les mesures prises à temps. La taille plus que l’âge était le critère de base pour nous séparer en deux catégories, les plus grands et les plus petits.
Parmi les petits, plus en manque d’affection, dont l’âge allait de dix à treize ans, circulaient des petits secrets amoureux avec tel ou tel du groupe des grands. Il n’était pas rare de voir apparaître au tableau noir ou sur les pupitres de la salle de lecture les initiales ou même les prénoms complets des amoureux. La correspondance était acheminée par des messagers de confiance qui les déposaient sous l’oreiller, dans un livre ou un missel sur les bancs de l’église. Mais la malchance faisait souvent obstacle à ces ruses. Un garçon entre dans l’église ou au dortoir à une heure suspecte, quand personne n’y va et ne se rend pas compte que l’œil vigilant du compagnon intercepte l’opération.
Une fois, par les œuvres du frère-préfet, une lettre de Paulo à Estevan fut saisie et ce n’est qu’après leur départ du séminaire que les motifs en furent connus. Paulo venait de passer dans la classe des grands parce qu’il était de haute taille. Il avait douze ans révolus, de longues jambes, des boutons sur le visage, était un peu gauche. Paulo se consumait de la douleur d’avoir perdu son ami. Avisée un mois plus tard par le Recteur, la mère d’Estevan vint le chercher. Pleura toutes ses larmes et passa plus d’une heure devant l’autel demandant miséricorde et regrettant que Dieu ayant si grand besoin de bons pères récusât l’offrande généreuse faite avec tant de sacrifices deux ans auparavant. Elle sortit par la porte de la chapelle, tenant son fils par la main, pour toujours, pour être livré à la perversité du monde, comme on disait.
– Les amitiés particulières, expliquait le Recteur qui portait des lunettes noires, sont les mauvaises herbes, elles révèlent une bassesse de caractère et dévoient l’affection qui doit s’adresser uniquement à la Vierge Marie et au Christ. C’est le diable qui sème dans l’âme de la jeunesse la graine du vice.