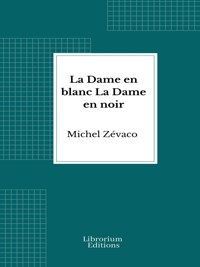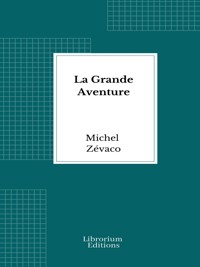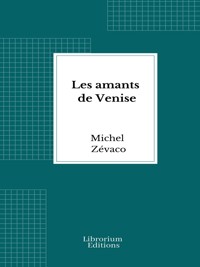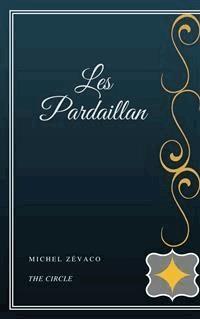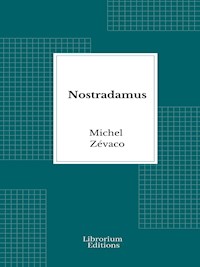0,50 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: E-BOOKARAMA
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Französisch
"L'Hôtel Saint-Pol" est un roman de cape et d'épée écrit en 1909 par Michel Zévaco. Bien sûr, il y a un héros invincible, une héroïne plus belle que les plus belles, douce, intelligente et tout et tout... et ils ont à faire face à de terribles dangers.
Ce récit a un fond historique dont l'action se déroule principalement à la cour de Charles VI. La folie du roi conduit son proche entourage à une lutte de pouvoir sans merci. Michel Zévaco sait retenir l'attention du lecteur à merveille grâce aux très nombreux rebondissements de cette histoire sans temps morts...
"L'Hôtel Saint-Pol" a une suite qui s'intitule "Jean Sans Peur", aussi publié par E-Bookarama.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
table des matières
L'HÔTEL SAINT-POL
I – LA REINE
II – LA MÈRE DE ROSELYS
III – LE POISON DE SAÏTANO
IV – HARDY DE PASSAVANT
V – RÊVES ET RÉALITÉS
VI – ENTRÉE EN SCÈNE D’IMPÉRIA
VII – DESTINÉES PARALLÈLES
VIII – MARGUERITE DE HAINAUT
IX – LAURENCE ET ROSELYS
X – LE ROI FOU
XI – PRISONNIER D’ÉTAT
XII – L’ANGE DE L’HÔTEL SAINT-POL
XIII – L’HOMME DE LA CITÉ
XIV – LE MARI DE LA DUCHESSE D’ORLÉANS
XV – PREMIER GRONDEMENT D’ORAGE
XVI – LA FILLE DE JEAN SANS PEUR
XVII – RÉCONCILIATION DE JEAN SANS PEUR ET DE LOUIS D’ORLÉANS
XVIII – LE RETOUR DU CHEVALIER DE PASSAVANT
XIX – L’AUBERGE DE LA TRUIE PENDUE
XX – JACQUEMIN GRINGONNEUR
XXI – DES VISIONS
XXII – L’HÔTEL DE BOURGOGNE
XXIII – LE BRAVO
XXIV – LA RUE BARBETTE
XXV
XXVI – LA MÉMOIRE ET LE CŒUR
XXVII – L’ESCABEAU DE GRINGONNEUR
XXVIII – L’ATTAQUE
XXIX – PASSIONS HEURTÉES
XXX – L’HOMME DE L’ÉPOUVANTE
Notes de bas de page
L'HÔTEL SAINT-POL
Michel Zévaco
I – LA REINE
Dix heures du soir vont sonner…
Dans la vaporeuse atmosphère de la nuit d’été, en ce coin de Paris qui s’étend de la rue Saint-Antoine à la Seine, c’était une saisissante vision que celle de cette formidable enceinte crénelée sur laquelle pèse un vaste silence…
C’est une forteresse géante où dix mille hommes d’armes se peuvent loger, une forêt de tours, de beffrois, de flèches, de clochetons, une cité fantastique où les musiques des fêtes et les orgues de huit chapelles chantent tour à tour la gloire de Satan et celle de Dieu, tandis que le rugissement des lions, du fond des cages, répond au cri de veille des sentinelles, une véritable ville féodale enfin, où dans six jardins et quatorze cours s’espacent à l’aise le palais du roi, le palais de la reine, l’hôtel des Archevêques, le logis de Pont-Périn, l’hôtel de Saint-Maur, le palais de Beautreillis, somptueux édifices gothiques dominant de leurs campaniles vingt autres bâtiments épars dans l’enceinte.
Cet immense domaine porte un nom que partout on murmure parmi de mystérieux récits, d’exorbitantes légendes :
Cela s’appelle L’HÔTEL SAINT POL.
Dix heures du soir vont sonner…
Au palais de la reine, tout se tait…
Au fond de la fastueuse chambre à coucher, en costume d’apparat, cotte-hardie lamée d’argent, voile de dentelle retombant du hennin, se tiennent les trois filles d’honneur, immobiles.
Devant un haut miroir d’acier, les poignets encerclés d’émeraudes, les mains scintillantes de bagues selon la mode qu’elle a importée, les yeux d’un bleu noir, la chevelure blond ardent, éblouissante dans l’éclat de ses dix-huit printemps, Isabeau de Bavière, la reine de France.
Elle écoute, elle attend, elle écoute encore, elle est nerveuse, impatiente, elle soupire – et, tout entière, elle tressaille lorsque sonnent dix heures… enfin ! Alors elle se retourne :
– Pour cette nuit, vous avez congé. Des escortes vous reconduiront au logis Passavant, Laurence ; – à l’hôtel de Coucy, Blanche ; – et vous, Colette, à l’hôtel de Saveuse. Allez.
En parlant ainsi, sa voix grelotte comme lorsqu’une rafale de folie ravage un cerveau. Et son masque d’étrange beauté se convulse sous l’effort de quelque terrible émotion.
Les demoiselles d’honneur s’inclinent en une lente révérence, et quand elles se redressent, l’une d’elles, cette fille, là près du lit, si belle, si pure, si touchante, Laurence d’Ambrun est devenue pâle comme la cire des flambeaux qui éclairent cette scène. Sûrement, c’est une âme en détresse. Il y a du désespoir dans l’attitude de cette jeune fille, et ses yeux reflètent quelque douleur sans remède… La reine pâlit à son tour. Et d’une voix altérée où vibre on ne sait quel menaçant soupçon :
– Vous avez la mort sur le visage, d’Ambrun !… Pourquoi ?… Répondez !…
– Un malaise, Majesté, répond Laurence avec effort. Si vous daignez le permettre, je resterai au palais.
– Rentrez chez vous ! gronde la reine. Rentrez et reposez-vous cette semaine, reprend-elle plus calme. Allez, ma chère. Demain, je vous enverrai mon guérisseur au logis Passavant.
Laurence bégaie un morne remerciement, et sort avec ses compagnes.
– Oh ! songe-t-elle, éperdue, elle nous renvoie ! C’est le comte de Nevers qu’elle attend ! Je le sais ! J’en suis sûre… le malheur est sur moi ! Le malheur et… le châtiment !… Seigneur, Seigneur, ne punissez que moi, et sauvez l’innocente !…
Elles traversent la salle de Mathebrune attenante à l’appartement privé : déserte ! – puis la salle de Théseus : déserte ! – puis la galerie monumentale à double colonnade : déserte ! On a fait le vide dans le palais de la reine !…
Et, tandis que Blanche de Coucy et Colette, de Saveuse, obéissant à l’ordre, descendent le majestueux escalier en granit d’Égypte, franchissent les cours et quittent l’Hôtel Saint-Pol, Laurence d’Ambrun demeure là, appuyée à une colonne de la galerie, les mains jointes, désespérée. Et d’un accent d’affolement, elle murmure :
– Il va venir !… C’est fini !… Adieu mon dernier espoir !… Il aime la reine !…
Quelques minutes, Isabeau a écouté les bruits qui s’éloignent, s’étouffent, s’éteignent. Alors, sûre de la solitude, elle s’élance ; de son pas onduleux et souple, elle parcourt le même chemin que les filles d’honneur ; mais, au bord du vaste et superbe escalier qui descend droit au vestibule, elle s’arrête comme au bord d’un lac d’ombre.
Et soudain paraît celui qu’elle attend !
C’est un jeune homme de vingt-cinq ans, d’une âpre beauté, d’une élégance rude, largement découplé, le front violent, la lèvre dédaigneuse, l’œil cruel chargé de défiance. Il monte jusqu’à Isabeau, met un genou sur les dalles et murmure :
– Jean sans Peur, comte de la marche de Nevers, attend les ordres de sa reine !
– Relevez-vous ! commande Isabeau.
Et, quand il a obéi, elle hésite, elle tremble, sa gorge s’oppresse, son sein se soulève, ses lèvres brûlent, et, tout à coup :
– Pourquoi, depuis huit jours que vous êtes à Paris, aux lices, à la chasse, aux fêtes données en votre honneur, partout, est-ce moi, toujours moi que vous regardez ?
La parole brève, Nevers répond :
– Pourquoi aux fêtes et partout et toujours, est-ce vous, vous seule qui prenez ma pensée, mon regard et mon âme ?
Jean sans Peur, avidement, la contemple, l’étudie. Son regard, aux lueurs d’acier, brille d’une ruse effrayante. Et celui-là, aussi, est en pleine jeunesse ! Et si le délire de la reine est un de ces phénomènes qui bouleversent toute psychologie, sa passion, à lui, est plus hideuse, car c’est l’amour de soi poussé à la frénésie, car c’est l’ambition brûlante, dévorante ! Lui ! Lui ! Il n’y a que lui ! Il brisera, détruira, broiera tout sur son chemin !…
– Madame, murmure-t-il, ah ! madame, vous ne me condamnez donc pas ?…
– Vous condamner ! moi !
Le cri a fait explosion sur les lèvres de la reine, le cri qui la livre comme une ribaude du Champ-Flory, le cri qui proclame la déchéance de son honneur de femme, de sa dignité d’épouse. Et ces paroles sont les premières qu’elle échange seule à seul avec cet homme ! Et il y a huit jours que, pour la première fois, elle a vu Jean sans Peur, absent de Paris depuis trois ans ! Et c’est leur premier rendez-vous !…
Ébloui, balbutiant des serments informes, il a ouvert les bras, et s’avance… mais alors Isabeau se dérobe !
Elle le couvre d’un regard sérieux jusqu’à la menace, et gronde :
– Je vous veux pour moi, pour moi seule, tout entier, force et pensée, esprit, âme et corps. Prenez garde, Nevers ! Prenez garde avant de répondre à la question suprême ! Jurez que vous n’avez dans votre vie aucune attache d’amour.
– Aucune ! répond Jean sans Peur.
– S’il y en avait une, jurez de la trancher… entendez-moi ! Ce n’est pas seulement une rupture que j’exige : entre vous et moi, je ne veux rien de « vivant »… rien !…
Nevers lève la main et jure !
Dans les lointains de la galerie passe une plainte… si ténue qu’ils ne l’entendent pas. Et c’est Laurence d’Ambrun qui râle :
– Adieu ! Adieu à l’espérance !…
Isabeau se rapproche de Jean sans Peur. Sans doute, ce qui lui reste à dire est effroyable : dans un souffle, elle commence :
– Les attaches d’amour ne sont pas les seules… Ma cousine Marguerite de Hainaut est votre épouse… Votre cousin Charles sixième est mon époux…
Elle s’arrête… elle n’achève pas… Une longue minute, penchés l’un sur l’autre, les yeux dans les yeux, blêmes figures de crime, ils s’interrogent, ils se répondent par leurs regards… et c’est fini… ils se redressent… ils se sont entendus parler dans le silence, ils se sont compris !… Alors, elle achève, d’une voix lente et grave :
– Maintenant, Jean sans Peur, vous pouvez répondre. Prenez garde !…
Et Nevers, sans hésiter :
– Par le ciel, par cette nuit d’où je veux dater ma vie, par cette âme que je vous donne, je jure que je vous aime !
Dans cette seconde, tous deux s’immobilisent, pétrifiés… Là, dans la galerie même, derrière une colonne, il y a eu quelque chose comme un cri étouffé… Il semble que, là-bas, un pas se traîne… Isabeau s’éveille de sa stupeur… Audacieuse et flamboyante, elle bondit… et elle entrevoit une forme indécise qui s’enfonce dans le couloir réservé aux filles d’honneur…
Alors elle s’arrête. Un sourire crispe ses lèvres : elle a reconnu cette forme…
De son allure silencieuse et rapide, elle revient sur Jean sans Peur, l’entraîne jusque dans sa chambre à coucher, et là :
– Nous avons été guettés : nous sommes perdus, si vous ne tuez l’espionne.
– Je suis prêt ! gronde Jean sans Peur en montrant son poignard.
– Pas dans le palais. Le cadavre nous accuserait. Ni au poignard. Le sang reste !
– Où et comme vous voudrez !
Froidement, en quelques rapides et indistinctes paroles, le meurtre a été décidé.
« Trône et sceptre ! songe Nevers. La gloire ! La puissance ! Et qui sait ? L’empire de Charlemagne restauré ! Le monde sous mon talon !… Et quant à cette fille qui, depuis huit jours, me supplie du regard, qui prétend se prévaloir de ce caprice d’antan… malheur à elle, si elle se trouve sur ma route ! »
Isabeau, d’un signe, ordonne à Jean sans Peur de l’attendre, et elle se glisse, empressée, funèbre, dans l’obscurité de la galerie, entre dans le couloir, choisit d’un seul coup d’œil, entre dix autres, une porte devant laquelle elle s’arrête. Brusquement, d’un mouvement furieux, elle l’ouvre toute grande…
C’est la porte de la chambre où loge Laurence d’Ambrun…
Il nous faut ici conter son histoire. Elle sera brève. Elle pourrait tenir en ces trois mots : « c’était une orpheline ».
Sa naissance avait tué sa mère. Et elle atteignait sa quinzième année lorsque, en février 1387, mourut son père, le baron d’Ambrun, l’un des plus vigoureux partisans du duc de Berry dans sa lutte contre Philippe duc de Bourgogne, dont Jean sans Peur était le fils aîné. En partant pour l’éternel voyage, d’Ambrun confia Laurence à la veuve de son ami et compagnon d’armes, Tancrède, chevalier de Passavant [1].
La veuve, Alice de Passavant, recueillit la demoiselle d’Ambrun et lui fit place en son hôtel de la rue Saint-Martin. Mais, au commencement de 1389, cette noble femme, rongée par le chagrin, s’en fut elle-même rejoindre son bien-aimé Tancrède… Elle laissait un fils dont on venait de célébrer le sixième anniversaire.
Cet enfant se nommait Hardy, et nul autre nom n’eût pu lui convenir.
Les deux orphelins, donc, Laurence d’Ambrun et Hardy de Passavant, se tinrent lieu de toute famille : ils furent frère et sœur, elle a l’âge des premiers émois du cœur, lui grandissant de façon plus qu’étrange, en force physique et courage d’âme.
Tout à coup, à la fin de cette même année 1389, Laurence devint inquiète, agitée, quitta souvent seule le logis, parut souvent les yeux rouges, et pâlit de jour en jour.
Un soir, elle embrassa Hardy en sanglotant. Puis elle sortit… et ne revint plus !… Ce qui s’était passé, à quel vertige avait succombé la pauvre fille sans mère, sans guide, sans expérience de la vie, on va le savoir.
Hardy pleura longtemps sa sœur. Puis, l’équitation, l’escrime, la natation, la manœuvre de la lance, de l’arbalète occupèrent sa vie.
Le temps s’écoula.
Hardy accomplit sa dixième année.
Un jour d’hiver, aussi subitement qu’elle était partie, Laurence reparut au logis, mais combien triste et maigrie, pauvre oiseau blessé qui regagnait péniblement l’ancien nid !… Elle était vêtue de noir. Elle portait dans ses bras une petite fille fraîche, rose et souriante. Pour elle-même, et non pour Hardy qui n’entendit pas, elle murmura :
– Seule, je fusse morte plutôt que de souiller ce cher foyer de ma présence. Mais cet ange, mon Dieu ! Ah ! toute la honte pour moi plutôt que la misère pour elle !…
Et, arrêtant d’un geste timide les effusions de Hardy, elle demanda en tremblant s’il y avait encore place pour elle au logis Passavant. Pour toute réponse, le petit chevalier assembla ses gens et leur ordonna d’obéir à Laurence comme à lui-même. La gouvernante ayant assuré qu’elle n’obéirait pas fut chassée incontinent. Le gouverneur voulut hasarder une observation. Mais Hardy tira sa dague et le menaça de la lui passer aussitôt tout au travers du corps. La maison trembla, et le chevalier, ayant fait sortir ses gens sans avoir rien compris à leurs mines indignées, essuya les larmes de la pauvre fille.
Puis il jeta un regard curieux sur l’enfant qu’elle serrait sur son sein avec une sorte de passion farouche.
– C’est votre fille ? dit-il.
Laurence, avec une expression d’indicible émotion, leva les yeux au ciel, et, sans répondre, présenta la fillette à Hardy :
– Elle s’appelle Roselys, murmura-t-elle.
Hardy demeura les yeux écarquillés, béant d’admiration, et, enfin, joignant les mains :
– Qu’elle est belle ! soupira-t-il.
Une flamme d’orgueil et de joie fugitive éclaira le visage de Laurence.
Six mois passèrent, au bout desquels Laurence d’Ambrun était redevenue la belle jeune fille qu’elle avait été, mais avec on ne sait quelle profonde mélancolie qui la rendait plus touchante. Elle ne vivait que pour Roselys : avec une intense, une effrayante transfiguration de tous ses sentiments, Laurence s’absorbait en Roselys. Il n’y avait rien dans l’univers : il y avait Roselys !
Ce fut à ce moment que le hasard, cet anonyme endosseur de la Fatalité, mit la fille du baron d’Ambrun en présence de la duchesse de Berry – la même qui, au fameux bal où le costume du roi fut enflammé par une torche… maladroite, sauva Charles VI en l’enveloppant de son manteau. Par malheur, la duchesse n’avait pas oublié les services rendus à sa maison par le père, mort pauvre – et trop fier pour avouer sa détresse : elle s’inquiéta, questionna, fut sympathique, et promit un poste de fille d’honneur, en même temps qu’une généreuse dot de deux cents écus d’or à la rose, pour le trousseau. Laurence trembla : refuser ce titre que se disputaient les plus puissantes familles, c’était provoquer le scandale et l’enquête ; l’accepter, c’était courir au-devant d’une horrible catastrophe si jamais on découvrait que… Quinze jours après, elle recevait son brevet !
Bientôt, elle entrait en fonctions.
Le service – qu’elle partageait avec quinze autres demoiselles de haute noblesse – consistait à habiter près de la reine quinze jours chaque mois : une semaine de jour et une semaine de nuit.
Laurence d’Ambrun, donc, était demoiselle d’honneur depuis environ dix-huit mois et presque entièrement rassurée sur les dangers qu’elle avait redoutés. Roselys allait sur la fin de sa cinquième année, Hardy achevait ses douze ans, et il en paraissait tout près de quinze.
Un jour, rentrant de l’Hôtel Saint-Pol, Laurence trouva le logis en émoi ; dans l’après-midi, faisant leur quotidienne promenade, Roselys et Hardy s’étaient approchés du bord de l’eau. La berge était là, très élevée. Un faux pas précipita Roselys dans la Seine. La gouvernante appelait au secours lorsqu’elle aperçut Hardy qui s’était jeté à l’eau, saisissait l’enfant près de couler et la ramenait évanouie sur les bords. La digne matrone raconta par la suite que jamais elle n’avait vu figure plus terrible que celle de Hardy luttant pour sauver sa petite amie.
Voilà ce que, ce soir-là, apprit Laurence. Elle serra convulsivement dans ses bras Hardy de Passavant, et, dans un mouvement de terreur folle, murmura :
– Si elle était morte !…
– Si elle était morte, je serais mort…
Ceci fut dit d’une telle voix que Laurence tressaillit et jeta un regard profond sur le petit chevalier. Et alors, la vérité lui apparut : l’affection de Hardy pour Roselys avait grandi avec, une vigueur qui la stupéfia et la désespéra. C’était une passion, une de ces fleurs mystérieuses, charmantes et troublantes, que, sans le savoir, les enfants portent quelquefois dans leur cœur comme en une serre impénétrable, inconnue d’eux-mêmes. Laurence fut bouleversée : l’effrayant problème de l’avenir de Roselys pour la première fois, se dressa devant elle.
Oh ! c’est qu’elle évoquait l’avenir ! l’effroyable moment où cette enfantine affection s’affirmerait en amour, où Hardy voudrait tout connaître de la vie de Roselys, où il questionnerait, où il interrogerait Laurence !… Et où elle serait forcée d’avouer la lamentable vérité :
Roselys ?… Une fille sans nom !…
Fille sans nom !… Aujourd’hui, cela se pardonne, oui, peut-être… mais alors !…
Fille sans nom !… C’était, en ces siècles barbares, l’infamie que nul ne pardonnait ! C’était l’ignominie !
– Dans trois ans, dans deux ans, songeait Laurence, dans quelques mois, il sera trop tard. Il faut fuir… fuir avant que Hardy ne comprenne… ne demande… Seigneur, sanglotait-elle, « prenez ma vie ! ». Et en échange, « donnez un nom à cette innocente !… ».
Soudain, au mois de juin de l’an 1395, Laurence d’Ambrun se reprit à vivre.
Une joie fiévreuse éclata dans ses beaux yeux… Un bruit s’était répandu dans Paris… et en même temps une pensée d’espoir, sans doute, s’était levée dans l’âme de Laurence, et s’y fortifiait.
Un soir, une fanfare de trompettes passa au coin de la rue Saint-Martin et se perdit au loin vers l’Hôtel Saint-Pol. Laurence d’Ambrun jeta sur Roselys un regard brûlant, et son cœur, éperdûment, cria :
– Tu es sauvée ! Tu ne mourras pas de honte ! « Hardy ne te chassera pas ! » Car ton infamie de fille sans nom, JE VAIS LA RACHETER AU PRIX DE MA PAUVRE VIE INUTILE ET BRISÉE !
Le dimanche, commença au palais sa semaine de nuit.
Le mercredi, toutes ses dispositions étaient prises, sans doute : dans la journée, elle habilla Roselys avec une coquetterie exquise, et l’emmena avec elle… « à l’Hôtel Saint-Pol ! ».
Nous ne dirons pas ses précautions pour l’introduire secrètement.
C’est le soir de ce mercredi que Jean sans Peur entra au palais de la reine ! Ce fut ce soir-là que, dans les profondeurs de la galerie silencieuse, un sanglot répondit au serment du comte de Nevers ! Ce fut ce soir-là, vers onze heures, que la reine Isabeau pénétra dans le couloir réservé aux chambres des filles d’honneur. C’est à cette heure-là que, d’un geste frénétique, elle ouvrit toute grande la porte de l’une de ces chambres… celle de Laurence d’Ambrun !…
II – LA MÈRE DE ROSELYS
Laurence, frissonnante et fébrile, avait réveillé Roselys, endormie dans un fauteuil où elle l’avait couchée presque entièrement vêtue, pour qu’elle fût prête le lendemain matin au moment voulu. En un tour de main, elle eut rajusté les vêtements de l’enfant. D’une voix morne, elle répétait : « Fuir ! Il faut fuir ! Cela a été horrible ! Allons ! Dépêchons ! Il faut fuir !… » À ce moment, et comme elle attachait le manteau de Roselys, le bruit de la porte s’ouvrant frappa son cerveau comme un fracas de tonnerre. Dans la même seconde, elle fut debout, face à la porte, les lèvres entre les dents jusqu’au sang pour ne pas crier, et, couvrant de son corps, cachant le fauteuil au fond duquel elle avait rejeté l’enfant…
Isabeau semblait calme. Ce fut distraitement qu’elle dit :
– Je vous avais ordonné de rentrer au logis Passavant…
– Ce malaise, Majesté, murmura Laurence, avec une volubilité confuse. C’est passé. Tout à fait. Majesté… je…
– Restez !…
Laurence s’immobilisa. Et, presque aussitôt, la reine ajouta :
– Qui est cette enfant ?… Cette enfant que vous cachez ?…
C’était l’attaque. Laurence vacilla. La reine se mit à rire, montrant une double rangée de petites dents aiguës.
– Une idée folle, ma chère… j’ai cru une seconde… j’ai cru que vous étiez la mère !
Laurence ne broncha pas. Dans sa tête, il n’y avait plus que des remous d’horreur.
– Mais riez donc ! Était-ce fou ! Une demoiselle d’honneur fille-mère et introduisant l’enfant d’ignominie au foyer de la reine ! Voyez-vous la belle, la sage, la sévère d’Ambrun attachée au pilori des Halles pour crime d’infamie et de lèse majesté !…
Laurence grelotta. La reine marcha sur elle et, tout près, la voix changée :
– Vous ne dites rien ?… C’est votre fille, n’est-ce pas ?… Non ?… C’est non ?… Soit ! Comment s’appelle-t-elle ?
– Roselys, bégaya Laurence toute raide.
– Charmant. Mais Roselys qui ? Roselys quoi ? De quelle famille ? Parlez !…
– Je ne veux pas ! râla Laurence.
– Vous ne voulez pas ?… Non ?… Allons ! Vous avez introduit chez mois une bâtarde !
Laurence, péniblement, tourna la tête vers sa fille. Et il y avait une épouvantable tristesse sur son visage où coulaient des larmes lentes. Elle parvint à murmurer :
– Pitié, madame, pitié, oh ! pitié pour cette toute petite innocente… que je…
– Que vous avez recueillie, n’est-ce pas ? N’ayez pas peur… C’est cela ?… dites ?…
– Oui, Majesté, oui ! C’est cela ! cria Laurence en se raccrochant à l’espoir.
– Pauvre petite !… Recueillie, soigneusement cachée par vous au logis Passavant… pas de nom ?… dites !…
– Sans nom, oui ! répéta Laurence.
– Eh bien, dit tranquillement la reine, « il faut qu’elle ait un nom !… ».
Laurence, violemment, redressa la tête. Ses yeux furent deux abîmes de terreur. À ce moment, Isabeau lui asséna le coup décisif :
– Pour qu’elle ait un nom, il faut qu’elle soit réclamée, adoptée devant l’official…
Un gémissement de bête qu’on tue – et la reine acheva :
– Pour cela, il faut que trois jours durant, sous le porche de l’église cathédrale… l’enfant soit exposée !…
Il y eut alors le geste furieux de Laurence empoignant Roselys à pleins bras, et ce hurlement :
– MA FILLE !…
Et ce cri féroce :
– Ah ! je savais bien que je t’arracherais la vérité ! Je l’ai vu tout de suite que c’est ta fille ! Je l’ai su dès mon premier coup d’œil, comme je sais !… comme je devine le nom de son père ! Le nom de ton amant !… Ta pâleur, tes larmes, tes joies soudaines, tes mystères depuis huit jours qu’il est à Paris, tes regards même, rien ne m’a échappé !… C’est lui ! C’est lui ! Parle ! Avoue ! Crie que c’est lui ! Ou, de par Dieu, je réveille tout l’Hôtel Saint-Pol et je te fais fouetter nue dans la grande cour par les valets de chiens !…
Et Laurence, d’un accent à faire pleurer :
– C’est lui !…
– Jean sans Peur ?
– JEAN SANS PEUR !…
De nouveau, ce fut le silence. Toute droite, les bras croisés sur son sein soulevé par des spasmes, pareille à une impératrice des temps néroniens, Isabeau contempla Laurence écrasée à ses pieds.
Longtemps, elle demeura ainsi.
Par degrés, comme s’affaissent les houles de l’Océan, le visage d’Isabeau se calma :
– Pourquoi sous mon toit avez-vous amené la fille de Jean sans Peur ? demanda-t-elle, impassible.
Laurence avait en elle une pensée vivante encore : Sauver sa fille !
Alors, sans lever la tête, en quelques paroles, elle évoqua son malheur : comment « il » était venu et avait rôdé autour d’elle, et quelles promesses il avait faites… les quelques mois d’enivrement où elle avait cru au bonheur sur terre… l’irrésistible amour qui s’était emparé d’elle… puis, la naissance de Roselys – et l’abandon ! Et elle dit son incurable désespoir devant l’affreux avenir de sa fille méprisée, honnie, chassée par Hardy, montrée au doigt… Quand Laurence eut ainsi porté sa croix à toutes les étapes de son calvaire, Isabeau, froidement, répéta :
– Pourquoi au logis de la reine avez-vous introduit la fille de Jean sans Peur ?
– Pour la sauver ! cria la mère dans une explosion d’amour et de sanglots. Pour lui donner un nom ! Je savais que demain matin, à la première heure, « il » serait à l’Hôtel Saint-Pol… Je voulais le supplier… l’entraîner ici… je pensais que la vue de ma fille, si belle, si pure… sa fille ! sa fille, madame !… j’espérais qu’un mariage… fût-il secret ! donnerait à Roselys un nom… et droit de cité… droit de vie !… Hélas ! Ce que j’ai vu dans la galerie… c’est la mort de ma fille !…
Isabeau avait tressailli de stupeur. Laurence ne l’entendit pas murmurer :
– Un mariage ! Cette fille est folle… ou bien ignore-t-elle donc…
Oui ! Elle ignorait, la malheureuse ! Elle ignorait que, dès l’an 1385, la raison d’État avait donné à Jean sans Peur une épouse qui, d’ailleurs, ne quittait pas Dijon et tenait peu de place dans l’existence de son mari.
Isabeau songea à foudroyer Laurence d’un seul mot. À ce moment, comme si une dernière espérance eût palpité dans son cœur, la mère de Roselys leva ses bras tremblants et montra un visage éclairé par la plus pure clarté du dévouement maternel.
– Majesté, râla-t-elle, si vous vouliez… vous !… si ce miracle pouvait se faire… que vous preniez ma fille en pitié… si vous le vouliez… ce mariage…
– Elle est folle ! se dit tout haut la reine.
– Non, ma reine, non ! cria Laurence. Je vous comprends. Je sais l’abîme qui me sépare de l’héritier de la couronne de Bourgogne ! Je ne suis pas folle : Je ne songe pas à entrer dans sa vie, sur mon âme, je le jure, oh ! tenez… je jure sur ma fille… S’il lui donne un nom ! Eh bien ! Par les saints ! Par la Vierge ! Je jure que dans l’heure même qui suivra le mariage, je disparaîtrai, et Jean sans Peur sera libre !…
– Vous disparaîtrez !… Comment ?
Et avec l’inexprimable, l’auguste simplicité de son sacrifice, la mère répondit :
– JE ME TUERAI !…
Isabeau se sentit soudain misérable et toute petite, comme il arrive à l’homme placé devant quelque grandiose spectacle de la nature. La mère acheva :
– Je demande un nom pour ma fille. En échange, j’offre ma vie. Voilà. C’est tout. Décidez, Majesté !
Alors la jalousie, la rage, la terreur même d’une dénonciation jetèrent dans l’esprit d’Isabeau leurs poisons corrosifs. Et tout à coup son regard s’éclaira d’une lueur funeste. Depuis plus d’une heure, elle cherchait le moyen sûr de tuer Laurence en évitant le scandale d’un meurtre en plein palais. Et voilà que ce moyen, Laurence elle-même l’avait trouvé ! Un sourire glissa sur ses lèvres livides, pareil à ces lueurs des nuages porteurs de foudre. La reine, brusquement, se pencha sur Laurence :
– Vous m’avez vaincue, dit-elle. Vous avez fait naître la pitié en moi. Je vous pardonne. Je vous sauve, vous et votre enfant…
– Majesté ! Majesté ! Que dites-vous !…
– Eh bien ! oui, votre fille aura le nom auquel elle a droit ! Ce mariage, dès cette nuit, se fera, mais secret ! Et vous vivrez !
– Grâce ! délira l’infortunée. Ne vous jouez pas de moi !…
– Vous vivrez. Allez. Soyez forte. Retirez-vous au logis Passavant. Dans une heure, je vous y rejoins !
– Seigneur ! écoutez mon ardente prière ! Seigneur, protégez la reine ! Seigneur, bénissez la reine !…
Isabeau, déjà, était partie. La mère de Roselys demeura prosternée, à peine respirante, bien près de succomber sous le poids énorme de cette joie, Roselys entoura son cou de ses deux bras et murmura :
– Vite, allons retrouver Hardy qui nous défendra, lui !
– Oui, oui ! fit la mère toute pantelante.
Et, transfigurée, légère, enivrée, sa fille dans ses bras, elle s’élança…
Isabeau s’était arrêtée dans la salle de Mathebrune. Là, écumante, elle frappa d’un violent coup de marteau un large timbre, qui rendit un son lugubre et prolongé. À cet appel, le palais tressaille, son apparente solitude s’anime, des pas précipités secouent le silence de ses profondeurs, des flambeaux éclairent autour de la reine la robe de drap noir d’un prêtre, la robe de bure d’un secrétaire muni d’un écritoire à la ceinture, la robe d’acier du capitaine des gardes, d’autres encore. À chacun pris à part, Isabeau donne des instructions précises. Et chacun s’éloigne en hâte… Demeurée seule, la reine murmura, ou plutôt haleta :
– À lui, maintenant ! Malheur, malheur, s’il hésite ! Bois-Redon est là !…
Et rude, agressive, elle entra dans sa chambre, où Nevers attendait cette amante de dix-huit ans.
Que dit-elle ? Qu’exigea-t-elle ? Qu’imposa-t-elle ?… Jean sans Peur était l’homme de la force et de la cruauté froide. Jean sans Peur ne reculait ni devant le meurtre violent, ni devant le crime lâche. Mais lorsqu’il sortit et que, à son tour, il eut franchi l’enceinte de l’Hôtel Saint-Pol, il tremblait…
Lui parti, la reine s’enveloppa d’un manteau à capuche, et, dans la ruelle de son lit, ouvrit une petite porte secrète. Apparut une cellule carrée, où, sur l’unique siège, était assis un homme tout jeune, une façon de colosse à figure très douce. C’était le fameux Bois-Redon, futur capitaine du palais, futur… mais alors garde du corps, chien de la reine, prêt, sur un signe, à ramper, à mordre, à caresser, à éventrer…
– Bois-Redon tu vas marcher près de moi. Tu ne me quitteras pas de la longueur du bras. Tu n’entendras, tu ne verras rien de ce qui se dira ou se fera…
– Bon. Je serai muet, et sourd, et aveugle. Où va la reine ?
– Au logis Passavant, rue Saint-Martin ; mais d’abord dans la Cité, rue aux Fèves. (Bois-Redon pâlit un peu.) Maintenant, retiens ceci : qui que ce soit, manant ou prince, si je te dis : frappe…
Bois-Redon sourit. D’un geste redoutable, il assura sa dague, et, hors l’Hôtel Saint-Pol, se mit à marcher près de la reine, faisant craquer ses muscles puissants et sondant la nuit de son mufle tendu. Près des moulins Notre-Dame, ils descendirent sur la Berge. Bois-Redon détacha un esquif et, en quelques coups d’aviron, porta la reine dans la Cité. Évitant le Val d’Amour et ses bruyants cabarets nocturnes, ils s’arrêtèrent dans la rue aux Fèves devant une maison basse. Peut-être étaient-ils attendus : la porte s’ouvrit ; ils entrèrent… Bois-Redon fit un signe de croix.
L’homme qui avait ouvert à la reine lui fit traverser une première salle. Dans une seconde, il l’arrêta :
– Je suis prêt, dit-il. J’ai les trois « vivants », madame. M’apportez-vous le « mort » ?
– Les trois vivants ! balbutia la reine.
– Indispensables pour ce que vous m’avez commandé. Je les ai eus aujourd’hui, non sans peine… À vous de me fournir l’enfant mort – « de mort violente », n’oubliez pas !
– De mort violente, oui ! répéta Isabeau.
– Mais « sans effusion de sang », n’oubliez pas !… Hâtez-vous, madame. Les trois vivants attendent… Regardez…
Il tira un rideau. Bois-Redon ferma les yeux… Isabeau regarda :
Il y avait simplement trois escabeaux – des escabeaux cloués au plancher, impossibles à bouger. C’était simplement trois escabeaux en chêne. Mais chacun d’eux, supportait une effigie de la peur – trois vivantes effigies, secouées d’instant en instant de spasmes terriblement réguliers – trois représentations de ce qu’il peut y avoir d’anormal, de monstrueux, d’extra-humain dans la peur – les silhouettes convulsées de trois adolescents solidement bâillonnés, solidement attachés. Le premier paraissait quatorze ans, le deuxième quinze, le troisième seize.
La vision disparut : l’homme venait de pousser le rideau. La reine essuya la sueur froide qui perlait à son front. Elle raffermit ses nerfs, et elle dit :
– Saïtano, ce n’est pas pour « cela » que je suis venue ce soir.
L’homme de l’horreur parut étonné. Du regard, il interrogea la sombre visiteuse. Elle se pencha, murmura quelques mots. Celui qu’elle avait appelé Saïtano sourit, hocha la tête, ouvrit une armoire de fer, promena son doigt parmi les quantités de flacons d’une étagère, en choisit un et le tendit à la reine :
– Prenez, c’est la foudre.
Isabeau saisit le flacon, le cacha sous son manteau – et Saïtano l’escorta jusqu’à la rue, en répétant :…
– Au plus tôt l’enfant mort ! Ou je ne réponds pas des trois vivants…
La reine frissonna longuement, et enfin répondit :
– Eh bien ! cette nuit… oui, dès cette nuit, peut-être !
Et elle s’en alla, songe mortel qu’engloutit la nuit complice… elle s’en alla vers la maison où attendait la mère de Roselys… où habitait Hardy… un enfant !… et elle songeait « à ces trois vivants qui ATTENDAIENT l’enfant mort !… ».
Un silence d’angoisse pesait sur le logis Passavant.
Sur le coup d’une heure du matin, il y eut la brusque invasion du logis ; il y eut quelques cris, et tout fut fini : la petite garnison de dix mercenaires était prisonnière, les gens du service gardés à vue, les salles occupées.
Le capitaine des gardes attendait Isabeau près de la porte d’entrée. En peu de mots, il raconta l’exploit, et termina :
– Tout s’est passé en douceur, sauf pour le petit chevalier. Quel démon, madame ! À preuve Claude le Borgne, qui gît là quelque part, le ventre ouvert… quel enragé démon !…
– Le jeune Passavant n’est pas blessé ?
– Pas une égratignure ! fit le capitaine.
– Bien. Très bien !
Puis, ce rapide colloque :
– La chapelle ? – Éclairée, disposée. – Le scribe ? – Dans la chapelle, madame, avec ses écritoires et grimoires. – Le prêtre ? – À l’autel, tout prêt aux oremus. – Et elle ? – Au pied de l’autel, en prières. – Et… lui ? – Le comte de Nevers attend devant la porte de l’oratoire. – Bien ! Conduisez-moi. Ici, Bois-Redon ! et attention !
Le colosse à figure de poupée eut un mouvement d’épaules sous la cotte de mailles, et un mouvement de la main vers la poignée de sa dague. C’était éloquent. Cela suffit à Isabeau. Elle arriva devant l’oratoire, et vit Jean sans Peur figé. Le cœur de la reine battit à grands coups. Mais, refoulant donc cette émotion d’amour :
– Êtes-vous prêt ? dit-elle. – Madame, c’est horrible !… – « Êtes-vous prêt ? » – Madame, si cela se découvre, c’est pour moi la mort infamante… – ÊTES-VOUS PRÊT ?…
Et la reine, oui, cette femme qui adorait sûrement Jean sans Peur, du regard, cria à Bois-Redon : Attention !
Jean sans Peur saisit le sinistre coup d’œil et, cette fois, répondit : « Je suis prêt ! »
Ils entrèrent tous quatre dans l’oratoire.
La reine marcha tout droit à Laurence d’Ambrun agenouillée, la figure dans les mains, et la toucha à l’épaule. Laurence frissonna… Penchée comme le mauvais ange, Isabeau, dans un murmure :
– J’ai simulé une perquisition ; les gens de ce logis sont gardés et ne sauront rien…
– Oui, Majesté, oui… soyez rassurée, ma bonne, ma généreuse Majesté ! Plutôt m’arracher la langue… oh ! dire que, tout à l’heure, je vous ai haïe !… Dire que vous donnez un nom à ma fille !… Et que vous me laissez vivre !…
– Allons, calmez-vous, levez-vous…
Laurence d’Ambrun, secouée de sanglots, se met debout… et alors elle frémit ! Son sein palpite ! Pour un instant, Laurence est redevenue l’amante !… En foule, les souvenirs d’amour, de son premier, de son unique amour, se sont levés en elle… et son front s’empourpre : le regard de Laurence vient de tomber sur Jean sans Peur !…
La reine voit Laurence qui recule et se courbe devant Nevers, vaincue – et alors elle donne l’ordre au prêtre :
– Voici les actes, là, sur cette table… Voici les témoins : ce gentilhomme, mon scribe, mon capitaine, – et moi !… Voici les fiancés : noble demoiselle Laurence d’Ambrun ; très haut et puissant seigneur Jean de Bourgogne, comte de la marche de Nevers… Remplissez votre office, messire !
– Vous savez, murmure sourdement le prêtre, vous savez que ce sera un sacrilège !
– Et vous savez, vous, que, si vous ajoutez un mot, je vous fais jeter dans les fosses de la tour Huidelonne !
Le prêtre blêmit, soupire, et l’office commence ! L’office qui unit à Laurence d’Ambrun Jean sans Peur, l’époux de Marguerite de Hainaut !… Quinze minutes plus tard, tout est terminé ; il n’y a plus qu’à signer les actes déposés là-bas, à l’entrée de l’oratoire, sur la table… une petite table sur laquelle attend aussi une coupe… Pourquoi ? Pour qui cette coupe dont le métal scintille faiblement là-bas ?…
Le premier, d’une main agitée, le prêtre signe : et il s’en va.
Le capitaine trace une croix : et il s’en va.
Le scribe signe : et il s’en va.
Bois-Redon signe… et il reste, lui !
La reine, alors, dans un violent parafe, appose son nom sur l’acte de mariage, comme sur un acte de condamnation à mort. Et c’est le tour de Jean sans Peur. Il prend une plume, la dépose, la reprend, et enfin, le front ruisselant de sueur, lentement, il écrit… il signe… il a signé !
– À vous ! prononce la reine.
D’un geste d’emportement sublime, tandis que la rosée de ses larmes se répand plus tiède, plus précipitée, Laurence a saisi la plume… La reine s’est glissée vers la coupe de métal !… Laurence écrit, signe de son nom, signe de ses larmes… La reine emplit la coupe ! Elle l’emplit de ce que contient le flacon ! Elle l’emplit du poison de Saïtano !…
Enivrée, balbutiante, extasiée, Laurence d’Ambrun se redresse… et alors, soudain, l’horreur la saisit à la gorge, son cœur se brise, ses jambes fléchissent, elle comprend… elle a compris !… La reine, terrible, implacable, lui tend la coupe !… La mère s’écrase à genoux, se traîne, lève les mains, et, dans une déchirante clameur :
– Grâce ! Grâce ! Laissez-moi revoir ma fille une dernière fois !…
Et la reine, rudement, violemment :
– BUVEZ !
Laurence, d’un bond, se releva, recula, affolée, criant : – Je ne veux pas m’en aller sans revoir ma fille ! – Buvez ! répéta Isabeau en marchant sur elle. Laurence grelotta : – Laissez-moi revoir ma fille, et puis je veux bien mourir…
Ce mot, soudain, déchaîna en elle l’instinct de vivre. Elle hurla : « Non ! non, je ne veux pas mourir ! » Sa fille Roselys, le chevalier Hardy, le mariage, la promesse de disparaître, tout cela s’effondra ; elle ne fut plus qu’une pauvre chair pantelante au contact de la mort, condamné s’arc-boutant pour se refuser à l’échafaud, cerf pleurant devant la meute, agonisant qui s’accroche furieusement aux tentures du lit… formes diverses du même sentiment chez toute créature poussée au bord du néant.
III – LE POISON DE SAÏTANO
L’homme de la Cité qu’on appelait Saïtano, après avoir escorté la reine et Bois-Redon jusqu’à la rue, était rentré chez lui. Il avait couru jusqu’à l’armoire de fer et passé en revue ses flacons alignés.
– Très bien, murmura-t-il en refermant. Toute la question est de savoir si l’être quelconque à qui mon « poison » est destiné sera oui ou non frappé… Ce serait une décisive expérience… Sachons d’abord où va se passer la chose…
Il sortit de chez lui. Il avait remarqué la direction prise par ses deux visiteurs. Il se jeta sur leurs traces, se glissa à leur suite et arriva à temps pour les voir entrer dans un logis de noble structure : l’hôtel Passavant.
Alors, sous un auvent d’auberge, il alla s’adosser à la maison d’en face, et attendit – l’oreille tendue à ces cris funèbres qui jaillissaient de l’oratoire… les cris de Laurence d’Ambrun.
C’était affreux…
Elle ne voulait pas mourir ! Si jeune, si belle, si vivante, elle éprouvait ce qu’il y a d’horreur à regarder la mort face à face, en pleine connaissance de soi-même, en pleine force de vie ardente… Elle jeta autour d’elle des regards de feu, vit Jean sans Peur et il n’eut le temps ni de reculer ni de la repousser, déjà elle l’enlaçait :
– Je t’ai aimé, souviens-toi !
Il se débattit. Plus étroitement, elle s’attachait à lui et criait :
– Toi aussi, tu m’as aimée, souviens-toi !
D’une secousse, il se libéra de l’étreinte ; elle trébucha jusqu’au mur… Bois-Redon était là :
– Monsieur, supplia-t-elle, ah ! monsieur…
– Ceci ne me regarde pas, dit Bois-Redon.
Alors elle s’appuya au mur, baissa la tête et pleura : elle était vaincue ; ses yeux atones se fixèrent sur la coupe que lui tendait la reine. Elle la prit en disant :
– Oh ! que cela va me faire mal !…
– Non, dit la reine. Vous ne souffrirez pas.
Et elle répéta la parole de Saïtano :
– C’est la foudre !
Un instant après, Laurence tint la coupe entre ses doigts crispés. Et tout à coup elle, la porta à ses lèvres. Soutenue par cet espoir qu’elle allait être « foudroyée », elle la vida d’un trait, et puis la laissa tomber à ses pieds.
La minute qui suivit fut étrange. Figés, la reine, Bois-Redon et Nevers regardaient. Ils éprouvaient à son maximum d’intensité ce malaise nerveux des gens qui attendent la détonation de la mine alors que la mèche brûle. Et la détonation ne se produisait pas…
Quoi ? Qu’y avait-il ?
Laurence avait bu le poison – la foudre – la mort instantanée, et Laurence était debout ! Loin de se décomposer, son visage perdait sa teinte livide pour se colorer de rose, et dans ses yeux qui avaient contenu toute la terreur se levait une aube souriante !…
Elle vivait ! Non seulement elle se sentait vivre, mais c’était encore d’une vie plus ardente, plus généreuse, comme si ses veines eussent roulé les flots d’un sang plus jeune.
Bois-Redon demeurait hébété. La stupeur de Nevers touchait à l’effroi. La rage d’Isabeau était au paroxysme. Brusquement, la vérité fit irruption en eux ; Laurence n’était pas empoisonnée !…
Non. Elle ne l’était pas. Soit hasard, soit calcul en vue de quelque mystérieuse expérience, l’homme de la Cité, au lieu d’un liquide mortel, avait remis à la reine une bienfaisante liqueur – oui, bienfaisante à coup sûr, indiciblement bienfaisante, car Laurence, de seconde en seconde, sentait des forces inconnues se développer en elle et régénérer son être entier.
Elle tendit les mains à la reine et murmura :
– C’était une épreuve… Mon Dieu, mon Dieu… ce n’était qu’une épreuve !
Les regards de Nevers et d’Isabeau se heurtèrent : – Si elle vit, c’est pour moi la mort infamante, dit l’œil sanglant de Jean sans Peur. – Qu’attendez-vous, alors ? répondit le regard de la reine.
Et Laurence, d’un accent tout mouillé de reconnaissance éperdue, balbutiait :
– Soyez rassuré, monseigneur, vous aussi, ma reine ; vous me donnez la vie, mais…
Un soupir bref coupa sa parole – et elle s’affaissa le long du mur, derrière la table ; la figure contre les dalles… la foudre ! cette fois, c’était bien la foudre qui s’était abattue sur elle : le poignard de Nevers !
À ce moment, une femme vêtue de noir, impassible figure de bravo femelle, entra dans l’oratoire en disant : « Le scribe m’a avertie, madame, et me voici… » Sans doute elle avait un rôle à jouer. Et la reine la connaissait, car elle lui dit : – Tu sais ce que tu auras à faire, Gérande ? – Le scribe m’a tout dit. – Tu es prête ? – Toujours ! – C’est bien. Une litière attend au coin de la rue Saint-Martin. Elle est là pour toi.
Jean sans Peur s’était penché sur Laurence. Un dernier soubresaut la mit sur le dos. Elle porta la main à la blessure qui trouait le sein. D’un geste inconscient, elle agita cette main pleine de sang – et ne bougea plus. Nevers se redressa, recula, essuya la sueur de son visage ; et alors il vit que ses doigts étaient rouges : cette sueur, c’était le sang de la victime.
À son tour, Bois-Redon se pencha, examina la plaie d’un œil expert, posa sa main sur le cœur, attendit une minute, et enfin se releva en disant :
– Morte !
On pouvait se fier à lui. Il s’y connaissait.
La reine, de nouveau, se tourna vers la femme qu’elle appelait Gérande… une violente rumeur, tout à coup, éclata dans l’intérieur de la maison, un tumulte de pas précipités, des insultes, des voix qui criaient : – Arrête ! Arrête ! – La porte de l’oratoire battit avec fracas, et le chevalier Hardy de Passavant s’avança, les vêtements en désordre, la dague au poing. D’un geste impérieux, Isabeau arrêta sur le seuil les gens d’armes auxquels il venait d’échapper et qui le poursuivaient.
– Mort de tous les diables, cria de loin le capitaine des gardes. Claude Le Borgne et Lancelot Tête de Fer, ça en fait deux les tripes au vent ! Quel démoli ! Quelle griffe !
– Madame, gronda Jean sans Peur, c’est un témoin : il faut…
– Il ira loin ! fit Bois-Redon qui eut un sifflement d’admiration.
– Silence ! dit Isabeau à Nevers. – Il ira jusqu’à la Cité, souffla-t-elle à Bois-Redon. Jusqu’à la rue aux Fèves ! Jusque-là d’où nous sortons ! À toi, Bois-Redon !
Hardy trépignait, en proie à un accès de fureur blanche qui, deux minutes, étrangla sa voix. Enfin :
– Que faites-vous ici ? Qui êtes-vous ? Des truands ? Parlez, pillards de nuit ! Où est Roselys ? Qu’avez-vous fait de Roselys ? Par mon père, par le ciel, vous allez voir ! Hardy ! Hardy !-Passavant-le-Hardy !
La reine, déjà, avait donné à Bois-Redon des instructions complètes que termina ce mot réédité de Saïtano : – Surtout, sans effusion de sang, n’oublie pas !
D’un bond, Hardy fut à la table. Au choc, elle se renversa. Les trois actes de mariage voltigèrent çà et là. Frémissant, Jean sans Peur ramassa des parchemins…
– Hors d’ici, truands, hors d’ici ! criait Hardy.
Sa griffe de lionceau se leva… Au même moment, il fut entouré, enveloppé, repoussé hors de l’oratoire, dans la salle des pèlerins, de là dans la salle d’honneur, de là dans la cour, de là dans la rue…
Isabeau jeta un coup d’œil à la femme entrée tout à l’heure :
– Va, Gérande. Et dépêche !
Le bravo femelle, à rude poigne, s’éloigna. Quatre des gardes se détachèrent pour l’escorter. Bientôt, au fond du logis Passavant s’éleva la plainte terrifiée d’une voix de petite fille.
Et des appels :
– Hardy ! À moi, Hardy !…
C’était Roselys qu’on emportait…
Quelques secondes, la reine écouta ces cris d’enfant. Puis le silence plana. Elle se tourna vers Jean sans Peur et le vit qui, à la flamme d’une cire, brûlait des parchemins roulés en boule… les actes de mariage !
– C’est fini ! dit-il. Plus rien à craindre.
– Allons, dit la reine.
Escortés par le capitaine des gardes et ses hommes, dont deux allumèrent des torches, Isabeau et Nevers sortirent, évitant de regarder du côté de la flaque pourpre qui s’élargissait sur les dalles.
Sous son auvent, Saïtano guettait. Lorsqu’il vit paraître la reine, il s’avança. Son premier coup d’œil fut pour les mains du capitaine des gardes ; son deuxième pour celles de Jean sans Peur. Il les vit rouges, et il sourit.
– Madame, dit-il, une « erreur… » oh ! réparable, certes…
– Elle est réparée ! fit Isabeau, hautaine.
– Est-ce que la personne… a bu tout de même ? demanda-t-il avidement.
– Oui. Attention, reprit la reine avec rudesse. L’erreur, je vous la pardonne. Mais ce que vous avez promis…
– L’enfant mort, madame ! Donnez-moi l’enfant mort ! Le reste me regarde !
– On vous l’apporte ! dit sourdement la reine.
Elle s’éloigna, suivie de toute la bande, dans la lueur des torches, fatale, terrible – inconsciente peut-être.
– L’enfant qui vient de passer, poursuivi ! Je m’en doutais, songea Saïtano. Bien. J’ai quelques minutes…
Et il entra dans le logis, se dirigea au jugé vers la pièce dont, du dehors, il avait vu les baies teintées de lumière : l’oratoire. Il l’atteignit, s’y glissa, et tout de suite vit le cadavre. Rapide, silencieux, il courut s’agenouiller, souleva le corps, l’adossa au mur, posa sa main sur le cœur, comme avait fait Bois-Redon.
Alors un sourire d’inexprimable triomphe détendit ses lèvres. Il haleta :
– L’expérience est concluante. Voici une femme laissée pour morte. Le coup a atteint les sources de la vie. Elle devrait être morte. On a dû sûrement s’assurer qu’elle était morte… oui… mais elle a bu ! Elle a bu ma liqueur qui a arrêté la mort au seuil de cette blessure !… C’est donc bien vrai ! Je suis donc vraiment sur la trace de la grande découverte !… Et tout à l’heure, avec le sang de l’enfant mort mêlé au sang des trois vivants…
Il s’arrêta, flamboyant d’orgueil…
Puis, sans plus s’occuper de Laurence, morte ou vivante, d’un glissement de spectre, il se retira…
Elle demeura là, adossée au mur, comme Saïtano l’avait placée. Et son sein, d’un mouvement rythmique, se soulevait et s’abaissait. Le sang ne coulait plus de la blessure. Le cœur battait… ce cœur dont Bois-Redon avait constaté l’immobilité !…
La morte vivait…
Cependant, Hardy de Passavant bataillait dans la rue, reculait, revenait à la charge, attaquait, donnait un coup de griffe, reculait encore, refoulé par ces ombres qui le pressaient de toutes parts, refoulé vers la Seine, vers la Cité… vers le logis d’horreur où les trois vivants attachés sur des escabeaux « attendaient » l’enfant mort !… Il n’avait pas une blessure, pas une égratignure. Il se rendait compte qu’on le ménageait. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors que lui en avait déjà blessé cinq ou six ! Que voulaient-ils ? À quoi cherchaient-ils à l’acculer ? Il s’affaiblissait. Il haletait. Des pensées d’épouvante l’assaillaient. Il avait la sensation qu’un danger pire que la mort le menaçait. Quoi ? Quel danger ?
– Plutôt mourir ! cria-t-il en se jetant une dernière fois sur les silencieux fantômes.
Plutôt que quoi ? Il ne savait pas. Mais il se rua pour mourir – pour échapper à la « chose inconnue », et dans le même moment, il s’affaissa, assommé par un coup sur le crâne.
IV – HARDY DE PASSAVANT
L’évanouissement de Hardy fut bref. Lorsqu’il revint au sentiment des choses, il se vit étendu sur un plancher rugueux qui se balançait mollement, et il entendit le froissement soyeux de l’eau déchirée à intervalles réguliers ; il ne fit qu’ouvrir et fermer les yeux ; la vision lui resta, très nette, de deux formes noires, assises côte à côte sur un banc, et d’une tête penchée sur lui… ce fut un éclair : il était dans une barque, poussée par deux rameurs, et quelqu’un veillait sur lui.
Pourquoi dans une barque ? Où le conduisait-on ?…
De nouveau, il rouvrit et ferma les yeux. Cette fois, toute son attention s’était concentrée sur cette tête penchée. Hardy frémit. Sur ce visage de colosse, en toutes lettres, il venait de lire la volonté de le tuer.
Mais pourquoi ne le tuait-on pas ?…
Le colosse, l’homme qui l’examinait, c’était Bois-Redon.
Et Bois-Redon songeait :
– Pourquoi sans effusion de sang ? D’un seul coup de dague, ce serait fait. Et puis, le corps à l’eau, ni vu ni connu. Au diable le Saïtano et ses œuvres de maléfice ! Mort violente sans effusion de sang !… Que faire ? Un nouveau coup sur la tête ? Lui serrer les doigts à la gorge ?…
Traduction claire mais longue d’une pensée confuse qui ne fut qu’une bouffée… à peine le temps d’atteindre le milieu du fleuve. Si Bois-Redon, à cet instant, avait regardé de près l’enfant, il eût eu une notion exacte des formes que prend l’horreur sur un visage humain. Mais Bois-Redon s’était redressé. Il venait de choisir. Un coup d’assommoir sur la tête, c’est plus vite fait. Avec une effroyable tranquillité, Bois-Redon retroussait la manche de son bras droit.
Hardy, sur cette figure de poupée, vit la bouffée de pensée mortelle ; il vit le hideux préparatif ; il se raidit ; toutes les forces vives de son esprit, de son imagination, de son corps, de ses nerfs, il les appela, les condensa, pour ainsi dire.
– Il faut que je le tue, ainsi ! grogna Bois-Redon.
Il leva son poing, – masse de boucher.
Dans ce moment, la barque oscilla comme une balance affolée : les rameurs eurent à peine le temps de crier : Ho ! ho ! Nous chavirons !… Bois-Redon eut à peine le temps de lever le bras… D’une ruée frénétique, Hardy soudain debout, ses forces décuplées, repoussait violemment le colosse ; il y eut un juron furieux ; puis le bruit mou d’un corps dans l’eau… Hardy venait de sauter.
L’instant d’après, parmi ces lueurs vagues qui jaillissent des sillons liquides, les gens de la barque le virent qui émergeait. L’un d’eux leva sa rame. Bois-Redon, à temps, arrêta le coup, et hurla :
– Sans effusion de sang, qu’on t’a dit, triple brute !…
Et lui aussi, sauta.
La barque, doucement, se mit à descendre le courant, entre la double haie de maisons qui baignaient leurs pieds dans le fleuve, se maintenant de conserve avec les deux nageurs, impassible spectatrice du drame. Mais Bois-Redon vociféra :
– Voulez-vous bien déguerpir, truandaille !
La barque fit demi-tour. Bois-Redon se coupait ainsi tout secours possible. Mais il lui avait été ordonné de n’être vu de personne en entrant dans la rue aux Fèves.
Hardy était bon nageur ; il plongea, puis revint à fleur d’eau, puis, d’un effort méthodique, se mit à descendre le fleuve bordé de maisons, sans quais, sans berges. Avec la rapidité du souvenir et de l’imagination, il se dit qu’il ne retrouverait de berges pour aborder que soit devant le château du Louvre, soit devant la tour de Nesle. Tout affaibli qu’il était par la lutte et le coup reçu sur la tête, il nageait avec vigueur.
Il entendit derrière lui un clapotement ; une seconde il tourna la tête et il vit…
Une énorme silhouette de ténèbre plaquée sur ténèbre se dressait sur lui…
Le colosse, d’un effort, se soulevait hors de l’eau pour se laisser retomber de tout son poids sur Hardy. Dans la nuit, il y eut un ricanement, un rauque : « Je te tiens !… » puis plus rien : Hardy éperdu avait plongé. Bois-Redon, entraîné par l’élan, disparut sous l’eau…
Là, il y eût alors de terribles remous…
Tout de suite, Hardy chercha à remonter à la surface et, à chaque tentative, il se heurtait à un bras prêt à le happer, à ce grand corps qui se débattait, à cet ennemi qui, frénétiquement, le cherchait… Hardy étouffait, il râlait, il était au bout de ses forces… Une seconde, ils furent corps contre corps… D’un dernier recul de tout son être, Hardy se libéra… revint à l’air et se laissa aller à la dérive. Il ne voyait plus l’ennemi. L’instinct seul le soutenait encore et le guidait… Non loin de lui, sur sa gauche, une ombre se dressait, gigantesque fantôme qui semblait s’intéresser à ce drame.
Hardy reconnut ce fantôme : c’était la tour de Nesle… Le souffle court, les yeux agrandis, il put donner le suprême effort, il sentit qu’il touchait et se traîna vers la berge… Il n’en pouvait plus et dans cet instant il entendit que derrière lui quelqu’un s’avançait, le suivait pas à pas, sortait de l’eau en même temps que lui… Tout à coup, dans le lourd silence, la grosse cloche du Louvre, derrière, tinta fortement, sonna une demie. Hardy fut secoué de la tête aux pieds d’un tressaillement tel que son impression très nette – sa dernière impression ! – fut que le battant de la grosse cloche venait de le frapper à la nuque. Dans la même seconde, son être entier parut se pétrifier ; il tomba tout d’une pièce et demeura sur le sable, sans mouvement, sans respiration, sans vie…
Bois-Redon s’arrêta, soufflant, grognant, se secouant. Il se mit à genoux sur le sable en grommelant on ne sait quoi contre la nécessité de tuer les gens sans verser le sang :
– Tiens ! fit-il brusquement, il est mort !…
La besogne était toute faite. Bois-Redon cessa de grogner. Longuement, minutieusement, la main, puis l’oreille sur le cœur, il examina Hardy.
– Mort de noyade, fit-il enfin. Et pas une égratignure. Tout va bien. Allons !
Il prit le cadavre dans ses bras et s’aperçut alors qu’il était d’une inconcevable raideur. Il eût été impossible de plier un bras ou une jambe de ce cadavre.
– Oh ! frissonna Bois-Redon, est-ce donc que déjà la mort accomplit son œuvre ?… déjà ?… si vite ?…
Mais ennuyé d’en avoir pensé si long en une seule fois, il secoua la tête et, jetant le corps sur son épaule comme une planche, se mit en route, entra dans la Cité, parcourut la rue aux Fèves, étroite, noire, sinistre, s’arrêta devant la maison bancale et bossue qui ne tenait debout qu’en employant ses deux voisines comme béquilles. Au coup de marteau, Saïtano parut. Bois-Redon entra dans la première salle encombrée d’herbes qui séchaient en paquets, pendus aux poutres et aux murs…
– Passez, dit Saïtano.
Bois-Redon fit un rapide signe de croix et entra dans la deuxième salle. Le rideau était ouvert. Les trois « vivants » étaient là, sur leurs escabeaux, les veines de leurs tempes enflées par l’épouvantable effort tenté pour crier, les yeux fous, les cheveux hérissés. Et ils virent !… ils virent passer Bois-Redon avec, sur l’épaule, ce cadavre raide comme une planche…
– Passez, dit Saïtano.
Bois-Redon, blême, entra dans une troisième salle. Elle était dallée. Elle n’avait pour tout meuble qu’une grande table de marbre légèrement inclinée, et dans un coin, un seau en bois, dans ce seau une grande éponge. Bois-Redon comprit et déposa sur la table de marbre le corps de Hardy.
– Aidez-moi, dit Saïtano.
Il commençait à dévisser les fortes vis qui maintenaient au plancher les pieds des escabeaux. Bois-Redon obéit en grelottant. Bientôt les trois escabeaux furent transportés dans la salle dallée, près de la table de marbre, et les yeux fous des trois « vivants » se fixèrent sur le « mort »…
Bois-Redon partit. Une fois dans la rue, il se mit à courir comme un insensé… il avait peur !
Saïtano demeura seul – en présence du mort et des trois vivants.
C’était un homme sans âge, d’une extravagante maigreur, non sans beauté dans ses attitudes, avec un visage d’un sérieux angoissant où, sur des yeux qui perçaient jusqu’à l’âme, des yeux incandescents, on ne voyait que le front majestueux et terrible. On l’avait vu à Palerme, à Naples, à Venise, à Florence, patries de stryges et de sorciers. Il venait de Rome, et son regard, qui avait sans doute interrogé les descendantes des sibylles, gardait le reflet du mystère que les siècles ont fait peser sur la Ville Éternelle.
Saïtano songea tout haut :
– Encore un effort, et j’y suis ! Ce que j’ai vu de cette femme au logis de la rue Saint-Martin me prouve que je suis dans la bonne voie…
Ses yeux se heurtèrent aux regards de malédiction et d’horreur des trois enchaînés.
– Passavant ? reprit-il. Hardy de Passavant ? Ce doit être du beau sang très pur… Silence, vous autres, silence !…
Il disait cela aux trois bâillonnés dont les regards hurlaient. Ils entendaient ! Ils écoutaient ces paroles qui tombaient brûlantes comme du plomb fondu dans leurs pauvres cervelles affolées et s’y gravaient à tout jamais…
– Ne criez pas ainsi, leur dit-il. Vous ne pouvez me faire ni pitié ni peur. J’ai un nom qui exclut tout sentiment humain. Je m’appelle Science. Or la science possède une logique implacable. Qu’est-ce que la science ? La conquête de la vie. La vie sans fin ! L’éternité !… Cela doit arriver. Dans dix mille ans peut-être. Mais pourquoi pas aujourd’hui ? Il s’en faut d’un rien. Vie éternelle ! Quel rêve ! quel rêve !… Cette reine stupide s’imagine que je cherche le moyen de satisfaire ses pauvres, ses basses passions, et de supprimer le fou de l’Hôtel Saint-Pol !… Sacrifier ; cela ces trois vies humaines… ce serait horrible ! Les sacrifier pour dompter la mort et me faire l’égal de Dieu, c’est autre chose ! Taisez-vous ! Que sont vos trois vies, cent, mille, un millions de vies, si j’arrive à résoudre le grand problème !
Leurs têtes vacillaient. Ils étaient aux limites de la terreur. La folie flambait dans leurs yeux immenses remplis de plaintes et d’imprécations.
– Je vais, dit Saïtano d’une voix étrange et tremblante, je vais mêler votre sang vivants goutte à goutte, au sang de ce mort, Assez !… Allons !… Au travail !… Commençons par ouvrir le cœur de l’enfant mort !…
Il mit à nu la poitrine de Hardy, et posa un flambeau près de sa tête.
De l’armoire de fer, il sortit trois flacons pareils à celui qu’il avait donné à la reine, et il les plaça sur la table de marbre. Puis, dans une boîte, il saisit un outil d’acier très mince, très affilé. Un instant, il considéra cette peau blanche, fine, délicate…
Et tout à coup, il appuya la pointe du scalpel sur la poitrine.